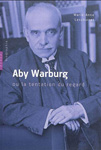
Aby Warburg, ou la tentation du regard, Marie-Anne Lescourret, Hazan, 432 p., 29 euro.
Nous voici face à une biographie faite dans les règles du genre, détaillée, pointilleuse, inexorable, « à l'américaine » : l'histoire de la famille Warburg, qui remonte au XIIe siècle ne nous est pas épargnée (cela dit, les tribulation de cette famille juive qui a vécu surtout en Allemagne et au Danemark est tout à fait intéressante en soi). Puis commence le récit de la jeunesse d'Aby, que son frère aîné surnommait Albymelesh. Il est devenu un homme de petite taille, très soignée dans sa manière de s'habiller et de se présenter. Il se passionne pour les arts, mais éprouve quelque difficulté à adhérer à ce qu'on pouvait lui enseigner.
La simple histoire des artistes, qui prédominait depuis Giorgio Vasari, ne lui suffisait plus : il fallait inventer de toute pièce l'histoire de l'art comme phénomène culturel. On apprend d'ailleurs dans ces pages que l'histoire de l'art en Allemagne n'a été enseignée qu'à partir de 1860 et que les premiers professeurs étaient issus de toutes autres disciplines, dont la théologie ! Pour lui, il n'y avait que Goethe qui avait compris ce qui était fondamental : le développement de l'oeuvre pour elle-même et non la sempiternelle affaire de la quête du beau, qui a son importance, mais qui est relative. Il considère Winckelmann comme le véritable créateur de la notion d'histoire de l'art, mais n'adhère pas à ses principes esthétiques trop idéalistes. Il préfère de loin les thèses avancées par Lessing et son Laocoon est une grande et profonde révélation pour lui.
Warburg étudie et étudie à Marburg, encore à Bonn, en particulier, puis se voit chargé en 1890 de la création de l'Institut d'histoire des cultures à Leipzig. Bien qu'il aille toujours à contre-courant de ses pairs, il se fait peu à peu une réputation, même s'il est fort peu publié. Il a eu l'occasion de voyager en Italie en 1888 et ce fut pour lui une révélation. Il songe à faire sa thèse sur Filippino Lippi -, en fin compte, il va opter pour Botticelli. Et il ne cesse jamais de s'interroger sur la manière dont cette histoire de l'art pourrait accomplir son cheminement. Il ne se contente pas de la forme et du style : il cherche le mouvement, l'action, la dynamique de l'oeuvre (il pense toujours à ce que lui a fait comprendre Lessing). Ses contemporains, tel Worringer, lui apporte des éléments qu'il juge fructueux, mais pas suffisants par rapport à ce projet dont il recherche la véritable nature. C'est ce qui fait l'originalité de cet homme dans un monde où l'on recherche plutôt des certitudes. Les professeurs veulent établir des vérités incontestables. Ce n'est pas son propos. Il se passionne aussi pour les écrits de Jacob Burckhardt, qui a une vision jugée « iconoclaste » de la Renaissance. C'est alors qu'il décide de commencer un travail sur les fêtes de la Renaissance. En somme, sans entrer dans chaque détail de son existence laborieuse qui le conduira à fonder son propre institut, on voit se dérouler l'existence d »'un homme qui ne cesse jamais d'élargir le champ de ses curiosités intellectuels et sensibles (la psychologie va jouer un rôle de premier plan dans ses spéculations).
L'auteur a tenté de narrer de manière concise une vie intense, dont chaque instant est marqué par des rencontres, des découvertes et des interrogations sur le monde tel que nous le percevons et le représentons. Ce travail est remarquable et je regrette de ne pouvoir accompagner cette biographe érudite jusqu'au terme de ses recherches sur cet homme si difficile à cerner et à analyser. Warburg est un cas. Mais c'est lui pourtant qui aura raison sur les plus brillants de ses collègues, quelle que soit la richesse de leurs spéculations. Au fond, Aby Warburg annonce une ère qui viendra bien après sa propre disparition (1929), quand l'histoire de l'art se regarde dans un miroir et se demande ce qu'elle a été et ce qu'elle est en fait. Il ne jette aux oubliettes tant de grands historiens auxquels nous devons des trésors de connaissances et de méditations. Tout au contraire. Mais il a toujours su que chacune de leurs recherches avait leurs limites et donc qu'il leur manquait quelque chose. Il ne comble pas ce manque. Mais il indique à ceux qui lui succède qu'il s'agit de ne pas s'arrêter de se remettre en cause.

Le Songe, Sor Juana Inès de la Cruz, traduit de l'espagnol (Mexique) par Jean-Luc Lacarrière et présenté par Marge Glanrz, « Orphée », La Différence, 128 p., 8 euro.
Bien que sa naissance à Amecameca (actuellement dans l'Etat de Mexico), en 1648, a été placée sous d'assez mauvais auspices (elle est une fille illégitime), elle fit néanmoins des études brillantes et a démontré un don précoce pour l'écrire : elle a composé un petit drame religieux à l'âge de huit ans ! Quittant l'hacienda de son grand-père, elle se rend à Mexico chez des parents qui lui permettent de poursuivre des études. Son talent précoce fit rapidement sensation. Ses qualités littéraires et son savoir considérable la firent remarquer à tel point que la vice-reine en fit sa dame d'honneur. Elle est ensuite entrée dans les ordres malgré une vocation bien médiocre.
Elle eut des responsabilités importantes (elle est devenue économe de sa congrégation). Elle se fit des ennemis dans la hiérarchie catholique et elle dut même se présenter à un procès devant de doctes juges, comme le Christ l'avait fait encore enfant ! Elle en sortit victorieuse. Et elle a même dû se confronter à l'illustre et talentueux Gongorà. Sa poésie est de facture baroque. Mais sans entrer dans la préciosité. Ses poésies sont complexes car elles sont nourries de références de toutes sortes, surtout à la mythologie gréco-latine, ce qui est singulier pour une religieuse. Mais c'était pour elle un moyen de mettre en évidence la méthode pour atteindre le Très Haut : elle ne répudia pas la sensualité, les sentiments, la raison, la science, le savoir universel au nom d'une quête mystique, au contraire, tout ce qui peut élargir la connaissance du monde serait pour elle un instrument utile pour atteindre le but ultime.
Le Songe est sans doute l'oeuvre qui résume le mieux sa pensée extraordinaire et restitue sa faconde très maîtrisée, qui allie un incroyable savoir littéraire et scientifique, sa pénétrante interprétation théologique et une imagination plus que fertile. Et c'est un des grands textes de l'ère baroque, dans les deux sens du terme -, comme culture, et comme phénomène singulier.

Sept méditations sur Kafka, Alvaro de la Rica, préface de Claudio Magris, traduit de l'espagnol par Gersende Camenen, « Arcades », Gallimard, 230 p., 21 euro.
Il existe, depuis de nombreuses décennies, une étrange maladie qui frappe la gent littéraire, mais aussi philosophique et psychanalytique : la kafkamanie. Cette maladie, qui semble incurable, ressemble pour beaucoup à l'exégèse chrétienne. Mais elle est beaucoup plus libre car elle permet de dire tout et son contraire, sans que personne, à de rares exceptions, viennent y mettre son nez et dire ce qu'il peut penser de ces manipulations intellectuelles parfois proches de l'escroquerie. Franz Kafka est l'un des rares auteurs soumis à ce genre de traitement. Marcel Proust, sur lequel on a déversé une quantité indicible de commentaires, est considéré avec plus de respect.
Le problème est que chez Kafka est impossible de savoir au juste quel a été le dessein de son entreprise d'écrivain. Alors on a fabriqué un Kafka capitaliste, un Kafka plutôt bolchevik (une idée se Sartre !), un Kafka qui reflète l'essence du judaïsme (et de surcroît un Kafka kabbaliste : Ivan Klima m'avait montré chez lui un énorme livre américain qui traitait de cette extravagante supposition) et encore un autre Kafka qui a colporté des idées socialistes, un Kafka politique en somme. On nous a dispensé le Kafka sioniste, car bien que « membre « du cercle de Prague qui se réunissait au Café Arco, constitué de personnalités vouées à la cause sioniste, à commencé par son ami de coeur Max Brod, il n' jamais professé d'opinion dans ce sens. Brod le déplore d'ailleurs longuement dans ses souvenirs sur son amis disparu trop tôt et imagine, dans son roman, Le Royaume enchanté de l'amour (1927) de faire de son héros deux personnages, l'un, le plus proche de son modèle, Kafka, indifférent à la cause juive, l'autre, son double, engagé dans la lutte pour la recréation d'Israël.
Parmi tous les poncifs que l'on colporte sur le compte de l'écrivain pragois, il y a un qui a la vie dure : celui d'avoir préfigurer l'holocauste. Où ? Comment ? Pourquoi ? Personne n'est capable de le dire. Tout ce que je peux dire moi de sûr et certain, c'est que quarante-neuf membres de sa familles ont été victimes de cette folie. N'ont survécu en fait de ce désastre qu'une de ses soeurs et sa nièce. Mais pour le reste, je mets au défie quiconque de trouver une phrase, un mot que annonce le processus de destruction du peuple juif en Europe ! La Colonie pénitentiaire ne concerne pas les régime totalitaires, mais la relation de l'individu avec la loi, dans tous le sens du terme, de la loi biologique à la loi des hommes et même la loi divine, pour tant est que Kafka y ait cru une seule seconde.
Kafka est un homme qui se demande ce que c'est d'être juif et qui va tenté de le comprendre par divers moyens (la découverte du théâtre yiddish, ses relations avec Jiri Langer, converti au hassidisme, la quête de son nom juif, l'apprentissage jamais terminé de l'hébreu, puisqu'il a continué, déjà très malade, à suivre des cours à Berlin, etc.). Dans ces sept méditations, bien décevantes, Alvaro de la Rica fait de nombreuses erreurs, répétant des erreurs glanées dans des ouvrages antérieurs (par exemple, jamais Rilke ne s'est prononcé sur sa littérature ; c'est un ami de Rilke qui a assisté à une lecture du jeune auteur en Allemagne. Ou encore, il range la Lettre au père parmi la correspondance et non dans l'oeuvre - Kafka n'aurait jamais osé donner ce texte à son géniteur (qui, de toute façon, ne lisait jamais ce qu'il écrivait, ce qu'il a noté plusieurs fois dans son journal intime avec amertume et tristesse), bien qu'il ait tenu à la faire lire à sa mère).
Le livre fourmille de ces approximations et l'auteur ne paraît pas avoir bien vérifié ses sources. Sur quoi médite-t-il au début sur la Colonie pénitentiaire et nous en fait une belle analyse, très claire, sans parvenir à une conclusion pertinente. Ensuite il s'engage dans l'affaire des fiançailles et ne nous apprend là non plus rien qu'on ne sache. Il n'analyse pas à fond la relation avec Grete Bloch et l'affaire de l'enfant secret qu'elle aurait eu avec lui (histoire certainement forgée de toute pièce, mais à laquelle Brod a cru, parce qu'il voulait peut-être le croire !). L'entremetteuse (ce qui n'a rien d'extraordinaire dans les coutumes juives) est devenue la ou la maîtresse du promis ou du moins l'objet de son désir érotique ! Il aurait été alors peut-être nécessaire de dire que Kafka avait une vie amoureuse qui n'était pas indifférente.
Un chercheur a écrit sur la question, mais notre auteur n'a pas eu la curiosité d'aller comprendre cet aspect de la vie de l'auteur du Procès. Ce dernier était déchiré entre son désir d'être un bon Juif pour sa famille (enfin, jusqu'à un certain point, par exemple, quand il a laissé en plan et son père et son beau-frère lorsqu'il a été nommé directeur juridique de l'usine d'amiante !). Il a été le prisonnier d'une contradiction considérable entre ce désir de quitter sa famille (lié à ce fort sentiment de judéité mal vécue qu'il ne parvenait pas à acquérir tout à fait, à l'amour qu'il portait aux siens et peut-être un souci de rester fidèle à une tradition déjà bien galvaudée par ses parents -, de cela aussi il fait état dans son journal intime dans des terme d'une ironie cinglante) et celui d'être un Juif parfaitement intégré à son monde, à la modernité (d'où Amerika) et aux moeurs de l'immédiate avant guerre de 14-18. Son écriture se propose dans ce déchirement, qui n'est pas toujours explicite, mais qui est renforcé par sa conception du monde (si vous allez à Prague, vous pourrez, comme je l'ai fait, voir la bibliothèque de Kafka, méticuleusement reconstituée par un collectionneur allemand : il y a les oeuvres de Kierkegaard, qui rivalisent en nombre avec celles de Dickens et de Goethe) et puis Flaubert, qu'il lisait en français : il adopte la posture du philosophe danois et croit avec certitude que l'homme ne fait que marcher vers sa mort. Cette mort que l'auteur montre (à juste titre) comme une obsession récurrente dans ses écrits, Kafka ne la vit pas seulement comme un drame existentiel, mais comme une sorte de course poursuite entre lui et le temps qui va le dévorer.
Mais le summum est atteint dans la troisième méditation (l'auteur est modeste : il se croit déjà être quelqu'un qui concilierait les vertus de Montaigne et d'Augustin d'Hippone !) il nous fait des parallèle oiseux entre certaines des images trouvées dans ses écrits et le sacrifice du Christ. Il se réfère beaucoup à Jean et là, il aurait du prudemment s'inspirer d'Ernest Renan, et s'interroger sur le bien-fondé de cet évangile, qui part en vrille avec l'Apocalypse, la Jérusalem céleste et l'effroyable destin de nous tous quand nous ressusciterons d'entre les morts ! Nous voilà en pleine kitscherie de l'Opus Dei ! Il n'ose pas faire un parallèle entre Jésus de Nazareth et Kafka de Prague, mais c'est pourtant le fond de l'affaire. Encore aurait-il fallu que ce dernier se soit intéressé de près à la religion des goyim, et cela ne semble pas des plus sûrs.
Sans doute avait-il glané quelques rudiments au lycée royal et impérial, mais je doute fort, d'après ce qu'il a laissé à la postérité (et aussi dans sa correspondance abondante), qu'on ait affaire à un Kafka christianisé ! Si vous venez un jour chez moi, vous trouverez une bibliothèque consacrée exclusivement à Kafka avec différentes éditions de ses écrits et la majeure part de ceux qui ont commenté son oeuvre, de Singer à Blanchot, en passant par Deleuze et Guattari. Ce livre rejoindra les autres et il est peu probable qu'il en ressorte comme Elias Canetti, Max Brod, Johannes Urzidil, Ivan Klima, Milan Kundera, Roberto Calasso ou, mieux, Claudio Magris, qui a eu la bonté d'écrire une belle préface pour ce livre (avec cette belle fable tirée des légendes entourant François d'Assise), plus belle que le livre à mon sens et qui évite d'ailleurs d'entrer dans le vif des questions qui y sont abordées.

Gabriele d'Annunzio, l'Abruzzo e i luoghi della memoria, texte d'Enrico Di Carlo, photographies de Gino Di Paolo, De Siena Editore, Pescara, 168 p., 49 euro.
Même si vous ne lisez pas l'italien, ce livre pourra vous séduire, à condition de vous intéresser à l'oeuvre de Gabriele D'Annunzio. Né à Pescara, ruiné à Florence, réfugié en France jusqu'à l'entrée en guerre de l'Italie en 1915 aux côtés de l'Angleterre et de la France contre les grands empires, l'auteur de l'Innocent et du Feu est né à Pescara. Encore aujourd'hui, miraculeusement après les énormes bombardements allemands en 1943, sa maison familiale est encore debout et est un petit musée charmant. C'est la maison dont il parle dans son poème, Nocturne. On ne sait trop pour quelle raison, d'aucuns ont imaginé que le Vate (ce qui voudrait dire quasiment le Barde) ait éprouvé une répulsion pour sa région d'origine. Ce livre cite les textes où il loue les beautés des paysages de l'Abruzze, de ce qu'il ressentait dans les rues de Pescara et de ce que lui inspirait la cathédrale la rosace de L'Aquila.
Il évoque aussi le couvent de Francavilla Mare où avait installé sa demeure et son atelier le peintre Michetti, qui y recevait ses amis : c'est là que D'Annunzio a écrit le Plaisir enfermé à clef dans sa chambre ! En somme, nous faisons ainsi un voyage dans cette région il est vrai assez mal connue du touriste et encore plus du touriste français, et qui est sauvage et parfois désolée. Dans ses chaînes montagneuses vivent encore les ours et les loups, qui ne sont exportés de la Slovénie ! En somme, grâce aux beaux clichés de Gino de Paolo et aux recherches d'Enrico Di Carlo, nous découvrons ces lieux que l'écrivain a souvent vantés avec chaleur dans ses livres comme dans sa correspondance. C'est une aventure que Stendhal n'a pas tentée, à tort. Son Italie était celle des cartes postales et des opéras. Là, nous découvrons une Italie inconnue et riche de merveilles culturelles.
Paris autrement, Fausto Manara, Dominique Stella, préface de Philippe Daverio, Institut Français de Milan, s.p.
Dans le cas de cet artiste qui est à la fois peintre et photographe grâce aux possibilités offertes par les technologies avancées, Paris n'est qu'un prétexte car on aura bien du mal à trouver un coin de la capitale française ou quelque chose qui nous remémore Cartier-Bresson ! En revanche, il s'est servi de tout un matériau en couleurs qu'il a glané lors de ses visites parisiennes. Ses oeuvres sont très déconcertantes et là, je dois le souligner, la présentation de Dominique Stella n'est pas inutile, loin s'en faut. Ce sont des photomontages, qui sont aussi des collages, des anamorphoses, des compressions et des dilations de différentes images qui finissent par former une « image ». Il est inutile de chercher une représentation : il faut ne prendre en considération que le résultat de cette alchimie électronique. Ce sont des tableaux avec des éléments figuratifs (la plupart du temps), mais qui ont une finalité intrinsèque : ils existent en soi et pour soi. Pas d'arrière-pensée, pas de message subliminal, par de double ou de triple sens. Non, rien que des effets obtenus à force de réflexion et de patience pour aboutir à ces compositions étranges et déconcertantes, qui n'ont de références qu'en elles-mêmes. Au fond, on pourrait dire la même chose de Kandinsky ou de Paul Klee. Mais nous avons appris à accepter les codes de leurs toiles et de leurs dessins. Ici, on doit apprendre d'autres codes pour apprécier les jeux chromatiques et formels (aussi ludiques qu'élaborés) de Fausto Manara.
|
