Les « digérants » de Marc Giai-Miniet
par Yak Rivais
Les boîtes murales de Marc Giai-Miniet se présentent comme des vitrines porteuses d’étagères, peu profondes, sans personnages. Des tranches d’immeubles. Des huis-clos. Le haut est clair, plutôt blanc, le bas sombre jusqu’au noir. Sur les étagères supérieures s’alignent des minuscules livres. Une (ou des) chaudière(s) occupe(nt) la partie médiane, où les livres sont probablement brûlés, et tout en bas, la cave est un embarcadère d’où partent des véhicules joujoux. Comment « lire » ces boîtes verticales au-delà du plaisir esthétique évident?
L’écrivain travaille sur un incipit. Cet incipit se révèle élément déclencheur d’un ensemble gigogne du mot au livre, dans lequel le message subliminal est à la fois exhibé et caché, toujours inconsciemment par l’auteur. Le peintre, lui, ne travaille pas sur concepts. Marc Giai-Miniet a fait un pas de clerc : ses boîtes jouent du simulacre. En haut, la parole, les idées, la connaissance, la mémoire blanche du monde (écrite et à écrire). En bas, après consommation d’énergie, l’embarquement. Pour le Styx ? Comme je l’ai montré ailleurs à propos de l’oral, le langage consomme du non-dit pour produire du dit sur la colonne d’air : entre pulsion et ordre, l’énergie dont la parole a besoin.
Dans le « Quart Livre » (1552), Rabelais imagine un voyage. Il s’inspire de celui récent de Jacques Cartier. Pantagruel et ses amis s’engagent sur une piste satirique. Ils visitent des îles, peuplées de Chicanous (la justice), Tohu-Bohu (tempête, passe au large), Macraeons (vieillards), Tapinois (absurde), Quaresmeprenant (Andouilles et Cuisiniers), Papefigues (protestants) et Papimanes (catholiques), et soudain, le voyage change de registre. Nous sommes en pleine Renaissance. Des artistes célèbrent ou ont célébré le corps. Léonard de Vinci, visionnaire, a imaginé l’inconscient (pas de sourcils pour la Joconde, on passe du regard à la pensée sans frontière définie). Rabelais, médecin, voit plus court. Son voyage continue, humain, physiquement, biologiquement. En pleine mer, Pantagruel et ses amis entendent des paroles. Gelées, elles proviennent des éclats d’une bataille ancienne en dégelant : la parole reste, vivante. Elle exprime la mémoire, la pensée, même lorsqu’elle se limite à des borborygmes. Et le voyage se poursuit dans le corps même du monde-homme. On arrive à l’île de Messer Gaster, le Ventre. « Tout pour la tripe », écrit Rabelais. Car c’est pour le Ventre, « premier maître ès ars du monde » que l’homme a tout inventé pour survivre : l’agriculture, l’art militaire, les mathématiques etc., tout dans le monde est conditionné à la nécessité de se nourrir. L’homme est homme. Le voyage, dès lors refuse tout compromis avec sa première ébauche satirique. On ne s’arrête pas à l’île de Chaneph (hypocrisie), ni à l’île de Ganabim (des larrons), et on se contente de tirer une salve de canon pour saluer de loin les Muses, mais les coups de canon fichent la trouille à Panurge, qui rêvait. Croyant entendre et voir le diable, il s’oublie. Frère Jean s’aperçoit « que sa chemise était toute foireuse et embrenée de frais. La vertu rétentrice du nerf qui contracte le muscle nommé sphincter (c’est le trou du cul) était dissolue par la véhémence de la peur qu’il avait eue en ses fantastiques visions »… C’est bien là que s’achève le voyage intérieur : de la tête à l’anus. Voici les dernières lignes du « Quart Livre » : « Appelez-vous ceci foire, bren, crottes, merde, fient, déjection, matière fécale, excrément, repaire, laisse, émeut, fumée, étron, scybale ou spyrathe ? C’est, crois-je, safran d’Hibernie. Ho, ho, hie! C’est safran d’Hibernie!* Assurément! Buvons. » Rabelais remet l’homme à sa place. Il avait d’ailleurs résumé sa position en « citant » Villon : « Ne suis-je badaud de Paris ?/ De Paris emprès Pontoise, /Et d’une corde d’une toise/ Saura mon cou que mon cul poise » (pèse).
1 2 3 4 suite

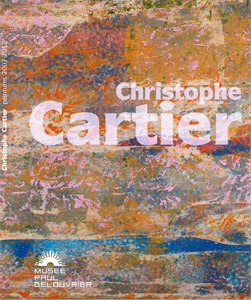 Christophe Cartier
Christophe Cartier


