La bibliothèque de l'amateur d'art
par Gérard-Georges Lemaire

Il Fabbro e il Boscaiolo, Julien Blaine Fondazione
Berdarelli, Brescia, 216 p.
Julien Blaine, commentaires de Jean-Charles Agboton-Jumeau,
Art-Matin, 58 p., 5 €.
Eastern, Julien Blaine, Dernier Télégramme, s.p.,
9 €.
Andare, Julien Blaine, L’Asterico Edizioni, 24 p.
Je parle à la machine, Julien Blaine, Collodion, 18 p., 5
€.
Je l’ai vu et entendu lire à la Sorbonne, Julien Blaine, qui, après quelques minutes, du haut de son pupitre, a commencé à s’échauffer devant une salle composée pour l’essentiel de professeurs médusés -, médusés, sans nul doute, sans voix, c’est indubitable, mais comme fasciné par l’étrange personnage qui se démenait sur cette scène improvisée, dans cette salle lourdement décorée dans le pur style de la IIIe République, avec ses rouges, ses bleus et surtout ses ors. Ils le regardaient sans un geste, la bouche bée, comme s’ils voyaient devant la parodie de ce qu’ils sont devant leurs étudiants. C’était le Rapport à une académie de Franz Kafka non avec un singe, mais avec un homme chevelu, portant un costume tout à fait de circonstance et des lunettes cerclées de métal posées sur le nez. Ce fut une soirée insolite. La raison en était une exposition de livres de poètes d’avant-garde, de Marinetti à Garnier, en passant par le héros de cet événement peu sorbonnard.
Julien Blaine ne cesse ni d’exposer ni de publier. Sous les formes les plus diverses. La Fondation Berdarelli de Brescia l’a célébré cet automne. Dans ce fort volume, Blaine indique au lecteur qu’il devrait voir partout des « poëmes métaphysiques ». L’homme de toutes les provocations et de toutes les déclarations imaginables annonçant la fin d’un peu tout (il a beaucoup fait pour la fin de la performance qui a été sa raison de vivre pendant des décennies) car chez lui, le mot « fin » ne signifie pas que le film est terminé, mais qu’il se poursuivra bientôt sous d’autres formes. Il y a inclus une grande quantité de fables, qui sont des objets photographiés. La réalité lui fournit les ingrédients de son art. Un cliché et l’idée est dans la boîte. Il suffit alors pour lui de la légender et de la produire dans une longue suite sur un thème unique. Il y a chez une telle force vitale, un tel humour (souvent mal séant, souvent peu raffiné, car il ne veut pas passer pour un dandy nostalgique, mais pour un Gargantua des mots et des photographies. Il est aussi le fabriquant des ihali – « installations humaines anonymes laissées là par inadvertance ». Il nous fournit de nombreux exemples parlants. Le monde peut être lu comme un gigantesque poème visuel des plus grotesques.
Blaine aime brouiller les pistes. Il se fait passer pour un charlatan. Pour un rustre. Il se complaît dans son complet de mauvais garçon de la littérature, de garçon boucher de la vieille poésie. Mais on ne parvient jamais à y croire tout à fait car c’est un fin connaisseur des lettres et des arts et ses détournements néo-conceptuels ou post- dadaïstes sont ridicules, cela n’est que par trop évident, mais nous font comprendre qu’une fois les robinets ouverts du prétendu « art fait par tous », bien des propositions esthétiques font eau de toutes parts.

Les Hirondelles de Montecassino, Helena Janeczek,
traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli, Actes Sud, 302 p.,
23,50 €.
1944. L’auteur évoque la célèbre et terrible bataille de Monte Cassino, qui a duré plus de quatre mois, les troupes alliées débarquées en Italie se trouvant bloquées par les troupes allemandes au sud de Rome. Le bombardement intensif du splendide édifice religieux a fourni aux forces ennemies un refuge inexpugnable. La narratrice s’attribue un père polonais qui a participé à ces combats sans merci. Mais ce père juif est-il une fonction du récit ou véritablement le géniteur de la jeune femme qui relate ce passé douloureux ? C’est ce qui fait toute l’étrangeté de ce livre. Nous sommes loin ici de l’évocation précise et documentée des événements militaires, qui ne servent qu’à sous-tendre le récit et lui donner sa dimension hautement dramatique. Ce qui l’intéresse d’abord, c’est comment la guerre fait s’entrecroiser des destins, fait naître, face au danger et à la mort, des intrigues, des amours, des amitiés, des haines. On découvre des soldats, qui vont vivre des heures qui comptent double, triple, et dont certains ne reviendront pas des pentes de ces collines abruptes. Il ya un Américain, un originaire du peuple Mori, des polonais de l’armée du général Anders, des Juifs, des anciens du Bund, des goumiers berbères. (Il y avait aussi les Français du maréchal Juin, des Anglais, des Canadiens, des Indiens, des Africains du Sud, des Néo-Zélandais, des Italiens : plusieurs continents s’étaient concentrés en ce lieu pour arracher l’Italie à Hitler). Ces êtres issus de lieux et cultures souvent distantes, se sont retrouvés côte à côte à souffrir l’âpreté des affrontements inhumains. Ensemble, ils vont finir par percer la ligne Gustav et prendre ce qui reste de l’abbaye bénédictine en laissant des pertes énormes. Dans l’entrecroisement de ces histoires, Helena Janeczek, mêlent le particulier et le général, la guerre et la solitude du guerrier, et mille vicissitudes qui nous ramènent avant guerre et nous projettent après guerre. Cette œuvre laisse un bien étrange sentiment : d’une côté elle est passionnante, de l’autre, on a le sentiment que quelque chose fait défaut. Peut-être est-ce parce que cet épisode nous attellement été raconté qu’il est difficile de le percevoir d’une autre façon, dans l’œil et dans l’esprit d’une femme qui en tire une vue de l’esprit.
précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 suite
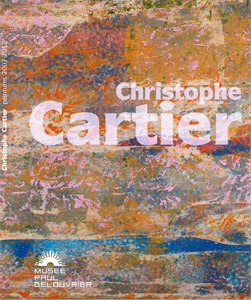 Christophe Cartier
Christophe Cartier


