La bibliothèque de l'amateur d'art
par Gérard-Georges Lemaire

Mémoire de Lazlò, Yves Buin, Apogée,
112 p., 15 €.
C’est ma conviction : Mémoire de Lazlò est sans nul doute le meilleur livre de fiction qu’Yves Buin a écrit à ce jour. D’entrée de jeu, il le présente comme un hymne à la littérature de voyage et surtout à Herman Melville. Il évoque l’enfance de son héros et des rêves qu’il partage avec son petit ami d’alors. Mais qu’on ne s’attende pas à des périples à la Jules Verne ou même des explorations à la Victor Segalen. En réalité, son personnage ne va nulle part. Ou tout du monde dans le sens commun. C’est le développement d’une grande et belle métaphore, qui se traduit par un voyage mais pas nécessairement en allant vers des horizons lointains ou traversant des continents inconnus. C’est la relation au monde qui est vécue ici comme un voyage périlleux et plein de dangers, comme une découverte des lieux et des hommes qui les habitent. C’est un parcours initiatique qui est écrit avec beaucoup de charme et une intensité rare. Et cette pérégrination tâtonnante des deux garçons apparaît comme l’apprentissage non seulement de la réalité qui a encore à leurs yeux quelque chose de magique, mais aussi et surtout des sentiments encore ignorés qui vont métamorphoser leurs existences. C’est écrit avec un sens parfait de l’épure, une poésie parfaite et une curieuse façon de prendre le roman comme un moyen pour raconter une autre histoire qui, elle, n’est pas de nature romanesque.

L’Enfant secoué, Patrick Froehlich, Publie
-Papier, 152 p., 13,98 €.
Patrick Froehlich est un jeune auteur, médecin comme Louis-Ferdinand Céline, qui s’était fait remarqué par la publication de sa première œuvre de fiction, la Toison (« Fictions & Cie », Seuil). C’était un très beau livre, d’une écriture originale, qui montrait des dispositions intéressantes. Mais les éditions du Seuil ne l’ont pas accompagné sur le chemin rude de l’écriture. Il publie aujourd’hui l’Enfant secoué, un livre qui est remarquable. L’auteur a su transformer ce drame qui fait partie des aléas « communs » de la vie de famille quand le nouveau-né se révèle trop bruyant ou trop agité, en une méditation sur la relation du médecin et du corps et, plus généralement sur la séparation des corps (ou leur rapprochement, ce qui en est le corollaire obligé). C’est aussi l’histoire de la mère et de l’enfant traversée par des sentiments et des affects contradictoires. En somme, ce n’est pas un roman dans le sens qu’on adopte en général, mais une méditation sur tout ce qui se joue dans l’histoire d’une naissance. Et ce qui se jour là n’est pas que du bonheur (encore faudrait-il manipuler avec précaution ce mot), mais une source infinie de pensées et de sensations qui montrent combien cela est difficile et problématique. C’est un livre prenant, passionnant à plusieurs titre, et qui se lit avec avidité. L’auteur n’a pas commis qu’une seule erreur : écrire de longues périodes sans alinéa, sans respiration. Bien sûr cela renforce l’angoisse qui doit émaner de ce qu’il nous raconte. Mais cela est un peu décourageant pour le lecteur. Mais au-delà de cette « maladie infantile de la littérature », Patrick Froehlich possède un réel talent, qu’il apprendre maintenant à contrôler, à dompter, comme une bête fauve.

L’Impossible cadavre, suivi de L’Os
d’Ôr, (Cyril Loriot), Le Grand Souffle, 300 p., 19,80
€.
Comment qualifier cet ouvrage ? Ce n’est une affaire tout à fait simple car l’auteur s’est délibérément placé entre différents modes d’écriture. Disons que c’est une sorte de méditation philosophique qui est produite sous l’espèce d’une fiction. C’est indéniablement une ouvre singulière, qui a au moins le mérite de n’adopter aucun canevas connu, mais c’est aussi une œuvre un peu décousue et souvent mal ficelée. Trop souvent l’auteur se paye de mots au lieu de nous conduire à une autre façon de considérer le monde et de moduler sa manière de l’interpréter. On a l’impression de lire Christian Prigent qui aurait choisi d’utiliser le langage de la philosophie comme matière première. L’entreprise n’est pas dépourvue d’intérêt, mais elle semble n’être qu’une matrice dont il faudrait encore parvenir à décrypter les différentes parties. Que l’auteur présente le tout comme un essai alors que la seconde partie, L’Os d’Ôr est bâti à l’instar d’un poème me paraît tout à fait excessif. Pour conclure, il y a une dualité dans son excès : d’une part, un aspect positif qui consiste dans le dépassement de formes de langage désormais dépassées, de l’autre, dans une certaine complaisance à produire des énoncé qui ne repose que sur cet excès, ce débordement et, hélas, ce trop-plei n de mots et de phrases.
précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 suite
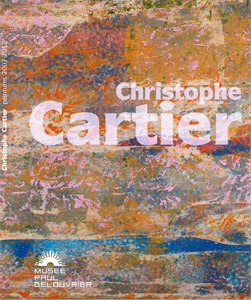 Christophe Cartier
Christophe Cartier


