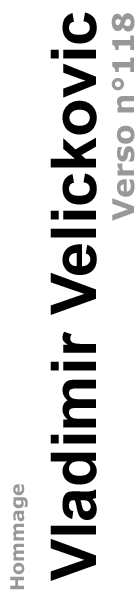En hommage à Vladimir Velickovic
par Jean-Luc Chalumeau
Velickovic (1935-2019) nous a quittés trois mois avant l’ouverture de la rétrospective qui lui sera consacrée à Landerneau par le Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour la culture. Il l’avait méticuleusement préparée avec moi depuis deux ans. Depuis que, le 31 août 2017, Michel-Edouard Leclerc nous avait proposé de nous lancer dans cette aventure. L’exposition ne sera pas chronologique, mais thématique. Elle sera centrée sur l’admirable série Grünewald par laquelle il a synthétisé, depuis les années 90, son inlassable questionnement sur la condition humaine par le moyen de la peinture. Mais dans les années 80, déjà, il avait produit un chef-d’œuvre, la Grande Poursuite, qui sera l’un des points forts de l’exposition. Ce polyptyque m’avait paru répondre alors à la question : « comment peindre la nuit ? ».
La Grande Poursuite est composée de trois panneaux de 2 mètres 25 par 1 mètre 65 et d’un quatrième, de dimensions réduites, qui intervient au terme de la lecture (la poursuite se déroule de gauche à droite). On y voit des rats emportés dans une course éperdue, puis deux corps d’hommes qui franchissent un obstacle. Les uns et les autres sont précipités dans une fosse à la troisième séquence. La dernière petite toile ne représente qu’une tête, renversée, qui exprime l’horreur d’un cri. Elle se heurte à une barre jaune dont on ignore la fonction. « La tête apparaît comme coupée, écrasée sur cette barre, disait le peintre, on peut penser que le corps engagé dans la poursuite a traversé cette barre et que cela l’a tué. Tout à coup l’anonymat des corps est dévoilé. Mais c’est trop tard : la tête est peinte dans un état d’ultime cri. »
L’ensemble des quatre tableaux a d’abord été daté 1983. Il avait été exposé, photographié, commenté. Cependant, en septembre 1985, la Grande Poursuite n’était plus la même (Velickovic finira par la dater 1986, et il enlèvera la petite toile finale). Je la retrouvais dans l’atelier de Velickovic en pleine opération de recréation (elle durait depuis des mois). C’est que le peintre n’avait jamais fini de reprendre la matière de ses tableaux (la matière, bien plus que les formes) pour lui donner une intensité maximale. Les clairs-obscurs, cent fois peints, finissaient par conférer une présence sculpturale aux corps. Loin des détails anatomiques autrefois traités avec le réalisme d’un biologiste, les muscles semblaient taillés dans la pierre. La touche, plus libre, était mieux visible, qui affleurait au terme d’une superposition complexe de couches de pigments. Ce qui était déjà réalisé deux ans plus tôt ne satisfaisait donc pas l’artiste (« il n’est pas bon que l’artiste soit content » enseignait Léonard). Devant cet acharnement à se rapprocher d’une certaine idée de la perfection en art, comment ne pas penser à Giacometti tel que le perçut Jean-Paul Sartre ? « Il pouvait gagner la partie sur l’heure : il n’a qu’à décider de la gagner. Mais il ne peut s’y résoudre, il remet sa décision d’heure en heure, de jour en jour ; parfois, au cours d’une nuit de travail, il est tout près d’avouer sa victoire : au matin tout est brisé. Craint-il l’ennui qui l’attend de l’autre côté du triomphe, cet ennui qui morfondit Hegel lorsque celui-ci eut imprudemment bouclé son système ? »
Velickovic n’était pas prêt de boucler son œuvre en un système, il ne le serait jamais. Comment ne pas voir, à chaque tableau, que les supplices qui y sont décrits sont d’abord l’expression du tourment sans fin – mais fécond – d’une peinture européenne possédée par la volonté de dire l’inexprimable à partir d’un sacrifice originel ? L’iconographie artistique occidentale commence avec la représentation d’un homme-Dieu cloué sur une croix, et c’est assez pour que soit dite l’opposition profonde qui la sépare une fois pour toutes de l’art d’Orient. La question « pourquoi adorent-ils un supplicié ? » résumait pour André Malraux le malaise des bouddhistes devant le crucifix, et plus généralement devant tout l’art d’Occident. « L’opposition la plus profonde se fonde sur ce que l’évidence fondamentale de l’Occident, chrétien ou athée, est la mort, quelque sens qu’il lui donne – alors que l’évidence fondamentale de l’Inde est l’infini de la vie dans l’infini du temps… » (Antimémoires)
1 2 suite

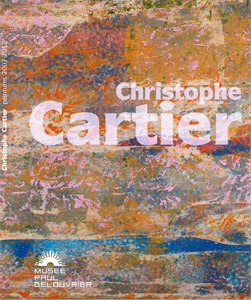 Christophe Cartier
Christophe Cartier