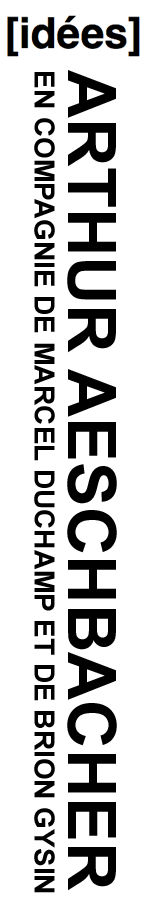|
Si, comme eux, il est fasciné par le paysage plastique qu’offrent les rues de nos villes, il n’est pas attiré par la seule valeur esthétique que peut proposer une stratification d’affiches plus ou moins lacérées, plus ou moins malmené par les intempéries ou par les passants. Il ne cherche pas non plus une poésie spontanée des figures représentées sur les affiches de cinéma. Non. Son univers repose sur d’autres éléments. Il est d’abord intéressé par les affiches qui comportent du textes et, le plus souvent des affiches de théâtre de la Belle Epoque, avec leur encrage si dense. Il les recherche et en achète des stocks. Puis il les découpe selon des principes plus ou moins aléatoires, qui proposent des states de noms, de titres de pièces, de noms de théâtres, qui deviennent le plus souvent incompréhensibles pour ne conserver que la magie des lettres fracturées ou placées dans une déclinaison formelle. Il se rapproche ce faisant d’une certaine idée de la poésie visuelle, mais sans en adopter les modes. Parfois aussi, il parvient à des compositions quasiment abstraites (dans le sens d’ « informelles »). Il n’y a pas pour lui de règle systématique. Il aime jouer avec ses fragments et entend bien en tirer des représentations offrant à la fois des différences marquées et une logique commune dans leur conception. Il serait impossible ici de résumer le long et passionnant parcours d’Arthur Aeschbacher. Le lecteur doit seulement savoir qu’il a depuis quelque temps subtilisé à Marcel Duchamp l’idée d’un ready-made particulier (un ready-made rectifié) – c’est le cas par exemple pour son cycle baptisé Pacifico – et à Brion Gysin une dérivation de son invention, le cut-up, que William S. Burroughs a brillamment exploité dans plusieurs de ses romans. S’il a toujours utilisé, entre autres techniques, le cut-up, il ne l’a pas fait pour obtenir d’autres significations sémantiques, mais des contrapositions optiques. Et maintenant, il a imaginé d’aller plus loin en faisant pivoter des éléments plastiques ou typographiques (selon les cas) : ce sont les turn-cuts.
Dans cette nouvelle suite d’œuvres qu’il a conçues cette année, il a choisi d’utiliser des carrés ou des rectangles de couleurs, qui sont disposés sur la toile en fonction de ces mouvements qu’il a imprimés à chacun d’entre eux. Il a ajouté à son titre : Rotative. Là encore il fait allusion à plusieurs œuvres de Duchamp, mais comme pure référence : il insiste sur le caractère giratoire de ses compositions. Cette idée a existé depuis le début du siècle dernier avec les rayonnistes et les futuristes, même chez Rodtchenko et d’autres encore. Mais il n’a pas souhaité parvenir à une circularité de son tableau. Il prétend seulement indiqué que les pièces de sa composition sont mues par divers mouvements giratoires allant dans des directions parfois contraires. Pour lui, l’œuvre d’art est un jeu. Il s’inspire souvent des créations populaires, celles du cirque, des fêtes foraines ou des boutiques. Il en emprunte des suggestions ou des formes. Et il les transpose. Mais l’art reste un jeu sérieux. Il ne se place pas dans la dérision ou le nihilisme : tout ce qu’il accomplit est une méditation sur un espace inexploré de la peinture ou du collage (souvent des deux à la fois). Mais c’est une méditation joyeuse, ludique, je le répète, et faite pour faire de chacune de ses inventions un compagnon au cœur de la métaphysique déconcertante de la vie qui a besoin de cet genre d’attitude artistique comme les Grecs anciens avaient besoin de leurs dieux et demi-dieux.
« Turn Cut Rotative », Arthur Aeschbacher, galerie Arhème,31 rue de Beaune, 75007 Paris, jusqu’à la fin décembre 2017. |