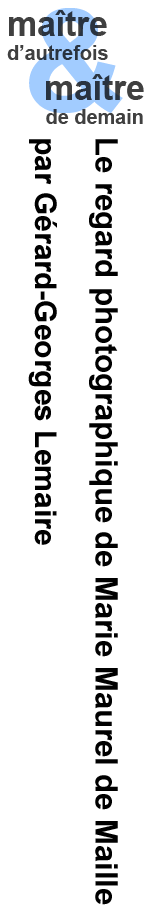|
Je m’interroge une fois encore sur ce constat : de plus en plus d’artistes ont choisi d’utiliser les ressources de la photographie plutôt que celles de la peinture ou des techniques traditionnelles – pour quelle raison ? La plupart sont loin de poursuivre l’aventure de ces pionniers qui, à la toute fin du xixe siècle ont désiré faire de la photographie un art à part entière, un art qui posséderait les mêmes qualités que la peinture. L’esprit du nouveau a balayé très tôt ces tentatives souvent ingénieuses et probantes. Et il est évident que d’aucuns ont voulu que cette technique toute nouvelle leur ouvre des horizons esthétiques inédits, comme l’ont fait Man Ray ou Josef Sudek dans la première moitié du XXe siècle. Tout cela a évolué très vite. A notre époque, il ne s’agit plus de pictorialisme, ni de compositions d’avant-garde, parfois presque abstraites. L’arc des possibles s’est aussi considérablement élargi avec toutes les innovations électroniques. La conséquence en est que le langage que permet l’usage de la photographie a de plus en plus été adopté. Je ne répondrai pas ici à la question que je posais – cela nous entrainerait trop loin. Je choisirai plutôt de prendre pour exemple l’œuvre d’une jeune artiste de valeur, Marie Maurel de Maillé. Celle-ci n’a pas un seul registre : au contraire, elle a multiplié ses modes d’expression. On peut, si on les compare, comprendre qu’il y a le même œil derrière l’objectif et donc le même esprit. Toutefois, il y a aussi l’envie manifeste de ne pas se laisser enfermer dans une formule en la déclinant au fil du temps. Il n’est donc pas possible de parler de « style » à son sujet, mais plutôt d’une manière de considérer ses différents sujets.
Dans ses compositions, Marie Maurel de Maillé peut choisir un détail du corps d’un modèle, ou un autoportrait (qui n’est pas désigné comme tel), souvent masqué, ou encore opter pour un plan plus large ; parfois on pourrait croire que la figure est peinte (ou simule la peinture) alors que le décor est franchement photographique. Elle introduit toutes sortes d’ambiguïtés, qui sont subtiles et procurent à ses œuvres une curieuse étrangeté alors que, le plus souvent, il n’en émane rien d’étrange en plus des travestissements. En somme, elle fait tout son possible pour éviter d’appartenir à un genre bien défini. Elle en joue et voit l’art, tel qu’elle le pratique, comme un léger glissement et de la perception et de l’entendement. Et dès qu’elle introduit une once de théâtralité, celle-ci est aussitôt contredite par un élément qui la réduit ou qui en dévie le sens. Il en résulte des œuvres qui, tout en étant d’une assez grande simplicité formelle, avec peu d’aspérités évidentes, présentent des décrochements qui en altèrent la limpidité et, aussi, la quasi-transparence visuelle. Tout repose sur ces minimes doutes que le spectateur finit par ressentir en les observant de près. Ce qui est et ce qui n’est pas sont étroitement liés dans ces constructions mentales, où sont souvent évitées toute référence culturelle et toute référence historique. Il s’agit là d’une insensible mais réelle corruption de la nature même du cliché photographique, qui au-dehors de trucages ou de manipulations diverses, a des spécificités bien précises. La beauté qu’elle poursuit est d’abord un jeu entre le thème supposé et sa dérivation par un biais ou un autre. C’est ensuite l’entrée dans un univers qui a subi une métamorphose qui, j’insiste, n’est pas toujours perceptible à première vue.
On pourrait croire que l’artiste ait choisi de proposer une forme de narration. Non. Tout commence et tout finit avec une « image ». Même quand elle a recours à la mascarade, il n’est question que d’une « planche » et que d’une personne, que ce soit un enfant ou une jeune femme la plupart du temps. Et quand anecdote il y a (les mains qui glissent sur les touches d’un piano alors que le couvercle se referme ou est refermé en partie), elle ne s’intègre pas à un ensemble pouvant constituer une histoire. La main enfantine qui tient un oiseau (on n’arrive pas à comprendre s’il s’agit ici d’un oiseau vivant ou d’un oiseau empaillé), le cheval blanc dont on ne voit qu’une partie du corps et sans qu’on puisse savoir dans quel lieu il est placé. Seule la nature morte se rapproche d’un genre pictural tout à fait précis, disposée sur une table où des ombres se dessinent ; au fond, on semble deviner une lueur bleutée qui passe à travers un volet. C’est un peu l’exception qui confirme la règle.
Mais je veux revenir un moment sur le problème du théâtre. Au XVIIe siècle, il n’est pas rare que les peintres se soient inspirés largement (et parfois exagérément) de ce qu’ils ont vu sur scène. Ils ont souvent imité les dispositifs scéniques. Si l’on remonte un peu dans le temps, la théâtralité d’une peinture d’histoire remonte jusqu’à la Renaissance car les différentes figures impliquées devaient s’ordonner selon un principe spatial (en premier lieu la perspective), et également selon un principe que je qualifierais de narratif et, parfois, de hiérarchique pour les œuvres religieuses ou celles liées à la magnificence du pouvoir. Tous les éléments sont mis en place pour que le sujet choisi puisse être compréhensible malgré le nombre de figurants. Pour illustrer mon propos et montrer en quoi l’artiste dont je vous entretiens a préservé quelque chose de cet héritage, je choisirai un cliché où l’on voit une femme de dos portant une robe rose (manifestement un vêtement ancien) à genoux, le corps placé face à un mur. Son visage est coupé et l’on ne voit qu’une partie de sa longue chevelure brune. Voilà comment un effet est mis à mal pour faire apparaître à sa place une représentation un peu énigmatique. Il y a là une sorte de dénégation, mais partielle.
Il me faut aussi parler d’un travail que Marie Maurel de Maillé a esquissé et qui est très révélateur de ses intentions. Elle a commencé une série de prises de vue dans des demeures d’écrivains ; parmi celles-ci, on peut voir les appartements de Chateaubriand et ceux de Madame de Sévigné. Elle n’a pas fait un reportage, ni tenté de restituer l’ensemble des pièces où ont vécu ces grands personnages de la littérature. Elle a choisi des détails qui, par définition, ne révèlent qu’une partie des chambres explorées. Mais elle ne se focalise pas sur des objets ou des fragments infimes de mobilier : elle en montre assez pour qu’on puisse deviner dans quelle optique ces lieux ont été décorés et par conséquent quel a été le goût de leurs illustres habitants.
De toute évidence, l’artiste a les idées bien en place. Elle ne cesse pourtant de chercher avec ardeur quel pourrait être le chemin principal où s’engager. Son hésitation n’est pas un tâtonnement, mais plutôt le désir de tenter parallèlement plusieurs expériences qui vont se recouper et aboutir soit à l’épanouissement d’une méthode (même provisoire) ou, à l’inverse, à la multiplication de ses procédés, pour engendrer une sorte de labyrinthe au sein duquel elle peut à la fois se dire et se dissimuler, toujours avec talent. |