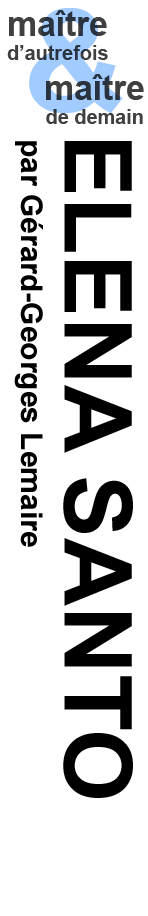|
|
PARTIE I : LÀ OÙ LA FORME N’A PLUS DE NOM ou L’AVENTURE PICTURALE DE SANTORO
Je sais que je me répète, mais il est bon et nécessaire de ne jamais mettre de côté les relations avec l’histoire ancienne ou récente d’un art spécifique. Après la dernière guerre, avec l’essor de l’Ecole de Paris, l’abstraction a largement dominé le monde de l’art français. Le même phénomène s’est produit aux Etats-Unis avec l’Ecole de New York, qui a connu un succès national et international assez rapide, et même en Italie avec Lucio Fontana et le spatialisme, Alberto Burri, Emilio Vedova ou Giulio Turcato. Ce phénomène a donné lieu à toutes sortes de définitions plus ou moins précises ou plus ou moins légitimes : informel, abstraction lyrique, abstraction géométrique, et bien d’autres encore. Il n’a cessé de créer d’autres expériences formelles les décennies suivantes et encore jusqu’à nos jours (avec des tendances et des groupes de toutes sortes de BMPT à l’Optical Art, en passant par Supports/Surfaces), le nuagisme, etc. sans parler des individualités qui se sont affirmées). En somme l’art abstrait a franchi tous les obstacles pour parvenir jusqu’à nous en nous offrant encore bien des surprises alors qu’on a prophétisé l’épuisement de ce genre de langage plastique. Cette histoire peut être regardé comme l’héritages des créations du début du siècle dernier ou se révéler des innovations.
Quand on observe l’histoire picturale de Santoro, on s’aperçoit rapidement que ce peintre a suivi une logique qui ne s’appuyait (de manière explicite) sur aucune des grandes lignes tracées par des artistes passés désormais adulés – il ne s’inspire ni de Kandinsky, ni de Kupka, ni de Malevitch, ni de Rodtchenko, ni de Balla, ni de Prampolini, en somme d’aucuns de ceux qui ont marqués l’art de la première moitié du XXe siècle, et on ne saurait trop à qui le rattacher dans la seconde partie de cette période pourtant si riche en inventions de toutes natures. Les travaux qu’il a entrepris au cours des années soixante et soixante-dix n’appartiennent à rien de ce qui a pu être produit en Europe ou en Amérique du Nord, ni même en Amérique latine, qui n’a pas été avare de groupes importants (je songe surtout à Madi à Buenos Aires). Je ne chercherai donc pas à le définir ni à l’associer à quoi que ce soit de connu et reconnu. Il a choisi une voie qui échappe à toutes ces façons de vivre l’abstraction, des Métasignes de Jean Degottex à l’Outrenoir de Pierre Soulages, en passant par les compositions en plomb d’Umberto Mariani.
Il convient aussi de préciser que ses formes abstraites ne le sont pas toujours tout à fait ! On rencontre, de-ci, de-là, des formes organiques, des plantes plus ou moins déformées et en tout cas impossibles à identifier, A ce propos, il a même composé de vastes paysages irréels, sortes de forêts vierges imaginaires comme dans Preludio de 1969. Il s’est orienté alors vers quelque chose de surréaliste, mais sans rien emprunter à ceux qui ont été proches, à un moment ou à un autre, d’André Breton et de ses conceptions esthétiques. Il a voulu donner naissance à un foisonnement qui avait quelque chose d’onirique, mais en insinuant sans cesse un doute sur la nature de ce qu’il désirait nous faire voir. Un fantasme de son esprit ou une Nature qui s’était dévoyée au gré d’une métamorphose climatique ou géologique ? Sans doute peut-on considérer que les deux choses se sont confondues. Et puis il a cette manière de traduire toute cette végétation touffue, pléthorique et baroque en procurant une sensation d’étouffement, d’enfermement, en somme d’une sorte d’angoisse contrebalancée par cette beauté presque inconcevable. Il n’a pas développé cette dimension qui était pourtant très prometteuse. Peut-être ne voulait-il pas se laisser prendre au piège et décrire des forêts vierges aussi attrayantes et curieuses que celles du Douanier Rousseau. Ce qui est étonnant c’est qu’il ait pu s’engager dans cette direction alors que, d’autre part, il a opté pour une géométrisation très radicale de ses tableaux. Mais il nous révèle que son univers est d’une richesse considérable, qui peut aborder des territoires extrêmement éloignés et même incompatibles. Il a tenu à préserver une liberté sans partage : celle de circumnaviguer dans des océans appartenant à des planètes différentes. Mais l’essentiel de sa quête pendant cette période est encore issue d’une spéculation d’un autre incomparable. Au fond, il aurait pu devenir plusieurs peintres qui auraient conduit des œuvres contrastées (pour ne pas dire opposées) de façon simultanée. Il est en effet difficile de saisir pleinement ce qui l’a conduit à faire tel ou tel choix. Sans doute a-t-il voulu échapper à ce questionnement.
Pour ce que je peux en savoir, l’essentiel de la production de Santoro a été de procéder à l’anamorphose de figures dont on ignore l’origine. Ce qui est très intriguant dans cette suite imposante de toiles, c’est qu’elles portent toutes un titre qui, parfois, sont très évocateurs, faisant allusion à des sensations, des sentiments, des choses précises, à des personnages même (comme Fangio par exemple), à des concepts, en somme à toutes sortes de mots véhiculant des significations dont il n’est pas possible de concevoir le lien avec ce qui apparaît à la surface de l’œuvre. Sans doute ils auront un sens dans l’esprit de l’artiste, mais ils ont plutôt tendance à désorienter le spectateur, qui se sent obligé à percer ce mystère et à trouver le rapport entre le titre et l’œuvre à laquelle il est associé étroitement, mais sans procurer aucun indice de cette liaison. Comme les formes qui se développent dans chacune d’elle sont en premier lieu des manifestations d’une impulsion dynamique dans la plupart des cas – je citerai comme exemple dans cette optique Fremito de 1971 -, qui paraît avoir pour objet de déconstruire une figure et de la projeter dans un espace où elle perd son identité et donc son essence pour adopter une nouvelle identité et un rôle nouveau. L’idée semble être – je peux me tromper de faire surgir une vision emportée par une force intérieure qui tient d’une volonté dionysiaque.
Les manifestations plastiques déclinées par ne répondent à aucune règle précise. Elles n’ont en commun que cette négation de leurs modèles supposés. D’aucunes semblent des compositions statiques qui procurent l’impression d’avoir été disloquées et remaniées, alors que d’autres, à l’inverse, nous paraissent comme enlevées par un vent violent et distendues dans l’espace assigné. Ce jeu qui a pour titre générique Filoplastica dénote le besoin du créateur d’échapper à toute interprétation. Comme si le dialogue entre leur procréateur et son interlocuteur (nous, en l’occurrence) devait être changé au point de modifier de fond en comble ce qui fait la vérité de cette intelligence réciproque. Les clefs qui servent à permettre cette confrontation subtile et sensible ont été brisée. Des postures inédites sont à postuler et ce n’est pas une mince affaire : il faut renoncer à ce que nous savons, même lorsque l’œuvre s’avère être un fruit inconnu (et un peu effrayant) de l’imagination de notre interlocuteur. C’est un authentique défi et le relever exige un renoncement à nos connaissances et à notre mémoire, en somme à l’essentiel de notre bagage culturel. Et pourtant, le spectateur n’est pas repoussé au point de quitter le lieu de cette rencontre problématique. Au contraire, il éprouve la nécessité de résoudre cette question qui le dérange autant qu’il l’attire.
Entre exaspération et fascination, l’œil s’arrête sur ces formes qui ne sont pas tout à fait des formes, mais des évanescences colorées, souvent monochromes. Mais encore une fois, il n’y a pas un canevas qui sous-tende cette série. Le seul principe est l’émergence de pièces colorées, qui sont de nature organique ou encore nés d’un rêve ou d’un cauchemar, décrits dans des harmonies chromatiques singulières, qui peuvent être plaisantes ou non. Le principal pour le peintre est de capter l’attention et de faire en sorte que notre regard soit pris au piège et que notre cerveau se mette en mouvement pour découvrir ce qu’il entend nous dire. Tant que n’aurons pas découvert ce qu’il nous chante, nous allons continuer à sonder ce que ces ouvrages nous cachent. Giovara (2001), Gertico (2007), Defrazione (2018) sont les étapes d’une évolution qui ne dévoile pas un instant sa raison d’être et ses finalités. Et malgré cela, ces moments artistiques ne nous révoltent pas. Ils ne nous satisfont pas non plus. Ils ne sont pas porteurs de plaisirs comme un nu de Renoir ou un petit étang de Claude Monet. Ils sèment la zizanie, cultivent le doute, nous contraignent à nous demander quelle est vraiment la substantifique moëlle de l’art pictural ainsi dévoyé.
Nous devons mieux observer la série baptisée Recto-verso. Elle a été inaugurée en 2018 et a pris son essor en 2021. Est-elle achevée ? Nous l’ignorons. Mais ce qu’elle nous apprend que cette fois Aurelio Santoro a fait fi de toute matérialisation de la forme : il n’y a que le mouvement du pinceau et que des couches de couleurs qui s’accordent à moitié, comme il a le don de le faire. La pure jouissance ne fait pas partie de son vocabulaire. Il veut l’ambigu et le trouble. La peinture est pour lui (c’est ce que je ressens) une sphère qui est en même temps amère et fruitée. Sans quoi elle ne serait qu’un exercice de virtuosité qui ne serait plus en mesure de nous placer devant cette énigme lancinante, ludique et grave pourtant, qui est au cœur de sa pérégrination saturée d’inquiétude et de dilemmes.
PARTE II: IL GIOCO DEGLI SCIOCCHI
In ogni caso, la ricerca di Elena Santoro non è facile da approcciare e ancor più da interpretare. In realtà, è progettato per confonderci. Anzi, ultimamente non ha l'ambizione di sedurre lo spettatore, ma piuttosto di confonderlo, perché non può in alcun modo aggrapparsi a vecchi concetti: estetica, bellezza pura, pittoresca, aneddotica, o qualsiasi altra cosa conosciuta e rispettata. Anzi. Si parte da un luogo unico e anche da una vista unica: una folla di persone in una piazza che guarda qualcosa che non vediamo dall'altra parte.
La scena non cambia di una virgola. Va sottolineato che questa visione di un gruppo sconosciuto è assolutamente priva di interesse, se non altro per rappresentare la folla di una grande città. In primo piano c'è un grande tappeto dalle forme curiose. Questo tappeto, o a volte questi tappeti, che sono identici, sono proprio dietro questa folla. Questa disposizione è sull'orlo dell'affollamento, dove possiamo vedere le gambe dell'ultima fila degli spettatori riuniti. Ma a volte questi individui stanno su questo grande tappeto. Ciò che cambia in questa serie di immagini è solo il rapporto dimensionale tra i diversi elementi che le compongono. Questi spostamenti, a volte impercettibili, nell'angolo di vista e nelle dimensioni degli extra e cose intriganti come il tappeto e i suoi doppi, possono essere visti come l'oggetto centrale di questa ricerca che non attira l'interesse e tuttavia trattiene lo sguardo. Questo è un fenomeno che va oltre la comprensione. Ma sicuramente è la nostra curiosità impenitente che fa sì che l'occhio sia attratto dal punto in cui si sta svolgendo un evento, anche senza il minimo interesse.
Ovviamente, l'artista ha scelto la porta stretta della sperimentazione senza capovolgerci. L'immagine può essere enigmatica, ma non c'è nulla di fantastico o incongruo in essa. Si potrebbe anche parlare di alta banalità. Il vero problema è l'organizzazione dello spazio, che è in continua evoluzione. Avrebbe potuto prendere qualsiasi altro soggetto. Ciò che lo interessava di più era avvicinare o allontanare gli elementi l'uno dall'altro o giocare con la superficie del tappeto, che lì non ha posto. O. Ma siamo entrambi delusi e allo stesso tempo incuriositi e, come si può supporre, ci avviciniamo a questa piccola folla per scoprire cosa l'ha fatta riunire. Siamo entrambi incuriositi da questa piccola folla e da uno dei suoi membri che si è fermato a guardare questo spettacolo di cui non sapevamo nulla. In un certo senso, Elena Santono ci sta ingannando nel cercare di vedere cosa sta succedendo! Per lei, in questo caso specifico, la fotografia è priva di qualsiasi soggetto autentico, ma rimane uno strumento che ci costringe a dirigere lo sguardo verso un punto specifico.
Questo punto è necessariamente una falsa pista. O peggio. Ma non è nemmeno un puntino all'orizzonte. Il caso va contro ciò che può rendere una fotografia affascinante o interessante (non ci troviamo nemmeno di fronte all'orrore o al più spiacevole). No. Per lei si tratta di creare una trappola in cui cadiamo inevitabilmente. È un inganno molto imbarazzante perché non ne esci meglio, tutt'altro.
Elena Santori si è mossa verso una riflessione radicale che mette in discussione gli scopi più ovvi della fotografia. Si tratta di un gesto singolarmente audace in un campo di esplorazione così vasto che ha reso la fotografia un'arte a sé stante. Ha introdotto il dubbio e un senso di perdita. Ora resta da vedere cosa vorrà affermare una volta che avrà giocato questo strano lancio di dadi. |