De la gestation au geste
par Lorenzo Vinciguerra
Ces opérations ne sont pas anodines. Si le hasard y prend part, c’est par nécessité. Ils témoignent d’une condition tout à fait essentielle au travail du peintre. En partie, la peinture doit se faire nécessairement hors portée de la vue, au creux de l’union entre un touché et un touchant. Car pour voir, l’œil a toujours besoin d’un recul, d’une distance, qui est irréductible. Cette même distance sépare le peintre de sa toile. Tel est le paradoxe : pour voir, il faut avoir touché, et, comme par un interdit émanant du corps lui-même, il n’est pas donné de voir ce qui est touché au moment où il est touché. La structure en chiasme du touché/touchant dont parle Merleau-Ponty est aussi invisible que l’œil qui voit, et ne peut se voir lui-même. Elle cache ce point aveugle qui retient quelque chose de « l’opacité du monde »[9]. Mais cette structure en chiasme devait être à notre insu d’abord dans la chair du monde, enfouie dans ses couches souterraines, pour qu’un jour, elle puisse advenir au grand jour dans la nôtre.
À sa façon, Arnal participe de cette mouvance artistique qui a décrété qu’il fallait « sortir d’une peinture de l’œil »[10]. Seul un préjugé scopocentrique put faire que l’on sous-estima chez les peintres l’importance de ce qui chez eux n’est pas une affaire de vue. On sait que Matisse faisait des portraits les yeux fermés. Or, il y a dans ce qui unit et à la fois sépare la main de l’œil la même distance et la même profondeur qu’il y a entre le sensible et le visible. Ce travail de gestation, où la couleur travaille au noir, Arnal y pourvoit, il le supervise même. En échange, il doit renoncer à le voir. C’est dire que la peinture est d’abord un échec assumé du visible au coeur du sensible, que les plis et replis du corps et du monde n’ont à proprement parler rien de visible tant qu’ils n’ont pas été séparés de leur première union, là où précisément on y voit rien. De ce revers, le peintre tire en effet son droit à œuvrer, c’est-à-dire à faire voir. L’œuvre d’Arnal délivre ainsi un enseignement qui fut naguère celui de Klee : la peinture n’est pas un spectacle. En un sens, elle n’est même pas à voir. Car c’est plutôt elle qui fait voir, en même temps qu’elle nous guide vers ce que voir et faire veulent dire. On voit selon ou avec elle. C’est pourquoi son « lieu », comme le notait si bien Merleau-Ponty est si incertain (où est le tableau ?). De même, à l’origine, ce n’est pas “moi” qui vois les choses, mais plutôt les choses qui me regardent[11].C’est parce qu’elle me regardent que je peux m’apercevoir parmi elle. Loin d’être une traduction de ce qu’il aurait d’abord vu, la vision du peintre est donc bien plutôt le résultat de ce que les couleurs et les lignes lui font découvrir. C’est pourquoi ses actions se perdent dans la nuit des temps.
[9] L’Œil et l’Esprit, p. 9.
[10] Duchamp et Klein ont dit la même chose, mais, chacun à sa manière ; cf. Lorenzo Vinciguerra, « La matière grise et la matière bleue de l’art. Le problème du mouvement chez Yves Klein et Marcel Duchamp », Milovan Stanic (ed.), Ligeia, « Art et Espace », année XX, janvier-juin 2007, p. 150-159.
[11] L’Œil et l’Esprit, p. 31-32.
précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 suite

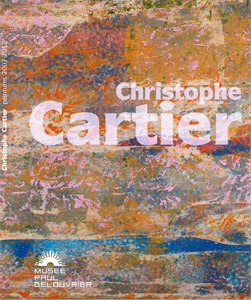 Christophe Cartier
Christophe Cartier


