| |
|
|
[Visuel-News]
06-11-2025
La chronique de Pierre Corcos
Si proches, si éloignés La chronique de Gérard-Georges Lemaire
Chronique d'un bibliomane mélancolique
La chronique
de Pierre Corcos |

|
| Si proches, si éloignés |
Ils partagent le même lieu, le même lit. Ils semblent si proches, ils s'écoutent, ils s'offrent même des petits cadeaux. C'est un couple moderne, dégagé des rôles conventionnels. Mais alors pourquoi communiquent-ils si mal ? Pourquoi sont-ils si éloignés ?... Le percutant dramaturge allemand Marius von Mayenburg, dans Peu importe (jusqu'au 4 janvier au Théâtre La Scala), se livre à une expérience qui n'est pas sans rappeler la thérapie du psychodrame (Levy Moreno), soit inverser les rôles, mettre chacun à la place de l'autre et comprendre ce qui se passe... Erik (Assane Timbo) est traducteur, il travaille à la maison et s'occupe des enfants, tandis que Simone (Marilyne Fontaine) est cadre dans l'industrie automobile, appelée sans cesse à voyager. Alors mésentente de rivalité, de ressentiment ? On inverse les rôles et l'on observe. Mais peu importe (titre de la pièce) car en fait rien n'est résolu... C'est que le problème, situé à l'extérieur du couple, travaille son intériorité, et sans même qu'il en ait conscience (on appelle cela « aliénation »). Car le surtravail, le rythme infernal imposé, la peur de perdre son emploi et la mythification de la réussite matérielle ont totalement aspiré l'espace serein du dialogue. Il ne reste plus alors que de la tension, des réflexes et des routines langagières sur fond de paranoïa... Pour accompagner cette analyse critique de l'auteur allemand, rester « au plus près du texte, de sa vitesse et des virages qu'il prend », l'énergique mise en scène de Robin Ormond s'appuie sur une remarquable direction d'acteurs. L'époque d'Ibsen est loin : on n'a pas plus le temps de se reconnaitre (ou se haïr) que d'ouvrir simplement les cadeaux que chacun offre à l'autre. Et qui jonchent la scène, comme les marchandises surnuméraires du monde consumériste. L'extraversion généralisée du capitalisme éloigne incoerciblement ceux qui se croyaient proches. Et l'indifférence croît... Magistral !
Les Petites misères de la vie conjugale de Balzac, dans une adaptation efficace et une mise en scène enlevée de Pierre-Olivier Mornas (au Théâtre de Poche Montparnasse), montrent qu'on ne communiquait certainement pas mieux dans le cadre du mariage bourgeois au 19ème siècle. Frustrée d'une vie sociale intéressante, probablement d'une sexualité épanouie, sans doute enfin de reconnaissance ou considération, l'épouse (ici Caroline, interprétée par la malicieuse Alice d'Arceaux) ne peut que subir « le caractère atroce et étouffant » du mariage. Et être jalouse par peur, chercher de minables compensations dans la coquetterie, enfin devenir peu à peu acariâtre. Quant à l'époux (Adolphe, incarné par un Pierre-Olivier Mornas, très drôle), si près qu'il soit physiquement de sa moitié, il en est loin par l'esprit, préoccupé par son honorabilité, la gestion financière du ménage (on reconnaît bien les analyses de Balzac !) et les différentes manières d'échapper aux obligations conjugales. Balzac se montre autant un sociologue critique, dénonçant les moeurs de la société et l'institution du mariage de son temps, qu'un psychologue et romancier convaincu des profondes différences entre un homme et une femme. Les costumes d'époque enracinent le spectacle dans un 19ème siècle évoquant un provincialisme en voie de disparition. Dans un petit espace et avec un décor minimum, voici un rapide voyage dans le temps qui, par le comique, nous fait ressentir une autre forme d'incommunication. Qui ne découragera point Éros.
Un quinquagénaire, comme le dramaturge et metteur en scène portugais Tiago Rodrigues, (et encore plus un septuagénaire !) pourrait, en une emphase badine, s'écrier dans la conversation qu'une distance infinie sépare le monde de sa fille du sien. Et que, par la culture, l'attitude, les références, elle et lui vivent sur deux planètes différentes... Ce serait là une façon expressive de parler, par hyperbole et métaphore. Or l'idée lumineuse du spectacle La distance, dont Tiago Rodrigues a écrit le texte et assuré la mise en scène (c'était jusqu'au 5 octobre au Théâtre 71 de Malakoff) consiste à traduire ces deux figures de style en un récit concret et une parabole. En effet le père (Adama Diop) vit sur la Terre, et la fille (Alison Dechamps) sur Mars ; l'écart générationnel se traduit ainsi par une distance spatiale... Ce qui permet à l'auteur, pour justifier son récit, d'imaginer une dystopie (des collapses catastrophiques sur la terre) et une utopie (une partie de l'humanité est allée coloniser Mars pour y bâtir un nouveau monde, et oublier l'ancien). Cette entrée rarissime et bienvenue au théâtre de la science-fiction n'élude pas pour autant la problématique oedipienne (il faut mettre à distance le discours parental pour trouver enfin sa propre parole), au contraire elle lui confère une ampleur civilisationnelle. Le dispositif scénographique est également original. Le plateau, circulaire, tourne au rythme des échanges entre le père et la fille. Ces échanges ne sont pas les dialogues habituels (du théâtre, du quotidien) à cause de la distance entre les deux planètes, plutôt des messages « audio » enregistrés et envoyés. Forme de communication qui à la fois permet l'aveu, la déclaration substantielle, et renouvelle les codes théâtraux. Ces trouvailles ont été applaudies, notamment par un public de jeunes. Loin d'être gratuites, elles servent une réflexion lucide sur notre difficulté croissante à communiquer avec en commun pourtant un monde à la dérive...
|
Pierre Corcos
[email protected]
06-11-2025 |
| P-S = Pendant deux semaines la mise en ligne de Visuel News n'a pas été possible, et nous vous prions de nous en excuser. |
|
|
| Verso n°136
L'artiste du mois : Marko Velk
|
Silvia Paladini,
navigatrice et bibliophique de l'art.
par Gérard-Georges Lemaire
|
Elena Santoro
par Gérard-Georges Lemaire
|
Griffures : Luisa Pinesi joue
entre surface et profondeurs
par Gérard-Georges Lemaire
|
Rencontres au café Tortona
avec Ariel Soule
par Gérard-Georges Lemaire
|
Le fil rouge d'Akane Kirimura
par Gérard-Georges Lemaire
|
Pierre Delcourt
en quête d'un absolu du visible
par Gérard-Georges Lemaire
|
Stefano Soddu,
entre diverses dimensions
par Gérard-Georges Lemaire
|
Une expédition picturale à Cythère
en compagnie d'olivier de Champris
par Gérard-Georges Lemaire
|
Dans l'atelier de Hans Bouman
par Gérard-Georges Lemaire
|
John Giorno : William Burroughs
tel que je l’ai connu.
par Gérard-Georges Lemaire
|
Giampiero Podestà, ou l'origine d'un monde
par Gérard-Georges Lemaire
|
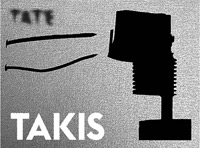 [idées] [idées]
Takis: Contemporary Poet of Heaven and Earth
by Megakles Rogakos, MA MA PhD |
Sur les pas d’Adalberto Borioli
par Gérard-Georges Lemaire
|
Marilena Vita,
entre mythe et onirisme
par Gérard-Georges Lemaire
|
Le regard photographique
de Marie Maurel de Maille
par Gérard-Georges Lemaire
|
Santiago Arranz,
l'ami intime des écrivains
par Gérard-Georges Lemaire
|
 [idées] [idées]
George Koumouros
"Portrait Landscapes"
Exhibition curated
by Megakles Rogakos
PRESS RELEASE |
visuelimage.com c'est aussi
|
Afin de pouvoir annoncer vos expositions en cours et à venir
dans notre agenda culturel, envoyez nous, votre programme, et tout
autre document contenant des informations sur votre actualité à : [email protected]
ou par la poste :
visuelimage.com 18, quai du Louvre 75001 Paris France
à bientôt.
La rédaction
Si vous désirez vous désinscrire de cette liste de diffusion, renvoyez simplement ce mail en précisant dans l'objet "désinscription". |
|
