|
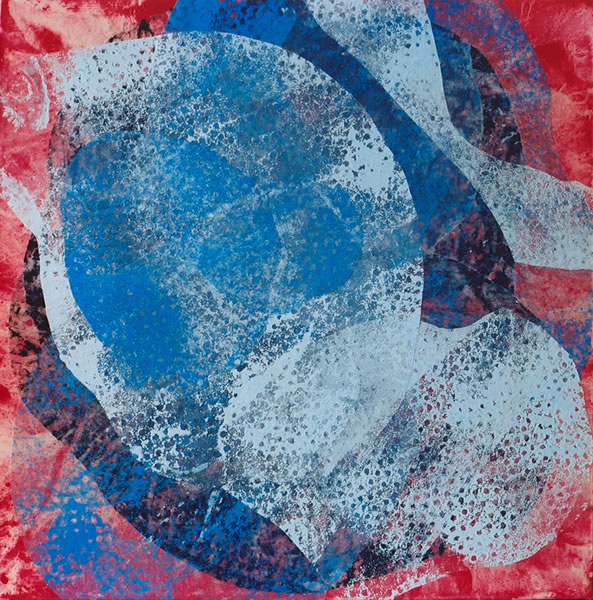
Christophe Cartier appartient d’évidence aux artistes de la
série qui s’emparent d’un motif, d’une forme,
d’un thème ou de tout autre élément récurrent
pour les tirer en de longues suites qui semblent se répéter
(alors que la différence, tenue ou ténue, marque à l’évidence
chaque pièce d’une série). Cartier a ainsi décliné plusieurs
séries, depuis les intérieurs obscurs des années 80
jusqu’aux phosphènes aujourd’hui soumis sous le vernis :
chaises au miroir, spectres affectés de leurs doublures, langues
de terre stratifiées, spirales enroulées sur le centre qui
les aspirera, ombres engendrées des décombres qu’elles
engendreront, coupes charnelles, élevages de restes enfouis et relevés
de traces effacées, ovulations solaires Insensiblement (car sans
véritable solution de continuité), Christophe Cartier est
passé d’une figuration annulée à une abstraction
matérialisée, glissant d’une représentation
extérieure du monde intérieur à une présentation
intérieure des apparences extérieures. Ce parcours que nous
envisageons dans sa durée macrocosmique, des origines au présent
fuyant, se saisit aussi dans le trajet de l’instant microcosmique,
du passé proche au futur immédiat, quand Cartier reprend
la pulsion, la création brute, pour la reproduire ou la régénérer,
selon le processus qu’il adopte, copie ou dérive. La peinture
de Cartier apparaît finalement pétrie de contradictions, en
recherche d’originalité et en souci de duplication, savante
et naïve, informelle et informée, minérale et déminéralisée,
ternie et bariolée. À coup sûr peinture de routier
de la modernité réfléchissant la peinture, et non
moins évidemment art d’apôtre de l’immanence en
quête d’une vision du jamais vu. À tel point qu’on
peut se demander si sa véritable matière n’est pas
l’entre deux, la faille, le gouffre, la profondeur invisible que
cèle la surface du visible mais que découvrent les bords
quand on écarte les images. |

