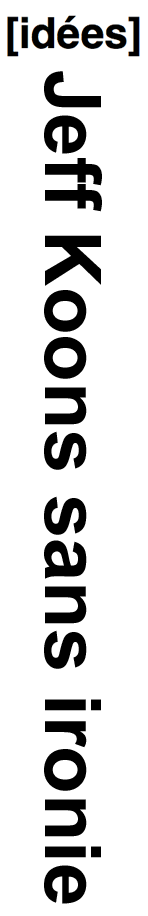|
 Dans cette lithographie de 1989, Koons fait la publicité de son expo sur la banalité tout en parodiant les méthodes publicitaires des magazines d’art. Attitude paradoxale, donc. Il pose en jeune et beau professeur, sourire ravi et énigmatique aux lèvres, entouré d’enfants curieux, et il tient une craie avec laquelle il a écrit, entre autres : exploitez les masses et la banalité comme sauveur. Slogans provocateurs, ou bien donne-t-il tout bonnement son programme ? Jeff Koons a toujours été un excellent vendeur et, ici, il prend des allures de Saint Jean Baptiste annonçant la venue du Christ. On sent une réminiscence de l’art italien destiné aux foules catholiques. Peut-être le bon pasteur répondra-t-il à tous ces bras levés… Par des banalités ? Il sait en tout cas manier encore l’ironie. Ensuite, il va s’en détacher complètement. Dans cette lithographie de 1989, Koons fait la publicité de son expo sur la banalité tout en parodiant les méthodes publicitaires des magazines d’art. Attitude paradoxale, donc. Il pose en jeune et beau professeur, sourire ravi et énigmatique aux lèvres, entouré d’enfants curieux, et il tient une craie avec laquelle il a écrit, entre autres : exploitez les masses et la banalité comme sauveur. Slogans provocateurs, ou bien donne-t-il tout bonnement son programme ? Jeff Koons a toujours été un excellent vendeur et, ici, il prend des allures de Saint Jean Baptiste annonçant la venue du Christ. On sent une réminiscence de l’art italien destiné aux foules catholiques. Peut-être le bon pasteur répondra-t-il à tous ces bras levés… Par des banalités ? Il sait en tout cas manier encore l’ironie. Ensuite, il va s’en détacher complètement.
Le rejet de l’ironie signe non seulement une prise de distance vis-à-vis de Warhol, mais aussi un renoncement à la tradition artistique européenne, à l’idée du désintéressement kantien ou de l’artiste comme marginal à l’avant-garde de l’évolution sociale. Koons a vu très tôt que l’art américain était en mesure d’affirmer une voie autonome, qu’il devait se réinventer aux États-Unis comme tout ce qui était venu d’Europe, y compris le christianisme qui s’était régénéré dans une religion made in U.S.A., le mormonisme. Et puisque le marché de l’art devenait en Amérique une industrie qui allait bientôt dépasser en volume financier celle du cinéma, le saut transatlantique semblait évident. Koons a cependant encore eu besoin de l’Europe, via la Cicciolina, au début des années 1990, car, sans provocation, il était très difficile de percer. Mais, là aussi, il a su américaniser sa forme de pornographie, l’empaqueter dans un style très hollywoodien, l’afficher comme un film réalisé pour les masses par les deux stars – lui-même et la Cicciolina ‑ qui semblent descendre du ciel. Il est piquant de constater que les écoles qui visitent l’expo de New York évitent soigneusement l’étage Cicciolina et que les curateurs du Whitney Museum, dans les explications placardées sur les murs, déclarent sérieusement que Koons « ne nous promet rien de moins que de nous émanciper de la honte liée à l’acte sexuel » de la même façon que dans son exposition d’objets quotidiens intitulée « banalité », il avait voulu nous « délivrer de la stigmatisation du mauvais goût ». Rien que ça ! En plus d’être bon et moral, Koons devient thérapeute, sinon rédempteur. Moi qui croyais, avec Isaac Babel, que la banalité c’était la contre-révolution, que c’était ce qui nous plongeait dans un quotidien assez déprimant, j’avais été victime d’une illusion. La banalité peut rapporter gros. Mais il faut sourire, être aussi optimiste que le recommande Koons, sans oublier d’aimer mon paquet de céréales du matin. Peut-on trouver une attitude plus américaine ? (Peut-être celle qui apporte la démocratie en Irak à coups de bombes.)
Nous sommes là devant un art de masse (je m’excuse d’utiliser encore le mot « art » que chacun sait indéfinissable, mais je l’emploie seulement pour désigner un type d’activité culturelle, donc dans un sens sociologique), comme je pouvais le constater en regardant la foule qui piétinait pendant de longues minutes devant le Whitney Museum et jusque dans la 75e rue pour accéder à l’expo. Le plus étonnant, c’était de voir les enfants, affublés de tee-shirts au nom de leur école pour qu’on ne les perde pas, menés par des instituteurs qui s’ingéniaient à leur expliquer pourquoi ils devraient aimer ce qu’ils avaient devant eux, les lapins gonflables et autres cœurs-miroirs, des adorations d’enfance transfigurées, toute une culture pop revisitée. |