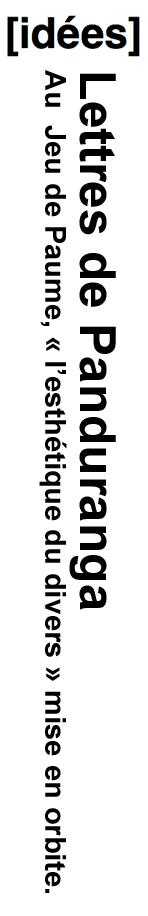J’ai rencontré Nguyen Trinh Thi au Jeu de Paume et nous avons abordé certains points que je souhaitais voir préciser. Elle est consciente de la tournure exotique que peut prendre le mode de présentation « sous vitrine » de certains objets qui accompagnent la projection de son film, et a toujours voulu éviter cette vision des choses dans son travail.
« Je m’efforce d’éviter de parler au nom des autres » dit l’une des lettres de Panduranga.
Comme je la questionne sur la forme « cabinet de curiosités » que prend la scénographie – documents d’archives cotoyant une carapace de tortue – l’artiste répond : c’est la forme même de la vitrine qui donne ce côté « ethnographique ». D’ailleurs, lorsqu’elle fait dire par la voix de la correspondance de Panduranga «Je ne suis pas ethnographe – à étudier et consigner systématiquement le mode de vie des Cham (…)– mais je ne suis pas non plus journaliste qui peut se contenter d’écrire directement sur les sujets » , elle se positionne comme une artiste. Cette indépendance d’esprit est certainement ce qui lui permet de dire les choses au Vietnam : ni comme une activiste, ni comme une journaliste, le fait de parler en tant qu’artiste lui ouvre le champ des possibles. « Le rôle de l'artiste, s'engager ou disparaître » nous dit Nguyen Trinh Thi.
Au Vietnam, la postcolonialité n’est pas encore d’actualité.
Sur le postcolonialisme, l’artiste est très claire « je n’aborde pas cette question ». Mais alors, pourquoi cette référence au film « Les statues meurent aussi » film engagé, s’il en est ? L’utilisation de l’image d’archive de Charles Carpeaux n’est pas là pour servir un propos sur le fait colonial. « Je ne fais pas de théorie » me dit encore Nguyen Trinh Thi. Ah bon ? La lecture postcoloniale que je fais de son travail artistique est donc due à mon point de vue strictement français. Dans ce cas, le casque colonial de Charles Carpeaux qui se détache en blanc sur fond de ruines sombres participe bien de ce que je nomme « l’esthétique de la postcolonialité » , et rien d’autre.
|