Ce
qu’Arthur Aeschbacher nomme le « merveilleux
illisible » est le point central de son travail,
point autour duquel tourne tout son rapport à la
lettre. « Tourner », c’est bien
le mot : dans ses Turn-cuts, les textes sont découpés
en petits carrés, puis recollés en
opérant une rotation. La « forme-mot » vole
alors en éclat et l’alphabet – que
l’on peut pourtant encore deviner – s’efface
et échappe à notre lecture, en un
mot se dérobe. Mot dérobé donc,
mais dans les deux sens du terme : Arthur Aeschbacher
en prélevant le texte, le vole au réel,
nous le subtilise pour le métamorphoser
en peinture, en matière, en couleur. Et
pour nous dérouter un peu plus encore, il
le fait tourner sur lui-même. De même
dans les Oblitérations, les mots fluctuent
entre l’effacement et le marquage, l’impression
sur le papier et la disparition comme écriture.
Il faut oblitérer la langue, la mêler à la
couleur, la rendre à ses qualités
plastiques : en usant de la fragmentation, la surface
de l’oeuvre se met en mouvement ; de la décomposition à la
re-composition et de l’éclatement à l’agencement,
elle devient le théâtre d’un
désordre créateur, d’un « chaosmos ».
Le sentiment d’étrangeté face
au signe linguistique qui nous est habituellement
familier s’avère d’autant plus
saisissant qu’il se manifeste sur des supports
issus du quotidien : cette danse folle des mots
s’opère ainsi sur des boîtes,
des stores et des affiches. Le langage connu devient
insaisissable, l’objet commun révèle
sa poésie.
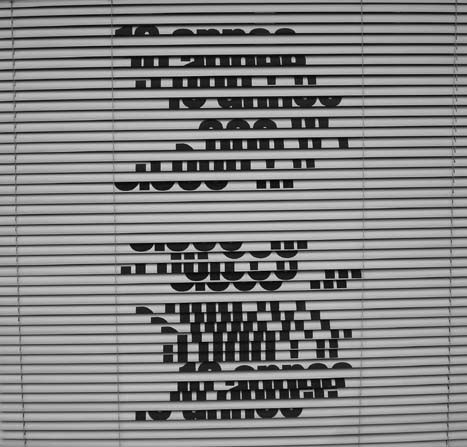
Si, de Dada aux Nouveaux Réalistes en passant par le lettrisme,
l’art du XXe siècle a exploré dans tous les sens
les relations « de la poésure et de la peintrie »,
pour reprendre la fameux mot de Raoul Haussman, A. Aeschbacher entretient
quant à lui un rapport plein de liberté avec cette histoire
de la lettre en peinture, occupant une position à l’écart
des étiquettes, entre influence et totale indépendance.
Ses affiches ne sont pas lacérées, mais ré-agencées,
ses boîtes ne sont pas des ready-mades mais des espaces de collages,
et ses Stores-surfaces sont de malicieux clins d’oeil au mouvement
Support/surface. L’artiste aime détourner les règles
de l’art, faire jouer les concepts entre eux ; il en va ainsi de
son emploi du texte dans la peinture. Où son ami Brion Gysin (qui
inspira notre artiste par sa technique du cut-up) partageait son oeuvre
entre le domaine poétique et le domaine pictural, Arthur Aeschbacher
précise que son travail n’avait rien à voir avec
la littérature ; il se veut uniquement plasticien. De même,
s’il est affichiste, ce n’est pas, comme Villeglé,
pour révéler une « guérilla des signes »,
mais plutôt pour faire de l’affiche la matière première
qui ouvre un champ de création et permet le déploiement
de l’imaginaire. Sans besoin de lutte armée, avec bonheur
et finesse, Arthur Aeschbacher libère l’art du collage de
ses tentations destructrices comme de son discours sociologique.
C’est ce qu’à de merveilleux
cette illisibilité : la plongée dans
le champ purement esthétique et la jubilation
du jeu. Jeu avec les codes, mais surtout jeu avec
le public qui tente, sans jamais y parvenir, de
se faire lecteur de ces fragments de textes. Arthur
Aeschbacher ne déconstruit pas le mot pour
mutiler le logos, mais pour l’ouvrir à une
dimension ludique. Il aime à tromper notre
attente, et ce faisant nous amène à entrer
dans cet univers sans alphabet, à prendre
plaisir à l’indéchiffrable.
Ludique mais loin d’être désinvolte,
l’art d’Arthur Aeschbacher tend à une
pensée aux frontières du verbe. Depuis
plus de cinquante ans, il nomadise la langue – dans
le mouvement cher à Deleuze de déterritorialisation
et de reterritorialisation – explorant l’espace
ambigu entre le mot et son absence. Comme l’écrit
si bien notre artiste : « Opacité d’un
silence, un vrai silence de plomb, d’encre
d’imprimerie dans un océan de réflexion,
qui vous attend au détour du langage » C’est
au détour du langage – c’est-à-dire
non en son sein, mais à sa marge – que
s’enracine donc le riche et ininterrompu
mouvement de sa pensée.

