
Aristide Maillol, la quête de l'harmonie, sous la direction d'Antoinette Le Normand-Romain & Ophéliz Ferlier-Bouat, musée d'Orsay, Editions Gallimard, 352 p., 45 euro.
Nul n'ignore en France, quand il s'intéresse un tant soit peu à l'art, qui est Aristide Maillol (1861-1944), mais on est souvent bien en mal de cerner son oeuvre et on se contente de percevoir un sculpteur néoclassique. Les oeuvres disposées dans les jardins des Tuileries sont souvent tout ce que l'on connaît de lui et seuls les plus curieux vont visiter sa Fondation. Il y a d'abord chez lui un étrange paradoxe qui est dû à sa situation dans l'histoire de l'art et à sa longévité. Il faisait partie de sa jeunesse des artistes audacieux et, à la fin de sa vie, il s'est retrouvé en phase avec l'Art Déco ! C'est un méridional - il est né à Banyuls. Il décide très tôt de se consacrer à la peinture. Il va s'installer à Paris et parvient à entrer à l'Ecole des Beaux-arts, non sans mal, en 1885.
Il entre dans l'atelier d'Alexandre Cabanel et dans celui de Jean-Léon Gérôme, mais il subit assez vite une double influence : celle de Puvis de Chavannes et celle de Paul Gauguin, ce qui démontre d'emblée sa volonté de se jeter dans l'aventure d'un art moderne tout en conservant des liens étroits avec un passé glorieux. Mais il rejette rapidement l'académisme de ses maîtres. Il prouve de belles qualités de peintre (c'est l'une des découvertes qui nous propose cette belle exposition au musée d'Orsay) : il suffit de voir sa Couronne de fleurs (1889), ses autoportraits et ses portraits de femmes. Il suit l'esprit de l'impressionnisme avec une authentique recherche, mais ne parvient pas à trouver un caractère propre et une originalité. Il est brillant, mais pas inventif. Il en est bien conscient et sa technique appréciable ne suffit pas à lui faire franchir une étape décisive.
Il laisse de côté pinceaux et palettes. Alors, il s'intéresse de plus en plus aux arts décoratifs, d'abord à la broderie (où il excelle) et surtout à la tapisserie (son Jardin est vraiment une réussite). Il apprend cette technique et ouvre un atelier dans sa ville natale en 1893. Son travail est apprécié. C'est alors qu'il commence à faire de petites sculptures en bois, avec toujours une vision décorative, mais qui demeure assez figurative. Mais ce n'est qu'en 1902 qu'il réalise une sculpture d'une certaine dimension qu'il baptise La Méditerranée (il avait peint une toile avec ce même titre, avec une jeune femme nue devant la mer). Il réalise une seconde version moins réaliste trois ans plus tard. Cette même année 1902, Ambroise Vollard lui propose de faire chez lui une exposition. Maillol est très influencé par l'art grec ancien et résiste aux sirènes de la modernité sans pourtant s'y opposer. C'est ce qui va faire l'originalité de sa démarche pendant toute son existence. On lui commande en 1912 un monument pour célébrer Paul Cézanne. Après la Grande Guerre, il réalise de nombreux monuments aux morts. Il s'intéresse aussi à la gravure et il illustre entre 1926 et 1927 les Eglogues de Virgile, Daphnis et Chloé de Longus en 1937 et Les Chansons pour elle de Paul Verlaine en 1939. Son évolution dans le domaine de la sculpture a été plutôt lente et a passé par différentes phases.
Par exemple, il s'est attaché, au début, à réaliser de petites pièces en terre cuite. On sent qu'il se cherche encore. Et cela aussi bien dans sa technique que dans son style, mais toujours en faisant preuve de qualités indéniables. On constate aussi dans ses dessins qu'il a choisi sa voie dans le mode d'expression : le réel reste présent, même s'il est stylisé. On comprend aussi qu'il est en mal de sujets. En fait, il utilise avant tout le thème de la baigneuse, qui lui permet de concilier paysage, marine et le nu féminin. C'est, comme Eugène Delacroix, un artiste sans imagination (mais ce premier allait puiser ses sujets chez les grands écrivains). Et il finit par définir une ligne de conduite qui continue à balancer entre le classicisme le plus pur et une écriture « abstraite » (dans le sens de Worringer : la stylisation et l'épuration des formes). Ce gros catalogue a le mérite de nous faire découvrir Maillol, qui reprend une place dans l'histoire du XXe siècle. Son existence artistique est étudiée dans ses moindres détails et on peut mieux saisir le sens de sa démarche. Ce qui l'a rendu longtemps si hésitant a fini par forger sa véritable nature. Cette exposition surprendra plus d'un visiteur et le catalogue remarquable lui donnera tout ce qu'il faut savoir sur cet homme qu'on a beaucoup caricaturé.

Pieter de Hooch, un peintre à l'infinitif, André Scala, « Studiolo », L'Atelier contemporain, 160 p., 7, 50 euro.
Le grand problème que pose nos musées, notre histoire de l'art en général, est de mettre en exergue certains grands maîtres d'autrefois en éclipsant les autres aux yeux de ceux qui cherchent à s'initier aux différentes formes de la création en Occident au fil des siècles. Le nom de Johannes Vermeer a quasiment éclipsé celui de la plupart des autres peintres du Siècle d'Or. Ce n'est pas moi qui vais dénigrer l'art de Vermeer, bien au contraire. Mais j'aimerais qu'on puisse apprécier des peintres de premier plan comme Pieter de Hooch (Rotterdam 1629-1684 ?). Ce livre vient à point nommé pour qu'on connaisse mieux ce grand créateur. Il est d'origine assez modeste et l'on sait peu de choses de son enfance. Nous savons qu'à partir de 1650 il a travaillé pour un bourgeois collectionneur. Mais on ignore qui ont été ses maîtres, bien que de nombreuses aient été avancées. Son art est pensé dans un esprit qui n'est pas éloigné de celui de Vermeer : ce sont surtout ses "kamergezichten" (vues de chambre), ses conversations, ses paysages urbains. Comme son célèbre contemporain, il se limite à la vie quotidienne et à l'urbanité. Sans doute est-il moins métaphorique et moins soucieux de contenir ses personnages dans des lieux fermés et souvent exigus.
L'atmosphère n'est la même, loin s'en faut. Ce qui guide cet homme n'est pas du tout du même registre que ce qu'a entrepris Vermeer. Il a aussi le souci de rattacher l'histoire des Pays-Bas à celle des Bataves combattant les Romains. C'est une autre différence de taille. Mais sait-on tout de Vermeer ? De son oeuvre, on sait peu de choses jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. On sait de lui qu'il a été inscrit à la Guilde de saint Luc à Delft en 1655. Et il en est demeuré membre jusqu'à son départ à Amsterdam en 1660. L'auteur, faute de preuves tangibles en dehors des peintures, s'efforce d'expliquer la transition que Hooch a adopté alors que la peinture de genre a eu une grande vogue (ce n'est pas un genre mineur). Il parvient à expliquer la place qu'il a prise dans ce contexte qui est nouveau dans l'art. Il expose de quelle manière il a voulu disposer ses scènes intimes avec un sujet qui semble dépourvu d'intérêt, mais qui, en fin de compte, révèle les moeurs et le mode de vie d'une époque précise en un lieu précis. On découvre ainsi toutes ses subtilités. Comme Vermeer, il a réalisé quelques peintures religieuses. Mais c'est un aspect secondaire de son travail. Voilà un livre comme on aimerait en avoir plus, qui est la somme des connaissances que nous avons (bien maigres, hélas) d'un peintre de grande valeur dont on sait si peu mais dont les compositions ne peuvent manquer de frapper l'imagination.
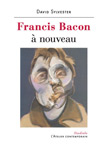
Francis Bacon à nouveau, David Sylvester, traduit de l'anglais et préfacé par Jean Frémon, « Studiolo », L'Atelier contemporain
Dans sa préface, Jean Frémon, nous présente David Sylvester (1924-2001) comme un écrivain. Or, il a été journaliste à ses débuts, de livres d'histoire de l'art, de monographies d'artistes (d'Alberto Giacometti, qu'il connaît en premier à son arrivée à Paris en 1947, jusqu'à Richard Hamilton et Lucian Freud, pour ne citer qu'eux), d'entretiens (dont ses célèbres entretiens avec Francis Bacon), de commissaire d'expositions (il a été chargé d'une exposition d'Auguste Renoir et d'une autre de Bacon à la Biennale de Venise qui lui a valu un Lion d'or). Puis d'une autre sur Henry Moore). Bref, c'est un dilettante dans le sens propre du terme, un splendide connaisseurs des artistes de son temps. Dans ce livre - qui est constitué pour moitié d'entretiens avec le peintre), il fait un portrait de Bacon et nous illustre son univers avec mille détails révélateurs. Il n'a pas entrepris de faire une étude en coupe réglée de son oeuvre, même s'il nous apprend beaucoup de choses à son sujet, mais plutôt de voir cette oeuvre étonnante et son créateur encore plus étonnant et imprévisible sous différents éclairages, enrichissant sans cesse l'idée qu'on peut se faire de l'un et de l'autre.
Ce qui est clair, c'est que David Sylvester veut faire oeuvre d'historien à sa façon, sans rien établir de systématique. C'est plutôt sa perception aiguë des détails qui font surgir une vérité cachée ou tout du moins peu visible de cet artiste qui compte le plus pour lui. Il suppose que son lecteur peut de lui-même explorer l'univers pictural de ce créateur si peu ordinaire, mais qu'il a besoin de toutes sortes d'indices pour en approfondir l'apprentissage. C'est un livre réellement indispensable pour tous ceux qui cherchent à savoir qui est Bacon et ce qu'il a recherché dans cet usage exubérant de la peinture. Car Bacon a fait partie de ces grands transgresseurs du siècle passé. On a besoin qu'il nous guide encore aujourd'hui et son travail assez peu académique reste plus efficace qu'un essai systématique et impératif, sur un art aussi violent, sacrilège, provocateur et donc aussi peu académique.

L'Odysée de Pénélope, Margaret Atwood, traduit de l'anglais (Canada) par Lori Saint-Marin & Paul Gagné, préface d'Ono-dit-Biot, « Pavillons Poche », Robert Laffont, 186 p., 8, 50 euro.
Ecrivain célèbre, populaire même, traduit dans de nombreuses langues, Margaret Atwood (née en 1934), auteur de près de vingt romans, de recueils de poèmes et de mille autres choses, est en quelque sorte l'écrivain officiel du Canada. Elle fait moisson d'une quantité de prix et de décorations qui dépassent l'imagination ! Cet ouvrage est une fiction où Atwood s'est divertie à recomposer une part de L'Odysée dans l'optique de Pénélope. De plus, elle utilise principe des choeurs antiques pour scander son récit, et n'hésite pas à faire de l'humour sur cette histoire qui se termine de manière tragique dans un bain de sang. Mais elle ne possède pas l'humour débridé et libérateur d'Offenbach et ses pastiches de l'antique n'ont d'autre objet que de percevoir cette histoire à travers le regard d'une femme (ce qui a déjà été fait). Bien sûr, ces pages se lisent avec un relatif plaisir et elles font parfois sourire. De plus, sa vision de la tragédie antique ne manque pas de singularité et est donc attrayante. Mais ce n'est pas là un grand morceau de littérature qui nous oblige à relire Homère d'une autre façon en faisant ainsi des découvertes majeures ou bouleversantes sur le périple d'Ulysse et sur son retour tapageur à Ithaque. Disons que c'est un simple divertissement qui pourrait très bien convenir à des plagistes légères et qui n'a pas envie de se confronter à Fédor Dostoïevski ou à Henry James. C'est assez bien ficelé et habilement fait, mais c'est le fruit du travail appliqué d'une main qui a du métier, mais pas du génie dans l'écriture.

Le Grand canyon, Vita Sackville-West, traduit de l'anglais par Matilde Helleu, préface de Gaelle Josse, Autrement, 294 p., 21, 50 euro.
Cette oeuvre de fiction de la célèbre Vita Sackville-West (1892-1962), l'auteur de All Passion Spent et de The Edwardieans, a été écrite pendant la guerre. On est en droit de s'étonner de la voir traiter un sujet qui ait trait à l'actualité, et à une actualité tragique et toute contemporaine, je veux parler de la dernière guerre mondiale. Mais elle a écrit cette histoire dans une sorte d'ambiguïté puisque les événements belliqueux servent un peu de prétexte, mais surtout de toile de fond à une autre histoire. Nous sommes dans le Grand Canyon, en Arizona et là, dans un hôtel, des personnes de la bonne société européenne semble vivre dans le même état d'esprit et dans les mêmes conditions qu'avant que l'Allemagne ne remporte la guerre en Europe.
Les personnages principaux - Mrs Temple, Mr & Mrs Dale, etc. - évolue dans cette région perdue des Etats-Unis comme si elles se trouvaient à Bath, et ne donnent pas l'impression d'être très affectés par les événements qui frappent le monde. C'est une manière de railler les moeurs d'une certaine sphère de la société, mais aussi de montrer comment ces membres de cette élite fait face à ce qui se déroule autour d'eux. C'est un livre particulièrement déroutant car sortant complètement des rails littéraires de cet auteur, mais aussi parce qu'elle l'a pensé au moment où la Grande-Bretagne était en bien mauvaise posture. Mais il se lit avec intérêt et même avec plaisir car le tragique n'est pas dans les faits et gestes de ses figurants, mais dans un contexte des plus graves, quand l'Allemagne nazie pouvait encore gagner la partie... C'est une curiosité qui mérite d'être connue.

Conversation tardive, Jean-Jacques Gonzales, L'Atelier contemporain, 208 p., 25 euro.
Ce volume n'est pas banal dans sa conception. Une collection de photographies assez banales, dont on ignore tout de l'origine, donne lieu à un récit. Mais celui-ci ne nous offre pas une véritable trame, mais plutôt une idée des liens entre les figures saisies sur le papier. Ce serait l'idée d'un petit roman, mais sans qu'on en puisse connaître le sens et les grandes lignes. C'est donc assez mystérieux, mais n'implique une recherche labyrinthique de ses tenants et de ses aboutissants. C'est pour moi l'histoire de ces vieilles photographies que l'on retrouve et dont on ignore qui sont les visages que l'on y voit. Tout laisse croire qu'il s'agit d'un groupe familial et aussi d'une époque qui nous fait remonter en arrière de quelques décennies. L'idée est intéressante et intrigante. Bien sûr, ce périple nous laisse un peu sur notre faim, car ni les textes ni les images nous permettent de reconstituer un monde complet. Mais le voyage en soi est intéressant et aiguise notre curiosité. Il semblerait qu'il s'agisse de clichés ayant appartenu à des membres de sa famille, mais dont il ne connaît que de minces bribes de leur parcours temporel. Il nous fait partager ses interrogations et aussi son dépit de ne pas pouvoir réaliser l'intégralité du puzzle de la mémoire. Jean-Jacques Gonzales nous invite à vivre avec lui ce qu'une photographie associée à plusieurs autres peut encore évoquer en faisant ressurgir des fragments là où le langage n'a plus voix au chapitre et est même réduit à l'impuissance. Ne reste plus qu'une fiction un peu énigmatique et qui rend cet univers sans qualité soudain très excitant.
|
