| |
19-09-2024 12-09-2024 05-09-2024 08-07-2024 27-06-2024 20-06-2024 13-06-2024 06-06-2024 30-05-2024 23-05-2024
|
|
[verso-hebdo]
06-06-2024
|
La chronique
de Gérard-Georges Lemaire |

|
| Chronique d'un bibliomane mélancolique |
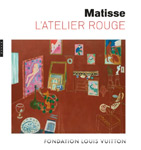
Matisse, l’Atelier rouge, sous la direction d'Ann Temkin & de Dorthe Aagesen, Editions Hazan / Louis Vuitton, 232 p., 45 euro.
L'idée de départ de cette exposition a été de partir d'un tableau d'Henri Matisse baptisé aujourd'hui L'Atelier rouge. Il est actuellement conservé au Museum of Modern Art de New York. Cette oeuvre quasiment monochrome montre différents représentant l'atelier de l'artiste à Issy-les-Moulineaux achevé en 1911, tableaux un grand cadre, des meubles, dont un fauteuil, et une poignée d'objets. Les conservateurs ont imaginé de rassembler toutes ces oeuvres figurant sur la toile car cette composition est une sorte de manifeste de la peinture que Matisse a pu concevoir au terme de la période fauve qui a tant scandalisé et tant inspiré les artistes de son temps. Cette composition a été présentée à la Seconde exposition postimpressionniste organisée à Londres par Roger Fry en 1912. Puis il a été montré à l'« Armory Show » à New York et ensuite à Chicago, à Boston puis à Düsseldorf. En fait, elle ne portait pas ce titre : c'est Alfred H. Barr, fondateur du MoMa qui lui a attribué ce titre. Il s'appelait à l'origine Panneau rouge.
Le célèbre conservateur n'a donc pas vraiment trahi la pensée de Matisse, même si ce dernier avait eu une idée plus neutre. Déjà en 1913 un marchand de tableaux allemand, Alfred Fletcheim, l'avait dénommé Atelier - intérieur. Bien que ce tableau soit l'un des chefs-d'oeuvre de Matisse, il a été peu montré et peu discuté par la suite. On apprend qu'il avait été fait pour le grand collectionneur russe Sergeï Chtchoukine, mais que celui-ci l'avait refusé. Le catalogue commence par nous narrer l'histoire de ce nouvel atelier édifié en 1909. Pour la première fois, le peintre a un lieu assez spacieux et adapté à son travail. Et il ne se trouvait pas très loin de Paris. Il a continué à enseigner dans l'ancien couvent du Sacré-Coeur, où il avait son atelier un peu exigu avait aussi installé sa famille dans une belle maison à l'angle de l'ancienne route de Clamart, non loin de cet atelier démontable. Un chapitre est consacré à Chtchoukine, qui lui avait acheté un grand nombre de tableaux et qui les avait arrangés dans son palais à Moscou. La révolution bolchevique fait que toute sa collection devient un bien d'Etat et son palais est aujourd'hui le musée des Beaux-Arts Pouchkine.
Un autre chapitre continue à lier l'artiste et le mécène, car Matisse avait élaboré un ouvrage baptisé L'Atelier rose en 1911, qui a été présenté au Salon des Indépendants cette même année. Nous découvrons aussi plusieurs petites toiles qui présentent un détail de l'atelier. Au contraire de la grande et superbe composition, qui a un fort accent démonstratif, avec le sol rose et le grand tableau bleu au centre, nous sommes persuadés que Matisse avait voulu donner au tout un tour didactique. Les autres toiles, au contraire, ne font que révéler son décor intime. Mais nous pouvons pénétrer dans les secrets de son art avec des oeuvres importantes, comme le luxe, et l'ébauche d'autres toiles emblématiques. Il y a aussi de petites sculptures. C'est absolument passionnant.
Une autre découverte de grand intérêt est cette aquarelle qui qui dérive de l'Atelier rouge, mais cette fois en rose (janvier 1912). Le reste concerne l'époque suivante et puis le musée de New York. Mais cela nous permet de connaître une toile intitulée Café et datée de 1916, très loin du magnifique Café marocain qui se trouve au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Cette exposition digne d'éloges et ce catalogue très riche ne peuvent que conduire à revoir du tout au tout notre vision du parcours d'Henri Matisse. Nous sommes là face à l'exceptionnel.

Animaux-&-artistes, Julien Blaine, Les Presses du réel, 64 p., 12 euro.
J'ai retrouvé sous un meuble un petit livre de Julien Blaine, dont je ne vous avais jamais parlé, justement parce qu'il avait disparu. En attendant un nouvel ouvrage de son cru, je tenais à corriger ma bévue et à vous dire deux mots sur ces curieux animaux qu'il a imaginés. On découvre d'abord Lolo, l'âne qui est sans aucun doute la figure la plus emblématique crée par cet inventeur infatigable, mais qui utilise un humour potache.
La photographie où il porte une tête d'âne et où il lève un bras dans une pose antique est sans aucun doute un de ses portraits (autoportrait oserais-je dire) le plus célèbre. Mais il ne faut pas oublier Nong Thanwa, l'éléphanteau, Juuso, l'ours brun, Poulpo, le poulpe, Hunter, le shiba-inu, Congo, le chimpanzé et Pigcasso, la truie. Ce petit bestiaire est richement illustré, et chacun de ses protagonistes C'est là bestiaire où dominent la fantaisie et le grotesque. Blaine joue ici au destructeur de nos valeur, littéraires et zoologiques, et veut distraire ses lecteurs, c'est-à-dire les contraindre à percevoir notre monde sous un regard nouveau. Il y réussit très bien. Il a toujours été un briseur des conventions et en même temps, un artiste qui se cache derrière masque de Commedia dell'arte.

Bernard Plossu, introduction de Laurie Hurwitz, Poche Photo, Actes Sud, 14, 50 euro.
Bernard Plossu est né en 1945 à Dalat au Viêtnam. C'est son père qui l'a initié à la pratique de la photographie. Il ne fait pas de brillantes études et ne passe pas son baccalauréat. Il a voulu ensuite suivre des cours de philosophie, mais s'en est vite détourné. L'événement décisif est le voyage au Mexique où il a de la famille. C'est là qu'il va faire ses premières expériences et aussi commencer à définir un style. Il écarte toute forme de folklore et abolit le pittoresque. Il saisit des scènes, des architectures, des objets, qui ne paraissent n'avoir que peu d'intérêt.
Ce qui compte pour lui, c'est que le sujet puisse produire un cliché qui puisse entrer dans son univers. Il a ensuite beaucoup voyagé, en Afrique (en particulier au Niger), aux Etats-Unis, surtout en Californie et au Nouveau Mexique. Il va aussi sillonner l'Europe, se rendant à Rome, à Naples en Andalousie. Il fait peu de portraits, et quand il en a fait, il s'agissait de Françoise, sa compagne. Entre-temps, il s'est forgé une solide réputation et a été amené a travaillé pour de grandes revues. IL a été rangé dans la catégorie des artistes car ses photographies n'apportaient rien à la connaissance des peuples, des lieux urbains, des paysages. L'étrangeté de son propos le met tout à fait à part de ses contemporains. Sans doute son défi à l'esthétique l'a fait remarquer. On peut discuter de la valeur de sa démarche. Mais on ne pourrait dire qu'elle n'est pas authentique.

Roses, pivoines et iris, Anne Sefrioui, Editions Hazan, 118 p., 24, 95 euro.
L'auteur nous apprend que la représentation des fleurs connaît un grand essor au Japon à partir du XVIIIe. Le boudhhisme avait introduit depuis longtemps le don de fleurs dans les temples. Et puis le rapport avec la nature a toujours eu une importance cruciale dans l'histoire de ce pays. Les plus grands artistes qui travaillaient la xylographie ont donc tenu à représenter des fleurs de toutes sortes. Une fleur isolée ou un petit groupe de fleurs a pu dès lors être le sujet exclusif de ces estampes.
Bien sûr, elles peuvent aussi être inclues dans un paysage, voisiner avec des oiseaux ou arrangées par de jeunes et jolies femmes. C'est un aspect moins connu de l'art japonais de cette période, mais qui a pris une telle ampleur qu'il est impossible de l'ignorer. Ce volume est une petite merveille, qui montre les réalisations de grands maîtres, comme Tanigami Konan, Utagawa Hiroshige II, Shodo Kawazaki, Karsushika Hokusai, Ohara Shoson, je ne saurais les citer tous. Mais c'est un véritable enchantement car leur manière de rendre les fleurs est vraiment extraordinaire. Parfois, elles sont incorporées dans des scènes avec des figures humaines. Quoi qu'il en soit, ce que nous découvrons dans cet ouvrage est de l'ordre de la beauté sans partage, avec néanmoins avec un souci de restituer les plantes avec un réalisme très précis.
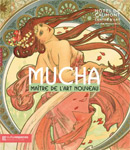
Mucha, maître de l'art nouveau, sous la direction de. Tomoko Sato, Stéphanie Contarutti & Philippe Thiébaut, Editions Hazan / Hôtel de Caumont, 192 p., 29, 95 euro.
Il y a eu, il y a quelque temps, une belle exposition d'Alfonse Mucha présentée au musée du Luxembourg. Mais elle était forcément limitée étant donné que ce beau lieu parisien n'est pas immense. Cette exposition qui a eu lieu à l'Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence a été de loin plus importante. Rappelons que Alfons Maeia Mucha est née en Moravie du Sud en 1860. Pendant son enfance, c'est le chant qui l'a le plus passionné. Sa famille s'est installée à Brno en 1872.
En 1875, il a fait la découverte des peintures murales de Jan Umlauf dans une église de Ùsti nad Orlici et en a été profondément impressionné. Deux ans plus tard, mauvais élève, il a été renvoyé de son école. Il a donc dû travailler comme greffier à Ivacice. Il a commencé à prendre des cours de dessin et de peinture dans l'atelier de Josef Zelen`y. Il a tenté ensuite de rentrer à l'Académie des Beaux-arts de Prague, sans succès. Il alors travaillé comme décorateur pour des théâtres. En 1879, il s'est rendu à Vienne où il a travaillé pour une entreprise de décoration. Il y a suivi des cours du soir et a beaucoup fréquenté les musées.
En 1885, un riche propriétaire terrien lui a demandé de décorer son château. En 1885, il a voyagé en Italie et en Suisse. Il est entré à l'automne à l'Académie des Beaux-arts de Munich. Il y est devenu le rédacteur en chef de la revue Palette. Il s'est initié à la photographie en 1887. Il s'est alors installé à Paris et il y a étudié à l'Académie Julian. Un an plus tard, il est inscrit à l'Académie Colorassi. A partir de 1889, il a collaboré à des revues à Paris comme à Prague. En 1890, il a rencontré les peintres Nabis. Il a participé à leurs réunions à la crémerie de madame Charlotte Caron. Il a fait, en 1891, il a connaissance de Paul Gauguin avant son voyage pour Tahiti.
Ce fut au cours de l'hiver 1894 qu'il a rencontré Paul Gauguin avant son départ pour Tahiti. Il a commencé à collaborer avec l'éditeur Armand Colin. Il a décidé de donner des cours de dessin. Il a pu alors s'acheter un appareil photographique. Peu avant Noël, il a fini de dessiner la première affiche pour Sarah Bernardt (Gismonda). Cette dernière s'est enthousiasmée pour sa création et elle a décidé qu'il serait son décorateur exclusif, autant pour les affiches que pour les décors de théâtre.
Sa vie a basculé du jour au lendemain : il était désormais célèbre et n'était plus dans le besoin. Il a réalisé de nombreuses oeuvres décoratives, son succès étant fabuleux, et aussi des peintures jusqu'à la déclaration de la guerre. Lorsque celle-ci s'est achevée, il a décidé de rentrer dans on pays. Il y est devenu quasiment le peintre officiel et a surtout entrepris un ensemble de tableaux colosal : L'Epopée slave, qu'il peint dans un château en Bohême (il avait déjà réalisé onze de ces toiles gigantesques à Paris). L'ensemble est terminé en 1928 et il a décidé d'en faire don à la ville de Prague pour le dixième anniversaire de son pays. En mars 1939, l'Allemagne envahit son pays. Il est arrêté par la Gestapo, il est interrogé et emprisonné. Il est libéré peu après, mais sa santé s'est bien dégradée et il meurt au mois de juillet.
Dans ce beau catalogue, on peut admirer l'ampleur du champ de son histoire artistique. On peut en effet y admirer ses affiches, ses couvertures de revues, ses illustrations pour les livres, ses costumes de théâtre, et mille autres choses qui sont du ressort des arts décoratifs où il a excellé (il a fait des éventails, des boîtes, des menus, des tissus, des publicités, etc.). Mais on peut également y faire la découverte de sa peinture, qui est bien méconnue ou sous-estimée. Je dois reconnaître que j'y ai fait moi-même des découvertes, comme Le Repos de la nuit, qui fait partie d'une suite intitulée Les Moments de la journée (1899). C'est là le moyen de prendre la juste mesure de cet artiste merveilleux, célèbre, c'est vrai, mais assez mal connu qui n'a jamais galvaudé son talent.
|
Gérard-Georges Lemaire
06-06-2024 |
|
|
| Verso n°136
L'artiste du mois : Marko Velk
|
visuelimage.com c'est aussi
|
Afin de pouvoir annoncer vos expositions en cours et à venir
dans notre agenda culturel, envoyez nous, votre programme, et tout
autre document contenant des informations sur votre actualité à : info@visuelimage.com
ou par la poste :
visuelimage.com 18, quai du Louvre 75001 Paris France
À bientôt.
La rédaction
Si vous désirez vous désinscrire de cette liste de diffusion, renvoyez simplement ce mail en précisant dans l'objet "désinscription". |
|
