| |
24-01-2019 17-01-2019 10-01-2019 03-01-2019 13-12-2018 06-12-2018 29-11-2018 22-11-2018 15-11-2018 08-11-2018
|
|
[verso-hebdo]
13-12-2018
|
La chronique
de Gérard-Georges Lemaire |

|
| Chronique d'un bibliomane mélancolique |

Cassandre, Alain Weill, Hazan, 280 p., 99 euros.
Le nom de Cassandre (1901-1968) est associé pour moi à un beau souvenir d'enfance : celui d'une grande publicité pour marque d'apéritif Dubonnet, qui était déclinée en trois parties avec un petit monsieur stylisé, de profil, l'oeil rond, vêtu de noir avec un chapeau-melon sur la tête, assis devant un guéridon au-dessus duquel il soulevait un verre alors qu'on pouvait lire en-dessous le nom de la boisson vantée : « Dubo - Dubon - Dubonnet ». Cette réclame était peinte sur un grand mur aveugle situé entre la rue Vanneau et l'hôpital Laennec (je n'habitais pas très loin et je passais donc souvent devant, à pied ou en autobus, chaque émerveillé par ce qui était d'une certaine manière une sorte de petit film burlesque). C'est sans doute un chef-d'oeuvre de l'art publicitaire que les futuristes italiens, mais aussi les poétismes tchèques et les futuristes russes avaient préconisé entres les années dix et vingt du siècle dernier. Cassandre avait su allier un jeu savant et efficace entre l'image, la typographie et aussi l'audition, car ces trois paroles vous entraient dans la tête et y valsaient avec jubilation. J'ai aussi conservé le souvenirs de deux des affiches qu'il avait dessinées : L'Etoile du Nord, le Normandie et bien sûr le livreur de Nicolas avec toutes ses bouteilles dans les mains. En revanche, je ne souviens pas de ses publicités pour les Galeries Lafayette, qui ont été pourtant nombreuses -, mais elles ont été conçues à la fin des années trente, je n'ai donc pas pu les voir alors que les précédentes ont perduré jusqu'après la dernière guerre. Ce grand et très beau livre nous fait découvrir toutes les facettes de ce grand créateur. C'est d'abord un grand artiste dans ce domaine, qui est parvenu à conjuguer l'image et le texte dans une relation complémentaire. On sait qu'il a été très intéressé par les recherches du Bauhaus (dont il s'est d'ailleurs inspiré), mais aussi à la création plastique en France. Il a fait des études très passionnantes sur le caractère Peignot pour explorer toutes les possibilités qu'il peut offrir. Il crée en 1937 (le caractère a été inventé huit ans plus tôt) un volume intitulé Bifur financé par Charles Peignot, où il met en scène des compostions typographiques à partir de ce nouveau caractère presque exclusivement composé de majuscules. Il illustre aussi le texte de Blaise Cendrars, La Rue. Cassandre est un des grands théoriciens de l'art de la réclame entre les deux guerres. Sa réputation est telle qu'il va travailler aux Etats-Unis où il conçoit les couvertures du magazine Harper's Bazaar entre 1936 et 1937 (il remplace Erte). Mais s'intéresse aussi au décor de théâtre à partir du début des années quarante. C'est aussi alors qu'il revient à la pratique de la peinture, où il se révèle talentueux. En définitive, cette monographie nous fait découvrir le talent sans borne de Cassandre, son originalité, mais aussi ses capacités de penser et d'enseigner cet art, qu'il entend porter à son plus haut niveau créatif. Avec ce fort volume sous coffret, un hommage est enfin rendu à cet artiste des rues, de la vie de tous les jours, où ce qui est éphémère par définition se change en quelque chose qui dure dans l'imaginaire urbain. On y apprend que c'est lui qui a dessiné les caractères pour la machine à écrire Olivetti, le Graphila 81 et qui crée le logo d'Yves Saint-Laurent. Je vous recommande de vous le procurer sans attendre.

Doisneau et la musique, Clémentine Déroudille, Flammarion / Philarmonique de Paris, 192 p., 29,90 euros.
Tout l'intérêt de cet album repose sur le fait de nous faire découvrir un aspect assez méconnu de l'oeuvre de Robert Doisneau (1912-1996). Cette passion pour toutes les formes de musique -, de la musique populaire à la musique classique, en passant par les musiciens des rues et même le jazz, est ici documenté et expliqué. Ayant fait des études de gravure à l'école Estienne, il devient ensuite publicitaire à l'Atelier Ullmann et réalise ses premiers travaux photographiques. Puis il devient opérateur de cinéma et se lance en 1932 dans le reportage. De 1934 à 1939, il est embauché par Renault pour faire de la photographie industrielle. Toutes ces expériences lui ont offert une connaissance technique considérable, et aussi la maîtrise de toutes les formes possibles de relation avec la réalité visuelle. Mais il n'est pas allé dans le sens de l'expérimentation photographique. Au contraire, il a cultivé un réalisme qui n'est jamais dépourvu de poésie. Ce rapport à la musique est pour lui associé à des réminiscences enfantines. Il est d'abord attiré par ces chanteurs des rues, qui ont fait partie du quotidien encore pittoresque des Parisiens jusqu'aux années de l'après-guerre. Je me souviens de deux catégories de chanteurs gyrovagues dans les rues de la capitale : ceux qui venaient dans les cours des immeubles et les habitants jetaient des pièces du haut de leurs fenêtres et ceux qui se produisaient sur les trottoirs, vendant les partitions, ce qui permettaient aux passants de chanter avec eux les airs à la mode. C'est sans doute là un des aspects pittoresques le plus nostalgique de tout l'album. Et il s'est aussi intéressé à des interprètes qui privilégiaient les lieux les plus populaires, comme Pierrette d'Orient, qui jouait de l'accordéon pour accompagné Madame Lulu, sans doute fascinée par la beauté sauvage de la musicienne, qui contrastait avec la silhouette peu avenante de sa camarade. Il a aussi fait le portrait de vedettes qui sont devenues célèbres, à commencer par Fréhel, déjà une gloire du passé. Il a fait le portrait de Juliette Gréco, de Barbara à l'Ecluse, de Philippe Clay, d'Edith Piaf (un cliché extraordinaire pendant une représentation à l'Olympia), de Brassens, de Mireille, de Charles Aznavour, de Mouloudji, etc. Mais il s'est aussi intéressé à des phénomènes plus curieux, comme l'instrument inventé par Lasry et Baschet ou aux performances extravagantes de Maurice Baquet, qui ont dû beaucoup le divertir. Toute une section est consacrée au jazz, et une autre à Django Reinhardt et aux Gitans de Montreuil. A noter une parenthèse dédiée à Jacques Prévert avec lequel il était très ami. Voilà des documents qui peuvent remplir de mélancolie ceux qui ont connu ces années-là et faire découvrir aux plus jeunes un univers inexorablement disparu.

Les Contes cruels de Paula Rego, sous la direction de Cécile Debray, Flammarion / musée d'Orsay, 224 p., 39 euros.
Je dois vous confesser que je ne savais rien de cette artiste d'origine portugaise, née à Lisbonne en 1935, et qui a vécu une grande partie de sa vie à Londres où elle a exposé à la Serpentine Gallery et a reçu le prestigieux prix Turner. Il n'est pas aisé de la situer sur l'échiquier de l'art récent : on pourrait songer à Balthus, à Lucian Freud, et un peu à Edward Hopper. Mais ces analogies permettent seulement de circonscrire une aire particulière de la figuration : elles n'a de connivences profondes avec aucun d'entre eux. Ce qui la caractérise, c'est le sens du grotesque, d'une certaine manière de cultiver le monstrueux et de manifester le fantastique dans la vie commune. Son réalisme est le fruit d'une métamorphose de la réalité : il ne faut donc pas la considérer comme une artiste figurative dans le sens le plus conventionnel. Au contraire, elle aime jouer avec cette ambiguïté. La plupart de ses compostions sont traitées comme des scènes prenant un tour dramatique et parfois violent. Il y a chez elle une sorte de duplicité permanente, où ce qui serait somme toute banal prend une autre dimension. Je ne crois pas que le terme "cruel" soit le mieux adapté : je pense qu'elle va plutôt vers un dévoilement d'une vérité qui se cache derrière les apparences et qui n'est pas toujours belle ou charmante. Cette mise à nu théâtrale de ses tableaux sont la représentation des crises et des douleurs de l'être saisi dans ses activités les plus banales. Si elle s'en tient à des scènes de la vie moderne, elle rejoint certains des maîtres d'autrefois, qui savaient peindre plusieurs états d'âme et plusieurs idées discordantes dans la même composition. Ses travaux ne sont pas séduisants : ils sont plutôt fascinants et exercent sur le spectateur un attrait un peu malsain. Cet univers rappelle parfois celui d'Alice aux pays des merveilles dans un registre bien loin de la fable ou du conte de l'enfance, même si c'est l'enfance qui est en jeu. Disons qu'elle a construit une sorte de carnaval cauchemardesque qui est sa vision aigre et mordante du monde et des êtres. Paula Rego est une curiosité de l'art récent, qui mérite d'être découvert et apprécié à sa juste valeur, mais qui demeure dans les marges de l'histoire de l'art. Elle ne possède pas l'ampleur et la puissance drolatique et parfois morbide de Gérard Garouste dans sa dernière période de nature autobiographique.

Les Vacances de M. Picasso ; Picasso à Antibes Juan-les-Pins, collectif, Hazan / Musée Piccaso, Antibes, 160 p., 29 euros.
Encore une exposition de Picasso !, pourra-t-on entendre. Mais celle est particulière et très originale. De plus, elle nous apprend beaucoup de choses sur sa pratique artistique. Rappelons que l'artiste est venu est venu en villégiature à Antibes dès 1920 avec son épouse, Olga (on la voit danser sur le balcon dans une des photographies reproduites). Il y a fait de petites oeuvres charmantes, mais très mineures. Toutefois à bien y regarder, on se rend compte de choses curieuses et des plus intéressantes : je ne donnerai qu'un seul exemple : celle des baigneuses, que Picasso va utiliser de nouveau, quand il fera ses grandes scènes de plage surréalisantes ; on se rend compte qu'il fait des choses à main libre et qu'il les entrepose dans sa mémoire pour les utiliser longtemps après. Il y a bien d'autres choses passionnantes, comme ces bas-reliefs en sable faits sur le revers d'un châssis en 1930, qui n'ont pas eu d'échos ultérieurement. On peut aussi découvrir des oeuvres d'esprit cubiste, mais qui ont été réalisées bien après la fameuse période qui le rendit célèbre. Il est amusant de constater à quel point Picasso a aimé imaginer des formes tout en jouant : beaucoup de ces petites pièces exécutées rapidement sont des esquisses d'un chemin qu'il voudra emprunter, ou non. Et puis on voit une belle série de photographies des divers ateliers qu'il a eu à Juan-les-Pins. Cette exposition et ce catalogue nous font entrer dans l'intimité de la recherche de ce créateur qui ne semblait jamais devoir s'arrêter de vivre sa peinture ou sa sculpture. Il démontre aussi la facilité avec laquelle il a pu passer d'un genre à un autre (jusqu'à pasticher Henri Matisse !) et être plusieurs artistes à la fois ; il a cette étrange faculté (et facilité virtuose) d'aller de l'expression la plus réaliste jusqu'à l'imaginaire le plus débridé. A la villa Sainte Geneviève, il a peint un divertissant Minotaure à la carriole (1936) où il se parodie avec pas mal d'humour. En somme, c'est un parcours dans l'existence de l'auteur de Guernica qui mérite plus que le détour : c'est une initiation (et à la fois une excursion) à sa méthode capricieuse mais efficace de s'immerger dans les formes.

Marc Chagall, du noir et blanc à la couleur, collectif, Hazan / Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence, 216 p. , 29 euros.
Je ne sais trop si le thème avancé à un sens quelconque. Chagall a bien utilisé le noir et le blanc, surtout pour ses sculptures et certaines de ses gravures, mais rien de très particulier. Ses oeuvres les plus importantes sont le fruit d'une recherche chromatique très sophistiquée et qui a évoluée au fil des années. Mais peu importe : le problème pour les grands artistes du XXe siècle est toujours de trouver un biais pour donner un caractère original à l'exposition proposée. L'essai d'Ambre Gautier est intéressant car elle y analyse les différentes postures adoptées par le créateur selon les techniques qu'il emploie. On peut remarquer qu'il emploie assez peu la couleur pour ses sculptures. Le premier exemple de sculptures blanches qui nous est donné est Deux têtes à la main (vers 1964), puis vient l'Autoportrait (1963-1964) et Adam et Eve (1953) ; d'autres sculptures présentent également ce penchant pour le blanc. Il y a aussi ces volumes traités en noir, comme La Bête fantastique (1959-1960). Mais la sculpture reste un cas particulier : il y a bien quelques tableaux en noir et blanc, mais ils demeurent des cas très isolés. Quant aux gouaches et aux gravure, là on se trouve devant une situation somme toute assez classique. En somme, la question me semble assez peu concluante. Cela étant posé, l'ensemble des ouvrages proposés n'en est pas moins intéressant. Une section est consacrée à ses images biblique. Le terme me choque un peu car il y a des scènes tirées de la Thora, mais il y a aussi des scènes inspirées par le Nouveau Testament, fait étrange pour cet artiste juif, qui a beaucoup figuré le Christ en croix : personne en semble s'interroger sur cette iconographie qui peut être perçue d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue purement culturel étant issu de la Russise orthodoxe. Et cela est d'autant plus curieux que souvent ses grandes scènes religieuses font référence au monde de sa jeunesse, comme le magnifique Exode (1952-1966). La Révolution d'Octobre est souvent présence, justement dans ces scènes. Chagall a aimé disposer la tour Eiffel et de jeunes écuyères qui font des acrobaties hardies sur leur cheval, des vaches et des ânes qui volent, mais aussi tout l'univers de son petit stchetl de Vitebsk, un monde disparu, mais qui survit avec une immense intensité poétique dans son oeuvre.
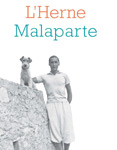
Malaparte, sous la direction de Maria Pia de Paulis, L'Herne, 336 p., 32 euros.
Curzio Malaparte (de son vrai non Curt-Eric Suckert, 1898-1957) est connu en France pour deux romans qui sont des chefs-d'oeuvre, Kaputt et La Peau. Contrairement à ce que certains ont pu dire, ses livres sont régulièrement réédités en français. Mais il n'a jamais eu la célébrité de certains de ses compatriotes italiens, comme Calvino ou Pasolini. On peut expliquer cela par le fait qu'il parle de l'histoire (surtout la dernière guerre), du fascisme ou de la culture de son pays. Ce nouveau Cahier de L'Herne a rassemblé un nombre important de lettres, de nouvelles, d'articles qui permettent de mieux connaître cet écrivain plein de paradoxes. En outre, on découvre des aspects bien moins connus de son activité littéraire, comme le théâtre : la représentation de son Du côté de chez Proust a scandalisé en France et celle de Das Kapital a suscité pas de réactions négatives. Il a aussi été tenté par le cinéma avec son Christ interdit. Mais ses incursions dans le domaine du spectacle n'ont pas été particulièrement couronnées de succès. Un domaine n'est pas exploré en profondeur : celui de la presse : en effet, il devient le directeur de L'Italia letteraria en 1925 et est l'année suivante nommé rédacteur en chef du grand quotidien turinois, La Stampa. Pendant la Seconde guerre mondiale, il fait de remarquables reportages, comme l'invasion allemande de la Russie (ses articles sont réunis dans La Volga naît en Europe) ; après guerre, il voyage en Union soviétique et en Chine. Après adhéré au fascisme et l'avoir critiqué de l'intérieur, il se rapproche des thèses communistes de Mao et offre sa magnifique villa de Capri construite par Adalberto Libera au gouvernement de la Chine Populaire, ce qui provoqua après sa mort bien des démêlés diplomatiques drolatiques ! Sans doute reste-il encore à mieux connaître le journaliste, qui a été l'un des plus remarquable du siècle dernier. Quoi qu'il en soit, ce cahier contient plus de documents d'époque sur l'auteur que de gloses universitaires et cela est un très bon point. Ensuite, cette correspondance dévoilée avec des figures telles que Salvatore Quasimodo ou Roger Vaillant, pour ne citer qu'elles, est passionnante et pleine de surprises. Enfin, les textes inédits, de son Autobiographie à la Lettre ouverte à Mussolini en passant par la Lettre imaginaire à Winston Churchill, sont autant de moyen de mieux connaître cet écrivain fantasque et qui a souvent trempé sa plume dans le vitriol, sans jamais pourtant se départir d'un certain humour et surtout d'une virtuosité stylistique toute baroque dans sa fiction. A se procurer sans faute !

Situations V, Jean-Paul Sartre, édition revue et augmentée par Arlette Elkaïm Sartre, Gallimard, 544 p., 35 euros.
La période couverte par ces essais de Jean-Paul Sartre est d'une importance capitale pour la France de l'après-guerre car elle part du début de la guerre d'Algérie jusqu'à l'effondrement de la IVe République -, quatre années qui ont été plutôt dramatiques. Je n'ai pas la place ici d'évoquer tous ces aspects politiques graves (ce que je regrette, car j'aurais bien aimé parler du Fantôme de Staline). Mais je dois faire un choix, faute de mieux. Je souhaiterais plutôt mettre l'accent sur un aspect assez mal connu de l'oeuvre de l'écrivain et du philosophe : sa relation aux arts plastiques, qui est assez peu prise en considération. En premier lieu, il faut évoquer le magnifique essai que Sartre a écrit pour préfacer le catalogue de l'exposition d'Alberto Giacometti à la galerie Maeght de mai à juin 1954. Pour cette occasion, il parle non plus des hauteurs de la philosophie, mais à partir de l'expérience qu'il a pu avoir et de la personne de Giacometti et de son atelier. Il se révèle ici un merveilleux observateur de l'univers d'un grand artiste, en qui il a dû voir un homme qui fait écho à ses considérations sur l'existentialisme, mais pas un observant de ses propos sur la question. Ces pages sont d'une grande beauté et ses observations sont absolument révélatrices de sa démarche. Mais il a peu écrit sur des artistes de son temps : Wols, Calder, Rebeyrolle André Masson retiennent tout en même son intérêt. La seule grande entreprise sur un peintre, il ne l'a accompli qu'avec Le Tintoret, sur lequel il va écrire des pages extraordinaires, d'une rare pénétration. Il a publié cinq chapitres copieux et intenses qui se retrouvent dans ce volume, dont seulement deux ont été publiés de son vivant entre 1957 et 1966, le premier s'intitulant Le Séquestré de Venise. C'est dommage que Gallimard n'ait pas édité l'ensemble - c'est pourtant qui lui avait commandité ce travail unique dans sa vie -, même si l'on ignore si Sartre pensait que l'ouvrage était terminé : c'est l'une de ses plus grandes oeuvres. Son style est libre, tendu, toujours tendu et exerçant toujours un incroyable pouvoir de séduction. Il est parti de l'idée que le peintre a été le prisonnier de sa ville natale, dans le sens où il a exprimé sa culture avec passion et parfois dans une relation conflictuelle. Il a fait là le portrait vibrant d'un peintre aux prises avec le monde qui l'entoure, monde qui l'inspire et lui a fourni les instruments techniques et théoriques de son art, mais qui aussi l'a entrainé à travailler dans une optique nouvelle et donc en légère mais réelle discordance avec ses principes esthétiques. L'extrême subtilité et l'extrême intelligence de la peinture, mais aussi de la personnalité du peintre qu'il essaie de camper devant nos yeux, la capacité de s'écarter des sentiers battus de l'histoire de l'art (mais sans néanmoins en contester les fondements), voilà ce qui rendent ces spéculations d'une rare beauté et d'une aussi rare profondeur. Ce tome V mériterait d'être lu rien que pour ces écrits fastueux sur l'art, que peu d'auteurs de son siècle n'ont été en mesure d'écrire.

Cachées par la forêt, Eric Dussert, La Table Ronde, 600 p., 22 euros.
C'est un livre à la fois inattendu et plein d'enseignement. Faire ce dictionnaire des femmes de lettres méconnues depuis le XIXe siècle est une idée excellente et je dois reconnaître humblement que sur le grand nombre d'auteurs examinés par Eric Dussert, que je n'en connaissais que deux, pas une de plus : Renée Vivien et Barbara Pym. Aucun nom en tout cas du siècle de George Sand ! Et cela est d'autant plus déroutant que la littérature est une sphère où la gent féminine a joué un rôle de premier plan et cela depuis la Renaissance. De plus, il faudrait souligner le fait que l'auteur s'est surtout attaché au domaine français avec peu d'auteurs étrangers. Prenons par exemple le domaine italien : connaissons-nous seulement les romans de Grazia Deledda, qui a pourtant été prix Nobel de littérature en 1926 ? Et que dire de toutes les poétesses futuristes ? Et qui connaît l'oeuvre de Marisa Madieri, l'auteur de Verde acqua, ou encore celle de Patrizia Runfola, auteur des inoubliables Leçons de ténèbres ? La question reste maintenant ouverte : Eric Dussert devrait maintenant imaginer une anthologie de toutes ces femmes inconnues pour que nous puissions comprendre ce qu'elles ont pu produire et nous faire ainsi une opinion. En tout cas, ce volume ne peut qu'aiguiser notre curiosité ! C'est surtout la première partie qui est passionnante car on voudrait vraiment savoir si des injustices graves ont été commises. La seule chose qui ne me semble pas pertinente, ce sont les écrivains qui sont nés après la dernière guerre : là, il faudrait tout de même que les choses se décantent. L'histoire fait des tris, parfois indiscriminés, mais qui sont corrigés par la suite. Tout est question de mode et aussi de circonstances : un éditeur peut très bien redécouvrir une femme de lettres et lui redonner sa place, comme cela a été le cas récemment pour Irène Némirovsky, qui a reçu un prix Goncourt à titre posthume. Je conseille en tout cas à tous de mettre le nez dans Cachées par la forêt, qui est en plus d'une lecture captivante.

Leçons américaines, Italo Calvino, traduit de l'italien par Christophe Mileschi, Folio, 224 p., 7, 25 euros.
C'est l'année même de sa mort, survenue en 1985, qu'Italo Calvino met la dernière main à la rédaction définitive des conférences qu'il avait données à l'université d'Harvard. On a tendance à oublier que l'écrivain a été un grand éditeur et qu'il a écrit de nombreuses préfaces, sans parler de sa version du Roland furieux de l'Arioste en italien moderne, qui est une grande réussite. Il n'est pas question ici d'un ouvrage constitué d'essais monographiques, mais plutôt d'une méditation sur l'art de l'écriture, mêlant des réflexions sur des auteurs du passé (d'Homère à Gustave Flaubert, en passant par beaucoup d'autres), mais aussi sur des auteurs qu'il a pu connaître lors de son séjour à Paris à partir de 1967, comme Georges Pérec. Il a choisi de traité des thèmes qui paraissent peu conventionnels, puisqu'il a fait des parties intitulées "Rapidité" ou "Exactitude" : cela lui a permis de confronter des expériences littéraires appartenant aussi bien à l'âge médiéval qu'au pléthorique XIXe siècle. Cette vertigineuse mise en relation d'auteurs de plusieurs époques différentes donne à ces essais une saveur très spéciale, puisqu'il ne cherche plus à faire de l'histoire, mais plutôt à comprendre comment l'on a pu envisager l'objet littéraire dans certaines perspectives. Autre aspect non négligeable de son mode d'exposition : une lecture très fluide et néanmoins dense de sa vision de la création des hommes de lettres à une échelle internationale. Ce recueil est une merveilleuse manière d'entrer dans l'intimité des projets romanesques ou poétiques, qui font valoir sa culture immense, et aussi sa faculté de comprendre l'enjeu réel de ces grandes entreprises dans la culture ancienne, dont certaines ont pu paraître aventureuses ou iconoclastes. Calvino a été un grand penseur de la quête menée par ces écrivains qui ont profondément marqué et leur temps et encore le nôtre. Ce sont des leçons qui doivent être méditées car elles n'ont pas pris une seule ride.

L'Automne de la Renaissance, Carlo Ossola, traduit de l'italien par Gérard Marino, préface de Mario Praz, Les Belles Lettres, « essais », 496 p., 35 euros.
Cette étude savante et passionnante a paru la première fois en Italie en 1971 et la préface du grand érudit Mario Praz, qui a d'abord paru dans le quotidien romain Il Tempo pour en rendre compte à sa façon si étrange et si labyrinthique, a été reprise pour introduire la seconde édition. Carlo Ossola, né à Turin en 1946, a d'abord été un critique littéraire, puis s'est tourné vers la littérature artistique. Il a enseigné à Padoue, à Genève et puis au Collège de France. Il a écrit un livre sur Giuseppe Ungaretti (1975), et un autre intitulé Dal « cortegiano » all' « Uomo del mondo » (1987). Le présent ouvrage est le fuit d'une recherche très importante sur cette période qui suit la Renaissance, et qui a vu apparaître et le maniérisme et le baroque (dont on ignore les contours, le mot lui-même étant à l'origine associé à la culture des perles et signifiant : irrégulière). Pour beaucoup d'entre nous, ce XVIe siècle est d'abord celui de la Contre-Réforme, ce qui n'est pas faux, mais pas suffisant pour comprendre l'évolution des arts plastiques et aussi de la littérature. Il y examine avec le plus grand soin, avec finesse et intelligence, toutes les conceptions avancées par les penseurs de l'art de ce temps, en particulier les spéculations de Varchi (auteur des Due lezioni en 1549, de Gregorio Comancini (vers 1550-1608) dans Il Figino, de Lomazzo dans L'Idea del tempio della pittura, pour ne citer que les plus célèbres. Bien sûr, Giorgio Vasari a été le principal précurseur de tous ces grands théoriciens de l'art. Le Florentin Benedetto Varchi (1502-1565) a d'abord été historien, puis ayant reçu commande de Cosimo I de conférences sur les grands artistes, il a recueilli celles-ci dans les Deux leçons, qui ont suscité bien des réactions, de Vasari à Cellini, de Bronzino à Pontormo, entre autres. Mais Ossola s'intéresse avant tout à ce qui justifie une transformations assez radicale des principes de l'art. Dans un contexte historique des plus complexes, tourmenté, et source de nombreuses inquiétudes, il décrit comment les arts ont pris des voies assez en rupture avec le passé récents et ce n'est pas le réalisme initié par Caravaggio qui en est l'expression la plus flagrante, même si elle est notable. Pour lui, on passe alors de l'inventio à la dispositio. Si bien que les idéaux de la Renaissance laissent la place à d'autres, plus complexes et assez contradictoires, qui veulent que l'art n'est plus l'humble sujet de la Nature, mais celui qui peut la manipuler et la transfigurer à sa guise. Comanini dans son Figino (1591) fait l'apologie d'Arcimboldo parce qu'il est la manifestation la plus pure de l'allégorie et ensuite parce qu'il a su adapter la doctrine de l'harmonie musicale pythagoricienne dans ses « consonances chromatiques « (il a été le seul à louer ce peintre à son époque !). Pendant l'ère maniériste, les grotesques se sont développés d'une façon exponentielle (il suffit de voir les décorations de la Villa Médicis à Rome), ce qui peut sembler une bien étrange manière de traduire l'Ut pictura poesis d'Horace. Mais ce qui surprend le plus à mesure qu'on avance dans la lecture de ce livre, c'est que le grotesque et le bizarre prennent le pas sur l'ordre géométrique et divin du néoplatonisme. L'ingenio (le talent) change peu à peu de signification et devient activité créative et puis artifice considéré comme un bien et non un mal. On honore dès lors le penchant capricioso de l'artiste et, de là, sa bizarrerie foncière, notion qui n'appartiennent pas une seconde à la Renaissance (même s'il a existé des cas plutôt étranges comme Crivelli et Cosme Tura). En somme, Carlo Ossola nous invite à suivre l'évolution des concepts qui finissent par aboutir à un art totalement nouveau et frappé d'étrangeté. On a longtemps mis entre parenthèse cette littérature artistique qui a accompagné ce changement profond de la peinture occidentale. Sans oublier l'acceptation générale de thèses qui peuvent encore paraître de nos jours des plus extravagantes. Et pourtant, il est indispensable de suivre l'érudit dans ce cheminement parfois labyrinthique pour comprendre de manière plus solide les fondement de ces démarches artistique qui ont conduit au « baroque «, ou tout du moins ce que nous recouvrons de ce terme impossible à définir. L'Automne de la Renaissance est certes un ouvrage savant, mais qui est tout à fait lisible, ne demandant au fond qu'un peu de patience car la route stipulée » est assez longue et semée d'embûches. Selon moi opinion, il est incontournable pour connaître l'art du Cinquecento.

L'Unique et sa propriété, Max Stirner, traduit de l'allemand par Henri Lasvignes, « La Petite Vermillion », La Table Ronde, 416 p., 10, 60 euros.
Si l'on ne sait rien d'autre de Max Stiner, pseudonyme de Johann Caspar Schmitt, (1806-1856) on n'ignore pas le seul de ses ouvrage passé à la postérité, qui vient d'être réédité : L'Unique et sa propriété. Il faut reconnaître qu'il y formule en 1844 une thèse des plus singulières pour son temps : le Moi est souverain et tout ce qui peut le contraindre, de la religion à la force étatique, de la société dans son ensemble doit être fermement combattu. Stirner est donc l'ennemi à la foi l'ennemi du libéralisme politique et du libéralisme social : il ne plaide pas en faveur d'un monde meilleur ou d'une utopie, mais est plutôt le paladin des droits propres de l'individu, qui rejette en bloc tous les « sentiments donnés ». Il condamne autant la famille que le droit divin, le patriotisme autant que la mariage. En somme, il veut entendre que la loi impérative de l'Ego qui rien ne peut contrarier. A partir de là, il préconise une Association des égoïstes qui serait la seule à permettre le seul contrat social envisageable. Il en arrive même à jeter par-dessus les moulins la notion d'humanisme, qui ne serait en réalité qu'une métaphore voilée du christianisme. Le monde nouveau qu'envisage le jeune élève de Hegel reposerait exclusivement sur un accord tacite entre tous les individus, accord qui pourrait être révoqué le cas échéant. De toute évidence, l'Unique ne peut s'accommoder des systèmes, quels qu'ils soient, même celui de la perception des choses et celui des notions abstraites. En définitive, il veut abolir tout ce qui n'appartiendrait pas à cette pure subjectivité de l'être, n'acceptant même plus l'idée de l'Homme. La conclusion finale de sa pensée se résume dans cette formule restée célèbre : « Je n'ai basé ma cause sur Rien. » Ce fort volume intéresse son camarade de faculté, Ludwig Feuerbach, et Karl Marx, se sent obligé de prendre la plume pour lui répondre dans un pamphlet virulent intitulé Saint Max, déclarant qu'il ne voit en lui que la « plus pauvre des cervelles philosophiques «. Cependant, Marx ne publie pas son attaque, car il a été tout de même très intéressé par certaines des thèses formulées par Stirner. Engels l'a admiré et les théoriciens de l'anarchisme se sont revendiqués de lui et s'en recommandent encore de nos jours. S'il est plutôt difficile d'adhérer à ses conceptions, trop radicales et assez peu praticables, ces pages peuvent néanmoins servir à une réflexion approfondie de notre relation au monde tangible, intelligible et transcendant.

Papiers, la revue de France Culture, n° 26, 16,90 euros.
Le thème de cette nouvelle livraison de la revue trimestrielle de France Culture dont le maître d'oeuvre est Philippe Thureau-Dangin, est celui des « révolutions de l'intelligence », problème aussi vaste que passionnant car nous sommes confrontés à l'heure qu'il est à des métamorphoses considérables. Ce dossier, surtout fait de dialogues entre grands spécialistes de la question, est passionnant car on y discute des grands questionnements que cela peut poser à l'humanité ici et maintenant, pas dans un futur indéterminé. On y trouve aussi une réflexion tout à fait intéressante d'Irina Raicu à propos de A l'est d'Eden de John Steinbeck (écrivain peu attendu dans ce genre de débat) : Steinbeck s'est interroger sur la créativité individuelle contre la prétendu créativité collective. L'auteur de l'article en tire des conclusion sur un problème lié à ce que Steinbeck pronostiquait : le développement d'une pédagogie devenue une technologie éducative et l'analyse du niveau d'attention des auditeurs. Cela mériterait qu'on s'y arrête car on se rend compte que notre société possède désormais la faculté formidable de prendre en compte nos besoins, nos désirs, en somme ce qui nous constitue même dans la sphère privée, tout cela à notre insu. Dommage qu'on n'ait pas parler dans ces pages d'un autre grand écrivain américain, William S. Burroughs, qui avait imaginé un système de contrôle des consciences dans ses oeuvres de fiction (comme La Machime molle, ou Nova Express, par exemple) et dans d'autres textes qui donnent le frisson tant sa vision était juste au début des années soixante : il imaginait une guerre universelle et permanente entre des forces cherchant à contrôler l'humanité et les garçons sauvages qui se rebellent contre cette volonté hégémonique. Quoi qu'il en soit, la problématique de l'intelligence artificielle et du contrôle des fonctions du cerveau n'est plus du tout de la science-fiction. Parmi les sujets traités dans la revue, on pourra lire avec intérêt l'entretien avec Claude Lanzmann, l'auteur du film et du livre Shoah, qui vient de disparaître, une interrogation à plusieurs voix sur l'héritage discutable de Soljenitsyne, l'auteur de L'Archipel du goulag, l'écrivain russe qui nous a révélé l'horreur des camps de concentration soviétiques, mais qui, un fois libéré, s'est révélé exceptionnellement réactionnaire et propagandiste de la Sainte Russie orthodoxe et xénophobe (pour ne pas dire plus). En tout cas, l'honnête homme de notre ère aura bien autre chose à lire et à découvrir dans cette excellente revue, où seul manque un peu plus d'intérêt pour les arts plastiques.
|
Gérard-Georges Lemaire
13-12-2018 |
|
|
| Verso n°136
L'artiste du mois : Marko Velk
|
visuelimage.com c'est aussi
|
Afin de pouvoir annoncer vos expositions en cours et à venir
dans notre agenda culturel, envoyez nous, votre programme, et tout
autre document contenant des informations sur votre actualité à : info@visuelimage.com
ou par la poste :
visuelimage.com 18, quai du Louvre 75001 Paris France
À bientôt.
La rédaction
Si vous désirez vous désinscrire de cette liste de diffusion, renvoyez simplement ce mail en précisant dans l'objet "désinscription". |
|
