
Istanbul. Souvenirs d'une ville, Orhan Pamuk, traduit du turc par Savas Demirel, Valérie Gay-Askoy et Jean-François Pérouse, Gallimard, 536 p., 35 euro.
Cette chose étrange en moi, Orhan Pamuk, traduit du turc par Valérie Gay-Askoy, 686 p., 25 euro.
Orhan Pamuk, Cahier de L'Herne, sous la direction de Sophie Basch, 296 p., 33 euro.
Orhan Pamuk a reçu le prix Nobel de littérature en 2002, il avait tout juste cinquante ans ! C'est sans doute le plus jeune écrivain à avoir reçu cette distinction depuis sa fondation. Il faut dire qu'il a commencé à publier ses romans en 1982. Il n'a guère écrit qu'une petite vingtaine de livres, entre fictions, essais et pièces de théâtre. Mais chacun de ses livres est une splendeur. Une partie de ceux-ci racontent la vie dans son pays après la guerre, donc à son époque (les autres sont de caractère historique), comme le Musée de l'innocence par exemple. Ce genre d'ouvrages sont souvent à moitié autobiographiques et à moitié « documentaires » : la radiographie d'Istanbul et, par expansion, de la Turquie moderne. Istanbul fait partie de ce groupe-là. A partir du Musée de l'innocence et de ce dernier, il a eu l'idée de faire un musée avec tous les objets familiers ou personnels qu'il a pu récupérer de la période de l'après-guerre (il est né en 1948). Un livre a été ensuite publié (toujours chez Gallimard) sur ce musée maintenant ouvert au public qui est quelque chose d'étonnant et qui fait de Pamuk un artiste de premier autre (ce qu'il n'a visiblement pas recherché dans cette belle aventure). Aujourd'hui paraît une nouvelle version d'Istanbul, qui reprend l'édition française de 2007 pour le texte, mais qui comprend désormais 430 illustrations. Ce sont des photographies de l'ancienne capitale de l'empire ottoman, qui datent des années cinquante et soixante, avant que la ville ne soit complètement occidentalisé : seule les grandes mosquées sur ses sept collines lui donnent aujourd'hui une allure orientale et quelques monuments anciens, comme les palais impériaux et des villas en bois le long du Bosphore. C'est désormais une grande métropole très peuplée et qui a adoptée les modes de constructions de l'Occident. Ce que raconte l'auteur dans ce livre, c'est le monde qu'il a connu dans sa prime jeune, pendant sa scolarité et son adolescence. Il y évoque les affaires de famille, mais plus encore ce qu'il apprend dans les rues, par les informations, par les discussions. Il est par exemple le témoin des émeutes provoquées par les discours nationalistes et racistes d'un chef politique qui appelaient à chasser les Grecs et les Juifs. IL se rappelle avoir vu dans le quartier grec des jouets des enfants abandonnés un peu partout.
Chez lui, beaucoup d'événement personnels ou non sont traduits par des choses (alors chez Mafouz, presque se passe dans les conversations entre les habitants du Caire). Avec tous ces clichés, on a bien l'idée d'une ville déjà grande (il n'y avait qu'un million d'habitants en 1900), mais qui n'avait amorcé qu'en partie sa grande métamorphose. Il y avait encore le vieux pont de Galata et des quartiers vieillots et pittoresques qui avaient été épargnés par les nombreux incendies qui avaient ravagé des quartiers entiers. Ce qui fait la force de ces pages, c'est que l'auteur ne critique pas de manière véhémente, ni récrimine pas, ne semble pas se révolter, mais relate avec un semblant d'objectivité les faits. Pas le moindre pathos, mais beaucoup de nostalgie et de tristesse pour les faits dont il a été témoin ou dont il a eu connaissance. Tout cela narré comme un conte familier, avec mille et une histoires qui s'entrecroisent et le destin du narrateur qui se joue en même temps que l'histoire remodèle sa ville natale. C'est à la fois beau et matière à méditation. Et la présence de ces nombreuses photographies rend son discours beaucoup plus tangible pour le lecteur, surtout s'il ne connaît cette cité surchargée d'histoire ancienne, mais aussi d'une étrange histoire contemporaine, qui est celui de ce pays, tiraillé entre l'Europe et l'Asie depuis la prise de Constantinople.
Le nouveau roman de Pamuk, Cette chose étrange en moi, est l'histoire de Mevlut, qui a commencé par être marchand de yogourt avec son père et puis vendeur de boza. Ce sont les petits métiers de la rue, et ils ont continué à exister jusqu'à la fin du siècle dernier. L'auteur évoque la vie de ce personnage issu d'un petit village assez pauvre. Son histoire est narrée par cercles concentriques, approfondissement chaque fois un événement de sa vie, la relation avec ses parents, l'école et ses camarades de classe, les habitants du cru, l'amour qu'il porte à la fille cadette d'un de ses voisins, Rayhiat, son enlèvement et leur fuite à Istanbul, le service militaire et les exigences de son modeste métier. D'autres personnages interviennent dans ce long récit, le complétant ou en donnant une interprétation un peu différentes. En sorte que la vie de cette homme très modeste devient une sorte d'immense épopée qui. De plus, elle permet de comprendre ce qu'a été la Turquie entre les années 60 et les années 80, avec les changements dans le mode de vie et les coups d'Etats militaires. Et ses déambulations dans les rues nous font découvrir toutes sortes de types humains. Cela devient une sorte d'encyclopédie de la Turquie moderne, avec ses questions religieuses, ethniques, morales, professionnelles, en passant aussi pas celles de l'éducation dans les campagnes, de la misère dans les villages et de l'émigration massive qui commence alors vers les grandes villes. Si Pamuk écrit avec beaucoup de simplicité, cette double structure, avec des ponts temporels entre le passé et le présent de notre héros, qui n'a rien d'héroïque, on est emporté dans une aventure qui ne cesse d'être plus complexe et également mythique. On a le sentiment qu'il a voulu faire, à sa manière, quelque chose qui rappelle Ulysse de Joyce, mais dans une optique très différente. C'est d'une beauté infinie, en dépit du sujet assez peu attrayant, et c'est la découverte d'une société en pleine mutation, qui peut expliquer ce qui se passe en Turquie de nos jours. Il n'était que temps ! Les Cahiers de l'Herne viennent de consacrer un volume sur Pamuk et son oeuvre. D'abord des commentaires qu'il a pu faire sur certaines de ses oeuvres, surtout Neige, le Livre noir, le Château blanc, ou sur l'art du roman (il évoque le roman turc, ce qui est passionnant), sans oublier son discours quand il a reçu le prix Nobel de Littérature. Il y a peu d'entretiens, mais au moins un avec Claudio Magris, qui est passionnant au plus haut point, et aussi des essais écrits par des écrivains notoires, comme John Updike, Pietro Citati, Jan Morris et d'autres moins connus, mais toujours de qualité. Etant donné le nombre considérable d'inédits, on peut être heureux de consulter ce gros volume, car il existe bien peu de choses en France sur cet auteur en France (je le remarque depuis peu, mais l'on voit de moins en moins de monographies et de souvenirs paraître sur des auteurs relativement récents - on ne cesse de remuer le passer, comme, par exemple, les deux biographies qui ont paru sur Louis Aragon presque en même temps. Je note aussi que peu d'écrivains français de renom ont participé à cet hommage vivant (et non académique). C'est regrettable. Pamuk aurait mérité l'hommage de nos hommes de lettres. Bref, rien ne m'ôtera de la tête que ce livre est fondamental pour mieux connaître cet auteur qui est l'un des grands maîtres du roman de notre époque. Dommage qu'il n'y ait pas eu plus sur son Musée de l'Innocence (avec deux ou illustrations du lieu) et sur ses relations singulières avec les couleurs (comme les titres de nombreux de ses livres montrent quelle importance il leur accorde. Mais l'ensemble mérite malgré tout l'éloge et doit entrer dans la fameuse bibliothèque que je m'imagine de l'honnête homme moderne !

Jacques Réattu, arelatensis, un rêve d'artiste, Musée Réattu, Arles / Somogy, Editions d'Art, 384 p., 39 euro.
Jusqu'à ce jour, j'ignorais jusqu'au nom de cet artiste et par conséquent de l'existence de ce musée à Arles. Cette exposition et ce volumineux catalogue me permettent de découvrir cet artiste au parcours assez singulier. Il est né en 1760 à Arles. Il est le fils d'un aristocrate, Guillaume de Barrême de Château fort, qui est peintre. Mais il n'est pas légitime : sa mère est Catherine Raspal, la soeur de l'artiste. Ce dernier donne ses premières leçons au jeune garçon qui peut entrer à L'Académie royale de peinture et de sculpture en 1775. Il est l'élève, entre autres, de Regnault. Il a de l'ambition, des prédispositions et entend se faire connaître en se consacrant à la « peinture d'histoire ». Il participe à partir de 1782 au concours des torses en 1789 (on le voit dans l'ouvrage) au concours pour l'obtention du Grand Prix, qu'il obtient finalement en 1790. Sa pièce de réception s'intitule Daniel faisant arrêter les vieillards accusateurs de la chaste Suzanne, de facture assez néoclassique. Comme le prouvent les dessins contenus dans un de ses carnets des années 1792-1793, il ne cesse d'aller vers cette forme artistique. Il part pour Rome pour y passer quatre années. Mais les événements se déroulant en France l'empêchent de poursuivre son séjour romain. Il y a peint ses premières grandes oeuvres, La vision de Jacob (1791-1792) Prométhée protégé par Minerve et élevé au Ciel par le Génie de la Liberté dérobe le feu. Il a adhéré aux idées révolutionnaires Mais il continue à traiter des sujets mythologiques comme Orphée aux Enfers (1792) ou Achille secouru par Neptune (1793). S'il se passionne pour les ruines antiques, il n'en a pas moins fait de très beaux paysages des environs de Rome. Quand il rentre en France, il s'installe à Marseille en pleine tourmente : c'est la terreur. En 1794, ses voeux sont comblés : il se voit commander Le Triomphe de la Liberté, puis le décor du temple de la Raison dans l'ancienne église de Saint-Cannat. Ce Triomphe l'occupe jusqu'en 1798, achevant une première version en 1794. Il en a fait d'autres, mais ces affaires ne finissent pas trop bien car le vent de l'histoire a changé le régime ! Il a fait du temple en grisaille une grande détrempe sur toile) à Marseille en 1795, en faisant des scène allégoriques dans le genre antique (par exemple La Liberté combattant la tyrannie...). Il a aussi peint un triomphe de la Civilisation en 1796 (il a été par la suite attribué à David !), une Mort de Lucrèce et une Mort d'Alcibiade. E, 1797, il a décidé d'aller à Paris et essaye de retourner à Rome. Toutes ses démarches échouent. Il décide alors de rentrer à Arles. Là, il se consacre à la gestion de ses bien et peint encore, comme cette étrange toile, Salmacis et Hermaphrodite (1818), après une longue interruption. Il se consacre surtout à la décoration des riches villas de la région. Une grande carrière aurait dû s'offrir à lui, mais les événements lui ont été contraires. A la fin de sa vie, il n'a pas fondamentalement changé sa manière. Son Narcisse se mirant dans les eaux de la fontaine Liriope (1826) montre aussi que la qualité de son art est demeurée intacte et qu'il demeure encore dans l'esprit du temps. Sa carrière a été brisée, mais pas ses ambitions picturales, comme on le voit dans son projet de plafond pour le Grand-Théâtre de Marseille, Apollon et les Muses jetant des fleurs sur le Temps (1819) ou l'incroyable Cours du Soleil à travers les saisons (1826). A découvrir sans faute !
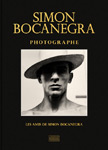
Simon Boccanegra, Jacqueline Germé, Claude-Louis Combet, Hélène Hazéra, « les Amis de Simon Boccanegra », Gurguff Gradenigo, 160 p., 29 euro.
J'ai connu l'oeuvre de Simon Bocanegra grâce à Jacqueline Germé, un écrivain discret, timide même mais de valeur. Les souvenirs qu'elle égrène en deux pages de ce livre magnifique sont un enchantement alors qu'elle raconte en toute simplicité ses relations avec l'artiste et les émotions que son oeuvre étrange a pu lui inspirer. Il faut d'ailleurs souligner que personne ne se paie de mots et que Claude-Louis Combet et Hélène Hazra ont cette même sobriété qui laisse transparaître néanmoins, à travers leurs réminiscences, leurs émotions et leurs sentiments esthétiques. Les photographies choisies pour ce volume, qui rappelle un peu le style de la grande collection de F. M. R., sont aux antipodes de la plupart des grands auteurs contemporains du genre dans ce domaine. Il a fait en effet des portraits de personnages connus (que ce soit Chantale Thomass, César, Azzedine Alaïa, Andrée Putman, Philippe Stark, ou encore Paloma Picasso, mais aussi de personnes inconnues, des prostituées (sujet qu'il a beaucoup aimé) même des clochards, qui sont loin d'être conventionnels. Mais ils n'expriment ni dérision, ni cruauté (comme on le voit trop souvent). Cependant, s'il a recherché l'incongruité, parfois l'insolite et même le bizarre, il n'a jamais visé la laideur ou la déformation de ses modèles. Il a imposé une autre vision des êtres (la même chose pour ses paysages, comme le pont Alexandre III ou Notre-Dame-de-Paris). Cette vision est unique et flirte avec l'humour, l'ironique et parfois le sublime (comme Ounamée sur un divan vert, qui est de toute beauté). Pas une seule de ses prises de vue n'est partie d'un parti-pris, mais elles ont toutes en commun un état d'esprit, une manière de percevoir et de s'approprier le monde. C'est à la fois drôle et émouvant, tapageur, presque iconoclaste, mais tous ces visages expriment leur vérité et leur singularité derrière des poses, des maquillages, une passion effrénée pour la mode frôlant le dandysme, ou, au contraire, une retenue et une timidité. Il n'a pas peur de montrer des visages laids et défaits par le temps, par défi, car personne ne peut se soustraire à son emprise et à sa dévastation. Ce grand artiste a maintenant un livre à sa mesure. Il ne reste plus qu'à espérer une future consistante rétrospective, au Jeu de Paume, pourquoi pas ? Il le mériterait amplement.

Journal de mon jardin, Vita Sackville-West, traduit de l'anglais et préfacé par Patrick Reumaux, « de Natura Rerum » Klincksieck, 388 p., 17,50 euro.
Victoria Mary Sackville-West, Lady Nicolson (1892-1962), épouse de Harold Nicolson, membre du parlement, elle a été connue pour ses recueils de poésie, ses récits de voyages, ses biographies et pour ses romans, dont les Edwardiens (1930 - Au temps du roi Edouard). Elle a connu Virginia Woolf en 1925 (elle lui dédie alors son livre Orlando et la publie dans sa maison d'édition, The Hogarth Press) et aurait eu avec elle une liaison sulfureuse. Elle est considérée comme un membre tardif du groupe du Bloomsbury. Elle s'est mise en tête de transformer de fond en comble les jardins du château de Sissinghurst, de les modeler selon son goût fantasque, mais juste, et d'en faire un chef-d'oeuvre inégalable. Elle a ensuite écrit un livre Charmant et plein de surprises, qui raconte cette aventure d'horticultrice esthète et savante, et qui est plus que cela : c'est un manuel pour initier les amoureux des plantes, une méthode pour parvenir à faire les plus beaux jardins même dans des espaces modestes, de comprendre comment harmoniser ses plantations en fonction des saisons, et aussi un morceau de littérature assez étonnant, illustré par de belles planches peintes par Harry Church. Même pour ceux qui, comme moi, n'ont pas vraiment la main verte, cet ouvrage est une merveille, car l'auteur ne cesse de varier son écriture : elle passe des conseils avisés et assez techniques au descriptions les plus poétiques (au début, elle nous dépeint un jardin blanc - un peu comme celui qui a été réalisé récemment à Kensington Palace à Londres). C'est une petite merveille de littérature, alors que l'objet est somme tout très pragmatique, même si les résultats escomptés sont purement artistiques. Il nous confirme la science qu'elle possédait dans l'art de la prose qui égale sans doute son art sublime de cultiver les fleurs son jardin.

Boussole, Mathias Enard, Babelio, 478 p., 9,80 euro.
Deux mots d'abord sur Matias Enard. J'avais lu son premier livre, la Perfection du tir, qui était l'histoire d'un tireur d'élite, d'un « snipper ». Il s'est mis dans la peau du personnage qui passe des heures à l'affût, caché, immobile, seul, qu'il parvient à nous faire vivre son aventure de l'intérieur. C'était une magnifique évocateur d'une figure qui, quand on pense à ce qui s'est déroulé à Sarajevo, soulève le coeur. Et pourtant, certains de ces hommes ont été des héros et le film Stalingrad, qui se conclue à la fin par un duel mortel entre un Soviétique et un Allemand, tourné en 2001, l'a peut-être inspiré. Cela importe d'ailleurs peu. J'ai beaucoup aimé Remonter l'Orénoque et moins Zone, trop touffu et partant un peu dans tous les sens, qui, rétrospectivement, paraît être le brouillon de Boussole. Au fil des ans s'est affirmé un talent de plus en plus sûr, avec une remarquable densité dans son écriture, si rare de nos jours, surtout en France à quelques rares exceptions près. Ce qui le distingue, c'est qu'il n'a pas souhaité se placer dans la tradition du roman français. Cela se sent dans les présupposés de Boussole : il a choisi un personnage central qui est autrichien (il se nomme Franz Ritter et il habite Vienne). Mais il n'y a pas que ce fait qui pourrait être qu'anecdotique. Ce musicologue passionné aime voyager en Orient et s'est entiché des cultures de pays lointains, comme la Turquie, l'Iran ou la Syrie. Il se remémore ses périples passés et chaque fois s'ouvre une parenthèse dans le récit, qui est plus qu'une parenthèse, mais un chemin de traverse essentiel de son roman. Il n'a pas écrit un roman picaresque, même si il y utilise quelques ressorts (et y place beaucoup d'humour et d'ironie), ni un roman en mosaïque, mais un roman rhizomatique, pour reprendre le terme de Deleuze et de Guattari (qui pourrait très bien s'adapter à son cas, plus en tout cas qu'à Frans Kafka comme ils l'ont fait). Il y a un fil rouge qui est une histoire d'amour intense avec Sarah, qui paraît toujours comme une ombre, mais une ombre qui indexe une réalité sentimentale puissante. Le passé et le présent se confrontent et ce mélangent, je veux dire que le passé est toujours présent, en palimpseste, dans notre civilisation, certes, mais aussi dans nos esprit, et il est placé en regard de la réalité actuelle, mais aussi revisité au sein de cette conscience de l'actualité et aussi de notre temps, qui file et pourtant retient ce qui l'a façonné. Des figures de grands musiciens, d'écrivains, de philosophes, certains très célèbres, d'autres moins - Sigmund Freud voisine avec Claudio Magris, Hector Berlioz et Heinrich Heine -, et tant d'autres qui deviennent des personnages de son histoire. Tout tient dans une nuit d'insomnie (on sent ici l'influence de Laurence Sterne et de son célèbre Tristram Shandy). On y croise Kafka et aussi Balzac et Flaubert. L'auteur ne cesse de repenser les rapports contradictoires que nous avons avec l'Orient. Mais aussi encyclopédique soit-il ce roman n'est pas impénétrable et ne demande pas d'avoir tous les volumes pondéreux du Larousse auprès de soi pour le comprendre. Toute personne cultivée pourrait le lire sans difficulté. C'est pour moi un chef-d'oeuvre et là, comme cela arrive trop rarement, le jury du prix Goncourt ne s'est pas trompé en 2015 (il s'est bien rattrapé depuis !). Boussole est un compagnon de voyage ou un compagnon de chevet. C'est un livre qu'on devra relire, comme on doit forcément relire les Essais de Montaigne ou la Recherche de Proust, car on n'en épuise jamais la totalité. C'est en plus aussi exaltant qu'un roman d'aventure (c'en est un en fait, mais de plusieurs types d'aventures)), même si l'on est à cent lieux de Dumas.

Les Bijoux bleus, Katharina Winkler, traduit de l'allemand par Pierre Stenou, Jacqueline Chambon, 240 p., 21 euro.
Ce roman a de quoi surprendre : l'histoire n'est pas d'une originalité folle, elle est narrée avec des phrases très courtes et sous une forme très elliptique. Mais, à mesure qu'on rentre dans l'histoire intime de cette petite fille vivant dans un village d'Anatolie orientale, puis qui devient une petite femme, qui est mariée très jeune à un homme qu'elle ne connaissait pas, qui a par la suite trois enfants, qui émigre en Autriche où son mari a trouvé du travail, qui est battue de plus en plus par ce dernier qu'à la fin elle finit dans un foyer spécialisé, peut être l'affaire de beaucoup de femmes turques provenant de ces régions reculées où l'armée turque pourchasse les militants du PKK (cela est une toile de fond très estompée). Mais la manière de raconter ce mauvais conte par l'auteur autrichien (c'est d'ailleurs son premier roman) est assez remarquable : Katharina Winkler sert à merveille mêler la réalité et le rêve dans l'esprit de son héroïne. Cette sobriété se change curieusement en quelque chose de fabuleux et la tristesse profonde de son existence se transmue en une magnifique fable qu'elle se murmure en son for intérieur. D'une vérité assez banale (même si l'on doit la regretter), on se retrouve dans un univers imaginaire, pleins de songes et de rêveries éveillées, qui transcende complètement le sujet. Chaque chapitre est ciselé et les paroles si économes de l'écrivain font souvent mouche. C'est un bien superbe commencement pour l'auteur qui a déjà su s'inventer une voix et une écriture, une capacité affermie de rapporter les faits et de les transporter dans une sphère un peu féérique, mais aussi remplie d'une once d'effroi. Filiz, cette petite épousée, ne cesse jamais de vivre sa vie dans un registre qui lui permet d'échapper à la misère, au dépaysement et surtout aux coups de son mari Yunus. Voilà un livre qui mérite d'être lu et l'on suivra les progrès de son auteur, qui n'est pas dépourvu de talent.

Il est avantageux d'avoir où aller, Emmanuel Carrère, Folio, 544 p., 8,20 euro.
Paru chez P.O.L. il y a un an, ce dernier livre d'Emmanuel Carrère a connu un vrai succès. Et je dois reconnaître qu'il le mérite. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas non plus une autobiographie (même si certains passages sont introspectifs), mais une collection d'articles, rédigés comme on ne le fait quasiment plus, des articles longs, détaillés et écrits de manière spirituelle et avec une connaissance profonde des sujets traités. Notre reporter, digne d'être considéré comme un héritier d'Albert Londres, nous entraine dans la Bucarest du couple Ceaucescu, avec la construction de son palais mégalomaniaque, dans la Transylvanie de Vlad Dracul, qui a inspiré le personnage fantastique du Dracula de Bram Stocker, qui a connu un succès immense en 1897. Il nous fait connaître des figures de la Roumanie moderne, tout en revenant sans cesse sur le passé. Puis il passe à d'autres sujets, à d'autres écrivains, des plus extraordinaires, comme Daniel Defoe, Leo Perutz, cet écrivain hors du commun, qui, comme Kafka, a travaillé pour les Assicurazioni Generali (mais lui, à Trieste), à l'incorrigible Mark Twain, du merveilleux Ferenc Karinthy, cet auteur juif de Hongrie à l'humour qui fait mouche et à la faconde irrésistible, jusqu'à des auteurs bon teint, comme Déon et même à l'infréquentable Renaud Camus : les critiques qu'il lui adresse sont tellement enrobées et pleines de digressions aimables qu'on ne pense plus qu'il lui adresse des reproches ! Il est vrai qu'ils ont le même éditeur ! Mais ça, c'est le parisianisme, même si ce Camus là (Camus le très petit) se veut un grand aristocrate de l'extrême droite de province, à la Barbey d'Aurevilly, mais sans le panache, sans la plume acérée et sans le talent fou de l'auteur des Diaboliques, alors qu'il n'est qu'un vulgaire antisémite, tout en n'étant pas Céline (de surcroît son intelligence et son « dandysme » ne pardonnent rien). Dommage, car ces concessions à la mondanité, de-ci de-là rendent le livre moins enthousiasmant. Mais enfin, le lecteur saura bien séparer le bon grain de l'ivraie et trouver les articles intéressants de cette longue pérégrination, si riche.

La Princesse de Bakounine, Lorenzz Foschini, traduit de l'italien par Karine Degliame O'Keefe, 224 p., 20 euro.
C'est à la fois un pan de l'existence du grand révolutionnaire et théoricien de l'anarchisme, Mikhaïl Bakounine, et ses relation privilégiées avant une grande aristocrate russe, Zoé Obolenskaia, qui a quitté son pays pour des raisons très différente, elle ne pouvait plus supporter la vie qu'elle menait dans son milieu. Mais elle était très loin de s'être convertie à la pensée de cet homme qui avait exilé par le tsar en Sibérie et ensuite emprisonné dans les geôles des Habsbourg à Prague. Leur rencontre a eu lieu à Naples. Bakounine avait quitté Sorrente où il avait trouvé refuge, mais où il s'ennuyait profondément. Il a donc décidé de se rendre dans la capitale du Royaume des Deux-Siciles, une ville bien plus cosmopolite. Cette rencontre crée entre eux une grande amitié, mais aussi la conversion de cette femme aux idéaux de l'anarchie telle que l'a défini Bakounine. L'ouvrage se présente comme une reconstitution, au prix de recherches assez difficiles, de la vie de ces deux figures en apparences si opposées (elle, elle appartient désormais à la grande littérature, car sa personnalité unique a inspiré Léon Tolstoï, Henry James et Joseph Conrad). Un étrange amour les a unis solidement. Elle s'est installée avec lui à Ischia, qui a été le théâtre de nombreux épisodes politiques (et autres !) en cette période troublée. Les parcours romanesques de ces deux figures insolites sont comme de puzzles qui finissent, à partir de 1866, n'en font quasiment plus qu'un seul. Tout cela a pour arrière-plan la lutte des Italiens pour leur indépendance, qui était alors loin d'être partie gagnée. Bakounine désespérait de Garibaldi. Il ne croyait plus possible sa victoire et donc l'unité de l'Italie (ce en quoi il se trompait !). C'est tout de même dans ce pays, toujours à Naples, qu'il a pu créer en 1869 la section italienne de la Première Internationale. Il entre en conflit avec Giuseppe Mazzini, qui tentera de lui barrer le chemin et de prendre le contrôle du mouvement révolutionnaire. En fin de compte c'est Bakounine qui l'a emporté après de violentes passes d'armes par voie de presse, déclarations, pamphlets. Il a aussi pas mal de fil à retordre avec Karl Marx (dont il avait commencé la traduction de Das Kapital) et, en 1872 s'est produite l'inévitable scission entre anarchistes et socialistes révolutionnaires d'obédience marxiste après le congrès de La Haye. Bakounine est même exclu de l'Internationale. Retiré en Suisse, vieux, amer et fatigué, il a renoncé à la politique en 1873. Un an plus tard, il a participé à la tentative d'insurrection à Bologne. Quant a Zoé Obolenskaïa, ses enfants lui sont retirés (elle en a cinq) et est répudiée par son mari, gouverneur de Moscou. Elle n'a pas cédé, malgré la douleur d'être séparée de ses enfants et a continué à militer aux côtés du vieil homme qu'elle admirait et aimait tant. Les biographes de Bakounine ne l'avaient pas prise tellement en considération. Grâce à Lorenza Foschini, on découvre cette figure haute en couleur qu'on ne connaît plus qu'à travers les personnages créés par les écrivains de son temps, dont Anna Karénine.

Vie de Napoléon, Stendhal, Petite Bibliothèque Payot, 288 p., 8,20 euro.
Le lecteur, même le plus cultivé, ne lit de Stendhal que ses romans et ses écrits sur l'Italie. Mais l'écrivain était un graphomane infatigable. Il a écrit des textes sur l'art et a commenté un Salon, sans compter une Histoire de la peinture italienne en 1817 (qui est un plagiat en bonne forme !), il a écrit une foule d'articles sur la littérature, un livre intitulé Racine et Shakespeare, et aussi des biographies de musiciens (Haydn, Mozart, Métastase, Rossini), qui ne sont pas excellents du reste, dont des pièces de théâtre jamais jouées à ma connaissance. Et je me garde de tout citer. Cette Vie de Napoléon, rédigée entre 1817 et 1818 à Milan (en guise de réponse aux Considérations sur la Révolution française de Madame de Staël, qui venait juste d'être publiées), n'a pas paru de son vivant. Il faut dire que sa fonction diplomatique sous la Restauration, déjà brisée dans l'oeuf à cause de ses opinions bonapartistes, n'aurait pas amélioré sa situation, déjà précaire (il a été évincé de son poste de consul de Trieste, alors autrichienne par le prince von Metternich lui-même, dont on sait le rôle prévalent lors du Congrès de Vienne en 1815). Cette Vie de Napoléon (que l'auteur, par prudence, déclare être le fruit de la compilation de plus de deux cents contemporains éminents) ne saurait satisfaire en soi l'historien moderne. Mais, cependant, la vision que l'auteur du Rouge et le noir en propose est on ne peut plus passionnante. En effet, il pèse le pour et le contre, souligne les défauts de cet homme qu'il considère un génie militaire et aussi un grand chef d'Etat. Il le compare à Jules César (le parallèle ne vaut d'ailleurs pas seulement pour ses actions guerrières : César lui aussi a tenté de s'emparer du pouvoir politique et d'abolir la République romaine. Les événements rapportés par l'écrivain sont traités un peu à m'emporte-pièce, mais ce qui permet de mieux comprendre le destin de cet homme qui accomplit en deux décennies ce que presque aucun grand dirigeant de l'Europe n'a pu réaliser dans toute son existence. Le style rapide, enlevé et un peu cavalier de Stendhal rend son épopée encore plus trépidante. Ce livre, ignoré jusqu'à une date très récente, mérite qu'on s'y plonge, car l'idée qui ressort de cette biographie est bien celle d'un génie universel, quelque soient ses erreurs et ses défauts. Et je dois reconnaître que cette description peut faire changer idées préconçues, préjugés et images d'Epinal. Stendhal a souvent survolé les sujets qu'il traitait. Mais ici, ce survol est paradoxalement tout l'intérêt de l'oeuvre : avec pas mal d'impartialité, c'est vrai, il a réussi a brosser un portrait tout à fait crédible de ce personnage qui a marqué la France et le monde de son empreinte. Il a rédigé par la suite, entre 186 et 1837, des Mémoires sur Napoléon. Qu'il n'a pu non faire sortir de presse !

La Morale des lignes, Mecislas Golberg, Alia, 176 p., 10 euro.
Ce petit livre est une révélation sans l'ombre d'un doute. C'est tout à la fois une méditation sur l'art graphique et un discours spécifique sur l'art d'André Rouveyre (1879-1962), qui a été le grand ami de Guillaume Apollinaire (et auquel il a consacré un livre de souvenirs mémorable paru en 1953. Fils d'un éditeur de Paris, André Rouveyre est entré à l'Ecole des Beaux-arts de Paris où il a été l'élève de Gustave Moreau. C'est à son cours qu'il a connu Henri Matisse, dont il est devenu l'ami. Il n'a pas terminé ses études et a bientôt commencé à collaborer à de nombreuses revues satiriques comme Le Rire ou Le Pêle-Mêle. Volontiers polémique, il a eu des démêlées avec Paul Claudel en 1914 et ce n'a pas été la seule dispute causée par ses portraits-charges ! Il a été par contre en de très bonnes relations avec Gide, Jean Moréas, Paul Léautaud et Rémy de Gourmont, mais aussi d'artistes, comme Amedeo Modigliani, qui a fait de lui un portrait en 1915.. En 1921, il a publié Souvenirs de mon commerce, où il parle surtout de ses relations avec les écrivains. Mais l'essentiel de son oeuvre réside dans ses recueils de dessins. En 1907, il fait déjà paraître Carcasses divines. Cet ouvrage sera suivi de Comédiennes, Monographie d'une comédienne tragique & comique, Visages des contemporains Portraits dessinés sur le vif (1913) et d'autres volumes qui se situent entre la caricature et le portrait tracé à la hâte. En 1908, le pauvre et talentueux Mecislas Goldberg n'a pas fait une monographie de ses travaux sur papier, ni une pure et simple description de ses oeuvres. Il s'est efforcé de construire une sorte de philosophie de son art à partir de l'idée de la ligne. Rouveyre, avec Warnod, a certainement été l'un des derniers de ces « humoristes » qui avaient prospéré pendant le XIXe siècle. Il voit en lui le représentant insigne d'une forme d'art qui n'avait pas encore ses lettres de noblesses (ce faisant, il se faisait l'héritier de Charles Baudelaire, qui avait consacré Constantin Guys, qui ne peignait pas, le paradigme du « peintre de la vie moderne). Goldberg explique la réalité qu'il met à jour et qui dépasse le réalisme, les extrapolations dont il use pour parvenir à ses fins, le rire inhérent à sa démarche, qui est une de ses armes favorites. Il explique : « L'esthétique, c'est de chercher cette échelle de simplification, de l'imposer aux surfaces et aux faits, de spiritualiser en un mot les instants fugaces de la vie, qui paraissent fugaces et confuses. »Il souligne que chez lui il y a eu la volonté d'aller puiser le spirituel qui se cache derrière les formes et les apparences. Goldberg caractérises ses figures. Par exemple il dit de son portrait de Jules renard : « Celui-ci a vu l'âme chancelante. Il s'accoude et il regarde, la vie passe... » Apollinaire a fait l'éloge de ce livre qui ne peut être comparé à aucun autre car il est littéralement combe de réflexions subtiles sur la définition de l'espace et de la ligne dans le dessin, sur ce qu'ils expriment et suggèrent. C'est un livre unique et merveilleux qui fait redécouvrir la magie sarcastique de la plume d'André Rouveyre. Aldous Huxley avait pourtant loué cet artiste dans son roman Chrome Yellow.
|
