
Dentro Caravaggio, sous la direction de Rossella Vodret, Skira, 484 p., 46 euro.
L'exposition de Michelangelo Merisi, dit le Caravage (ce qui est une erreur, car le peintre est en réalité né à Milan, pas à Caravaggio, où il a passé son enfance -, découverte qui a été faite récemment) est une splendeur. Chaque tableau est présenté seul sur une cimaise, derrière laquelle on peut voir un film montrant soit une restauration récente, soit un repentir de la main du maître. Une présentation très épurée, avec un éclairage particulièrement soignée, un parcours passionnant et, bien sûr, un choix d'oeuvre remarquable. Il est rare que le Palazzo Reale de Milan nous ait montré une exposition aussi belle depuis celle d'Hokusai et celle de Gaetano Previati. Elle permet au visiteur d'avoir une connaissance réelle de l'art de ce géant de l'art auquel on a attribué toutes sortes de légendes : du point de vue de sa biographie, on en a fait un mauvais garçon et un meurtrier, e réalité il s'était battu en duel et avait tué malencontreusement son adversaire ; sans doute a-t-il loin d'avoir été un saint, mais il a été tout sauf un malfrat et un tueur ! Du point de vue artistique, on lui a attribué un style réaliste qui concrétisait une rupture nette et radicale avec la Haute Renaissance et avec ses contemporains maniéristes. Il est indubitable qu'il ait fait entrer une forme de réalisme dans certaines des ses compositions (il n'est que de songer aux pieds de saint Matthieu à Rome); mais il est aussi vrai qu'il a été souvent le continuateur de cette nouvelle tradition apporté par Raphaël, Léonard de Vinci ou Guido Reni. Il y a des aspects idéalistes dans sa façon de représenter les figures et de les mettre en scène. Et il n'a pas hésité à employer les ressources du langage des maniéristes pour sa Fuite en Egypte. Ce qu'il a véritablement introduit, c'est un contraste déroutant entre des formes héritées de ce « classicisme » moderne et une note réaliste violente. J'en prends pour preuve la Judith qui coupe la tête d'Holopherne (1602) qu'on découvre dans les salles de l'ancien palais royal : Judith est traité comme une jeune beauté sorti d'un pur rêve esthétique, la vieille servante qui se trouve dernière elle est traitée dans un esprit plus proche de la réalité et, cela va sans dite, la tête du supplicié au première plan engendre un sentiment d'effroi. La Salomé avec la tête de Jean-Baptiste (entre 1607-1610 ?), agencé différemment, repose sur les mêmes bases contradictoires. Il est vrai que le dépouillement de la plupart de ses grandes toiles se caractérisent par un dépouillement souvent complet de toute architecture ou décor, l'artiste ne s'étant concentré que sur la figure considérée (il n'est que d'observer les différents portait de saint Jean-Baptiste). Plus le temps passait et plus il se débarrassait de tout ce qui pouvait être considéré comme accessoire. Il aimait aussi rendre ses personnage sur fond noir et utilisait souvent des vêtement d'un beau rouge incarnat, pour le Christ, pour la plupart des saints (sauf pour François d'Assise, qui était représenté vêtu de brun) - le rouge possède un pouvoir inégalé d'attraction et même de fascination, autant quand il s'agit du sang que quand il s'agit de la robe de sainte Ursule. Ainsi, cette exposition nous permet, en voyant certains de ses chefs-d'oeuvre, d'apprécier la stratégie de ses grandes machines religieuses, mais aussi de voir comment il appréhendait le portrait (celui du Chevalier de Malte - 1607-1608 - par exemple). Tel qu'en lui-même, le Caravage nous apparaît dans toute sa grandeur, mais également dans sa vérité. Il ne fait aucun doute qu'il a voulu se mesurer à ses grands aînés et qu'il a souhaité les surclasser. De plus il a désiré (et été poussé) à frapper de plein fouet l'imagination de ses contemporains selon les principes édictées par le long et laborieux Concile de Trente (il a duré plus de dix ans !), qui devait apporter une réponse efficace et rapide à la Réforme qui avait pris racine en Europe. Ces impératifs théologiques ont aussi servi à merveille les desseins du Caravage, autant que lui a servi l'Eglise à entreprendre cette reconquête de ses fidèles. Le jeu des contrastes entre l'ombre est la lumière est le plus souvent un jeu pictural entre le noir et certaines couleurs. C'est Rembrandt qui en a fait une tension entre un point de focalisation iconographique et des zones d'obscurité qui le rend encore plus puissant et resplendissant. En somme, au-delà de la découverte pour les uns, de la redécouverte pour les autres, ce catalogue nous montre tous les aspects de sa bella mano, qui finit toujours par prendre le dessus, même dans les scènes les plus brutales, comme la célèbre Flagellation du Christ du musée de Capodimonte à Naples.

Histoire du costume en Occident, François Boucher, Flammarion, 480 p., 45 euro.
Il est nécessaire de le dire d'entrée de jeu : ce livre est indispensable si l'on veut connaître comment l'art vestimentaire s'est développé depuis ses origines les plus lointaines. Mais ce n'est pas comme les histoires de ce genre qu'on a pu connaître : il y a une iconographie très abondante et chaque changement dans la forme et l'esprit du costume est étudié et commenté dans le plus menu détail. C'est une encyclopédie très complète mais ce n'est pas simplement ce qu'on appelle un « usuel ». De la Révolution à l'Empire, pour choisir cette période, on assiste aux métamorphoses nombreuses et quelques fois surprenantes de l'habit des hommes et des robes des femmes, qui ont des relations étroites avec la mode, cela est évident, l'art, le goût, même la politique de la période. Les nombreux tableaux reproduits nous montrent, surtout dans les portraits, les grands modèles qui s'imposent un temps. Le travail de François Boucher et de ses collaborateurs mérite le respect car il nous fournit l'ouvrage dont on ne peut se passer si l'on veut connaître cette histoire, mais aussi imaginé la grande Histoire ou les vie des rues dans les siècles précédents, car l'auteur nous fait commencer son voyage dès la préhistoire pour nous faire aborder presque à l'heure actuelle (la fin du XXe siècle). C'est conçu avec méthode, clarté et s élit avec un grand plaisir. Que rêver de mieux, surtout pour un tel sujet ? La réflexion qui s'impose en le consultant est la suivante : comment serons-nous habillé demain, dans les années qui viennent ? Je crois qu'il y a aura beaucoup à dire sur le passage du XXe au XXIe siècle, sur la sans cesse plus grand écart entre la mode, telle qu'elle est pensée par les créateurs, et ce qui se passe dans la rue. Plus la mode (disons, ce que nous offre la haute couture) devient extravagante (ce qui n'est pas nouveau), en se considérant comme un art à part entière, plus nos contemporains font d'autres choix. Ils achèteront sans doute des habits de soirée ou d égala pour les plus riches, ou des habits griffés, mais jamais il n'y aura une sorte d'unité vestimentaire. Finalement, les jeunes des banlieues sont peut-être plus attachés à une mode uniforme que leurs aînés ! J'ai hâte de voir l'édition revu, corrigée et surtout ajournée qui viendra dans un futur proche ! Mais déjà cette histoire est aussi utile que l'est le grand Littré pour la langue française.

Représenter la vision, Guillaume Cassegrain, Actes Sud, 304 p., 32 euro.
Il a été de bon ton de livrer bataille contre la pensée d'Erwin Panofsky de son vivant, et souvent de bon ton de le critiquer encore de nos jours. Les critiques les plus récentes, comme celles de Daniel Arasse, concernait le niveau de l'iconologie, c'est-à-dire de l'interprétation à tout prix. Mais, au fond, la méthode était bonne. Ce que conteste, implicitement, Guillaume Cassegrain, c'est plutôt la question du regard. Pour lui, le regard n'est pas en soi et pour soi. Il implique bien d'autres éléments. L'ekphrasis (puisque c'est au fond la première étape de l'édifice de Panofsky dans une optique moderne) est indispensable, mais la description de l'oeuvre n'est pas suffisante. Elle implique déjà des interprétations. Quoi qu'il en soit, l'auteur s'est concentré sur un sujet finalement peu traité (alors qu'il l'a été de manière surabondante pour d'autres époques de l'histoire de l'art occidental) : celui des apparitions et des visions miraculeuses. Son idée est bonne et son point de départ est aussi excellent : il part en effet d'une oeuvre d'un auteur inconnu qui a représenté sainte Catherine d'Alexandrie voyant lui apparaître la Vierge et le Christ. Il faut ajouter que cette vision a lieu alors qu'elle prie devant un tableau représentant la Vierge l'Enfant. Peu à peu, avec forces exemples d'oeuvres souvent très connues, il nous suggère que ces événements surnaturels sont recomposés selon des principes qui ne sont pas exclusivement théologiques : souvent dérivés des représentations mythologiques, elles ont de sources anciennes (depuis le Moyen Âge), et ont un langage spécifique qui, contrairement à d'autres thèmes, n'est pas associé directement au monde et au temps où il a été forgé. L'auteur a choisi de traiter le Cinquecento italien et en discerne l'origine à Bologne, à Plaisance, en somme dans la partie centrale et septentrionale de la péninsule. Il ajoute qu'il a été inspiré par la littérature (il donne en exemple une bien singulière histoire d'ange libertin dans le Décameron de Boccace) et que l'humour et l'érotisme ne sont pas absent de ces évocations mystiques. C'est là l'originalité de sa thèse. Il souligne aussi que, pendant la Renaissance, la réception de ce genre de composition a eu autant d'importance que sa mise en scène. Il fournit plusieurs exemples célèbres : dans La Vision d'Ezéchiel de Raphaël, le visionnaire est absent, alors que dans La Vierge de l'Annonciation d'Antonella da Messina, on ne peut « lire » que les sentiments complexes de la jeune femme élue sur son visage. De plus, ces « images saintes » ont souvent pour effet d'elles-mêmes provoquer des situations miraculeuses. On retrouve là la phantasia des Anciens. Au Moyen Âge, on distinguait le songe de la vision, sans doute pour repousser l'importance du rêve chez les païens. Mais la différence n'a jamais été évidente. Ce qui est intéressant dans la période qui l'intéresse, c'est que le dessin, grâce auquel l'oeuvre d'art peut exister, est alors considéré par certains artistes, comme Zuccaro, comme un « signe de Dieu ». La question demeure : que signifie donc raconter la vision ? Je n'ai pas ici l'espace que nécessiterait cette étude passionnante. Je laisse au lecteur le soin d'aller plus avant dans la réflexion de Guillaume Cassegrain qui est vraiment de premier ordre pour l'intelligence de la peinture et des relations très curieuses entre l'art et le catholicisme.

Anne et Patrick Poirier, sous la direction de Laure Martin, Flammarion / Maison Européenne de la Photographie, 264 p., 49 euro.
Après Robert et Sonia Delaunay, Sophie et Jean Arp et d'autres couples célèbres, Anne et Patrick Poirier ont décidé de faire équipe ensemble dans la création artistique. Ce qui les distingue des précédents, c'est que leur oeuvre est entièrement commune. Ils ont puisé leur inspiration dans les ruines. C'est le passé archéologique qui est leur principale source d'inspiration, ce qui a fait naître d'emblée une certaine ambiguïté dans leurs réalisations, même si elles paraissaient s'inscrire dans une optique avant-gardiste. Dès la fin des années soixante, ils se servent de reproductions de fragments de statuaires antiques, comme les Hermès de la Villa Médicis de Rome pour avancer ce qu'ils appelle leur « archéologie parallèle «. L'art médiéval les inspire aussi, comme le prouvent les stèles de la cathédrale Saint-André à Bordeaux. Les sites de fouilles deviennent leur champ d'investigation. Ils peuvent d'ailleurs passer de l'installation la plus ravageuse comme Mémoire avant dispersion (1999) à L'Incendie de la grande Bibliothèque (1978), qui pourrait faire allusion à la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Ils se mettent à fantasmer les ruines, comme Monsu Desiderio ou Hubert Robert. Ils inventent des architectures imaginaires d'un temps lointain, comme l'avait fait le peintre anglais John Martin avec des tours qui ne suggère aucune civilisation particulière et qui deviennent leur propre univers. De plus en plus, deux conceptions se compénètrent : le rêve de l'antique et leurs cités imaginaires. C'est alors qu'il multiplient des signes de reconnaissance, comme la flèche symbolisant la foudre et l'oeil géant de Mimas. Après quoi, ils opèrent un tournant décisif en créant des lieux avec du mobilier improbable dont les tiroirs révèlent des fragments de statues ou des objets et conçoivent des villes qui pourraient ressembler à la maquette de Germania élaborée par Albers ! Ce penchant pour le classicisme perd de son intensité quand ils prennent une autre direction, qui n'est pas opposée, mais un peu différent : l'étude de la mémoire. Cette fois, ils ont recours aux technologies modernes, avec des succès variés. Exotica est une représentation assez kitsch avec ce néon rose qui surplombe toute la ville qui envahie elle-même une île. Ils se lancent dans ce qu'il nomme l'archéologie du futur »avec des constructions de ruines modernes, nos ruines, celles des conflits récents. En fait, ils jouent peut-être trop sur des effets esthétiques clinquants qui sont la conceptualisation d'idées un peu trop sommaires. Ils ne peuvent s'empêcher de faire « beau », mais un beau ancien recouvert une mince couche de modernité. Au cours de leur long parcours, ils ont néanmoins su créer des visions puissantes et des ensembles qui donnent à méditer sur le rapport que nous entretenons avec la culture d'autrefois. Il est indéniable qu'ils ont marqué la fin du siècle dernier et un peu le début du nôtre.

Was bleist, Daniel Spoerri collectif, Mudima, 328 p., 20 euro.
Daniel Spoerri est désormais le derniers des Mohicans du Nouveau Réalisme inventé par le regretté Pierre Restany. Les récentes expositions des Abattoirs à Toulouse, englobant tout le groupe, et de la Fondation Mudima de Milan, présentant des oeuvres récentes de l'artiste, ont permis de faire le point sur son parcours hors du commun et couronné de succès. Quiconque s'intéresse à l'art contemporain a en tête les restes de repas que Spoerri a soigneusement conservé comme ultime expression d'un genre ancien : la nature morte. Il y avait quelque chose de dérisoire, sinon de dadaïste dans sa démarche, mais l'ironie mordante, paradoxalement, rendait implicitement hommage aux grands maîtres hollandais du Siècle d'or, à Chardin, à Cézanne et même aux cubistes. Spoerri, comme la plupart de ses amis, n'a pas été un destructeur, mais plutôt l'inventeur d'une autre façon de concevoir l'art. Il n'a pas eu la volonté iconoclaste de Fluxus, ni même la posture insolente de Joseph Beuys. Ce qu'il voulait présenter au public, aussi aberrant pût-il sembler à l'époque, possédait encore une valeur esthétique. Et cela vaut pour César, pour Hains ou pour Yves Klein. Il y a dépassement par les méthodes et les effets obtenus, mais pas une rupture irrémédiable. Je ne vois pas non plus comme un héros des temps récents, comme l'affirme Bazon Brock dans son essai, qui me semble un peu forcé. Spoerri a d'ailleurs été reconnu très vite et a figuré dans de grandes collections. En outre, il a dû évoluer : il ne pouvait pas faire toute sa vie des déjeuners sur l'herbe ou en appartement ! Ses collages récents sont néanmoins la manifestation d'une cohérence de son propos. Il y a dans ces accumulations de choses diverses et variées un savant mélange d'objets dignes d'être préservées et d'autres bon pour le rebut. Il met en scène ce monde dépeint par Jean Baudrillard, avec ses contradictions : la conservation de ce qui est ancien (un concept assez neuf dans l'histoire de notre civilisation) et l'imaginaire critique des artistes qui font feu de tout bois. Le dépotoir est source d'une esthétique du désastre d'un monde moderne qui ne cesse de produire et de jeter d'une manière compulsionnel. Le Nouveau Réalisme, pour l'essentiel, raconte cette histoire, le progrès technologique étant nécessairement accompagné de cette folie furieuse de se débarrasser de tout ce qui est désormais suranné. C'est presque un mouvement simultané, car tout ce qui est créé est sur le point d'être aussitôt démodé et rejeté ! Mais quoi qu'il pût faire, dans ses « tableaux », comme dans ses « sculptures », Spoerri reste peintre ou sculpteur car il compose toutes ces marques de la décomposition. Il finit par donner un ordre (arbitraire et purement personnel) à ce grand désordre dont nous sommes collectivement les auteurs. Cela est très frappant. La seule chose qui émerge et qui demeure critique est la mise sur le même plan de ce qui a une valeur et ce qui n'en a aucune : c'est là où le bât blesse, même dans l'art contemporain. On a tendance à divulguer des idées confuses sur ce que peut être l'art, ou plutôt de reconnaître pour artistique ce qui ne l'est pas. La sous-culture (bande dessinées et graffitis, le Street Art, pour ne parler que de cela) l'emporte de loin sur la grande culture et s'efforce même de la remplacer. Spoerri l'a vu, très bien vu et l'a représenté avec beaucoup de mordant et d'humour.

Umberto Gervasi, Momenti di verità, Carmelo Strano, Mudima, Milan, 72 p., 10 euro.
Je découvre l'oeuvre d'Umberto Gervasi. Sa sculpture a surtout retenu mon attention car elle a à voir avec les modalités de l'Art brut. Mais il s'agit d'une oeuvre qui a sa logique propre. Ses véhicules me rappellent un peu les chivas de la Colombie, ces autobus multicolores et richement décorés, que les artisans reproduisent en miniature, comme jouets ou souvenirs pour les touristes, et sont un peu le symbole de ce pays. Mais la relation n'existe que dans mon imagination. Ces moyens de transport, surchargés d'individus et d'animaux traités avec bien peu de réalisme, mais beaucoup d'humour, sortent tout droit de son inconscient et ont pris forme et consistance dans le champ de notre vision dans l'argile dont a été façonné Adam ou bien le Golem des légendes pragoises. Tout n'est pas toujours divertissant ici, je songe en particulier à Guardare per non dimenticare (Regarder pour ne pas oublier, 2007), qui montre un homme qui pousse un gros chariot rempli de cadavres. Inclassable, Umberto Gervasi est aussi peintre. Ses toiles sont assez différentes de ses ouvrages en trois dimensions : il s'agit le plus souvent de visages ou de figures, schématisées, mais pas grotesques comme celles présentes dans les sculptures, répétées et présentées de différentes façons, parfois tronquées, avec un jeu de polychromie très intense. Parfois, c'est une foule de personnages qui pullulent dans tout l'espace de la toile. Il faut que j'ajoute un mot sur l'auteur de la préface de ce catalogue, Carmelo Strano, qui est un des derniers représentants de cette catégorie d'individus qu'on a appelé « critiques d'art » : il incarne le meilleur de cette race presque disparue, remplacée par les soi-disant curators ! En somme, il cultive encore une manière de penser l'art avec discernement et intelligence, et aussi de bien l'écrire, se retrouve encore chez lui. Il a un talent inestimable. C'est à souligner. Et l'on a plus que jamais de personnes qui pensent et travaillent comme il le fait.

Raffaele Romano, Il tempo de l lavoro e il lavoro del tempo, Gianluca Ranzi, Mudima, Milan, 72 p., 10 euro.
L'oeuvre de Raffaele Romano surprend beaucoup, car elle est entièrement consacrée à l'art du dessin. Comment définir son art ? Ce n'est pas chose facile : pour donner une idée, il se situerait entre James Ensor et Marc Chagall. Ce n'est là qu'une façon de l'évoquer, mais il est à noter qu'il privilégie le noir sur fond blanc (il a néanmoins fait des huiles sur toiles très colorées) et que, dans ses scènes de groupe, on a la sensation d'un pullulement anarchiste, déconcertant, remplissant l'espace de toutes parts. Enfin, il a une prédilection pour le fantastique, ce que se remarque encore plus dans ses descriptions d'animaux. Son univers est tourmenté, mais il possède une certaine beauté, unique, reposant sur une contradiction recherchée : le trait rapide et acéré, la composition un peu chaotique, la bizarrerie de l'ensemble, les figures flottantes ne jouent pas dans le sens de l'harmonie. Et pourtant, tout paraît avoir été mis en place avec un sens paradoxal de l'équilibre. Cet univers qu'on pourrait qualifier de « baroque » est d'une grande poésie. Ses grands papiers (ils mesurent près de deux mètres) sont assez spectaculaires et puissants car ils procurent le sentiment que le monde visible se révèle sous l'espèce d'un grouillement d'êtres et de bêtes, de scènes bibliques ou simplement champêtres, qui sont emportées par une sorte de tourmente céleste. C'est une tempête incessante, qui pourtant, quand on regard, chaque sujet qui compose le tout, sont plutôt apolliniens. D'où l'étrangeté de son art. C'est un artiste qui ne s'inscrit dans aucun genre présent. C'est un solitaire qui a le courage de développer une oeuvre qui échappe aux modes et aux dénominateurs communs qui sont devenus des lieux communs. On ne peut pas ne pas regarder ses fusains sans en être profondément affecté, dans le meilleur sens du terme. Raffaele Romano est un artiste qui ne fait aucune concession et cultive une idée de la création comme l'expression d'une genèse en perpétuel mouvement.
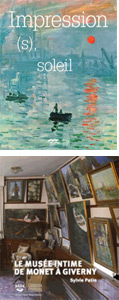
Impression(s) soleil, sous la direction d'Annette Haudiquet, MUMA, Le Havre / Somogy Editions d'Art, 224 p., 29 euro.
Le Musée intime de Monet à Giverny, Sylvie Patin, Editions Claude Monet, Giverny / Gourcuff Gradenigo, 152 p., 25 euro.
Impression, soleil levant, peinture exécutée au Havre en 1872 a été exposée deux ans plus tard lors de la première exposition des Artistes indépendants dans l'atelier de Nadar. Le terme d' « impressionnisme » y est né sous la plume d'un critique et le terme a eu la fortune que l'on sait. Le musée du Havre a donc eu l'idée de construire une exposition originale autour de ce tableau qui est devenu l'un des plus célèbres de Claude Monet. L'idée a été, d'une certaine façon, de comprendre comment la météorologie (qui a commencé à intéressé les savants au XVIIIesiècle et qui a même intéressé Emmanuel Kant , qui a écrit un petit livre à ce sujet) a dicté ses lois à la peinture. On a longtemps traité le ciel d'une manière plutôt conventionnel, même pendant l'ère des Lumières. Bien sûr, des peintres de marines, comme Joseph Vernet et Claude Lorrain dans le cycle des ports de France, sans oublier les peintres hollandais déjà au XVIIe siècle, ont été soucieux de traduite la nature avec réalisme. Mais les géants de cette période, comme Tiepolo, s'inventaient des cieux bien à eux et donc tout à fait imaginaires. Dans l'exposition du Havre, le premier peintre qui est présenté, si l'on s'en tient à l'ordre chronologique, est Joseph-Mallord-William Turner, dont les brumes et les brouillards qui envahissait presque toute la surface de la toile, étaient plus ou moins saturés de la lumière solaire. Il s'est d'ailleurs rendu au Havre en 1832 et en 1834 pour conclure son merveilleux livre Wandering by the Seine, et il a exécuté une gouache aquarellée représentant la tour François Ier en 1834. Turner a complètement modifié les codes de la peinture de paysage et des marines. Sa volonté de représenter les éléments dans ce qu'ils peuvent avoir de plus extrême Les nuées effaçaient parfois complètement le sujet, comme dans la Ville industrielle au coucher du soleil (vers 1830-1832), une aquarelle qui fait écho à ses plus fameuses compositions à l'huile. Deux éléments étaient prévalent : l'eau et le ciel. Les grands voiliers ou les premiers bateaux à vapeur qu'il représentait paraissaient ne plus être alors que des prétextes à ses exubérances célestes et aux reflets qui changeaient les couleurs des eaux océaniques. Personne n'osera le suivre dans cette démarche sauf, beaucoup plus tard, Félix Ziem. Dommage que la directrice du musée André Malraux n'ait pas pris en considération comme grand précurseur John Constable, bien connu en France de son vivant, dont les paysages ont sans nul doute été au fondement de l'école de Barbizon et de l'impressionnisme. Son Etude de la mer avec des nuages de pluie (vers 1824) fournit un exemple de ce qu'il était capable de faire dans le rendu d'un phénomène climatique. Toutes ses compositions d'après nature sont vraiment l'antichambre de la grande révolution qui se prépare dans le domaine pictural. Mais on ne peut pas tout avoir. En revanche, la présence d'Eugène Boudin s'impose, Monet ayant avoué tout le devoir pour ses débuts dans le métier de peintre. Dans ses grandes toiles avec des scènes portuaires au Havre, il s'est montré plutôt sage, il se montre beaucoup plus libre dans des scènes de plage. Monet et Boudin exposent ensemble au Salon de 1868 des vues de la jetée du port. Le long essai et pertinent essai d'Isolde Pludermacher rend justice aux recherches de Boudin, qu'on a longtemps perçu comme un peintre mineur. Une autre idée excellente du commissaire a été de montrer des clichés de Gustave Le Gay, un grand pionnier, qui a fit pas mal de vues de ports dont celui du Havre. Après quoi on découvre avec plaisir les oeuvres de Félix Vallotton et de Raoul Dufy sur ce même thème. Dans cet ouvrage, doté d'études très complètes, on retrouve l'idée qui a présidé à cette manifestation qui sort un peu des thèmes d'exposition classiques.
La demeure de Claude Monet une petite merveille et son jardin, sa propre invention qui lui a servi pour exécuter la suite des Nymphéas. C'est la maison d'un peintre arrivé, devenu plutôt assez riche après avoir connu des périodes terribles de vaches maigres. La collection qu'il y a réunie est d'une incroyable richesse. Sylvie Patin nous la fait découvrir et, je l'avoue, c'est un éblouissement : Edouard Manet, qui l'a été et soutenu pendant sa crise la plus grave, Paul Cézanne, Eugène Boudin, son « maître » ou plus exactement son initiateur à l'art de peindre, Renoir, Caillebotte, Jongkind, Berthe Morisot, Signac, Pissarro, Degas, même une Falaise d'Etretatpar Delacroix. Et ce ne sont pas là des oeuvres mineures ou de petites aquarelles ! Il y a une version des Baigneuses de Cézanne... L'auteur a eu l'excellente idée de rappeler quelles ont été les relations du peintre avec ses confrères qui se trouvent accrochés ses murs. En plus de cela, il y a de nombreuses composition se sa main dans son atelier, dont, par exemple, deux versions de la Femme à l'ombrelle(1886) et une belle Vue de Rouendans la brume hivernale (1892). Dommage tout de même que Sylvie Patin n'aie pas inclus dans ce livre indispensable les xylographies des maîtres japonais de l'ère d'Edo : ce sont aussi des oeuvres de premier ordre. Mais ce catalogue et les commentaires qu'il contient doivent forcément ravir les amateurs car Monet a fait de cette maison de Giverny un endroit d'exception, et aussi un véritable musée de l'impressionnisme d'une richesse notable. De voir ces tableau dans ce contexte est un régal dont on peut jouir aujourd'hui en se rendant sur les lieux et se remémorer en consultant cet ouvrage qui explique beaucoup de choses sur sa recherche picturale, cette fois à travers les tableaux de ses amis de l'Ecole des Batignolles.

En compagnie de Mrs Dalloway, Virginia Woolf, Folio, 96 p., 2 euro.
Virginia Woolf est plus connue pour ses romans et quelques essais que pour le reste de son oeuvre. Ses nouvelles sont souvent de petits bijoux, comme celles que nous propose ce recueil, extraites de Mrs Dalloway's Party. Le premier est sûrement le plus attachant de tous car il évoque une promenade dans Londres qui se termine avec une visite chez un gantier. Woolf a d'ailleurs écrit un petit texte sur Londres qui peut figurer parmi ses grandes oeuvres. Elle sait y tisser des liens entre les choses qu'elles voient et qui l'intéressent et d'autres éléments qui prennent une importance pour elle. Dans son Journal, en 1926, elle a noté : « Un de ces jours j'écrirai quelque chose sur Londres pour dire comment la ville prend le relais de votre vie personnelle et la continue sans le moindre effort.» Elle l'a donc fait avec délectation et l'on retrouve cet esprit « Mrs Dalloway dans Bond Street » où la tradition et la modernité se rencontrent et s'affrontent. La scène où la cliente demande de gants avec des boutons de perle. C'est en plus d'un comique pince-sans-rire car en plus du dialogue embarrassé entre Mrs Dalloway et la vendeuse, des pensées lui traversent l'esprit et l'écrivain les inclus dans le récit. Cette sorte de maillage se retrouve dans les autres histoires, qui sont plus celles de la mondanité, que Woolf tourne finement en dérision, mais aussi utilise pour enchevêtrer des réflexions que ses personnages peuvent faire en leur for intérieur. C'est à la fois délicieux, aigre (mine de rien) et drôle. Woolf est un auteur moderne, sans pourtant donner l'impression comme ses contemporains, Joyce ou Wyndham Lewis, de faire une littérature révolutionnaire, ardue et expérimentale, et pourtant, sa vision de l'écriture était aussi révolutionnaire que la leur, mais sans faire d'éclats et d'effets de manche. Au fond, on peut très bien lire ces nouvelles comme des moments de la vie de la bonne société. En réalité, c'est bien cela, mais avec la dérision en plus et un mode narratif d'un autre calibre.

Aventure dans l'armée rouge, Jaroslave Hasek, traduit du tchèque par Héléna Fanti & Rudolph Bénès, illustration de Joseph Lada, Ivbolya Viràg / la Baconnière, 96 p., 8 euro.
Jaroslav Hasek (1883-1923), le célèbre créateur du brave soldat Chvéik, qui a inspiré à Berthold Brecht une pièce célèbre, a été l'exact contemporain de Franz Kafka. Milan Kundera avance qu'ils se seraient connus et qu'on aurait même demandé à l'auteur du Procès de traduire le grand roman de cet homme qui menait une vie de patachon, dormait souvent dans les auberges et buvait comme un trou. Il avait bien trouvé une place dans une banque, mais il en fut rapidement renvoyé. Après quoi il s'est mis à collaborer à plusieurs périodiques tchèques, devenant même rédacteur en chef de Komuna, organe des anarchistes. Il est allé jusqu'à collaborer à une revue de vulgarisation scientifique, allant jusqu'à inventer les animaux qu'il devait décrire dans le moindre détails. En 1911, il a fondé le Parti du progrès lent dans les termes de la loi et s'est même présenté aux élections. En 1915, il est enrôlé dans le 91ème régiment d'infanterie autrichien et s'est retrouvé sur le front en Galicie à combattre les arnées du tsar. Là, il a été porté disparu et la nouvelle sa mort a été annoncée par trois fois dans les journaux de Prague. En fait, il avait déserté et avait ensuite rejoint les rangs de l'Armée rouge. Dans ce merveilleux petit livre, il raconte comment il a été nommé gouverneur de la ville de Bougoulma , perdue au fin fond de la Sibérie. Les épisodes de son épopée guerrière, des plus mouvementés, sont à mourir de rire. Bien sûr, avec lui, on ne sait trop s'il a donné une suite soviétique aux aventures de son soldat Chvéik ou s'il a vraiment été gouverneur de cette ville ou si tout cela n'est que le fruit de son imagination fertile. Il est ensuite rentré dans la nouvelle Tchécoslovaque et a poursuivi sa vie de bâton de chaise tout en s'étant forgé une réputation de leader bolchevik, sans doute usurpée ! Ces Aventures dans l'Armée rouge sont du même tonneau que ses livres précédent et elles sont irrésistibles de drôlerie et aussi d'une ironie ravageuse. Ce n'est pas pour rien qu'il a incarné l'esprit tchèque, brouillon, rebelle, blagueur et toujours prêt à faire un mauvais coup à ceux qui les dérangent ou qui les oppriment. Ce petit livre est d'une drôlerie à laquelle on ne peut échapper. Espérons qu'Ibolya Viràg continuera à nous faire découvrir la totalité de son oeuvre.

Les Mystères de Saint-Exupéry, Jean-Claude Perrier, « la petite vermillon », La Table Ronde, 240 p., 7,10 euro.
Antoine de Saint-Exupéry donne l'impression d'avoir été une âme noble, d'être un héros au grand coeur et ayant une personnalité que nous avons idéalisée après sa disparition fantomatique (jamais élucidée) lors d'un vol de reconnaissance au-dessus de la Méditerranée en juillet 1944. L'auteur n'a pas voulu faire ici une nouvelle biographie de l'auteur de Vol de nuit, mais plutôt de mettre l'accents sur certains aspects de son existence ou de son esprit. Rien chez lui n'est si lisse qu'il n'y paraît. Au terme d'une longue enquête, il nous fait apparaître un tout autre homme. Comme élève, il ne s'est pas révélé brillantissime, malgré une excellente éducation familiale (il échoue à l'examen d'entrée de l'école navale)). Il avait bien une passion, une fois arrivé à l'âge adulte : l'aviation. Mais pour le reste, c'est la poésie qui l'attire, et l'auteur nous fait découvrir des textes écrits dès 1912, à l'âge de douze ans, largement inspirés par le Parnasse. Son aspect le plus singulier est sans doute ses relations avec les femmes. On peut s'imaginer facilement ce beau jeune homme en séducteur, mais pas en Casanova frénétique ! Il a eu de nombreuses aventures et aussi de grands amours, qu'ils ne parvenaient jamais à terminer. Après une amourette avec une Odette de Sinety, il est tombé amoureux de Louise de Vilmorin, 1922 qu'il surnommait Loulou. Quand il épousa Consuel Suncin Sandoval en 1931, qu'il a rencontrée en Argentine un an plus tôt. Mais n'en continua pas moins à avoir de nombreuses aventures et même à fréquenter des prostituées. Si sa vie littéraire est couronnée de succès, il a un comportement compulsionnel et irrégulier. Il a des problèmes pécuniaires et se met à écrire pour des périodiques. Il a essayé de trouver une issue à travers le cinéma, en proposant l'adaptation des ses livres. Il se mit à écrire des scénarios. Ce fut le plus souvent un échec. Seul Courier sud a été tourné en 1937. Jean Renoir devait tourner Terre des hommes. Mais l'affaire a tourné court. Après quoi, l'auteur s'intéresse au séjour de l'écrivain à New York et à la saga du Petit prince. Les passionnés de Saint-Exupéry trouveront dans ce livre de quoi satisfaire leur curiosité...

A travers le mur, Hannah Arendt / Notre enfant, journal, Marthe Arendt, édition de Karin Biro, traduit de l'allemand par Diane Meur, Payot, 224 p., 20 euro.
Personne ne peut contester le fait qu'Hannah Arendt (1906-1975) est une des grandes figures de la philosophie et de la pensée juive du XXe siècle. Inconfortable dans les deux cas. Son Eichmann à Jérusalem (1963) a contrarié pas mal d'esprits en Israël et dans la communauté juive du monde entier (à tel point que son livre n'a été traduit en hébreu qu'en 1999), tout comme ses Origines du totalitarisme (1951) et sa Crise de la culture (1961) ont mis dans l'embarras pas mal de penseurs européens ou américains. Elle est devenue, avec le recul, une figure incontournable, mais profondément anticonformiste et inclassable. En même temps, elle a pris une dimension légendaire. Ce qui apparaît dans cet ouvrage, c'est la dévotion qu'on lui porte post mortem. La partie la plus importante de l'ouvrage rapporte, en allemand et dans la traduction française, le journal que sa mère, Martha Cohn, a tenu depuis sa naissance, le 13 décembre 1906, jusqu'en 1918. Son état de santé y est détaillé et, plus tard, ses résultats à l'école, sa relation avec ses parents, ses voyages. Ces notes prises avec un soin minutieux par sa mère sont suivies de trois petits contes qu'elle avait écrits dans son enfance, qui sont charmants, mais n'ont rien d'exceptionnels sinon un goût déjà prononcé pour la littérature. La copieuse et riche postface de Karin Biro est très intéressante car elle parle d'abord de ses parents et de leur manière de voir le monde : ce sont des Juifs qui aspirent à l'assimilation et qui ont des idées très avancées, ayant même un intérêt pour la pensée révolutionnaire de Rosa Luxembourg. Martha avait un salon où se retrouvaient des personnes cultivées, aimait la musique et la littérature. Elle suivait aussi avec intérêt tout ce qui concernait la pédagogie nouvelle. On lira ces pages avec attention car de sa prime enfance elle extrapole les traits de caractère qui la caractérisent. Il faut sans doute prendre ces considérations avec prudence, mais elles paraissent cependant esquisser avec justesse les grands traits de ce que Hannah Arendt sera plus tard. Le tout offre ainsi une documentation biographique qui est loin d'être négligeable.

Paris-Austerlitz, Rafael Chibres, traduit de l'espagnol par Denise Laroutis, Rivages, 180 p., 20 euro.
Rafael Chibres (1949-2015) est un écrivain originaire de Valence qui n'aimait pas beaucoup les idées reçues. Il a été assez critique face à tout ce qui s'est passé après la mort de Franco en Espagne. Il a écrit des romans intéressants, comme, par exemple, la Belle écriture ou la Chute de Madrid. Paris-Austerlitz est sa dernière oeuvre littéraire. C'est un livre noir, écrit un peu à la façon d'un roman policier plutôt glauque, mais avec une écriture plus élaborée. Tout se passe comme si l'écrivain avait voulu porter un masque de malfrat pour révéler ce qui lui tenait tant à coeur. La maladie et la mort sont omniprésentes dans ces pages. Le narrateur remonte le cours du temps, se remémore des moments cruciaux de son enfance, par exemple le rapport avec un père qu'il ne reconnaît pas. Il évoque aussi son installation avec tout son matériel de peintre dans un vaste appartement et surtout sa relation avec Michel, un jeune homme athlétique. Tous ces souvenirs se chevauchent et s'entremêlent. Ils constituent une sorte de flux discontinu de la conscience et d'une mémoire oublieuse qui rejette sur la plage de son esprit les épaves de son passé. La fiction devient alors une sorte de défilé d'images du passé et de scènes qui ont marqué ce narrateur qui semble être parvenu au point où les souvenirs arrivent par vagues subites et envahissent la pensée du présent. Ce livre est crépusculaire. Il ne se termine pas comme il a commencé : le style de l'auteur est plus posé, ses réflexions sont plus graves, même s'il a toujours l'envie de parler sur un ton argotique. Le récit tourne de plus en plus autour de la figure aimée de Michel. Et tout se termine dans un hôpital, là où a commencé le récit... Ce n'est certainement pas le meilleur livre de Rafael Chirbes, mais c'est sans doute l'un des plus émouvants, et pas seulement parce que ce fut le dernier.
|
