
Turner, peindre le rien, Lawrence Godwing, traduit de l'anglais par Ginette Morel, Editions Macula, 120 p., 16 euro.
Il s'agit en fait de la présentation de l'exposition que Lawrence Godwing avait faite pour l'exposition qu'il avait organisé en 1966 au MOMA de New York. Il a désiré alors surtout mettre en avant la modernité profonde de Turner, qu'on avait alors plutôt tendance à classer dans la catégorie « romantique ». Sans doute Turner a-t-il été le merveilleux observateur des fleuves de France et des lacs de son pays, mais sa peinture s'est vite révéler un champ d'expérience picturale qui l'a éloigné du réalisme de son temps. Il veut donc nous convaincre que ce n'est pas l'art qui imite la nature dans son cas, mais qu'il se sert de la nature pour inventer l'art, un art jusque là inconnu. Ce brillant disciple de Claude le Lorrain s'est transformé en créateur de scènes presque irréelles en accentuant les caprices de la météorologie (ou les fumées de l'industrie triomphante !). Cet essai doit être donné en exemple pour au moins deux raisons. La première est son écriture très claire, limpide compréhensible donc, rejetant les considérations érudites (et malgré tout essentielles) dans les notes en bas de page. La seconde est une refonte totale de la vision de la peinture de Turner, qui découle toujours des principes édictés par John Ruskin, qui n'aurait jamais pu accepter un Turner presque abstrait comme on le découvre ici ! Il nous montre un homme capable de défier ses contemporains sans qu'il passe pour l'ancêtre des peintres abstraits du siècle dernier. Il a eu d'incroyables intuitions et surtout la conscience que l'exercice de la peinture peut être un art en soi et pour soi avec un support réaliste assez ténu. Il faut donc lire cet ouvrage remarquable pour regarder Turner avec d'autres yeux.

Daniel Templon, une histoire d'art contemporain, Julie Verlaine, Flammarion, 416 p., 35 euro.
La galerie Daniel Templon a fait partie des lieux les plus importants de la création artistique et a connu son apogée pendant les années quatre-vingts. Elle était aussi incontournable de la galerie de française, la galerie Durand-Dessert, la galerie de jean Fournier ou la galerie Yvon Lambert (auxquelles j'ajouterais celles de Lucien Durand et celle de Piltzer). Ce n'était pas les galeries de la capitale, cela va sans dire, mais celles qui ont compté pour l'art le plus avancé de cette époque. Templon n'a pas tablé sur les groupes ou les mouvements. Il a tenté de présenter ce qui lui semblait le plus intéressant en France, en Europe et aux Etats-Unis. Il avait derrière lui l'expérience de la revue Art Presse qui a vu le jour dans la seconde moitié des années soixante-dix. C'était sans doute à l'époque la plus cosmopolite dans le domaine artistique car Opus international était avant l'organe de la figuration narrative, essentiellement hexagonale, même si elle comprenait bon nombre d'artistes étrangers. Les choix de la galerie et ceux de la revue vont converger vers une rupture qui survient assez tôt. Mais les liens noués étroitement au début ne sont pas tout à fait dénoués par la suite, loin s'en faut ! Donad Judd ou Carl Andre sont parmi les artistes minimalistes américains qui exposent au moment où la galerie déménage, quittant la rue Bonaparte pour s'installer rue Beaubourg, derrière de Centre Pompidou. Robert Morris, Richard Serra, Dan Flavin, Sol Lewitt, Frank Stella, Ellsworth Kelly, Kenneth Noland sont parmi les artistes d'outre Atlantique qui y ont trouvé refuge, pouvant ainsi confirmé leur aura internationale. Daniel Templon va aussi présenter les jeunes artistes lancés, entre autres, par son célèbre homologue Léo Castelli, comme Schnabel Robert Longo ou David Salle. Au début, ce fut une révélation. Il a aussi montré des artistes du Pop Art, comme Warhol ou des figures d'exception comme robert Rauschenberg. Mais cela ne l'a pas empêché de présenter des artistes français comme Le Gac ou Matin Barré, Olivier Mosset ou Daniel Buren. En somme, cette galerie est devenue la plaque tournante de l'art en train de se faire entre Paris et new York. Par la suite, Templon va connaître des hauts et des bas, mais sa vertu principale est de n'avoir jamais renoncé. Il a plus récemment recueilli des artistes de valeur, comme Daniel Dezeuze et Gérard Garouste (et il a eu raison e le faire) quand son collègue Durand-Dessert a fermé boutique de manière inattendue. Si l'on peut faire le bilan d'un demi siècle d'activité, la galerie Templon n'a pas démérité et elle demeure aujourd'hui encore un point de référence incontournable. Ce livre, qui n'est pas dépourvu de naïveté parfois, est néanmoins un instrument utile pour connaître cet histoire -, l'histoire d'un homme qui a beaucoup d'ambition, mais pas de prétentions. Il connaît ses limites (ce n'est ni un intellectuel, ni un grand historien d'art, même s'il n'incarne pas l'ignorance) et a su très bien jouer de ses défauts. Mais il a toujours une grande qualité : un véritable gentillesse et une capacité de prendre des risques sans se jeter du haut de l'empire State building ! Tous les amateurs d'art contemporain doivent lire ce livre. Sans faute !

Paris des rîves, Izis, Flammarion, 160 p., 9,90 euro.
Certaines des photographies d'Izis contenu dans ce recueil sont tellement connues qu'on ne sait même plus qui est son auteur. Il faut dire que cette vision de Paris, différente de celle de ses grands contemporains ne peuvent laisser qu'un sentiment profond de mélancolie à quelqu'un comme moi qui a connu enfant la capitale pendant les années 50. Si l'on fait exception des beaux portraits (Roland Petit, Elsa Triolet et Louis Aragon par exemple), c'est un Paris presque surréaliste qui surgit de ce passé qui semble beaucoup plus lointain qu'il ne l'est en réalité. Il y a une foule baroque faite de funambules, de malheureux de ce qui restait de la Zone, de vues du port (car nous avons notre port) de fêtes champêtres dans la banlieue et de foules dans les rues des quartiers populaires, tout cela nous donne une idée presque surréaliste d'une cité disparue ! Ce choix de clichés donne une idée moins pittoresque qu'il ne le semble de la réalité de l'époque. Qui aime Paris ne peut pas ne pas aimer Izis, même si le photographe se laissait aller au sentimentalisme. C'est une oeuvre majeure et presque un travail ethnographique. Les Parisiens, à travers on objectifs, peuvent paraître aussi singuliers que les Dogons ! C'est toutes mes jeunes années que je vois défiler sous mes yeux, à commencer par le manège avec les chevaux de bois ! C'est du grand art et aussi la préscience que tout ce monde là allait vite disparaître. Jacques Tati l'a traduit au cinéma avec Mon oncle. Izis l'a fait sans trop faire l'artiste et c'est profondément émouvant.

Et puis, et puis encore, Bruno Mathon, Impeccables, 80 p., 18 euro.
Nous découvrons un lieu dans une campagne peu fréquentées qui a eu son heure de gloire il y a bien longtemps. C'est désormais une modeste grange. Nous nous retrouvons dans l'atelier d'un peintre. Celui-ci traverse une phase difficile. Il est incapable de cerner la cause du mal qui l'afflige depuis un certain temps. Des images, plus encore des visions qui deviennent presque tangibles, ne cessent de se présenter à ses yeux. Et il ne retient de tout ce univers fantasmagorique venu de l'autre côté du miroir que l'idée de ces « images lambeaux » qui naissent de sa relation étrange avec tout ce qui l'entoure. Ses tableaux sont, telles qu'il les présente, plus des pages de notes que des toiles construites avec le plus grand soin et selon des règles précises. Son inconscient semble lui dicter ces signes noirs qui sont comme des notes sur la surface de l'oeuvre -, signes qui disparaissent ensuite, emportés par le mouvement de la peinture. La peinture que le narrateur est une expérience des limites, une expérience peut-être dramatique sur le plan intérieur, mais riche dans son développement ! Trois années passent : nous sommes désormais en 1978. Cette fois, l'artiste paraît être moins confronté aux démons de la nuit et la couleur fait désormais partie intégrante de son exercice quotidien et en partie apaisé de la peinture. La troisième et dernière partie du livre nous ramène en 1958. quand le narrateur, sa soeur et des amis se retrouvent sur la côte belge, à Knokke-le-Zoute. De ces étranges, des intrigues amoureuses, de ces histoires qui se croisent et finissent par se lier, a-t-il conçu cet étrange et inquiétant rapport au monde dans la solitude ? L'auteur ne dévoile pas le fin mot de l'affaire, mais nous ne l'espérions pas. On sent qu'une trame a été tissée qui a été le point de départ de son histoire intérieure.

Femmes d'homosexuels célèbres, Michel Larivière, La Musardine, 144 p., 18 euro.
C'est une idée excellente. Beaucoup des cas présentés dans l'ouvrage sont connus, mais, en fin de compte, sauf exception, on ignore le destin de ces femmes qui ont donné le change avec leur mari qui n'avaient pas d'attirance pour les femmes. Prenons le cas d'André Gide. Qui alu son journal sait parfaitement qu'il était attiré parles jeunes garçons. Mais que sait-on au juste de sa cousine, Madeleine Rondeaux, qu'il a épousée et dont il s'était épris très jeune ? L'auteur nous relate sn histoire, son drame intérieur et la grande déception quand il a décidé d'avoir un enfant avec la « petite dame », Maria van Rysselberghe, la soeur du peintre Théo. Et que dire de Marie Bonaparte, qui a épousé Georges, le prince héritier de Grèce ? Elle n »ignorait rien des penchants peccamineux de son époux et elle va trouver dans la psychanalyse e un échappatoire (c'est elle d'ailleurs qui amène Freud en France peu avant l'Anschluss) La relation entre Elsa Triolet et louis Aragon est plus complexe. L'écrivain avait été l'amant de Nancy Cunard. Sans doute avait-il eu une aventure avec le poète André Cravan. Ce que dit l'auteur de leur relation n'est sans doute pas faux, mais il lui aurait fallu poussé un peu plus sa réflexion. Il y a aussi le cas de Winnaretta Singer fille de l'inventeur et de l'homme d'affaires américain, et du prince de Polignac, qui en plus de sauver une famille de grande noblesse de la décrépitude, a permis aux conjoint s de chacun vivre leur vie comme ils l'entendaient. Elle, elle s'est dédiée surtout à la musique avec un grand discernement, aidant les grands compositeurs de son temps, Et que dire du mariage de pierre Loti avec Jeanne Amélie Blanche Franc ? Loti était un chasseur de jeunes garçons, mais a écrit une oeuvre on ne peut plus singulière avec le Mariage de loti ou Madame Chrysanthème, autant d'histoires d'amour dont il serait le protagoniste ! Loti est sans doute le plus pittoresque de cette galerie de faux maris ! Je ne doute pas un instant que les amoureux de la littérature et qui aiment connaître les auteurs dans leur vie privée se régaleront en dévorant ce livre !

Tragi-comédie de ma surdité, Charles Maurras, préface de François L'Yvonnet, « Carnets », l'Herne, 96 p., 7,50 euro.
Ces petits textes du fondateur de l'action française constituent une sorte d'autobiographie par fragments. Certains de ces textes ont été écrits en prison car l'auteur de Au café de Flore a été condamné à quelques années de prison, à l'indignité nationale et à perdre son siège à l'Académie française ! Il faut savoir que Maurras n'a pas été un collaborateur, qu'il s'est même souvent exprimé contre l'occupant avec une certaine morgue. En réalité, il n'a eu qu'un tort : dénoncer un Juif. Et ces dénonciations, dont le journal de Brasillach, Je suis partout, se faisait une spécialité conduisaient à la mort des intéressés. Il y avait dans le royalisme de Maurras un mauvais gène et cela l'a perdu. Il n'empêche que les textes réunis dans ce petit volume sont savoureux : sa rencontre avec Laurent Taillade, son admiration pour Jean Moréas, ses promenades parisiennes, ses cafés, débuts en politiques et, bien sûr, son problème d'oreilles et les prescriptions des spécialistes consultés. Maurras avait une très jolie plume, un vrai talent littéraire. Pourquoi s'est-il lancé dans ce que Charles de Gaulle appelait « le monarchisme mélancolique » ? Il semblait la question du coup d'Etat programmé pendant les années 1880 dont le général Boulanger aurait dû prendre la tête. J'avoue après beaucoup gouté ces petits textes où il a fait preuve de beaucoup d'esprit et même d'une certaine auto ironie. Cela dit, la prison et le reste, il ne l'avait pas volé, ce qui est triste car sa conduite avait été quasiment exemplaire.
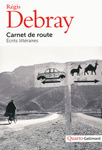
Carnets de route, Régis Debray, « Quarto », Gallimard, 1152 p., 28,50 euro.
Quel étrange personnage que ce Régis Debray ? Au fond, pourquoi le connaissons-nous ? Parce qu'il a été jouer au guérilleros en Bolivie et qu'il s'est retrouvé dans une cellule d'où l'a tiré André Malraux ? Ou est-ce parce qu'on l'a retrouvé dans les couloirs de l'Elysée comme conseiller de François Mitterrand ? Ou est-ce encore pour les quelques livres qu'il a commis, essentiellement chez Gallimard ? Cela dépend de la génération à laquelle on appartient et de l'intérêt suscité parle personnage. Moi, quand il a été rejoindre Che Guevara, je finissais le lycée. Je trouvais alors son aventure asse pitoyable (et, par la suite, j'ai trouvé encore plus pitoyable celle du Che). Conseiller du président de la république ! C'était bien l'histoire d'une classe de jeunes bourgeois qui se sont encanaillés dans les idées révolutionnaires et qui sont rentrés dans les rangs « par la gauche », si je peux me permettre cette expression. Venons-en au livre. Au lieu de faire simplement une anthologie de ses ce qu'il pense être ses meilleurs écrits, comme l'a fait Patrick Modiano, Régis Debray s'est construit un monument - et quel monument ! Il faut d'abord savoir que le volume est bâti comme une biographie, qui est entrecoupée par des écrits de tous genres. Cela commence bien sûr par la rue d'Ulm, pour rappeler qu'on est pas n'importe qui, et qu'ensuite au voyage en Amérique (la Bolivie, cela va sans dire, mais aussi Cuba !). Après quoi, le révolutionnaire le devint moins et se mêla de politique et le voilà dans les bureaux adjacents à celui du chef de l'Etat (il s'en explique d'ailleurs en disant qu'il n'avait pas fait un serment d'allégeance). Et puis le voici rue Sébastien Bottin à faire le grand écrivain. J'avais lu en son temps des choses de lui, qui ne m'avaient pas plu. Seul Contre Venise m'avait intéressé, bien qu'un qu'un obscur personnage du monde littéraire parisien avait déjà concocté un numéro spécial d'une collection (sans doute Autrement, mais je peux me tromper) dans une optique identique : montrer le Venise que les touristes ne connaissent pas. C'est une manière de voir les choses que je qualifierai d'assez ridicule. On ne va pas à Venise voir la zone industrielle de Mestre ! On va voir les palais, les églises, les oeuvres d'art, sinon on irait tous à Vesoul. Personne n'ignore qu'il y a un revers du décor et d'ailleurs certains le connaissent. Je dirais par conséquent que Contre Venise est un livre facile : vous êtes tous des idiots, vous allez visiter la basilique Saint Marc ! Et quand il parle de peinture, pas mal du Tintoret (sans doute parce que Jean-Paul Sacre a « écrit des pages magnifiques sur ce peintre), il veut en parler en des termes «cinématographiques (sic). C'est décourageant. On a l'impression que tous ses textes sont des exercices de narcissisme et d'idiosyncrasie. Et, de plus, qu'il joue à l'écrivain, mais qu'il n'y a pas seul ivre digne d'être cité et donc d'entrer dans une bibliothèque pour un lecteur de l'avenir. Ce qui est surprenant, c'est de voir que dans une collection aussi prestigieuse, où l'on a pu avoir la joie de lire Karen Blixen, Alexandre Dumas, William Faulkner ou Louis-René des Forêts, de voir ce satrape prendre d'assaut le navire de la notoriété. Régis Debray, c'est le Père Ubu de la littérature du VIIe Arrondissement ! Mais c'est surtout un signe assez fort de la soi disant déclin français.

Tout a une fin, Drieu, Gérard Guégan, Gallimard, 142 p., 10 euro.
Guégan a imaginé les derniers mois de la vie de Pïerre Drieu la Rochelle. IL est en fait arrêté par un groupe de résistants, qui font lui faire un procès. Mais le procès en question est en partie le procès que l'écrivain faisait à lui-même ? Il ne cesse depuis des années de parler de suicide et de l'ineptie de l'existence. Ce qui ne l'a pas empêché, en mimant a contrario son vieil ami Louis Aragon, s'engageant à l'extrême droite avec Jacques Doriot et le PPF, prenant fait et cause pour le fascisme sous toutes ses formes (mais la forme allemande lui semblait plus convenable) , s'emparant de la direction de la nrf, quand Gallimard faisait les yeux doux à l'occupant pour avoir du papier, devenant l'un des collaborateurs les plus notoires, ayant déjà publié en 1939 ce qu'il considérait son chef-d'oeuvre, Gilles, qui a été caviardé avec jubilation par Jean Giraudoux qui avait été affecté à la censure ! Il peut enfin rééditer Gilles sans altération aucune en 1942. Mais Drieu -, et Guégan le montre bien dans son étrange petit livre -, est un drôle de personnage, qui abandonne la revue tout d'un coup, sans explication convaincante. Je dois avouer avoir pris beaucoup de plaisir à lire cette fiction, qui n'a qu'un seul défaut : éprouvé le besoin d'aller relire les biographies de l'auteur du Feu follet, au lieu de se laisser porter par l'histoire que Gérard Guégan avait envie de nous raconter - sa vision toute personnelle et même fantasmée de Drieu !

Je viens, Emmanuelle Bayamack-Tam, Folio, 432 p., 7,70 euro.
Ce n'est pas vraiment le genre de roman que j'ai l'habitude de lire et d'aimer. Loin s'en faut. Mais l'auteur a suffisamment d'humour pour que je lui reconnaisse quelque qualité (une en particulier qui n'est pas mince, ce rire pantagruélique et dissonant dans le microcosme des lettres). Bien vade soi, elle est allée chercher sa pâture littéraire dans les moeurs actuelles de quoi discuter et de quoi plaisanter. C'est un peu comme un film français comique. Mais elle sait bien raconter et ça, c'est un don divin ! Elle n'écrit pas mal, ce qui est à souligner. L'histoire de la petite Charonne (six ans, noire et obèse) qui entre dans une famille où il y a déjà eux enfants fait des étincelles ! Charonne prend conscience d e sa différence, de ce qui la met à l'écart (en partie bien sûr) des autres enfants et du monde dominant. Mais elle sait se défendre et elle est réussit à en persuader son entourage. Et son entourage, c'est la classique famille française décomposée-recomposée, qui n'a plus ni queue ni tête. C'est assez drôle et assez bien vu. Donc, chers plagistes, plutôt que de lire Darieussecq ou Christine Angot, lisez cette femme qui a au moins le talent de faire un roman lisible et pas entièrement exténuant.

Regarde les lumières mon amour, Annie Ernaux, Folio, 112 p., 5,90 euro.
Je n'ai jamais lu de livres d'Annie Ernaux, je le reconnais. J'ai donc trouvé l'occasion excellente pour le faire. Mais quelle déception ! Je me suis retrouvé avec une analyse sociologique assez ennuyeuse du phénomène du supermarché avec tout ce que sa pratique peut impliquer. Ce n'est pas Georges Pérec et de loin. C'est un essai écrit comme une petit nouvelle de trois sous. Et quel titre ! La modernité, sous ses aspects les plus tapageurs et souvent les plus négatifs, mérite une exploration un peu plus poussée et surtout moins humorale. C'est une esquisse faire par quelqu'un sait ce qu'écrire veut dire, mais qui ne va pas jusqu'aux points fondamentaux de l'affaire. Dommage. Je ne vais plus m'approcher d'Annie Enaux pendant un certain temps !

L'Huître et la pomme de terre, Julien Blaine, galerie Jean-François Meyer, 32 p., tiré à 99 exemplaires.
Julien Blaine n'est pas un bout en train (ou un boute en train ?). C'est un peu d'Alphonse Allais de l'art e notre temps et nous avons besoin de cet homme précieux qui sait allier le théorique et le bouffon. Il s'amuse avec l'huître de Francis Ponge, qu'il transforme en brique. C'est un brique à braque assez peu respectueux, mais qui est un vrai éloge conceptuel de l'auteur du « Savon ». Sa perle se change en un être monstrueux qui en détruit la belle harmonie et semble une sorte de cancer du saint office de l'art qui a fait de dada une religion à prendre tout à fait au sérieux. Ses briques peuvent se changer en plaquettes de chocolat ou en chaufferettes assez sommaires (mais joliment décorées), ou en quoi que ce soit d'autre. Et l'huître là-dedans ? Elle est restée bien à l'abri dans le recueil de poésie de Gallimard, pas folle la guêpe ! Quant à la pomme de terre, elle lui permet de rejouer la naissance du monde de Gustave Courbet et de sortir une variété nouvelle baptisée Mona Lisa. Non, ce n'est vraiment pas très sérieux tout ça ! Mais l'art doit être pris par-dessous la jambe parfois par craindre qu'il se hausse trop du collet...
|
