
Voir double, pièges et révélations du visible, sous la direction de Michel Wetmans, Dario Gamboni & Jean-Hubert Martin, Hazan, 336 p., 75 euro.
Ce livre est à la fois remarquable pour ce qu'il apporte à la connaissance de l'art, et passionnant au plus haut point pour les différents aspects de la recherche qui y sont avancés. Le seul problème a sans doute été celui du titre. En effet, il ne rend pas compte de l'ensemble des problèmes soulevés. Si j'avais été à la place de Michel Wetmans, j'aurais pris pour exemple Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci (Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci) que Sigmund Freud a fait paraître en 1910. Non pas parce que l'inventeur de la psychanalyse a tenté de déchiffrer le langage de l'art (loin de lui cette idée), mais parce que le célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Vierge, l'Enfant Jésus et sainte Anne, lui permettait d'expliquer un point de sa théorie : l'image cachée dans une autre image. Et puis j'aurais choisi d'évoquer la fiction d'Henry James, l'Image dans le tapis. Cela aurait peut-être éclairé le lecteur de partir d'autres formes d'expression. En effet, l'ouvrage embrasse différents objets comme le paysage anthropomorphique (comme celui de Mattheus Merian, par exemple, parmi tant d'autres : le subterfuge a toujours plu), la représentation par cryptomorphose, comme l'a fait Pieter Bruegel avec obstination. La question de l'image double n'est pas simple, car elle se présente sous plusieurs jours très différents. Dario Gamboni a raison de citer Philostrate le Jeune qui affirmait qu'Apollonios aurait dit qu'il existait deux manières d'imiter la nature : la première par la pensée, la seconde par la peinture. La perception peut faire apparaître des images qui sont des leurres, mais qui n'en existent pas moins. L'ambiguïté peut être au fondement de toute tentative de figurer le semblant. Les savants qui ont fait des investigations dans le champ de l'optique comme les artistes ont vu l'immensité des ambiguïtés qui peuvent jaillir de la saisie des formes (il préfère en fait utiliser le terme de Gestalt). N'importe quelle forme a la faculté d'en suggérer une autre. Wittgenstein disait à juste titre : « nous les interprétons, et nous les voyons de la façon dont nous les interprétons. » Salvador Dalì a parlé d' « images à multiples figurations « et je crois que c'est lui qui a donné la meilleure définition. Cela a donné lieu à des jeux savants et complexes, et à d'autres plus simples comme les images réversibles. Les caricaturistes les ont largement exploitées. Cette problématique s'est d'ailleurs traduite par une hantise de l'image cachée : on est porté à chercher une image cachée dès qu'on regarde une oeuvre d'art. Pour Jean-Hubert Martin, Arcimboldo est l'archétype de l'artiste qui recherche d'une polysémie de l'image poussée à son dernier degré. Ses représentations des éléments et puis des saisons ont donné un visage aux éléments et, somme toute, à toute la nature. Il montre par ailleurs que le corps humain peut être le sujet d'une multiplication des éléments iconiques. En outre, on peut aller puiser dans la nature des représentations architecturales ou humaines inopinées. Enfin, il aborde la question de l'anamorphose, qui n'a cessé de se proposer de nouveau à mesure que les études sur la perspective se sont développées. Comme la question est d'importance, l'idée d'avoir fait suivre les différents essais d'une longue série d'oeuvres commentées fait de ce volume un excellent instrument de travail, car l'exhaustivité aurait été une erreur fatale en ne faisant que rendre l'optique de plus en plus trouble. Ce « catalogue » est une source précieuse d'information, certes, mais aussi une source de méditation à partir d'un exemple concret.
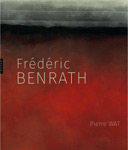
Frédéric Benrath, Pierre Watt, Hazan, 240 p., 69 euro.
J'ai eu l'occasion de rencontré à plusieurs reprises de rencontrer Frédéric Benrath chez le regretté Jean-Noël Vuarnet, qui était mon voisin. Mais je n'ai connu de lui qu'une mince part de son travail et surtout ce boulet théorique qu'il s'était attaché à tort : le nuagisme. Ce livre prend toute la mesure de son oeuvre picturale. Ses débuts au milieu des années cinquante et au milieu des années soixante n'étaient guère prometteurs (mais ce fut aussi le cas pour Simon Hantaï et pour les mêmes raisons : une sorte d'expressionnisme avec formes contorsionnés et pléthoriques). Pierre Wat associe cet art saturée de rhétorique plastique à son séjour en Allemagne et donc à une forme d'expression bien éloignée de celle de l'Ecole de paris et de celle de New York après la guerre. Il est clair que Benrath a voulu, à vingt-cinq ans (cela peut se pardonner) rejeter l'héritage d'une histoire encore trop présente et n'a pas hésité à déclaré que « le salut est dans le VIDE. » Il s'est vue comme un phare éclairant un monde encore à découvrir, quelque chose qui avait trait au romantisme allemand. Son Carnage en rose (1956) a quelque chose de paradoxal : d'une part le choix de la monochromie (même si la couleur retenue est un peu une provocation pour le bon goût des amateurs d'art). Puis il a composé des tableaux qui ne sont pas sans rappeler Hartung (sans l'imiter), mais avec des lignes innombrables qui s'entrecroisent et engendrent la dynamique de la composition. Enfin, il en vient à rendre ces lignes plus fluides, plus épaisses, moins agressives, et en arrive à la constitution de noeuds, comme dans La grande nostalgie (1959). Alors il se cherche dans de grandes toiles, dont certaines sont peu attrayantes. Au début des années soixante-dix, il en est venu à créer des volumes imaginaires, toujours abstraits, mais qui sont de véritables volumes feints. Il fait alors une série d'oeuvres intitulées Déserts et l'une d'elle me retient plus que les autres : elle a été achevée en 1971 et alors que les autres sont une sorte de décantation sémantique, celle-ci se rapproche d'un monochrome noir, mais avec des traces résiduelles de différents bleus. IL a ainsi effacé des années d'errance, en passant même par des « paysages » abstraits comme Melancholia (1962). Des ouvrages comme ceux qui constituent la suite de L'Exploration de l'air (1967) lui ont néanmoins permis de s'éloigner un peu de ces spéculations ne conduisant nulle part. A partir de là a commencé sa véritable renaissance intérieure, qui s'est traduite par des oeuvres plus libres et mieux agencées comme Capitale de la douleur (1969). Bien sûr, on pouvait qualifier ces tableaux de « nuagistes » car ses formes ressemblent à des nuages surplombant de hautes montagnes. Mais je crains ce n'ait été une erreur fatale. Son double abîme (1980) montre qu'il a su tirer de formes vaporeuses et colorées des effets sensibles et forts, qui n'ont rien à voir avec des cumulus ! Son Ultimo Solitudo (1985) est un superbe triptyque qui rejoint les préoccupations des grands artistes de cette période, dans l'optique d'un dépassement des termes consacrés de l'abstraction. Sans doute n'est-il pas allé au bout de son raisonnement, quelque chose a dû le retenir. Mais son travail prend place dans notre histoire récente ne serait-ce qu'avec le cycle de Mes hautes solitudes (2002) avec des confrontations de coloris ou avec celui de ses Saturations (1999), avec la réintroduction de la lumière dans un espace monochrome. Il ya par exemple une grande toile verticale, divisée en deux champs et qui n'a pas eu de titre. Elle a été faite un an avant le décès du peintre, en 2997 : d'un côté une grande plage noir, qui est plutôt un vert saturé et, de l'autre, une sorte de brun qui, curieusement, se rapproche de l'or. Plusieurs compostions de la fin de son existence ont cette qualité et cette force. Cette belle monographie lui rend justice.

Galleria Pieroni, Di Paolo Edizioni, Pescara, 526 p., 50 euro.
La galerie Pieroni, d'abord à Pescara de 1970 à 1978, puis à Rome de 1979 à 1992 a sans aucun doute été un des grands lieux de l'art en Italie à son époque. Aujourd'hui Mario Pieroni a souhaité raconter l'histoire de ce lieu qui est resté dans toutes les m »moires. Mais il ne l'a pas fait en écrivant son autobiographie, ni en demandant à un critique ou à un historien d'art d'en reconstituer les événements majeurs, mais seulement par les faits et les documents. Aucun commentaire n'est apporté à cette grande aventure, et seuls quelques entretiens nous permettent de découvrir l'existence de cet homme qui en a été à l'origine. Les parents de Mario Pieroni étaient dans le commerce de l'antiquité et de l'ameublement. Tout naturellement, il a pris en main l'affaire familiale. Mais cela ne pouvait satisfaire ses aspirations personnelles. Il se mit alors en tête de jeter un pont entre le design et les arts plastiques, ambition pas très facile à réaliser à l'époque où il l'a formulée ! Il a souhaité réaliser des multiples de grandes dimensions, ce qui n'était pas courant à l'époque. L'un des premiers artistes à collaborer avec lui a été Mario Ceroli, qui a réalisé pour lui un salon. Il a aussi édité les merveilleux meubles polychromes de Giacomo Balla, qui n'avaient eu aucun succès quand le génial futuriste les avait proposés. Mario Pieroni a commencé à fréquenter des artistes, à commencer par Ettore Splalletti, Jannis Kounellis, Getulio Aviani. En 1975, il décide d'ouvrir la galerie et puis la rebaptise Bagno Borbonico. Il s'agissait de prisons anciennes, qui avaient depuis longtemps disparu, mais dont le souvenir était resté vif. La première véritable exposition était une collective appelée « Dal mondo delle idée » avec Alviani, Ceroli, Laura Grisi, Enrico Job, Michelangelo Pistoletto, etc. Les années qui ont suivi la galerie est devenu un pôle d'attraction pour des artistes comme Giani Colombo, Kounellis, Alighiero Boetti. La première exposition personnelle a été celle de Luciano Fabro en février 1975, qui y a réalisé une « Installation théâtrale », puis est venue celle de Kounellis en octobre et celle de Spalletti en février 1976. Peu après, au mois de mai de la même année, puis c'est le tour de Mario Merz avec l' « Isola della frutta ». En février 1978, Vettor Pisani dévoile une installation pour le moins iconoclaste, « Joseph Beuys che non sa, et chi non ricorda ripete », où il met en scène à sa façon une fameuse « action » de l'artiste allemand faite à Düsseldorf en 1962, « Comment enseigner la peinture à un lièvre mort ». L'aventure s'est poursuivie à Rome via Panisperna à partir de 1979, avec l'appui de son épouse Dora Stiefmeier. Les artistes qu'il avait présenté à Pescara, puis Gino De Domicis, avec ses remarquables « 11 statue », Gehrard Richter, Gilbert & George, Meret Oppenheim, Fausto Melotti, Sol LeWitt, Giulio Paolini, pour ne citer qu'eux, ont montré l'ouverture de la galerie à d'autres expériences que celle de l'arte povera. Cette histoire, sans récit critique, mais par les images et les documents, c'est une partie consistante de l'art contemporain en Italie. Je pense que cette grande anthologie documentaire est un moyen de comprendre le mouvement des idées artistiques par les faits.

OEuvres, Kenzaburô Ôé, édition établie et présentée par Antonin Bechler, « Quarto », Gallimard, 1344 p., 31 euro.
Quelle distance sépare Kenzaburô Ôé (né en 1935) d'un de ses grands prédécesseurs, Yasunari Kawabata, qui avait reçu le prix Nobel de littérature en 1968 ! On a l'impression qu'ils ne parlent pas du même pays, ni de la même culture. Et même de Yukio Mishima, le disciple du premier, mais seulement dans l'admiration sans borne d'un Japon éternel qui venait d'être humilié par la puissance américaine. Mishima rêvait de reconstruire ce Japon du bushidô et de l'origine divine de l'empereur. S'il fallait le rapprocher d'un autre auteur, ce serait difficile, car il est l'expression d'une génération révoltée par la guerre et par les bombardements atomiques. Il faut d'ailleurs souligner, comme l'a fait Antonin Bechler dans sa préface que l'auteur n'a pas été franchement apprécié à ses débuts et que son oeuvre, dans son ensemble, ne fait pas du tout l'unanimité en dépit de sa grande notoriété. Ses nouvelles des années cinquante (Un curieux travail, le Faste des morts, Gibier d'élevage, Tribu bêlante, etc. ne donne pas une très belle image des Japonais qui soit des plus gratifiantes ! Et puis, son obsession permanente pour la mort, même sous la forme de tuerie quand il s'agit de l'élimination des animaux de laboratoire, ou des êtres qu'on a plongé dans une solution à des fins d'expérience, le sort réservé au parachutiste (un Américain de couleur) dans Gibier d'élevage...Si les conséquences terribles de la dernière guerre sont omniprésentes avec ses célèbres Notes sur Hiroshima (1965) où il a fait parler des survivants, et dans bon nombre de ses écrits. Ses Notes d'Okinawa (1970), non reprises dans ce volume), qui évoquent un épisode particulièrement tragique de la guerre du Pacifique a déclenché des discussions sans fin : elles ont duré plus de trente ans ! Il s'est de surcroît engagé dans une lutte sérieuse contre les accords militaires passés avec les Etats-Unis, et l'engagement, sous une forme déguisée, de son pays dans la guerre de Corée. En sorte que ce pays prétendument démilitarisé ne l'est pas tout à fait. De plus, il n'a jamais hésité à dénoncer les excès et les erreurs de l'occupation américaine. Une de ses pièces a obtenu un succès énorme parce qu'il y dénonce le viol impuni de jeunes filles par des soldats de l'armée des Etats-Unis. Rétrospectivement, il a jugé toutes ces années consacrées au militantisme, à l'exemple de son père spirituel, Jean-Paul Sartre, ont été inutiles. Ce n'est pas sûr. Ce qu'il déclare dans Moi, d'un Japon ambigu, est vraiment la clef du problème. Il y a de toute façon chez lui une fascination profonde pour tout ce qui touche les questions non seulement délicates, mais qui mettent en jeu des sentiments contraires. C'est ce qu'il affait avec son ouvrage de fiction le plus connu, Une affaire personnelle, où il est question d'un enfant handicapé gravement -, ce thème revient d'ailleurs dans une nouvelle. Il a aimé mettre en scène des êtres en proie à des hantises improbables, absurdes et parfois criminelles. Son rêve d'écrire l'histoire du Japon moderne (celui d'après la reddition) ne s'est jamais concrétisé. Ce n'était sans doute pas à lui de le faire. Mais il a bien contribué à soulever le voile et il a obligé ses compatriotes (et le reste du monde par la même occasion) à se poser des questions, même les plus difficiles. Ce recueil a été préfacé de manière admirable par Antonin Becher et nous fournit l'occasion de découvrir les différentes facettes de cet écrivain assez atypique, mais qui nous donne quelques clefs importantes pour comprendre le Japon contemporain.

Oscar Wilde fabuleux, Patrick Chambon, présenté et traduit de l'anglais par Pascal Aquiem, préface de Merlin Holland, Hazan, 128 p., 29 euro.
En France, les relations entre la bande dessinée et la littérature avaient bien commencé en 1988 avec la version illustrée de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline par Jacques Tardi. Liberté créative et respect de l'oeuvre romanesque avait fait bon ménage. Dans le cas présent, il s'agit de broder sur les aphorismes d'Oscar Wilde qui ont contribué à sa légende d'homme d'esprit. C'est ainsi que de planche en planche, on voit notre écrivain, traduit graphiquement par une caricature mettant en avant se penchants homosexuels, avec l'oeillet vert à la boutonnière, qui déambule d'un endroit à un autre tout en distillant des aphorismes. C'est assez ennuyeux et les relations que le dessinateur établit avec d'autres personnages célèbres n'est pas toujours du meilleur goût : ainsi voit-on l'auteur de Salomé en compagnie d'un individu qui ressemble à s'y méprendre à Andy Warhol. Les jeux de mots ne sont pas là pour remonter le niveau de l'affaire. Il faut admettre que je n'aime pas beaucoup de crayon de Patrick Chambon, ni sa manière de traiter le sujet avec une grande désinvolture. Je ne dis pas qu'il aurait dû évoquer Wilde avec le plus grand respect, mais cela ressemble à une caricature assez pitoyable de ce personnage qui avait ses travers, mais aussi un talent d'écrivain extraordinaire, tant pour le théâtre que pour ses romans et ses contes. Sans doute ce livre a-t-il été publié à l'occasion de l'exposition consacrée à Oscar Wilde au Petit Palais. Mais que nous apporte l'auteur de ces dessins en dehors de quelques private jokes qui ne peuvent être compris que de ceux qui aiment et lisent Wilde, c'est-à-dire une infime minorité de personnes. Le format du livre ne joue pas en faveur de Patrick Chambon car il n'y a souvent que deux images par pages. Peut-être a-t-il cru avoir du génie.

Le Pèlerin, Fernando Pessoa, texte établi par ana Maria Freitas & Teresa Rita Lopes, préface de Teresa Rita Lopes, « Minos », Editions de la Différence, 96 p., 6 euro.
Cette édition de ce petit récit incomplet de Fernando Pessoa présente un double intérêt. Le premier est contenu dans la préface érudite et éclairante de Teresa Rita Lopes, qui nous fait découvrir les aspects assez mal connus de nous de la vie spirituelle de Pessoa. Lui qui a eu une éducation catholique, s'est tout à coup détaché de l'Eglise apostolique et romaine pour s'intéresser à des figures comme le très mystérieux Christian Rosenkreutz, dit Christian Rose-Croix (1378-1484), dont l'existence est mise en doute, et qui apparaît pour la première fois dans les Noces chimiques de Christian Rosenkreutz, une oeuvre écrite par Johann Valentin Andreas en 1616. On le considère souvent comme le troisième manifeste rosicrucien.
De tous les érudits et théologiens qui se sont penchés sur la question, seul Rudolph Stein a cru en la vérité de ce personnage qui, dans le livre, vit une existence purement allégorique. Pour ma part, je vois dans ce texte quelque chose qui n'est pas sans rappeler the Pilgrim's Progress de John Bunyan, publié en 1678 et qui raconte l'histoire d'un homme appelé Christian qui part de la Cité de la destruction pour parvenir à la Cité céleste de Sion. Ce livre mystique est devenu un classique de la littérature anglaise et Pessoa possédait parfaitement la langue de Shakespeare. Mais ce débat pourrait se poursuivre à l'infini. Le texte de Fernando Pessoa est simple et linéaire. IL relate les aventures d'un jeune garçon qui menait une vie tranquille et qui a été amené a suivre un chemin, où il croise parfois l'homme en Noir, qui le persuade de poursuivre son entreprise et où il rencontre une jeune femme blonde d'une grande beauté dont il tombe amoureux. Mais de quel amour s'agit-il ? Mondain ou transcendantal ? Sans doute de nature religieuse, mais les lacunes du texte ne permettent pas de porter un jugement définitif. Même le résumé rédigé par l'auteur présente des répétitions et des contradictions. Mais peu importe : Pessoa est un auteur dont on n'a pas fini d'examiner tous les aspects, d'autant plus qu'il a eu ce goût immodéré comme le caméléonisme !

L'aventure, Giorgio Agemben, traduit de l'italien par Joël Gayraud, « Rivages Poche », 90 p., 8,10 euro.
Curieux ce petit essai inédit de Giorgio Agamben !Il s'intéresse surtout à ce démon qui a été le la portée sur laquelle Goethe a mené son existence. Mais il ne s'agit pas du démoniaque chrétien, mais du daïmon des Anciens, qui est pour lui le principe même de l'individualité. La lecture accidentelle de Macrobe (les Saturnales) à la fin de ses jours, l'a amené à penser de nouveau cette question. Dans les Mots imaginaires, il avait fait de ce principe de toute menée humaine en dehors de toute loi morale. Ce serait en effet en dehors de l'éthique que l'être se réalise dans et par la nature. Aux quatre divinités issues de la religion égyptienne, Daïmon, Eros l'amour), Ananké (la nécessité) et Tyché (la fortune) il s'est cru obligé d'ajouter une cinquième, Elpis (l'espérance). Mais Elpis en enfermée dans la sphère du démon. L'homme croit que c'est ce dernier qui l'anime. Ainsi est-il parvenu à une représentation de la destinée humaine qui lui paraissait équilibrée et juste. Pour ce qui est du terme « aventure », Agamben prétend en trouver le sens dans un passage d'un livre de Chrétien de Troyes, Yvain, le chevalier au lion : « je suis [...] un chevalier / en quête de ce qu'il ne peut trouver... » Et il poursuit en associant aventure et Tyché. L'aventure, poursuit)il, n'est pas seulement ce qui advient, mais le récit qui en est fait. La poétesse Marie de France en fait le mot clef de sa poétique. Et elle n'est pas la seule dans la littérature médiévale ! L'aventure serait donc la rencontre de sa propre histoire. Mais c'est autre chose qui intéresse l'auteur. Il constate qu'avec la Renaissance, l'aventure est discréditée. Il note aussi que Dante n'utilise jamais ce mot (à deux exceptions près dans une expression idiomatique -, il s'éloigne délibérément des « belles errances » des chevaliers). Et elle l'est encore plus par Hegel. Il faut attendre Georg Simmel pour comprendre que l'aventure est liée à la centralité de l'existence et, par extension, à l'amour, de manière indissoluble. Il se réfère enfin à la philosophie de l'aventure, proposée par Oskar Becker, un disciple de Heidegger. De fil en aiguille, Agamben en arrive à Gilles Deleuze, qui parle du « pur exprimé qui nous fait signe et nous attend ». Je laisse au lecteur le soin d'apprécier la conclusion. Mais je ne peux que reconnaître l'incroyable habilité technique (au-delà des connaissances) et la capacité de mettre en relation des cultures lointaines de Giorgio Agemben. Cette étude ne peut laisser indifférent.
|
