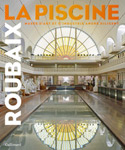
La Piscine, musée d'Art et d'Industrie André Diligent, Roubaix, Gallimard, 384p., 29 euro.
Cette année, La Piscine fête son vingtième anniversaire. Au cours de ces deux décennies, ce musée a réussi à se faire un nom et une belle réputation parmi les musées de province. Il est vrai que son directeur, Bruno Gaudichon, a su réaliser des expositions de qualité et plutôt prestigieuses, de Chagall au Bloomsbury en passant par Pablo Picasso, sans oublier les nombreuses expositions d'arts appliqués élaborées par Sylvette Botella-Gaudichon, et aussi les expositions d'artistes contemporains. Ce qui est remarquable par la politique suivie par les responsables de ce lieu est d'un côté préparer des événement d'une grande qualité sans pour autant négliger les collections et la spécificité du passé de la ville de Roubaix, qui a été une cité industrielle importante, en particulier pour le textile (une section de ce catalogue est d'ailleurs dédiée à cet aspect des choses). Et tout cela sans avoir les crédits que peut avoir un musée national comme le Centre Georges Pompidou.
Après la conclusion de la Grande Guerre, le maire socialiste, Jean Lebas, entreprend des projets ambitieux pour cette ville industrieuse qui comptait alors 125.000 habitants. La construction d'un grand établissement de bain conçu d'abord dans une optique hygiéniste. Cet ambitieux ensemble, qui remplit aussi un rôle sportif, est achevé en 1932. Il a été conçu dans l'esprit Art Déco, mais dans un style très épuré. Mais son entrée a été élaborée comme le narthex d'une église du haut Moyen Age, renforçant encore la singularité de son aspect architectural. Aujourd'hui, le grand bassin est entouré de nombreuses sculptures et les cabines de bains servent désormais de lieu d'exposition pour des oeuvres de petite taille.
Les origines du musée remontent à 1835. Il s'agissait alors de célébrer le nouveau patrimoine industriel. En 1862, le premier conservateur, Théodore Leridan le fait installer au second étage d'une ancienne filature où se trouvait déjà une bibliothèque. On y ajoute alors des objets et des tableaux provenant des églises de la région. C'est le coeur initial d'une collection augmentée par des achats et de nombreuses donations. On songe alors à l'installer sur la Grand Place de la ville, mais l'idée est abandonnée au profit d'une école professionnelle. Ce nouvel édifice est orné de groupes sculptés en marbre. En fin de compte, le musée est installé dans la partie postérieure de l'école et compte trois étages, le second étant réservé à la peinture. Le directeur, au début du XXe siècle, Victor Champier, obtient des attributions de l'Etat et fait de remarquables acquisitions, sans parler des legs importants qui enrichissent considérablement cette institution. A la suite de la dernière guerre, les édiles se désintéressent complètement de ce musée qui est presque laissé à l'abandon. Par bonheur, des dons de grands collectionneurs sont installés au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, sans cesse enrichit par de nouvelles donations. Mais ce n'est qu'à partir des années 1970 qu'on commence à penser à la réhabilitation du premier musée. C'est Didier Schulmann qui imagine de créer un nouveau lieu, le musée d'Art et d'Industrie. Et c'est André Diligent qui en assure la direction. Au début, il ne pouvait organiser que des événements temporaires, n'ayant pas encore un bâtiment pour y disposer les collections. Le nouveau musée est finalement inauguré en 2001 après avoir transité dans les locaux de l'ancien. Après bien des discussions, c'est la piscine, elle-même tombée en désuétude, qui est choisie pour la création d'un site digne de rassembler toutes les collections artistiques de la ville. Depuis lors, ce musée si particulier dans sa conception, n'a pas cessé de développé ses activité et de devenir le centre névralgique de la création à Roubaix.
Ce qui frappe dans les oeuvres réunies dans l'ancienne piscine, c'est que le patrimoine local y tient une place importante, presque autant que les compositions d'artistes connus en France. D'Auguste Rodin à Carolus-Duran, en passant par Jean-Joseph Weerts ou Jean-Léon Gérôme, c'est l'esprit de la seconde moitié du XIXe siècle qui prédomine. L'art moderne y a néanmoins sa place avec Emile Bernard, Edouard Vuillard, Camille Claudel, Pierre Bonnard, Alfred Marquet, Léonard Foujita, Tamara de Lempicka et un grand nombre d'artistes moins connus souvent originaires du Nord. A ce propos, on a consacré un espace notable au groupe de Roubaix, apparu après la dernière guerre dont le membre le plus connu est Alfred Manessier. Quant à la section contemporaine, elle est encore en pointillés. En revanche, tout ce qui concerne les arts appliqués est très riche , des créations d'Emile Gallé à celles de Carlo Bugatti ou de Roger Fry. Et tout ce qui concerne le textile, le vêtement, la mode en général, fait l'objet d'un soin tout à fait judicieux. Enfin, tout ce qui a trait au passé de Roubaix est très bien documenté et poursuit l'héritage du premier musée.

Signac collectionneur, sous la direction de Marina Ferretti Bocquillon & Charles Hellmin, musée d'Orsay / Editions Gallimard, 272p., 42 euro.
De la période impressionniste, restent en mémoire les collections de Claude Monet, de Frédéric Bazille et de Gustave Caillebotte. Ces peintres ont surtout acheté des ouvrages réalisés par leurs pairs moins fortunés. Celle de Paul Signac (1863-1935) n'était connue jusque-là que de rares conservateurs et une poignée d'amateurs. Fils d'un riche négociant de sellerie de la rue Vivienne, le jeune Paul appartenait à une famille protestante du Béarn. Il a pu commencer à constituer sa collection très tôt. On y trouve des oeuvres de grands artistes du XIXe siècle, depuis la période romantique, aussi de ses contemporains et puis des fauves.
Même s'il a pu se montrer sans trop de préjugés en des circonstances officielles, comme le Salon des Indépendants dont il est le président en 1911, à l'égard des cubistes et de toutes les avant-gardes du début du XXe siècle ; mais aucun des artistes représentant les courants les plus novateurs n'a trouvé place sur ses murs. Il abandonne ses études et il se lance dans l'aventure picturale. Il admire en premier lieu Alfred Sisley et puis Camille Pissarro, dont il devint un familier. Puis il découvre Vincent Van Gogh, qu'il admire au plus haut point. Il est aussi conquis par les recherches de Paul Cézanne dès qu'il en prend connaissance. A partir de 1897, il passe une partie de l'année à Saint-Tropez, dans sa résidence de La Ramade, où il reçoit grand nombre de créateurs comme Théo van Rysselberghe, Maximilien Luce, Ker-Xavier Roussel, Pierre Bonnard, Albert Marquet, Charles Camoins, Henri Manguin, Dunoyer de Segonzac, et Henri Matisse vient lui rendre visite en 1904 (c'est là que ce dernier imagine Luxe, calme et volupté). Depuis la disparition de son père et des complications familiales (marié depuis trente ans, il a une liaison avec Jeanne Selmersheine a eu une fille d'elle, Ginette), Signac a beaucoup de liquidités et doit renoncer à l'acquisition de toiles qui lui aurait plu comme deux belles pièces qu'il convoitait lors de la vente de l'atelier de Manet.
Mais il ne met pas un frein définitif à sa passion. Son idée est aussi de la léguer à sa fille, qu'il n'a pu reconnaître à sa naissance. Le maître le plus ancien figurant parmi ses choix esthétique, il n'y a qu'un dessin d'Eugène Delacroix, Mazeppa. Après lui, ce sont les impressionnistes ou leurs immédiats précurseurs, qui sont privilégies : Il y a un tableau de J. B. Jongkind, Notre-Dame (1864) et quelques-uns de ses dessins, une toile d'Eugène Boudin, plusieurs oeuvres de Camille Pissarro, un dessin en noir et blanc d'Edouard Manet, La Belle Polonaise (circa 1878), un certain nombre de Degas (avec qui il a eu des relations difficiles), des Cézanne, dont Les superbes Trois pommes (1878-1879), un superbe papier d'Odilon Redon (Le Centaure tirant à l'arc). Et puis il y a la remarquable huile de Monet, Les Pommiers en fleur au bord de l'eau (1880), Le Quai de la Rapée d'Armand Guillemin, de modestes Renoir et Deux harengs (1889) de Van Gogh, ainsi qu'une toile et des dessins de Charles Angrand, L'Air du soir d'Henri-Edmond Cross avec plusieurs compositions intéressantes, le Portrait de Paul Signac peint par Maximilien Luce en 1889, et plusieurs autres de ses créations.
On ne peut qu'être frappé par l'oeil et le discernement de Signac qui, sans pouvoir posséder des chefs-d'oeuvre, a possédé néanmoins des ouvrages dignes d'intérêt quelque soit l'artiste considéré. Bien sûr, son ami et complice Georges Seurat a une place de choix parmi ce florilège d'auteurs de grande qualité. On découvre sur les cimaises du musée d'Orsay de nombreuses oeuvres de son ami et complice Georges Seurat : différentes versions préliminaires d'Un Dimanche après-midi sur l'Ile de la Grande Jatte et une toile non indifférente, La Seine à Courbevoie (1885), une esquisse du Chahut (1889) et cette merveille qu'est Le Cirque (1891). Et restent encore de nombreux dessins, dont le très noire Dame voilée, mère de l'artiste (1882), L'Echafaudage (1886-1887), Le Glaneur (circa 1883), la mélancolique Banquiste (1883-1884), deux études pour Une baignade à Asnières (1883), des études pour La Parade (1887-1888), le Portrait de Paul Signac crayonné (1890) et d'autres trésors encore qui constituent une sorte de compendium de l'art de Seurat. Il a possédé aussi une gravure et un tableau de Walter Sickert, une toile de Théo van Rysselberghe - En mer, portrait de Paul Signac (1896). Dans cette collection impressionnante on croise aussi des peintres moins connus, mais aussi des gravures de Félix Vallotton, des compositions de Pierre Bonnard, de Ker-Xavier Roussel, d'Edouard Vuillard (Nu au tabouret dans l'atelier peint aux alentours de 1900), plusieurs travaux de Louis Valtat dont deux scènes au bord de la mer et enfin une petite étude de Henri Matisse, Le Goûter (1904) ainsi que Luxe, calme et volupté (1904-1905).
Suivent encore Maurice Denis, Albert Marquet, Jean Puy, Van Dongen, Camoin, et quelques autres. Et on ne saurait oublier ses xylographies japonaises d'Utagawa Kunisada (ce sont de véritables bijoux). Il est parvenu à constituer un petit musée très incisif sur son époque, et un peu de celle qui l'a précédée. Ce catalogue nous permet de connaître en détail les choix de Paul Signac, mais aussi sa vision particulièrement aiguisée de l'histoire de l'art en train de se faire dont il a été l'un des grands artisans. Signac n'a pas été seulement le théoricien du postimpressionnisme : il a été l'un des meilleurs observateurs de ce qui se fomentait en vue d'une révolution esthétique au fil de sa carrière.

Wahnsinnig Komisch, Follement drôle, sous la direction de Anne-Marie Dubois & de Thomas Röske, bilingue, Editions in fine / MahhsA, 232p., 32 euro.
Ce fort volume est le catalogue d'une exposition présentée au musée d'Art et d'Histoire de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Elle a pu être réalisée grâce à la très riche collection de cette célèbre institution française (MAHHSA) et la collection Prinzhorn de l'hôpital universitaire de Heidelberg. Cette dernière a été initiée entre 1919 et 1921 par le psychiatre Hans Prinzhorn, qui a été non seulement psychiatre, mais aussi phénoménologue et historien. Il s'est intéressé de près aux dessins exécutés par les patients de cet hôpital et a réuni quelques cinq mille pièces. Il a ensuite publié un ouvrage qui a suscité une grande curiosité de la part des spécialistes, mais aussi du public allemand.
Il a circulé dans toute l'Europe et de grands artistes comme Alfred Kubin, Paul Klee et Max Ernst se sont passionnés pour la question. Un musée a été créé en 2001 pour rendre accessible au public ces oeuvres qui révèlent des imaginaires tourmentés mais souvent d'une incroyable richesse artistique. L'hôpital Sainte-Anne a montré pour la première fois ce qu'il avait jalousement conservées en 1950 lors de l'« Exposition internationale d'art psychopathologique » présentée dans ses murs. Deux ans plus tard, le projet d'un musée voit le jour à Sainte-Anne. Un thème a été retenu pour cette nouvelle manifestation : l'humour. Les commissaires ont ensuite classé le sujet selon sept catégories. La première est celle dite des caricaturistes. La fantaisie débridée des internés dans ce champ d'élection commence par des gouaches et fusains de Caroline Macdonald, qui a fait des portraits en 1969 d'un caractère expressionniste. Alexandre Nélidoff a dessiné des visages grotesques au crayon avec peu de couleurs. Il a poursuivi ce genre de dessins à l'encre sur de petits carnets.
Quant à Rudolf Heinrichchshofen s'est orienté vers des scènes faites à l'encre et à la gouache d'une indéniable drôlerie, souvent inspirées de la vie quotidienne. Certains de ces patients sont capables d'inventions fantastiques, d'autres sont plutôt proches des enfants, comme on le constate dans la section « Crique sociale » avec Jakob Mohr. Et d'aucuns présentent des fixations obsessionnelles, comme Gustav Johann Wilhelm Sievers, qui représente toujours des femmes aux seins énormes. Auguste Millet, quant à lui, se rapproche des illustrateurs de fables. Une autre section a été dédiée à la satire animale. Ludwig Würtele est sans doute le plus fantasque de tous les personnages choisis : il montre par exemple dans un dessin au crayon des jeunes filles qui dansent avec des grenouilles portant le béret des étudiants. La fantaisie des internés est sans limite dans ce genre, plusieurs d'entre eux pouvant être regardés comme des illustrateurs aguerris de livres réservés aux enfants (je songe surtout à Marcel de Valoy). Dans une autre section, cette fois consacrée à la critique de la psychiatrie, on peut découvrir de singulières consultations ou encore des interventions chirurgicales à la fois effrayantes et divertissantes, comme c'est le cas avec Die deutsche mediznische Weltrekord d'Erich Spiessbisch (1952) où l'on voit la tête d'un homme avec une grosse plaque de métal sur le crâne. En d'autres cas, c'est la bouffonnerie pure qui triomphe, comme dans le théâtre conçu par Gustaf Jakobs dans Köner Hänneschen (1921) ou dans L'Incendie de la Sixtine de Maurice Blin (1950). Il y a des malades qui ont des dispositions picturales assez marquées, comme on le voit chez Guy Lanoux.
La section des grivoiseries nous réserve de belles surprises, comme c'est le cas avec Eduard Paul Kunze, qui utilise la technique du collage (il n'est que de voir son oeuvre sans titre de 1911) et dans toutes ses fantasmagories érotiques. C'est véritablement une anthologie graphique des plus intéressantes pour ceux qui étudient ces questions, mais aussi pour les personnes qui aiment l'art moderne et qui trouvent dans ces considérables collections matière à réflexion, pouvant se confronter à une étrangeté sans borne liée à un inquiétude plus ou moins sous-jacente. C'est un catalogue qui vaut la peine de consulter.

Géométries éclairées, Hélios Sabaté Berian, avec Miguel Chevalier, revue Ficelle n° 127, 60p., 9 euro.
Poète impénitent, Hélios Sabaté Berian a déjà de nombreuses publications à son actif. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est sa relation privilégiée avec les artistes contemporains : il a d'ores et déjà réalisé de nombreux ouvrages à tirage limité avec des peintres comme Arthur Aeschbacher et Kamiya (ce dernier aux éditions Akié Arichi cette année). Dans ses Géométries éclairées, ses poèmes sont placés en regard de compositions polychromes de Miguel Chevalier. Ce sont là deux univers très distants, celui de l'artiste étant de nature électronique, celui de l'écrivain étant proche de la nature. Mais cela fait bien longtemps que les artistes n'illustrent plus les poèmes des auteurs avec lesquels ils sont amenés à collaborer.
Il suffit pour cela de voir les livres édités par la galerie Maeght après la guerre. Mais dans ce rapport tendu entre ces deux mondes, la géométrie de Chevalier engendre un fossé énorme avec les vers d'Hélios Sabaté Berian. Cela n'a plus rien de très choquant aujourd'hui car on se rend compte que cette volonté pour les peintres de concurrencer les poètes n'est plus de mise. Il n'empêche que ces pages sont percutantes et que les textes brefs ne sont pas mis à mal par les compositions savantes du peintre espagnol. Rien ne saurait mieux faire comprendre - et apprécier - comment se joue une partie où la poésie avait largement le dessus sur l'art, « poésie muette ».
|
