
La Collection Emil Bührle, Gallimard / Culturespaces / musée Maillol, 192 p., 35 euro.
Emil Georg Bührle a vu le jour à Pforzheim (grand duché de Bade) en août 1891. Il a suivi des études littéraires et artistiques à l'université de Munich et il se passionne pour les impressionnistes en 1913. Mais il renonce à ses études et devient officier de cavalerie. Après la guerre, en 1920, il épouse Charlotte Schalk. Il va s'installer dans la région de Zurich pour s'occuper d'une importante usine d'armement située. Entre 1929 et 1939, il rachète toutes les parts de la société. Il a été naturalisé suisse en 1937. Mais il a continué à se passionner pour l'art et a acheté quelques pièces, des artistes De Die Brücke. En 1938, secondé par le marchand de tableaux Fritz Nathan, il commence à acheter les oeuvres, constituant rapidement une grande collection. Une partie de celle-ci est présente au sein de « l'Exposition d'art étranger » à Zurich en 1943. Mais jamais personne n'a pu voir dans son intégralité. Après le conflit mondial, il continue à acquérir des pièces remarquables, comme Le Gilet rouge de Paul Cézanne. Aussi curieux que cela puisse sembler il a visiter Paris pour la première fois qu'en 1941, en période peu adaptée pour le tourisme, mais sans doute favorable à de fructueux achats : en 2010, un journal de Lausanne déclare que treize des tableaux en sa possession seraient d'origine suspecte ; plus tard, en 1951, il fait procès à une galerie suisse qui lui aurait vendu des oeuvres spoliées et le gagne, puis La Petite Irène d'Auguste Renoir. En 1951, il visite la maison de Claude Monet à Giverny et décide de se porter acquéreur des grandes Nymphéas (peu après, il fait don de l'une d'elle au Kunsthaus de Zurich). Il a commencé à avoir de l'intérêt pour l'art abstrait fort tard, en 1952. Après sa mort en 1956, sa collection devient une fondation. Cette exposition et ce catalogue nous permettent de découvrir 57 pièces notables de cette immense collection ; on y découvre La Liseuse de Corot, des Sisley et des Pissarro, un paysage de Gauguin -, pas du tout négligeables -, l'étrange Tentation de saint Antoine de Cézanne, le magnifique Numéro d'illusionniste d'Edouard Vuillard, un nu de femme de Renoir, des ballerines de Degas, et tant d'autres peintures inestimables. Et ce n'est là qu'une infime partie de cette collection considérable, dans laquelle figure aussi des peintres d'autrefois. Le catalogue raconte l'histoire de ce marchand d'armes puissant qui a été un amoureux de l'art très avisé. C'est là une occasion de contempler des oeuvres dont certaines sont très peu connues, dont plusieurs toiles d'Edouard Manet comme Oloron-Sainte-Marie (1871), Les Hirondelles (1873), Le Suicidé (circa 1877) - une composition qui aurait pu être une source d'inspiration pour Walter Sickert.

Sonia Delaunay, la vie magnifique, Sophie Chauveau, Tallandier, 418 p., 21, 90 euro.
Il existait déjà des biographies de Sonia Delaunay. Mais aucune n'était aussi complète que celle que nous propose aujourd'hui Sophie Chauveau. Elle a éprouvé quelques difficultés à reconstituer la prime enfance de l'artiste. Née en 1885, elle a en effet grandi dans un shtetl non loin d'Odessa. Sa famille n'était pas fortunée. Un oncle sans enfant, Henri Terk, décide de l'emmener avec lui. La petite fille se retrouve dans une toute autre situation et a vécu à Saint-Pétersbourg dans l'aisance. Elle s'est révélée une bonne élève au lycée et montre de telles dispositions pour le dessin que son oncle engage un professeur pour lui donner des cours privés. Elle part ensuite étudier en Allemagne en 19à3. Elle y découvre les grands musées et surtout les peintres impressionnistes qui la fascinent. Elle parvient à ses fins et s'installe dans la capitale française trois ans plus tard. Elle étudie à l'académie La Palette où enseignent Jacques-Emile Blanche et Edmond Aman-Jean. Elle commence à se faire des relations et fait la connaissance de Fernand Léger. Elle fréquente beaucoup les milieux russes, rencontre Serge Diaghilev qui, à l'époque, dirige Le Monde de l'art, et se lie avec Marie Vassilieff. Elle a fait un voyage en Finlande et en a rapporté un tableau qui montée l'influence de l'expressionnisme et du fauvisme. C'est encore un peu maladroit, mais elle s'engage dans la voie semée exaltante mais semée d'embuches du modernisme. Elle rencontre Wilhelm Uhde, un historien et critique d'art allemand d'origine aisée, marchand de tableaux à paris où il vit depuis 1904, qui dirige une galerie à Paris et aussi collectionneur. Tout de suite, ils s'entendent très bien. Il décident de contracter un mariage blanc (Uhde n'est attiré que par les hommes), mais ils peuvent ainsi se libérer de leurs familles respectives. Ils s'unissent en 1908. Il lui organise dans sa galerie sa première exposition personnelle. Quelques mois plus tard, Uhde la présente à Robert Delaunay en 1909. Celui-ci s'est pris de passion pour les travaux sur la couleur de Michel-Eugène Chevreul et fonde le mouvement orphiste. Sonia est très amoureuse de lui et décide de l'épouser : leur mariage est célébré fin 1910. Elle est déjà enceinte. Ils installent leur atelier rue des Grands-Augustins. Elle ne peint plus sur toile, mais fait toutes sortes d'autres choses, dont de la broderie. Elle ne date pas à avoir un enfant, Charles. Avec Robert, elle rencontre souvent Apollinaire lors de ses mercredis au Café de Flore pendant les années 1912-1913. Sonia rencontre Blaise Cendrars venu de sa Suisse natale. C'est elle qui illustre Le poème du transsibérien (tiré à 60 exemplaires) qui paraît en 1913. Cendrars écrit ensuite « Sur la robe elle avait un corps », qui sera repris dans le catalogue de Sonia à Stockholm en mai 1916. Alors que robert laisse de côté des tours Eiffel pour se consacrer à un Hommage à Blériot, elle dessine des robes simultanées. Mais elle a tout de même peint le Bal Bullier. Une exposition est organisée par ses amis russes à Moscou. Robert, lui, expose à Berlin dans la galerie Der Sturm. Ils se sont installés à Louvenciennes, où ils sont souvent rejoints par leurs collègues russes, comme Larionov et Gontcharova. Robert, quand la guerre éclate décide de quitter la France (tandis pour Montparnasse s'engage pour défendre la France) et parvient ensuite à se faire réformer. Le couple s'installe à Madrid, puis va à Lisbonne (Robert y expose en 1916), où ils rencontrent Amedeo de Souza Cardozo ; puis ils retournent à Madrid où Sonia, ruinée par la révolution d'Octobre, ouvre une Casa Sonia « maison de décoration intérieure et de mode ». Serge Diaghilev lui propose la réalisation des costumes de Cléopâtre, tandis que son mari réalise les décors. Ils ne rentrent à Paris qu'en 1921. Sonia se passionne pour le mouvement Dada lancé par Tristan Tzara. Elle continue à faire des robes. En 1923, elle crée les décors et les costumes du Coeur à gaz de Tzara. Je m'arrêterai là car c'est la fin de la période héroïque. La collaboration de Sonia et de Robert continue jusqu'à la mort de ce dernier en 1941. Elle poursuit néanmoins ses recherches, toujours abstraites et elle est la fondatrice du Salon des réalité nouvelles. Elle décède en 1979 après avoir terminé son livre, Nous irons jusqu'au soleil. Cette seconde phase de sa vie, le lecteur la découvrira dans la biographie vraiment passionnante de Sophie Chaveau.

Michel-Ange, origine d'une renommée, Guillaume Cassegrain, Hazan, 304 p., 30 euro.
Encore un livre sur Michel-Ange, vous exclamerez-vous ! Mais bientôt, une fois passée la préface, vous serez rassurés. Il ne s'agit pas d'une énième biographie, d'une monographie qui vient s'ajouter aux autres, mais une étude sur un sujet qui n'est pas analysé à fond et qui est celui de la réception de son oeuvre en son temps ou peu après par des écrivains, des artistes ou des dilettanti. Une littérature énorme accompagne la vie et la création artistique du Florentin et il est l'un des premiers artistes à avoir eu un livre le concernant, écrit à partir d'entretiens entre le maître et l'auteur. Guillaume Cassegrain fait remarquer que, dès ses débuts, il possédait des dons surnaturels. Beaucoup ont fait observé qu'il avait su, dès ses premières réalisations, se distinguer et qu'il n'avait pas suivi la voie indiquée par un maître. Il entend ne pas se placer dans la perspective d'une tradition ou d'une quelconque école. D'aucuns ont alors souligné sa naissance « divine » à l'art et de nombreuses anecdotes ont accompagné cette affirmation. A partir de là, Cassegrain a constitué une anthologie de ceux qui, très tôt, ont contribué à engendrer un véritable mythe autour de sa personne et de tout ce qu'il a entrepris. Le fait qu'il a bénéficié de la protection des Médicis qui eux aussi ont compris ce qu'il pouvait représenter pour la métamorphose de l'esprit de cette période où la Renaissance a atteint son point culminant mais aussi sa fin. Son abondante correspondance avec des hommes éclairés est aussi révélatrice de ce phénomène. Ascani Condivi (auteur d'une Vita di Michelangelo Buonarroti en 1553) et Giorgio Vasari ont été les principaux artisans de cette vision sublimée de l'enfance et de l'adolescence de Michel-Ange. L'artiste a d'ailleurs contribué à cette légende en prétendant avoir une ascendance noble et puis a consolidé cette position en devant l'ami de figures importantes de la société transalpine. Cassegrain a organisé son ouvrage par grands thèmes. Après ses origines, il met l'accent sur sa physionomie qui a, elle aussi été largement commentée, et il a mis l'accent sur le corps, qui est magnifié et rendu selon un dessin qui n'avait pas encore son pareil. Il est de plus en plus convaincu que le corps est ce qui relie l'homme à dieu. Ce n'est pas là une rupture radicale avec le néoplatonisme, mais bien plutôt une réinterprétation radicale. Et la sexualité est associée à ce culte du corps -, cela peut se voir dans ses sonnets. Et il exprime cette conviction même dans les poèmes écrits à l'intention de Vittoria Colonna. Cela se traduit non seulement dans une connaissance approfondie de l'anatomie, mais aussi de manière assez curieuse dans le rendu de la masculinité et de la féminité, dont les frontières sont assez floues - on lui a d'ailleurs reproché d'avoir peint un Christ sans barbe ! La mélancolie est un autre grand paramètre de sa création. Elle est omniprésente. Michel-Ange se plaint souvent de sa solitude, des avanies du matérielles, d'être victime de la jalousie de ses pairs (en particulier celle de Raphaël), et s'avère conscient de posséder une âme supérieure qui l'isole de tous. Cependant il se complaît dans cette mélancolie qui le distingue, même si elle le fait souffrir. On a aussi loué son immense culture artistique et littéraire. Condivi et Francisco de Hollanda (qui a publié ses Dialogues avec Michel-Ange en 1548). Plus tard, le peintre lombard Giovanni Paolo Lomazzo louera cette qualité. Michel-Ange est un artiste qui est le propriétaire d'un concetto et cela lui a donné la faculté, en dépit de mille difficultés, de parvenir à imaginer un genre d'art inimitable -, le grand humaniste Benedetto Varchi insiste sur ce point : le concept est au coeur de sa pensée. En 1523, Paolo Giovio a fait état de son tempérament terrible et des témoins le confirme, comme le fait d'ailleurs Baccio Bandinelli en 1547. Et nombreux sont les écrits et les lettres qui font état de la solitude dans laquelle il travaille. Il rompt avec la tradition de la bottega. On connaît ce poème où il se lamente de la dureté de son operare quand il peint le plafond de la chapelle Sixtine. Oui, de plus, c'est mauvais caractère et qui s'emporte facilement. Plusieurs de ses connaissances parle de sa terribilità ! Et le livre s'achève sur quelques points de sa technique, en particulier la couleur, mais aussi sur le non finito qui n'est pas rare chez lui. C'est ici une étude superbe à travers les textes qu'on a pu produire sur lui de son vivant ou peu après sa mort. C'est fascinant et aussi d'une très grande utilité. Guillaume Cassegrain a fait un travail tout à fait admirable.

L'Art à Cuba, Gilbert Brownstone, photographies de Camilo Guevara, Flammarion, 224 p., 39,90 euro.
Il n'est pas facile de se faire une idée de l'évolution de l'art cubain après l'époque de Wifredo Lam. Non parce qu'il n'est pas possible de voir les oeuvres de ces artistes, mais tout simplement parce que nous n'avons pas eu pour la plupart d'entre nous l'occasion d'avoir eu une vision d'ensemble de ces dernières décennies. L'auteur parle plus de ce qui s'est déroulé grâce à la révolution castriste, l'éducation publique, la fondations d'institutions pour les différentes formes artistiques, dont le Centre de développement des arts visuels à La Havane) que des artistes cubains du XXe siècle.Dommage. Il n'est question en gros que de Victor Manuel Garcia Vàldez, qui a été un excellent peintre. Mais là, on reste franchement sur sa faim. C'est surtout une apologie du pouvoir en place qu'autre chose, presque un instrument de propagande. Mais oublions ça et voyons le florilège d'artistes qui nous est présenté. Le premier constat est, à quelques exceptions près, on pourrait avoir affaire à des artistes de n'importe quel autre pays. Presque tous semblent suivre les courants qu'on a vu se développer en Europe et aux Etats-Unis. On ne saisit pas quelle est la spécificité de leur travail. Prenons par exemple Carlos Garaicoa : il fait, d' »après ce que l'on voit reproduit, surtout des photographies de ruines et réalise des installations qui ont pour objet l'architecture en confrontant des éléments bruts (des empilements de traves de bois et des maquettes en verre d'ensembles d'immeubles ultra modernes. En ce qui concerne Alexis Leyva Machado dit « Kcho », celui-ci s'intéresse au monde de la mer, à la pêche surtout, avec des tableaux ou des installations dont le matériau principal est une grande quantité de des barques. Ce ne sont pas des oeuvres négligeables dans les deux cas, mais il leur manque un ingrédient essentiel : une véritable originalité dans leur conception (celle du sujet ne suffit pas -, il faudrait qu'elle soient conçues dans un esprit encore inouï). Quant à Lazaro Saavedra, il semble évoluer dans le sillage du groupe Fluxus avec des installations qui possèdent un certain humour, qui est efficace, mais qui me paraît un peu daté. Il tourne en dérision l'art conceptuel. Roberto Fabelo cultive lui le grotesque sans ménagement et construit des tours avec des instruments de cuisine. Admettons. Rien de ce qui figure dans ce libre n'est honteux, mais rien n'ont plus ne suscite une émotion forte et bouleversante. On regarde des créations réalisées par des professionnels qui ont de l'expérience et qui vont dans de multiples directions différentes. Ce qui m'attriste le plus le genre d'art qu'ils ont choisi, mais la volonté d'homologation qui est le grand paradoxe de l'art de ce siècle naissant. En somme, on a l'impression de faire un voyage non à Cuba dans des ateliers qu'on pourrait trouver en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, ou ailleurs. Les amateurs qui s'intéresse à ce qui se fait de nos jours pourront trouver profit à consulter cette ouvrage car le champ est très vaste et un nombre conséquent d'artistes est représenté. Toutefois, je songe à l'extrême richesse de l'art populaire haïtien, qui avait surtout pour raison d'être de représenter des épisodes de l'histoire de cette île qui a arraché son indépendance au prix de beaucoup de larmes et de sang. Il est unique en son genre. L'art cubain tel qu'on nous le montre dans ce gros volume est intéressant, il a sa valeur par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, sans aucun doute ; mais il ne parvient pas à se définir par rapport à une culture et à son devenir. Je ne dis pas que les créateurs doivent traiter des thèmes exclusivement cubains, mais au moins d'avoir un langage qui soit caractéristique de ce pays qui est si singulier. Cela n'en demeure pas moins une précieuse documentation sur les différents aspects de l'art récent dans ce pays qui ne ressemble à aucun autre en Amérique latine.
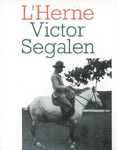
Segalen, sous la direction de Marie Dollé & Christian Doumet, L'Herne, 288 p., 29 euro.
Il était temps que les Cahiers de L'Herne consacrent une nouvelle livraison à Victor Segalen (1878-1919). Non pas qu'il soit passé à la trappe de l'histoire littéraire, mais il semble toujours être placé sur une orbite excentrée. On le lit surtout pour ses écrits sur Paul Gauguin, qui sont remarquables. Ou alors pour ses récits de voyage, celui-ci ayant été médecin de bord. Le premier ouvrage qu'il a publié, en 1902, est sa thèse : L'Observation médicale chez les écrivains naturalistes. On comprend déjà que son penchant allait vers la littérature de son temps et, la même année, il a publié un essai sur les poètes synthétistes et symbolistes au Mercure de France. C'est aussi une figure assez inclassable car il s'est penché sur le Tibet, la statuaire chinoise, s'est passionné pour l'archéologie particulièrement à propos de la Chine ancienne et a fait l'éloge de René Leys (il est allé souvent travailler dans ce pays entre 1909 et 1919). Cet homme qui avait tant de fers à son feu a disparu d'une manière mystérieuse près de Huelgoat à la fin du mois de mai 1923 -, la question de sa disparition n'a jamais été résolue. Le dossier débute par des textes inédits de l'auteur : des lettres adressées à Pierre Cassagne en 1914 qui concernent des questions liées à l'archéologie et qui ont été publiés dans L'Autorité, périodique que dirige ce dernier, une partie de La Statuaire chinoise, L' « Orchestrique de tombeaux chinois », un essai remarquable, Un grand fleuve, texte qui lui a été inspiré par son premier voyage en Chine, des fragments sur la peinture chinoise rédigés en 1911, et enfin des considérations sur la peinture et la porcelaine chinoises. Le tout complète la pensée de Segalen sur l'art ancien de l'Empire du Milieu. En ce qui concerne les essais, je relève le brillant texte de Claude Ollier et quelques pages éclairantes de Jean-Pierre Richard écrites en 1984. Suivent des essais inédits, dont « Segalen, Debussy, Gauguin » d'Etienne Bariller, un essai de Dominique Mabin, qui s'interroge sur sa mort obscure (on avait alors conclu à un suicide) ; on a aussi le bonheur de découvrir de la correspondance. Cela commence par des lettres de Rémy de Gourmont, avec qui il a été en relation dès 1901, d'autres de Charles Bargone, enseigne de vaisseau, grand ami de pierre Loti, et qui deviendra un auteur de succès sous le nom de Claude Farrère. Il y aussi des missives que le jeune Segalen a envoyées entrez 1913 à 1919 à Paul Claudel, qu'il considérait comme le plus grand poète de son temps. On trouve aussi dans ce Cahier de belles photographies de l'écrivain. Je ne saurais citer toutes les contributions qui enrichissent ce volume. Avec elles, les inédits et toutes ces correspondances qui permettent de mieux le situer dans l'univers littéraire du début du XXe siècle, et d'avoir la possibilité unique de mieux appréhender les diverses passions de cet homme qui n'a jamais privilégié le présent au nom du passé, et qui a su allier la connaissance scientifique (celle de l'archéologie) et une littérature qui avait une haute dimension poétique.

Helena Rubinstein, l'aventure de la beauté, sous la direction de Michèle Fitoussi, Flammarion / MAHJ, 256 p., 35 euro.
Elle est née en 1872 à Cracovie, et elle s'appelle Chaja ; elle était la cousine de Martin Buber. Son père tient une épicerie et elle a sept soeurs. A l'âge de quinze ans elle doit quitter l'école pour aider ses parents. Ce n'était pas une famille bien fortunée. En 1894, elle se rend à Vienne pour travailler comme un oncle comme vendeuse dans son magasin de fourrures. Deux ans plus tard, ses parents l'envoient en Australie pour retrouver d'autres membres de sa famille. Dans la petite ville de Coleraine, elle est employée par ses oncles. Elle se prénomme désormais Helena et elle apprend l'anglais. C'est alors qu'elle met au point sa première crème de beauté à base de lanoline. Elle 1900, elle se rend dans le Queensland pour être préceptrice des enfants du gouverneur. Un an elle plus tard, elle est à Melbourne ou elle trouvez un emploi dans un salon de thé. En 1902, elle crée un salon de beauté et la chance lui sourit : elle a une clientèle nombreuse. Elle écrit son premier Guide de la beauté qu'elle vend par correspondance. Elle fait de la publicité dans les journaux, son affaire croît et, en 1907, elle ouvre un magasin à Sidney, puis elle Wellington (Nouvelle-Zélande) l'année suivante. Puis elle se rend à Londres et là encore elle ouvre une filiale. Elle épouse son collaborateur, lui aussi d'origine polonaise, l'Américain Edward William Titus. Lors d'un séjour à Paris, le sculpteur Jacob Epstein la conseille pour l'achat d'oeuvres d'art. Une collection commence à prendre forme ; Elle commence à demander aux artistes de faire son portrait. Le premier est Paul-César Helleu. Il y en aura beaucoup d'autres par la suite. Son premier salon parisien se trouve rue du Faubourg Saint-Honoré. Misia Sert et Colette deviennent ses amies. A Londres elle fait décorer son salon par le sculpteur Elie Nadelman.1912 : elle a maintenant deux enfant, et elle décide de s'installer à Paris. Un an passe et elle fait construire un laboratoire à Saint-Cloud. En 1914, elle traverse l'Atlantique et donne naissance à un nouveau salon. En quelques années, elle est devenue une femme d'affaires redoutable et s'est associé avec Paul Poiret pour une ligne de maquillage. Elle vend sa branche américaine en 1928 pour une somme importante. A partir de la fin de la Grande Guerre, c'est-à-dire à partir du moment où elle crée la marque Helena Rubinstein, elle est allée de succès en succès. Sa collection d'oeuvres d'art est devenue si riche qu'elle est exposée au Museum of Modern Art de New York en 1936. Le seul événement marquant de sa vie est son divorce en 1938 : elle se remarie avec un prince géorgien. Que dire d'autre ? Toutes ses créations sont une réussite comme le mascara waterproof de 1938. Et Salvador Dalì peint un triptyque pour son nouvel appartement de Park Avenue entre 1942 et 1943. Et qui n'a pas peint son portait ? Il y eut Edouard Vuillard, Raoul Dufy, Marie Laurencin, Candido Portinari, Louis Marcoussis, Sarah Lipska, Graham Sutherland, pour ne citer qu'eux, l'ont faite poser. Ses collections prirent des proportions considérables : en plus de la peinture et de la sculpture moderne (de Maurice Utrillo à Marc Chagall), elle a aussi acheté des masques africains. La belle exposition du MAHJ et le catalogue qui l'accompagne ont permis de rassembler un grand nombre de photographies de cette femme résolue, qui s'est fabriqué une image à la hauteur de ses ambitions qui ont pris un tour industriel. On y découvre quelques uns de ses innombrables portraits et aussi un aperçu de son goût pour l'art et pour les cultures non européennes. C'est une femme assez secrète auquel nous avons affaire, qui s'est toujours dissimulé derrière un maquillage. C'est en tout cas une bonne occasion de faire sa connaissance.

Emerveillements, Jacqueline de Romilly, édition de Marion Bellissime, préfaces de Pascal Charvet, Monique Trédé & Arnaud Zucker, « Bouquins », Robert Laffont, 1376 p., 32 euro.
Jacqueline de Romilly (1913-2010) a été l'une de nos grandes hellénistes. Elle a, pour cette raison, reçu la nationalité grecque en 1995 à titre honorifique. Normalienne (comme son père) son aventure d'historienne commence avec une thèse d'Etat remarquée sur Thucydide soutenue en 1947. Elle devient maître de conférence à la Sorbonne deux ans plus tard et, en 1973, elle occupe la chaire de la Grèce antique au Collège de France. Sa carrière est foudroyante. Elle commence à publier à partir de 1956 et à côté de son oeuvre savante, elle publie aussi de la fiction, avec talent. Sa principale caractéristique est d'avoir su parler de la culture grecque antique avec une grande clarté et sans pourtant tomber dans le travers de la vulgarisation. Mais elle ne rechigna pas à écrire un Homère pour la collection « Que sais-je ? ». Son plus grand souci a été de se hisser au niveau de ses pairs les plus éminents sans jamais oublier le lecteur cultivé, mais non spécialiste, qui aurait souhaité d'en savoir plus sur la question. Cela explique et son succès et sa popularité. Le premier des ouvrages réunis dans cette riche anthologie est consacré à la figure d'Hector, le fils du roi Priam dans l'Iliade. Elle explique au lecteur de quelle façon Homère a dépeint ce personnage héroïque, le premier des défenseurs de la ville de Troie. Ses faits et gestes sont l'objet d'une analyse très pointilleuse mais, en même temps, faite pour que chacun de nous puisse comprendre comment il se comporte dans un univers très éloigné du nôtre et où n'existe aucune indication d'ordre psychologique. Grâce à elle, n'a plus de secret pour nous car elle ne se limite à en faire un portrait très détaillé, mais aussi de comprendre les relations qu'il entretient avec les autres personnages de l'épopée grecque. Ce grand texte, qui raconte une histoire assez compliquée, qui va bien au-delà de la guerre elle-même, se révèle sous sa plume d'une clarté impressionnante. A la fin elle explique quelle a été sa postérité. Hector apparaît rarement dans la littérature grecque par la suite (il ne figure même pas dans l'Odysée), mais on le retrouve dans la littérature latine avec L'Enéide de Virgile. Puis il parait à nouveau dans la poésie des Francs et figure en bonne place dans la Franciade de Ronsard. Quand on a lu ce long traité dédié à ce grand guerrier vaincu par Achille, on possède les connaissances d'un spécialiste de l'épopée homérique et aussi de sa pérennité à travers les siècles. C'est là vraiment une introduction réalisée avec une incroyable virtuosité et une volonté de rendre vivant et présent ce qui a été écrit voilà plus de vingt siècles. Le livre suivant est une étude sur Homère. Celle-ci est passionnante, car on y découvre que ce dernier déclare que des récits de la guerre de Troie ont bel et bien existé avant lui et qu'il en a eu connaissance. Homère se distingue de tous ses prédécesseurs en fondant en un seul et même texte tous ces hymnes pour fournir une version unique et cohérente. Il symbolise donc un moment clef et donc fondamental dans l'histoire des lettres. Elle ne se pose pas la question de savoir si cet auteur a vraiment existé ou non, ou s'il s'agit de plusieurs auteurs comme d'aucuns l'ont avancé. Mais, en revanche, elle se demande quelle a pu être la distance temporelle entre les faits rapportés et l'époque où ces livres ont été écrits. Là, elle fait un examen très fin de ce que l'on sait des moeurs (de l'art de la guerre aux coutumes alimentaires) des Grecs de l'Antiquité et aussi des invasions qui ont eu lieu dans la région. Elle montre aussi que le texte ne suit pas une logique parfaite, des épisodes antérieurs étant placés plus tard dans le poème. Elle pense que les événements se seraient déroulés au temps de Mycènes. La question de la structure des poèmes est une affaire assez compliquée qu'elle parvient à nous rendre plutôt limpide, même s'il est assez difficile de démêler les questions que cela suppose. En définitive, elle a assez de talent, en plus de sa science, de rendre tout très proche de nous malgré la distance temporale considérable. C'est là une réussite incontestable. Ne pouvant pas, dans le cadre de cette chronique, parler de chacun des ouvrages que contient ce recueil (Alcibiade, Réflexions sur la tragédie grecque, La Littérature ou Le Passé vivant, sans parler de son brillant essai sur le rapport de Jean Giraudoux avec la civilisation hellénistique), je m'arrêtai un instant sur La Douceur dans la pensée grecque ; le titre est pour le moins intriguant ! Elle utilise le mot « douceur » comme antinomique de la notion d'amertume. Dans une optique politique, ce pourrait être le synonyme de clémence ou de tolérance. Elle embrasse toute la littérature grecque ancienne pour traiter de ce sujet. Elle pense qu'il existerait une influence orientale dans cette idée nouvelle. Pour en saisir la progression, elle a choisi de traiter le thème de manière chronologique. Elle en décèle les premières traces chez Homère capable d'« introduire une comparaison tendre et pacifique en un moment où se déchaine la violence... ». Avant le Ve siècle, les mythes ont un caractère violent, impitoyable. Par la suite, cette dureté s'atténue. Eschyle pointe le doigt sur la justice dans ses tragédies. On supplie les dieux d'être cléments. La législation grecque avait aussi pour tâche d'éradiquer la violence entre les citoyens de la cité. Elle étudie alors les nouveaux mots qui apparaissent dans la langue, comme des termes tels que proas, philanthrôpos et épiekès. Mais Homère n'utilise déjà pas les deux premiers. L'usage s'en répand lentement et ne s'affirme vraiment qu'à partir de Socrate. Praos signifie surtout apaiser, philanthrôpos désigne une affection généreuse et spontanée, et a fini par s'appliquer à l'attitude de l'individu envers la collectivité et enfin épiekès est proche de la douceur. Ce brillant et complet examen philologique s'appuie sur les écrits des grands auteurs : c'est une véritable décryptage de la littérature des Grecs jusqu'au siècle d'or. C'est la « douceur » qui se trouve au fondement de la démocratie, même si elle a, à Athènes, ses frontières, car trop d'indulgence (Démosthène en atteste, puis Thucydide) peut être dangereux. D'autres, comme Isocrate, souligne la nécessité que le peuple doit agir avec vigueur sur les magistrats). Il est aussi né l'idée d'un « prince doux ». Dans ces pages éblouissantes, Jacqueline de Romilly met en lumière l'évolution d'une pensée qui associe la linguistique, la politique et la philosophie, sans parler des traditions. Bien sûr, je n'ai pu relater que le squelette de sa pensée et de ses raisonnements sur des points assez subtils et néanmoins d'une importance cruciale. Ce recueil ne saurait être lu d'une traite, mais dégusté au fil du temps pour pénétrer toujours plus profondément le génie hellénistique.

Le Dernier amour de Baba Dounia, Alina Bronsky, traduit de l'allemand par Isabelle Liber, Actes Sud, 160 p., 17,50 euro.
L'auteur (allemande, mais d'origine russe) nous invite à nous rendre en Ukraine, dans une petite ville située non loin de Tchernobyl nommée Tchernovo. Les habitants avaient dû l'abandonner Après la catastrophe nucléaire. Mais, après quelques années, quelques habitants sont revenus, bravant un danger encore bien présent. Le village n'est encore pas très habité et procure une sensation étrange à ceux qui y demeurent. Alina Bronsky s'est attachée à décrire cette atmosphère et les faits et gestes de ces personnes qui ont décidé de vivre là en dépit du danger encouru. Elle manifeste un réalisme qui est celui de notre époque, qui est légitimité par un problème de nature sociale ou écologique. On est bien loin du réalisme d'autrefois, car le vrai pivot de l'intrigue n'est pas la vie de tel ou tel personnage, mais plutôt le contexte qui surdétermine leur destin. Elle nous fait néanmoins découvrir des figures pittoresques, comme celle de ce centenaire que la menace nucléaire ne touche pas vu son âge, celle de Petrov, cancéreux, qui lui non plus n'a vraiment rien à perdre, et qui se console avec la poésie, celle des Gravilov, mari et femme, qui sont des passionnés d'échecs et qui sont sinon de très mauvaises langues, celle de Maria, avec son maigre poulailler et son hypocondrie sans fond et, bien sûr, Baba Dounia, qui finit par trouver l'endroit assez merveilleux après tout ce qu'elle a connu. Mais son bonheur est troublé par une lettre arrivée d'Allemagne, écrite en anglais par sa petite fille. Mais elle ne parvient pas à la lire faute de connaître cette langue et son coeur se remplit d'appréhension. A la fin arrive un homme accompagné par sa fille très jeune. Baba Dounia ne voit pas cette arrivée d'un bon oeil : elle soupçonne qu'elle dissimule quelque chose de trouble. Elle lui propose même une expérience terrible en exposant son enfant aux radiations nucléaires. A la fin elle part. la vie continue à imposer ses droits dans le village - malgré tout. Voilà en gros l'histoire, qui est bien narrée, mais qui laisse néanmoins le lecteur dans une sorte d'insatisfaction. Tout en tant réaliste, le roman est assez elliptique et même métaphorique ; c'est peu le cours qu'a pris le roman contemporain, pour le meilleur et pour le pire. Dans le cas présent, l'ouvrage se lire sans désagrément et on finit par croire à l'existence de ce village menacé et à cette petite population pittoresque. Ce n'est déjà pas si mal.
|
