
Qui veut la peau de Vénus ?, Bruno Nassim Aboudrar, Flammarion, 260 p., 20 euro.
L'auteur a manifestement hésité entre le roman et le récit historique. Il a préféré la voie du roman, mais l'accumulation de faits authentiques été un frein pour la composition de son ouvrage. Cela dit, celui-ci se lit avec beaucoup d'intérêt car j'avoue ignorer cet épisode tragicomique de l'histoire de suffragettes en Grande-Bretagne. Mary Richardson, une militante acharnée de cette grande cause de l'émancipation féminine veut accomplir en mars 1914 un geste aussi inattendu que scandaleux : vandaliser le célèbre tableau de Velàzquez, La toilette de Vénus, une de ses oeuvres les plus connues et un de ses chefs-d'oeuvre, accroché aux cimaises de la Tate Gallery de Londres. Pour accomplir cet acte sacrilège, elle a acheté une petite hache et a lacéré la toile au beau milieu de la foule des admirateurs. Ces derniers commencent d'ailleurs à la lyncher ! Ce geste symbolique, mais qui a des conséquences graves puisqu'il implique une restauration sérieuse de la toile (là, l'auteur fait entrer en scène le restaurateur qui nous explique longuement comment il faut s'y prendre pour accomplir une telle tâche) et qui suscite des polémiques à propos de l'authenticité de cette pièce (un savant voudrait pouvoir examiner en détail celle-ci avec les moyens les plus modernes que la science peut mettre alors à sa disposition). La presse s'est bien entendu emparée de l'affaire et tout le monde s'interroge sur les raisons qui ont poussé cette femme à s'en prendre avec autant de rage à une création du XVIIe siècle espagnol. Il est évident que c'est une image de la femme qui est ici en jeu. Mais souvenons-nous qu'à l'époque de Philippe IV, l'Eglise avait la main mise sur le pouvoir de l'autre côté des Pyrénées. La composition du peintre ne semblait choquer personne à l'époque en dépit de la sensuelle nudité de la déesse ! C'est donc une interprétation moderne qui a conduit Mary Richardson à ce vandalisme. Tout cela est très bien raconté par l'auteur. Il nous rappelle aussi que la cause du féminisme a finalement été entendue au 10 Downing Street : le premier ministre Lloyd George, en 1918, accorde le droit de vote aux femmes de plus de trente ans, sans doute en remerciements des efforts qu'elles avaient accomplis pendant la Grande Guerre. Dix ans plus tard, la loi mettra à égalité l'âge des hommes et celui des femmes. En somme, l'art croise toujours le chemin de la politique et de la lutte sociale à un moment ou à un autre !

L'Affaire Arnolfini, Jean-Philippe Postel, préface de Daniel Pennac, Actes Sud, 160 p., 18 euro.
Ce « roman d'investigation », comme l'appelle l'auteur, débute par une énumération de tout ce qu'on ne sait pas ou que l'on croit savoir à tort : on ignore presque tout de la vie de jan Van Eyck, en dehors du fait qu'il a vécu à Bruges et qu'il y est mort en 1441 ? On ne sait pas qui a été son maître, ni où il a appris la peinture. Qu'il ait été l'inventeur de la peinture à l'huile n'est pas vraiment une certitude. En ce qui concerne ses premières commissions, l'on pense qu'il a commencé par travailler pour le duc Jean III de Bavière, et qu'il a ensuite été appelé auprès de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. En ce qui concerne le tableau, l'auteur met en doute sa date (1434) car ce qu'a écrit l'artiste dit « qu'il s'est trouvé à cet endroit » à cette date. Enfin, l'histoire du tableau avant d'arriver à la National Gallery de Londres est aussi romanesque et énigmatique que le reste. Sans doute Jean-Philippe Postel a-t-il eu l'intention de dérouter le lecteur, alors qu'il fait des constations que pourrait faire n'importe historien d'art face à ces question restées sans réponses. Et les interrogations ne s'arrêtent pas là : l'auteur doute du patronyme des deux personnages - Arnolfini. Pour lui, ils se seraient nommés Hernoul-le-Fin. Et même s'il s'agit bien d'un Arnolfini, lequel des deux frères parle-t-on ? Hernoul ou Arnould ? L'auteur fait remarquer que saint Arnould était le patron des hommes trompés. Cette observation a-t-elle quelque chose à voir avec notre tableau ? La femme est enceinte et l'homme fait une promesse - ce qu'indique le geste de la main -, cela devant deux témoins que l'on discerne dans le reflet du miroir. Une parenthèse singulière nous surprend : l'auteur pense qu'il s'agit d'une apparition, la femme étant morte, s'il s'agit bien de l'épouse d'Arnolfini. Il se réfère alors à Melanchton et puis à Edgar Allan Poe. Et il établit un lien avec le purgatoire, qui n'a été introduit qu'au XIIe siècle et aussi à sainte Madeleine. Par la suite, on passe à l'interprétation de la scène (déjà largement commentée par de grands spécialistes) et de ce qu'on peut voir dans le miroir. Après quoi, chaque détail est examiné pour ce qu'il est et peut symboliser (la chandelle, la cerise, etc.) et là l'auteur se comporte comme un historien d'art émule de Panofsky. Pour terminer, il fait une comparaison avec les autres tableaux de Van Eyck. En conclusion, il en reste à l'hypothèse de l'apparition. Or celle-ci est hautement improbable car, en son temps, les artistes travaillaient exclusivement sur commission. Ce genre de scène macabre n'avait pas sa place dans la peinture au XVe siècle sinon dans la peinture religieuse ! L'analyse de l'art ancien ressemble à une enquête policière et elle est souvent décevante faute de documents sur lesquels appuyer ses théories. Ce livre est néanmoins intéressant et doit être lu car il montre bien les difficultés de l'interprétation et les très étranges observations des historiens d'art voulant absolument révéler le secret d'une oeuvre.

Cevdet Bey et ses fils, Orhan Pamuk, traduit du turc par Valérie Gay-Askoy, Folio, 976 p., 11 euro.
C'est le tout premier roman écrit par Orhan Pamuk, l'écrivain turc qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2006. Parue en 1982, puis largement remaniée en 1995, cette très longue oeuvre romanesque montre bien les ambitions de l'auteur : ne pas chercher dans l'histoire ses mécanismes es plus complexes, comme l'a fait Tolstoï, par ne citer que lui, ni traquer les circonvolutions psychologiques de ses héros pour les décrire comme l'auraient fait Luigi Pirandello, Italo Svevo ou August Strindberg. Et pourtant, Pamuk est parvenu à brosser une grande fresque de l'histoire de la Turquie. Il a choisi trois moments déterminants de l'histoire de ce nouveau pays né à la fin de la Grande Guerre pour marquer l'histoire des trois personnages principaux de sa fiction : il commence en 1905, quand l'Empire ottoman, déjà à son déclin, a tenté une timide démocratisation parlementaire à l'époque du sultan Abdülhamid II (dont le règne se terminera en 1909 par un coup d'Etat raté des religieux, conduit par les derviches très en cour alors dans le dernier palais appelé « Chalet ») ; la fin des années trente (cela coïncide avec la mort de Kemal Atatürk, qui s'éteint en 1938), justement quand la menace de la guerre mondiale qui se prépare se fait oppressante et que nul ne sait ce que la Turquie moderne va faire ; enfin il a traité les années soixante-dix, celles de sa jeunesse, quand les militaires font un premier coup d'Etat à l'aube indécise de la démocratie. Cevdet Bey est un homme curieux, plein de contradiction, qui avait choisi le commerce non seulement comme travail, mais aussi comme bannière morale. Il avait écrit sur son établissement « Gevdet et fils » alors qu'il n'était pas encore marié et qu'il n'avait pas d'enfants ! La fortune pour lui a été de devenir l'ami du pacha, qui lui fit épouser une de ses filles. Sa fortune était faite. Ses descendants vont prospérer en dépit des transformations radicales du pays et ils vont arriver à la troisième génération quand les officiers de haut rang s'emparent du pouvoir. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a peu d'événements saillants, encore moins de drames. Pamuk mise tout sur la dynamique de l'existence et des destins qui se croisent et s'enchevêtrent. La vie d'Istanbul et la vie dans les maisons de cette famille bourgeoise et paisible demeurent le coeur de sa chambre noire d'où il observe son univers. Il est à noter qu'il fait quasiment abstraction de quatre conflits armés : les deux terribles guerres des Balkans, la Première guerre mondiale et le guerre d'Indépendance en 1922. Tout ici s'inscrit en filigrane dans une apparente neutralité des faits et des gestes de ses personnages, de leurs aspirations, de leurs déceptions, de leur destinée. Il est parvenu à faire un tableau synoptique de la Turquie par petites touches impressionnistes alors que le grand roman, sans rien d'épique ou de dramatique, n'est qu'un roman familial révélateur de la pensée que l'auteur s'est faite des années précédant la chute de l'Empire ottoman et celles qui suivent la création de la République. Il y a des lenteurs, sans doute des moments moins forts, mais Pamuk possède déjà cette force incroyable qui transforme les choses les plus banales en éléments essentiels pour reconstituer le puzzle de ses récits intriqués. Il n'a pas choisi, comme le faisait Mahfouz (lui aussi prix Nobel et auteur de génie), de mettre en scène le peuple dans sa réalité la plus nue, mais aussi la plus belle, et dans le fourmillement vital des rues des quartiers populaires. Non. Il laisse filtrer les nouvelles, qui s'insinuent de temps à autre, et bouleversent l'existence de ces hommes et des femmes qui, mine de rien, ont forgé les bases d'une Nation neuve. Ce livre est une merveille absolue.

Théorie des sentiments moraux, Adam Smith, préface de Jean-Pierre Dupuy, traduction de Sophie de Condorcet revue par Laurent Folliot, Rivages poche, 784 p., 12 euro.
Le penseur écossais Adam Smith (1723-1790) ne fait plus partie des philosophes largement lus en France. Et pourtant est le premier théoricien de l'économie libérale et l'auteur de la richesse des Nations (1776) qui est l'un des livres clefs de l'économie moderne, non seulement dans sa perspective théorique, mais aussi dans la dimension visionnaire de l'organisation du travail dans les entreprises. Il s'est occupé de nombreux sujets, comme le rôle et les devoirs de l'Etat, la justice, la réglementation des finances (il s'est penché sur la question des monopoles), sur la démographie. Dans ce gros ouvrage publié en 1759, il s'interroge sur les jugements moraux et leurs effets et surtout sur le lien social que ce qu'il nomme l'« homme intérieur » doit prendre en ligne de compte pour exister au sein d'un groupe. Dans ce domaine, il n'est pas le premier à avoir développé des thèses de cette nature, mais il demeure celui qui a su en faire une synthèse brillante et efficace. Il s'interroge d'abord sur ce que signifie la sympathie ou l'empathie et prend pour exemple le jeu des acteurs sur scène, dont la fonction est de susciter la sympathie des spectateurs. Il analyse très méticuleusement tout ce qui peut avoir un rapport avec la nature de la moralité, puis à ses mobiles propres. Tout en en revenant aux philosophes antiques, surtout les stoïciens, il s'est inspiré de Thomas Hobbes et de Francis Hutcheson (son maître, un empiriste, lui-même disciple de John Locke, introducteur des Lumières en Ecosse). Il en vient à contester les conclusions d'Hutcheson, qui ne voulait pas faire reposer la morale sur les sentiments trop subjectifs et donc incontrôlables et difficiles à analyser. Il les réintroduit sous la forme d'un « sens moral » qui serait le sixième sens de l'homme, fondement principal d'une véritable philosophie morale. Il y aurait dans les sociétés modernes des clauses qui inciteraient à cultiver les sentiments dans le respect de l'autre et aussi pour être en mesure d'avoir un commerce agréable autant dans le travail que dans les loisirs ou la vie domestique. Dans son langage, c'est le passage de la « sympathie réflexive » à la position de l'observateur impartial (ce qui ne l'empêche pas de discerner les limites de la nouvelle société industrielle, et donc il n 'y a rien d'idéaliste dans l'esprit de la conquête de cette position -, c'est le mieux possible). De lui dérive la pensée de David Hume, mais il n'a pas été sans influencer d'autres grands philosophes, comme Diderot (toutefois plus séduit par Lord Shaftestbury, un penseur singulier qui a précédé Adam Smith puisqu'il est décédé en 1713, et qu'il a traduit en français en 1745) qui a conjugué dans son esthétique la plus complète liberté du goût qui est compensée par le sens moral, ce qu'exprime un peintre comme Greuze, alors que Chardin ne peut satisfaire que les sens, la sensibilité artistique et le plaisir puisque la majorité de ses oeuvres ne sont que de pures transpositions par la peinture d'émotions intimes. Je vous parle de temps à autre de la bibliothèque de l'honnête homme moderne : voilà un livre qui y a toute sa place.

Lettres sur la sympathie, Sophie de Condorcet, préface de Jean-Claude Bonnet, Rivages poche, 72 p., 7,50 euro.
Sophie de Grouchy (1764-1822), soeur du maréchal d'empire, a tenu un salon dans l'hôtel des Monnaies, qui a un certain éclat et qui a joué un rôle pendant la Révolution. Elle y reçoit Madame de Staël et Olympe de Gouges et écrit à son tour un pamphlet en faveur du droit des femmes : « Sur l'admission des femmes au droit de cité » (1790) Elle a été l'épouse du célèbre savant, qui a été arrêté en 1793 et qui s'est donné la mort en 1794. Au cours de cette épreuve terrible, elle fit face avec sa petite fille Eliza, comme elle le put. Elle traduit la Théorie des sentiments moraux d'Adam Smith tout en rédigeant ses commentaires sur la question, qu'elle a réunis sous le titre de Lettres sur la sympathie. Elle ne réfute pas les thèses énoncées par l'illustre homme de lettres écossais, mais développe sa propre conception de la sympathie, qui ne se résume pas selon ses goûts à la seule économie d'une société donnée. C'est un ensemble de sentiments, qui peuvent n'avoir que des fins amicales ou affectives. C'est un point de vue qu'on pourrait qualifier de « romantique » avant la lettre, si ce terme n'était pas si galvaudé désormais. Elle y discute d'art et de beauté. Mais elle conclut de manière assez voisine à Smith : « Il en résulte pour nous un motif intérieur et personnel de faire du bien et d'éviter de faire du mal, motif qui est une suite de notre qualité d'êtres sensibles et capables de raisonnement, et qui peut, dans les âmes délicates, servir à la fois de moniteur à la conscience, et de moteur à la vertu. » Cette prudence, cette sagesse qui corrige son transport pour tout ce qui peut être la source d'enthousiasme, sa modération en font un penseur digne de ce nom. Personne ne s'y est trompé alors puisque ses Lettres ont été jointes à la réédition du traité de Smith en 1798, puis les deux siècles suivants. Quand elle critique plus ouvertement Adam Smith, c'est pour parler de ses conceptions à propos de la révolution : elle plaide en faveur de l'égalité et donc rejette son principe de grandeur lié à la sympathie : elle dépasse tout ce qui peut être imposé par le haut, comme d'ailleurs le rire ou le sens du ridicule. Elle prétend cependant comme lui que la sympathie a affaire avec de hautes aspirations morales. Elle écrit par exemple que « la morale de Rousseau est attachante, quoique sévère ». Elle trouve les considérations de Voltaire plus indulgentes, et donc moins excitantes. Les quatre dernières lettres traitent de l'éducation (point essentiel) et puis surtout de l'injustice, qu'elle met en relation avec l'orgueil, la vanité et la jalousie. C'est en filigrane une critique des idéaux des montagnards et elle réaffirme que la propriété est propice au bien commun, mais à condition que le plus grande nombre puisse en bénéficier. Dans ces pages assez fermes, elle entend rappeler quelles ont été les idées des premiers révolutionnaires dont elle a fait partie et qui sont presque tous montés à l'échafaud. Par la suite, elle rouvrira son salon et sera une opposante à Napoléon Ier.

Défense des droits de femmes, Mary Wollstonecraft, (extraits) édition présentée par Martine Reid, Folio, 144 p., 2 euro.
Mary Wollstonecraft (1759-1797) a sans doute écrit le livre le plus important sur la condition féminine. Ce livre l'a rendue célèbre dans le monde. Mais elle a été une personnalité de premier plan dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle. Elle a fréquenté William Blake, le peintre d'origine suisse Henry Fuseli, dont elle a été un temps la maîtresse, puis elle épousé William Godwin, le philosophe et écrivain, auteur des Aventures de Caleb Williams, dont elle a une fille qui épousera Shelley et écrira le célèbre roman Frankenstein. Elle a écrit une histoire de la révolution française, une Lettre écrite en Suède, en Norvège et au Danemark (1796), deux romans, Mary : or a fiction (1788), Maria : or the Wrong of a Woman (1798), un traité sur l'éducation et deux livre pamphlétaires : A Vindication of the Rights of Men (1790), qui prône la vertu républicaine, et A Vindication of the Rights of Women with Strictures of Political and Moral Subjects en 1792, qui ne paraît que six ans plus tard. Ce n'est pas un pamphlet, mais un long essai où elle tente de développer d'abord tous les préjugés dont les femmes sont victimes, ensuite ce qui doit être fait pour que ces dernières se trouvent dans une situation plus digne et plus libre. Mais, aussi curieux que cela puisse paraître, elle ne réclame pas l'égalité totale avec les hommes, mais sur certains points où une certaine justice peut s'établir. En fait, elle se montre plus modérée qu'on a pu le croire par la suite et ne prêche pas le renversement des valeurs bourgeoises qui se sont renforcées partout en Europe et qui ont été confortées par la révolution en France. Elle défend l'institution du mariage et plaide surtout pour une éducation plus soignée des jeunes filles. Sans doute se montre-t-elle très acerbe à l'encontre de l'aristocratie et vante-t-elle les valeurs du travail. En revanche ses romans sont assez critiques en ce qui concerne le mariage tel qu'il est conçu. Dans la fiction, elle va beaucoup plus loin en ce sens que dans sa doctrine, qui demeure assez pragmatique, plutôt réaliste et passablement bourgeoise.

Amitié, Simone Weil préface de Valère Gérard, Rivages poche, 64 p., 5 euro.
Ce court chapitre extrait des Formes de l'amour implicite de Dieu, ouvrage que Simone Weil a écrit en 1942 nous rappelle les conceptions d'Adam Smith dont je parle plus haut. Mais s'il l'amitié peut contribuer à un bon et juste « contrat social », elle doit être entendue dans un sens chrétien (et non pas sentimental comme chez Sophie de Condorcet). Ce qui lie les êtres les uns aux autres est déterminé par ce que le Nouveau Testament stipule : le respect de l'autre, la solidarité, mais qui n'implique pas un attachement personnel particulier. C'est un modèle de comportement. Implicitement, ce serait le moyen de vivre ensemble dans un seul amour : celui de Dieu. Soit. L'utilitarisme social est somme toute la traduction dans la vie commune de ce qui doit rattacher l'homme au divin et gouverner toute son existence. Alors pourquoi avoir choisi de parler d'amitié au lieu de communauté d'intentions morales et politiques en ce monde ? Pour moi, son raisonnement est spécieux et dénote surtout une volonté de se distinguer à tout prix de la pensée païenne (celle des stoïciens, sans doute, mais` encore plus de Platon) et de la pensée des Lumières. Cela me fait penser aux nouveaux usages de la messe catholique où tout le monde s'embrasse dans les Evangiles ! Cet angélisme en pleine guerre mondiale me paraît assez mal venu et même franchement réactionnaire face aux totalitarismes qui, eux, voulaient fondre la société toute entière dans un moule unificateur. En oubliant que cette amitié universelle exclurait nécessairement ceux qui n'en participeraient pas.
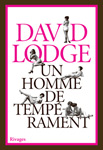
Un homme de tempérament, David Lodge, traduit de l'anglais par Martine Aubert, Rivages poche, 672 p., 10,70 euro.
Le point de départ de cette longue fiction - A Man of Parts, 2011 - est la vie de H. G. Wells, mais entièrement romancée, au point qu'on ignore tout à fait si l'auteur invente ou se sert d'éléments véridiques. Mais, dès le début, le lecteur est pris par le récit. Nous rencontrons le vieil homme à Londres à l'époque du Blitz. Contrairement à la majorité des habitants de son quartier, il n'a pas abandonné sa demeure. Il compte bien y reste coûte que coûte. Le célèbre écrivain est mort de sa belle mort en 1946 et il n'aurait peut-être pas écrit la Guerre dans les airs ! Mais peu importe. D'ailleurs notre homme de lettres aurait prononcé lui-même sa nécrologie en 1935 à la BBC. Il expose dans un entretien sa conception de la littérature et de l'existence (on sait qu'il avait caressé le rêve de devenir un vrai philosophe et d'écrire une véritable littérature). George Orwell, qu'il rencontre, souligne l'influence qu'il a eue sur les jeunes auteurs. Ce qui est frappant dans cette vraie-fausse biographie, c'est que David Lodge met surtout l'accent sur la vie sentimentale de son grand aîné, qui a toujours prôné l'amour libre. A travers des entretiens pour la plupart fictifs, le vieil homme raconte son existence. Sans doute l'idée de privilégier les aventures féminines de l'auteur de la Guerre des mondes semble-t-elle un peu facile. Mais, curieusement, Lodge est parvenu à faire un livre qui reste passionnant d'un bout à l'autre en adoptant ce point de vue. Bien que ce soit un roman fleuve, on ne d'ennuie pas une seconde à écouter les histoire de cet homme qui a eu bien des ambitions déçues et qui aurait aimé être reconnu pour sa pensée philosophique plus que pour ses nouvelles de science-fiction ! David Lodge, que je n'apprécie pas toujours, a écrit ici un grand livre, qui est à la fois drôle et tragique, et révèle ce que nous avons toujours ignoré de l'auteur de l'Ile du docteur Moreau. L'écrivain n'a pas insisté sur ce que d'autres ont pu nous apprendre sur les engagements politiques (il était favorable à un socialisme modéré), sur son goût pour la science, sur ses ouvrages de vulgarisations et sur les utopies, souvent effrayantes. Il fait émerger la partie immergée de cet homme, qui a été la victime de son succès.
|
