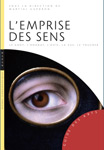
L'Emprise des sens, sous la direction de Martial Guédron, « repères iconographiques », Hazan, 336 p., 20 euro.
Cela n'a pas dû être tout à fait simple de construire ce volume autour des cinq sens. Sans doute existe-t-il une iconographie importante dans l'art, mais encore faut-il trouver un équilibre parfait entre le goût, l'ouïe, la vue, le toucher et l'odorat. Et le maître d'oeuvre de ce volume y est parvenu - volume ô combien utile pour les personnes souhaitant, non seulement peaufiner leurs connaissances en art, mais aussi relier celles-ci à d'autres domaines de la connaissance, comme la médecine par exemple. L'autre difficulté qui a dû se présenter, c'est qu'il ne s'agit pas ici de ne parler que des choses du passé, mais aussi de ce que le présent nous propose de nouveau, comme les technologies de pointe. Ce ne peut être exhaustif, mais au moins il y a des connexions importantes qui permettent ensuite d'aller plus loin dans le sujet choisi. La vue est de toute évidence le sens le plus facile à traiter dans ce genre de projet. Mais il faut admettre que les autres sens sont bien examinés, même si bien des obstacles se présentent, surtout pour l'odorat : une fleur peut-elle être l'expression d'une odeur ? Sans doute, mais c'est purement mental ! Quoi qu'il en soit, l'Emprise des sens est un ouvrage de référence dont l'utilité ne fait aucun doute, n'en déplaise aux spécialistes !

Manet, le secret, Sophie Chauveau, Folio, 496 p., 8,20 euro.
La biographie romancée est un genre assez horripilant. Surtout quand il s'agit d'artistes. Mais ce cas précis, il faut reconnaître à Sophie Chauveau d'avoir eu suffisamment de jugement et de talent pour ne pas transfigurer l'existence d'Edouard Manet. Il faut aussi lui reconnaître une autre vertu : celle d'avoir évoqué avec tant de charme un destin qui n'est passionnant que du point de vue de la peinture. La vie privée de Manet, si l'on fait exception de son voyage à travers l'Atlantique comme mousse et son séjour à Rio de Janeiro et de sa relation avec la jeune Néerlandaise, Suzanne, dont il a un fils, n'a rien de très remarquable. Ce qui est remarquable, c'est son courage face à l'hostilité que son art suscite, sa capacité de comprendre le devenir de la peinture (c'est lui en fait qui invente l'impressionnisme au café Guerbois -, un école qui aurait dû s'appeler l'Ecole des Batignolles), sa gentillesse et sa générosité envers ses collègues moins fortunés que lui, comme Monet par exemple. Bien sûr l'auteur imagine des conversations, des histoires qui ne se sont pas passées exactement de cette façon, mais elle ne dit rien de choquant et ne rajoute pas des couches superfétatoires de mythologie vulgaire. C'est donc un livre que tout un chacun peut lire avec plaisir. Il donne le loisir de découvrir le cheminement d'un individu en dehors du commun, mais qui n'a jamais fait parler de lui ailleurs que dans L'Artiste ou dans les revues spécialisées. Pas de scandales, pas de politique, pas de positions extrêmes, pas de gauloiseries ou de bizarrerie. Personne en son temps parmi les peintres n'a été aussi discret dans sa manière d'être (même s'il a aimé jouer au dandy) et d'aussi corrosif dans sa pratique de l'art. Eh bien, tout cela se comprend dans ces pages qui procurent une belle satisfaction à les lire.

Chambres closes, Emmanuel Pernoud, Hazan, 192 p., 16 euro.
Essai insolite s'il en est ! C'est le moins qu'oin puisse dire. L'auteur fait un parallèle osé (pour ne pas dire forcé) entre deux événements qui ont eu lieu la même année (1907) : l'achèvement des Demoiselles d'Avignon par Pablo Picasso et la parution du Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Sans doute se prévaut-il de la fameuse formule d'Isidore Ducasse avec sa table d'opération, mais sur le plan historique et sur celui de la théorie, le rapprochement ne joue pas. Peu importe, il s'engouffre dans cette brèche et commence une étude sur les chambres. IL commence (cela semble évident) par Edward Hopper, qui a peint une chambre vide en 1951. Il nous explique pourquoi : quand il était étudiant, il avait discuté avec ses camarades de cette question. Après quoi, il digresse sur la question, nous faisant passer des peintres hollandais du XVIIe siècle (qui d'ailleurs ne lui inspirent pas beaucoup de réflexions) à Franz Kafka. Mais l'idée de l'écrivain enfermé dans une pièce vide ou presque, seul et pour toujours, n'est pas l'invention de l'écrivain pragois. Par exemple, Gabriele D'Annunzio, quand il a séjourné chez son ami le peintre Michetti, s'est fait enfermer dans sa chambre pour écrire le Plaisir ! On passe bien étendu par les maisons closes de Maupassant pour arriver, on ne sait trop pourquoi à Dado. Soit. Bien sûr, l'auteur tente d 'associer le crime et l'espace forclos : des oeuvres de Walter Sickert (avec ses scènes de femmes massacrées sur des lits défaits) et de Félix Vallotton (avec ses belles gravures en noir et blanc) viennent à son secours, fort heureusement. Mais est-ce là un discours qui tient debout ? Que nenni ! Sans doute les intérieurs chromatiques des Nabis, surtout ceux de Vuillard, peuvent trouver un sens relatif dans cette recherche un peu ésotérique dans ses visées. Non, vous l'avez compris, je n'ai pas été convaincu. Bien des extravagances peuvent me séduire, mais des billevesées, ce n'est pas franchement possible.

Jean Genêt, l'échappée belle, sous la direction d'Emmanuelle Lambert, Gallimard / MUCEM, 260 p., 32 euro.
Il faut bien admettre que cette exposition et que ce catalogue encore plus, suivent une logique qui n'est pas tout à fait compréhensible. Il y a un aspect biographique, assez complet et bien réalisé. Puis il y a des points d'ancrages : le premier est lié à son premier livre, Journal d'un voleur, qui le révèle aux lecteurs aussitôt apparu chez les libraires et qui suscite l'admiration de grands écrivains de son temps, dont Jean-Paul Sartre. C'est aussi une introduction à sa jeunesse loin d'être dorée et à sa vie de petit malfrat, qui finit par préférer la prostitution au larcin, car moins fatiguant ! Ensuite, on a choisi de mettre en avant la pièce de théâtre qui a fait le plus scandale, les paravents, soulevant l'indignation des anciens combattants d'Algérie et de la France bien pensante. Enfin, on voyage avec lui autour de la Méditerranée pour arriver à la tombe où il est inhumé au Maroc. Au milieu de tout cela, il est question du magnifique portrait qu'a fait de lui Alberto Giacometti et dont l'histoire est commentée avec finesse et concision par Albert Dichy, qui met en regard le peintre et l'homme qui pose et qui n'aimait pas poser. Genêt a écrit un portrait de Giacometti à travers ses créations, l'Atelier de Giacometti, qui est une pure merveille. Il est indéniable qu'on est heureux de découvrir cette masse importante de documents, de lire ses brefs essais, de voir ces photographies et d'en savoir un peu plus long sur cet auteur hors du commun (« saint et martyr » comme disait Sartre dans sa longue préface !). Mais on ne comprend pas le sens du tout ! Le sujet étant du plus haut intérêt (on lit avec ravissement les deux textes inclus dans ce volume), on peut se contenter de ce plaisir. Mais pour un musée de cette importance, on est en droit de se poser des questions sur le sens de cette manifestation en fin de compte faite à moitié.

De l'Un-précis, entre chair iconique et écriture de lumière, Esther Segal, L'Harmattan
Livre singulier s'il en est, car il oscille entre la pure théorie de l'art photographique et une réflexion sur les oeuvres que l'auteur réalise à l'aide de ce médium. Elle prend appui sur Maurice Blanchot, Edmond Jabès, Emmanuel Lévinas et bien sûr le bon vieux Sigmund Freud pour insinuer un concept qui n'en est pas un entre le précis et l'imprécis, entre le visible et l'invisible qui est le flou. Et, chose curieuse, elle choisit comme exemple la figure de Judas, qui serait à ses yeux « Judas le flou », car il assume deux fonctions, celle du traître (c'est ce qui doit demeurer perceptible, c'est la destinée qui lui est assignée par celui qu'il a trahi) et celle de celui qui nécessairement savait (ce qu'avance, non sans bon sens, l' Evangile de Judas, apocryphe). Et elle emprunte à Didi Hubermann l'idée d'une ouverture unique qui est celle de l'apparition et de son paradoxe. Pour l'éprouver, il faut voir l'expérience du voile, c'est-à-dire trahir le visible. Nous voyons bien à ce stade que toutes les métaphores qu'elle emploie appartiennent au langage de la photographie. Après quoi, elle examine ce qu'est le flou, « indécis et fuyant ». Celui-ci devrait conduire à un contenu intérieur. Cette étude sur la dissolution des formes n'est pas une recherche de l'abstraction, mais bien autre chose. Nous voyageons dans le monde de l'art, du picturalism anglais à Boltanski en passant par Richter, mais aussi dans la peinture ancienne, pour rencontrer El Greco ou le Corrège. Elle en arrive à la notion de « flou métaphorique » qu'elle exploite dans ses propres travaux. Ce flou est un révélateur, car « plonger dans le flou, c'est plonger dans les profondeurs de l'intériorité, de l'inconscient et de l'artistique, vers l'abîme matriciel, nourrissant l'espoir fou de toucher l'essentiel. » Elle l'assimile à la mélancolie indécise de Kierkegaard. Par la suite, elle utilise la métaphore du désert. Là, elle recherche la relation de soi à soi ou à l'autre. Son cheminement a un triple aspect : esthétique, existentiel et mystique. C'est assez étrange pour qu'on se demande quelle est la fin qu'elle recherche. En fait, le mysticisme n'est pas la fin de ses menées. C'est une tension qui la transporte. Mais toutes ces images religieuses qui traversent son discours ne sont que les soubassements d'une quête éperdue de quelque chose qui se voit et ne se voit pas, qui se cache tout en se révélant. Et son art a cet aspect. Ses planches photographiques se changent en écritures -, une sorte de braille de l'imaginaire. Mais cela, je vous laisse le soin de le découvrir.

Sigmund Freud / Benedictus Spinoza, correspondance, 1676 - 1938, Michel Juffé, « connaissance de l'inconscient », Gallimard, 350 p., 24,50 euro.
Superbe idée que d'imaginer un échange épistolaire entre Baruch Spinoza (1632-1677) et Sigmund Freud à travers les âges. Déjà pour le fait que l'un et l'autre se sont éloignés des croyances judaïques (ce qui a valu au premier d'être excommunié) et à l'autre d'imaginer une théorie qui serait quasiment une alternative. Michel Juffé a rebaptisé Spinoza Benedictus afin de souligner le fait qu'il avait été mis au ban de la communauté juive d'Amsterdam à cause de ses écrits qui placent la nature au-dessus de tout et qui, implicitement, donnent le sentiment que Dieu n'est que secondaire dans cette relation de l'homme et du monde. Cela n'en fait plus un chrétien pour autant ! Mais là encore ce clin d'oeil est amusant. Les premières lettres sont très bien. Mais au fut et à mesure qu'on s'enfonce dans la lecture de ces lettres, c'est Freud qui discute avec lui-même ! Ce dialogue intérieur n'est pas tout à fait inintéressant, car il développe des concepts qui sont le fondement de la psychanalyse et aussi explique des points contestés par son créateur : comme la négation de la pulsion de mort, point sur lequel il insiste beaucoup. On découvre aussi que Freud ne lisait pas beaucoup d'ouvrages philosophiques et que, malgré les conseils insistants de Romain Rolland, il n'aurait lu Spinoza que fort tard dans sa vie. Ces lettres sont finalement la vie et la pensée de Freud reformulées face au Traité théologico-politique (1670) de Spinoza. Il y a des affinités entre les deux hommes, surtout dans la manière d'envisager le conatus, c'est-à-dire la volonté de persévérer dans son être. Pour le reste, non ,car l'auteur de l'Ethique mise tout sur la rationalité, alors que Freud explore l'inconscient qui agit sur la conscience de la rationalité. Ce qui les rapproche vraiment, c'est la rupture radicale avec la tradition juive. Pour Spinoza, ce fut un drame, pour Freud, la source de pas mal d'attaques et de polémiques. Ce livre a sa valeur dans sa capacité à développer les concepts clefs de la psychanalyse sous une forme qui est à la fois originale et pédagogique.

La Méthode Coué, Emile Coué, « Carnets », L'Herne, 72 p., 7,50 euro.
Nous ne cessons de parler de la méthode Coué, sans trop savoir qui était cette personne, ni la nature exacte de sa méthode. Et nous l'évoquons souvent de manière assez ironique. Emile Coué (1857-1926) était un pharmacien originaire de Troyes. En fait, il cherche les moyens de renforcer la puissance d'un remède par la parole, en joignant de petits encouragements écrits aux produits qu'il vend dans son officine. Il constate que les résultats sont très encourageants. Alors il commence à songer à une forme d'accompagnement thérapeutique à laquelle il a donné son nom. Dans un premier temps, il s'agit surtout d'un art de la suggestion, qui permettrait, par exemple, de faire en sorte qu'une personne qui souffre du vertige n'y soit plus sensible. D'expérience en expérience, il en vient à peaufiner sa méthode, qui repose beaucoup sur la volonté du patient et sur l'autosuggestion. La répétition tient une place prépondérante dans ses principes. Et nous n'avons retenu que cet aspect. C'est un petit livre qui ne peut que susciter la curiosité et nous confronte avec le bel optimisme scientifique du XIXe siècle.

Voyage d'un moineau de Paris, Honoré de Balzac, avant-propos de François l'Yvonnet, « Carnets », L'Herne, 98 p., 7,50 euro.
Ce petit volume contient deux nouvelles de Balzac qui sont presque des pochades. La première de ces histoire a fait partie d'un ouvrage collectif, qui avait été réédité il y a une vingtaine d'années au moins. Scènes de la vie publique et privée des animaux, illustrées par Granville, où, en plus de Balzac, ont contribué George Sand, Alfred de Musset, Charles Nodier, entre autres. Balzac a imaginé un moineau qui observe la vie sociale d'autres espèces, bien loin de la sienne, les fourmis, les abeilles et les loups (républicains sous sa plume !). IL est surpris par leur moeurs et les décrit avec minutie. Bien sûr, tout cela est métaphorique, c' est une vision caricaturée, mais féroce, de la manière dont les hommes imaginent leur existence ensemble. C'est la fois charmant et acide. La seconde nouvelle est bien plus connue. Il s'agit des Peines de coeur d'une chatte anglaise, qui est une description assassine des comportements des habitants de la perfide Albion, surtout en matière de galanterie et de proposition de mariage. Notre héroïne, qui vit dans un milieu très huppé, est déçu par le chat britannique, aussi beau soit-il, et préfère le petit chat français, plein d'esprit et de charme, même s'il n'est pas de son rang. L'auteur nous fait sourire et ne verse pas dans les niaiseries qu'inspirent souvent la gent féline apprivoisée ! Ce n'est pas le plus grand Balzac, cela tombe sous le sens, mais c'est un Balzac qui sait s'amuser et amuser ses lecteurs.

Un enfant, Thomas Bernhard, traduit de l'allemand (Autriche) par Albert Kahn, 168 p., 7,50 euro.
Ce livre autobiographique retrace les jeunes années de l'auteur à Traunstein, une petite ville de Bavière. Les deuxSpremières pages suffisent pour que le lecteur comprenne à qui il a à faire : un auteur qui a imaginé une autre façon d'écrire. Thomas Bernhard n'aime pas les paragraphes. Le récit s'enchaîne sans aucune interruption et cela le conduit à adopter une écriture bien différente de celle à laquelle nous sommes habitués. A la fois fluide et pleine de circonstancielles à l'intérieur, qui nous apporte mille informations sur l'enfant, ses parents, sa vie, ses pensées, grandes ou petites. Il aime les périodes un peu longues, qui lui permettent de transformer une phrase en une mine de renseignements. Le déroulé du récit est en somme pour lui un moyen de composer plusieurs partitions narratives, qui s'enchaînent les unes dans les autres à mesure que progresse son histoire. Cette promenade en bicyclette nous apprend mille choses sur le monde de cet enfant de huit ans. Il y a un esprit baroque dans ce livre (comme dans tous les romans et récits de l'auteur) qui est compensé par la simplicité des mots choisis. Tout est lié, et si nous suivons le petit héros dans ses menées, nous ne cessons de voir augmenter le capital de connaissances sur ses origines, sur son mode de vie, sur son entourage et sur le monde et l 'époque où il grandit. Et tout cela nous amène jusqu'aux leçons de piano et le concours qu'il passe pour entrer dans une école de commerce à Salzbourg. La guerre est déjà présente, omniprésente, mais encore loin. Là où s'arrête l'enfance de l'auteur. Ce livre est sans doute le moyen le plus efficace pour pénétrer dans l'univers de Thomas Bernhard. Un univers à nul autre comparable.
Abracadada, Jean-François Bory, Librairie de l'Iris Noir, 44 p.
Ce long poème (comme disent les Anglo-Saxons), (déjà publié par deux fois, mais absolument, résolument introuvable) est le comble de l'avant-garde (pour sa mise en page, pour l'usage de caractères et de signes des genres les plus divers, pour sa fragmentation, pour son esprit décapant, et j'en passe). Mais c'est également le comble de la dérision des avant-gardes, qu'il qualifie au début de dogmes et de dictatures. Voilà un poète bien ambivalent. C'est même sa raison d'être ! Mais ce qui passe aujourd'hui pour de l'avant-gardisme, n'est qu'une refonte de ce passé déjà centenaire ! D'où la vision dérisoire que notre auteur lui attribue tout en jouant sur tous ses registres. Jean-François Bory ne figure pas dans la collection « Poésie » chez Gallimard, et c'est vraiment regrettable : c'est sans le moindre doute l'un des poètes les plus originaux de sa génération. Pour s'en convaincre, il suffit de lire cet Abracadada, où cet apôtre de la religion née avec le futurisme, le dadaïsme, le surréalisme, le cannibalisme et que sais-je encore, s'amuse avec tout ce que ce passé rageur et tapageur lui a légué en héritage et a su en faire encore autre chose, qui donne un je ne sais quoi de neuf, d'inattendu, de sacrilège, à cette épiphanie en langues du monde entier (on y parle japonais et italien, et pas seulement). Marinetti, Tzara, Ezra Pound, une foule de poètes ont contribué à ce melting pot poétique. Mais il n'y a au bout du compte qu'une voix qui domine toutes les autres, la sienne, inimitable, d'une drôlerie irrésistible et pleine d'arrière-pensée sur l'avant pensée (des médisances, des plaisanteries de Gavroche de la noble poésie ultramoderne) des néo avant-gardes de tous poils. Etre et ne pas être tout à la fois, telle reste la question de ce que nous faisons là, anciens et modernes, en même temps, par définition, comme par punition.

Jean Fernel, premier physiologiste de la Renaissance, Paul Mazliak, Hermann, 164 p., 22 euro.
Cette étude sérieuse et documentée de la vie et de l'oeuvre de Jean Fernel (1497-1558) est d'un grand intérêt : elle nous révèle l'état de la thérapeutique et de la science médicale pendant la Renaissance française. Cet homme érudit, qui avait des connaissances dépassant le champ spécifique de sa recherche, a voulu considérer la médecine de la manière la plus rationnelle possible. Il tente de s'éloigner des modèles antiques et aussi des éléments introduits au Moyen Age. Les Sept livres de la physiologie, publié en 1554 d'abord sous le titre de Médicine, que l'auteur analyse en détail montre que son désir est réel et qu'il s'efforce de dépasser le savoir dans ce domaine. Mais il est freiné par plusieurs choses, en particulier son peu d'expérience en matière d'anatomie. Cela peut paraître paradoxal ,car il considère que l'observation du corps humain est primordiale ; mais les possibilités d'assister à une dissection étaient encore assez rares, d'où certaines erreurs. Il commente en détail ce qui lui semble être la machinerie du corps dans ses observations. Il commet bien des fautes dans son jugement, mais, quoi qu'il en soit, il ouvre la voie à la médecine moderne. Paul Mazliak expose très bien le rôle éminent de ce pionner de la médecine moderne et les cheminements précis de sa pensée pour aboutir à décrire le fonctionnement de la machinerie humaine.

Vivre avec un inconnu, miettes philosophiques sur les chats, Florence Burgat, Rivages poche, « Petite Bibliothèque », 110 p., 5,10 euro.
« Miettes philosophiques » me paraît un terme bien excessif pour ces réflexions, nourries de belles citations, qui tendent à faire mieux comprendre la relation complexe du chat et de l'homme. IL faut dire que les écrivains ont toujours éprouvé une attirance profonde pour cet animal, qu'ils regardent avec un étonnement et un plaisir qui ne se consument jamais. Dans ce petit ouvrage, le côté mystérieux du chat, son indépendance qui ait égale à sa dépendance, tout ce qui le rend digne d'admiration esthétique, mais aussi morale, sont sans doute faits pour que poètes et romanciers l'adoptent de manière exclusive. Le chien est un compagnon fidèle, le chat non. Il est à fois présent et absent et son énigme ne peut être dévoilée. Florence Burgat ne nous fait pas avancer beaucoup dans la connaissance de ces relations particulières, mais s'en tire bien, même si le sujet est éternellement rebattu. On lira avec satisfaction ce mince essai, mais l'espoir d'y trouver merveille est forcément déçu. Que les femmes et les hommes de lettres qui n'ont jamais écrit sur le chat lèvent la main !

Son corps extrême, Régine Detambel, Babel, 160 p., 6,80 euro.
Paru en 2011, ce roman (mais peut-on parler de roman dans ce cas d'espèce ?) repose sur l'obsession majeure de Régine Detambel : le corps, dans tous ses états, son corps, le corps des autres aussi. Elle a imaginé ici un accident épouvantable (ou peut-être un suicide) qui inflige de nombreuses blessures à Alice -, des blessures graves, longues à soigner. Et elle décrit les dégâts anatomiques avec le plus grand soin, ainsi que leur guérison à force de temps et de patience douloureuse. Comme toujours, l'auteur ne s'en sort pas mal, car elle est douée, elle aune belle écriture , elle est intelligente. Mais quelque chose manque à son histoire, qui tient à son état d'esprit « clinique ». Il manque de la chimie et de l'alchimie à ce récit, plus d'imaginaire et de folie, car la destruction partielle du corps est, pour qui en est la victime, un moment d'effroi qui porte aux extrêmes de la raison. Cela dit, elle introduit tout de même des bribes de bizarrerie chez son héroïne, qui font accepter le reste -, de belles et saines hantises fétichistes et un anticonformisme à tout épreuve. Ces divergences, ces différences, ces écarts, donnent plus de poids et de résonance au reste de son affaire, qui est tout à fait crédible, presque trop crédible. La réalité vécue dépasse parfois la fiction chez elle. Mais, n'allons pas nous plaindre, au moins, cet auteur a le mérite de ne pas sombrer dans la grisaille du roman passe-partout qu'on nous sert avec une régularité de métronome dans toutes les maisons d'édition de France et de Navarre.

Dans la peau d'une blanche, Marie Binet, L'Age d'Homme, 272 p., 20 euro.
On peut vraiment parler ici d'un roman familial. Quand décède sa mère, Agnès, Lisa s'intéresse à une pochette que cette dernière avait dissimulée. Contre l'avis de ses frères et de ses soeurs, elle décide d'emporter l'objet avec les secrets qu'il contient. Ce qu'elle y trouve n'est guère parlant, des bons de ravitaillement et quelques autres papiers. Mais elle est fermement décidée de faire parler même le plus mince indice. Avec obstination, elle réussit peu à peu à reconstituer l'histoire de sa mère, qui avait été la maîtresse d'un officier allemand pendant l'Occupation. Puis elle commence à voir plus clair dans l'histoire des origines : son père n'était pas hongrois, mais un homme dont le père était natif de la Martinique. Elle découvre avec stupéfaction qu'elle est noire ! Son grand-père avait connu l'éruption de la Montagne Pelée en 1902 et ses arrières parents avaient été des esclaves affranchis ! Ainsi se recompose le puzzle de son histoire et de l'histoire de ses ancêtres, en révélant des destinées bien curieuses. Au lieu d'être attristée par ses découvertes, elle en est au contraire galvanisée et poursuit avec vigueur son métier de cinéaste. De facto, l'histoire que nous délivre Marie Binet est beaucoup plus compliquée, car elle concerne tous ses proches, qui ont eux aussi leurs mystères. Composé de façon très classique, sans originalité aucune de ce point de vue, ce livre n'en est pas moins attachant, car l'auteur est douée pour narrer ces affaires de famille assez embrouillées et parfois dérangeantes. Cette fiction a tout à fait l'air d'une autobiographie peut-être transposée. Peu importe d'ailleurs, puisque seule compte la valeur de l'ouvrage, qui se lit quasiment d'une traite, avec intérêt et plaisir.
|
