
André Gide et les peintres, lettres inédites, dossier présenté par Pierre Masson & Olivier Monoyez, « les inédits de la Fondation des Treilles », « Les Cahiers de la NRF », Gallimard, 208 p., 18, 50 euro.
La passion d'André Gide pour la musique et la photographie où on le voit devant son piano est l'une des plus célèbres. Mais rares sont ceux qui connaissent ses relations privilégiées avec certains peintres. Cette anthologie de lettres échangées avec des artistes nous éclaire sur cet aspect méconnu de ses goûts. Il est assez curieux de constater que le premier créateur qui l'intéresse profondément est Odilon Redon. Leur échange de lettres commence en 1892, trois ans après que Gide ait lu A Rebours de J.-K. Huysmans. A cette époque, Redon est connu pour ses illustrations d'Edgar Allan Poe et de Gustave Flaubert et il est un des habitués des mardis de Mallarmé. Gide lui achète un fusain, Tête laurée de 1880, qui a été présentée à l'exposition chez Durand-Ruel. C'est le point de départ de sa collection. On ne sait quand ont cessé leurs échanges. Gide a écrit un essai critique sur son correspondant. En ce qui concerne Jacques-Emile Blanche, leur rencontre a lieu en 1891. Gide a eu l'idée de publier un livre de Blanche chez Gallimard, mais le volume se révèle trop gros et l'histoire s'est ensablée. Et c'est ce dernier qu'il a l'occasion de faire la connaissance de Walter Sickert, qui s'est installé à Dieppe. Gide fait le voyage et constate que ce dernier vit dans un dénuement relatif.
Il lui commande un panneau décoratif pour sa propriété de campagne et puis un tableau représentant une vue de Venise. Quand leur échange épistolaire cesse en 1912, Sickert a enfin gagné en notoriété. Ses relations étroites avec Théo Van Rysselberghe, lui ont permis de croiser de nombreux peintres postimpressionnistes, dont Paul Signac. Il a adressé à René Piot une longue série de missives. Celui-ci lui a fait une grande peinture murale pour sa villa de Montmorency. Quand il a dû la vendre, il lui a fallu l'aide de l'artiste pour la déménager. Parmi tous les peintres qu'il a connus, l'un des plus intéressants est le Britannique William Rothenstein (1872-1945), ami de Rodin, de Toulouse-Lautrec et de Degas, qui avait illustré un livre de Tagore. C'est au moment où il parvient à faire acquérir les droits de Tagore que Gide entre en relation avec lui. Il a aussi des rapports avec Dunoyer de Segonzac qui fait un petit portrait de lui au crayon, avec Marie Laurencin qui fait aussi un portrait de lui, et avec Raoul Dufy, qui illustre sa Tentation amoureuse. Gide a été un collectionneur « distrait », et pas toujours très avisé. On comprend dans ces pages que l'art l'intéressait, mais pas au point de nouer de fortes amitiés avec les artistes.

Léonard de Vinci, l'énigme des images, Jeanette Zwingenberger, Editions in fine, 96 p., 22, 00 euro.
Rarement l'anniversaire d'un artiste n'a entraîné un tel déluge de publications. Il est vrai qu'il ne s'agit pas de n'importe quel artiste, mais le phénomène mérite d'être souligné ! Dans cet ouvrage, l'auteur a voulu comprendre comment il a projeté ses objets et ses figures dans l'espace plastique. La première partie concerne les différentes Vierges apparues sous son pinceau. Elle commence par étudier celle de L'Annonciation des Offices de Florence. C'est une oeuvre de sa jeunesse à l'époque où il se trouvait encore dans l'atelier de Verrocchio. L'auteur en fait l'analyse iconographique avec soin. Le paysage dénote qu'il appartient encore à une phase bien affirmée de la Renaissance italienne.
La composition est horizontale et presque symétrique. Là encore le rendu est celui de l'époque (il l'a peint cette oeuvre entre 1472 et 1475). A ses yeux, la nouveauté résiderait dans la représentation du port de Livourne au fond. Mais je ne crois pas qu'il y ait rien d'extraordinaire puisque ce port permettait le commerce florentin sur la Méditerranée. On peut seulement s'étonner de la bande de tissu doré placée entre le manteau et la robe. Mais l'interprétation qu'en donne l'auteur ne repose sur rien de sûr. C'est une pure extrapolation. Rapprocher ce plissement de ses recherches anatomiques et des leçons de dissection du médecin Marcontonio de la Torre ne paraît pas probant, pas plus qu'une traduction d'ordre mystique. Les éléments de la réflexion sont justes, mais les conclusions sont bien incertaines. Et puis rapprocher sa peinture de ses dessins, qui n'étaient que des notes scientifiques est peu convaincant.
On peut dire la même chose à propos de Sainte Anne, la Vierge à l'Enfant bénissant Jean-Baptiste, un ensemble commandé par Louis XII vers 1499 et que Léonard a réalise en 1503 et 1519. La seule vraie question est le fond, qui a changé complètement de nature depuis ses débuts, avec ses subtils sfumati. L'auteur examine ensuite La Vierge aux rochers et rappelle les conditions de sa création (elle a fait l'objet d'un contrat en 1483 voulue par la confrérie laïque de l'Immaculée Conception, de l'ordre franciscain. Là où l'auteur a raison, c'est que Jean Duns Scott a bien été le premier a affirmer cette immaculée conception pour l'imposer comme dogme à la fin du XIIIe siècle. Pour le reste, je reste dubitatif. Mais ce que je vois de positif dans cette recherche, même si elle est mal menée, c'est qu'elle forcera le lecteur à s'interroger sur les divers éléments qui composent un tableau pour en deviner le sens. Mais comme l'a si bien souligné Daniel Arase dans On n'y voit rien, il demeure bien des zones d'ombre dans l'art de la Renaissance et celles-ci font souvent partie de la poétique de l'artiste ou même d'une signature occulte ou d'une plaisanterie difficile à déchiffrer. La seconde partie de l'ouvrage concerne les sciences, les motifs décoratifs et l'architecture. Le chapitre le plus curieux pour le lecteur est sans doute celui qui concerne le château de Chambord, car si Léonard a bien réalisé les escaliers, il avait dessiné les plans de tout l'édifice. En somme, cet ouvrage peut éclairer quiconque a envie d'en savoir plus sur Léonard de Vinci, mais à condition de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'affirme son auteur.
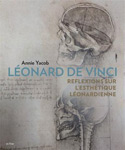
Réflexions sur l'esthétique léonardienne, Annie Yacob, Editions in fine, 160 p., 25 euro.
L'une des premières surprises que l'on a en lisant cet ouvrage c'est d'apprendre que Léonard de Vinci n'est entré qu'à l'âge de quinze ans dans l'atelier d'Andrea Verrocchio. C'est inusité à l'époque car les garçons pouvaient rejoindre une bottega à l'âge de huit ans. L'autre point est sa formation. On sait que l'artiste, a contrario de beaucoup de ses pairs, ne connaît ni le grec ni le latin et qu'il s'exprime dans le toscan vulgaire (on dirait dialecte aujourd'hui). D'aucuns ont pu affirmer que ce fut pour lui un complexe qui le hantera toute sa vie. Annie Yacob nous donne de nombreux exemple de son désir de se perfectionner et qu'il a tout fait pour se faire traduire des traités anciens, comme, par exemple, celui de Gallien.
Quand il part pour Milan, il n'emporte avec lui que cinq ouvrages fondamentaux, dont Les Eléments et l'Optique d'Euclide. On sait qu'il s'est constitué ne bibliothèque ancienne et moderne et qu'ii possède 103 volumes en 1503. Sa soif de connaissances est énorme. Mais son initiation reste essentiellement celle d'un autodidacte. Ce qui tranche avec l'image qu'il a laissé d'un génie universel !
Mais son sérieux et son acharnement à embrasser le plus de connaissances possibles, en dépit du barrage constitué par l'ignorance des langues classiques, sont remarquables. Il a aussi étudié l'italien des lettrés. En somme, il est parvenu, par l'étude mais aussi certains artifices (il n'a pas hésité à piller certains des auteurs florentins, en particulier pour tout ce qui concerne la mécanique et les techniques en général). Ce qui est vraiment passionnant ici c'est qu'on découvre l'origine des livres que Léonard consulte et aussi qu'il a commencé assez tôt (déjà chez Verrocchio) à faire des commentaires dans ses codex, critiquant par exemple les considérations sur l'optique de Roger Bacon. Mais la plupart du temps, il ne cite pas ses sources. On peut être surpris, quand l'auteur aborde la question de la peinture, considéré encore art mécanique, que le nom de Cicéron n'apparaisse pas car c'est lui qui a forgé la formule qu'il a reprise « la pittura è cosa mentale ». En revanche, il développe la relation de cet art avec la mathématique (il n'en est pas l'inventeur et de loin : Alberti en avait déjà indiqué les grandes lignes). En revanche, l'auteur voit bien le problème qui a été le sien dans la quête de la beauté qui est aussi pour lui recherche de la perfection. Et bien sûr, il est des adeptes qui croient que la peinture est comparable à la poésie en reprenant la formule d'Horace : « ut pictura poesis ». C'est tout l'enjeu à son époque de tenter de parvenir à cette équivalence. Léonard prône la prédominance de la vue sur l'ouïe. Je ne veux pas décortiquer tout ce que ce livre contient, car il est riche est malgré tout précis, en dépit de quelques erreurs patentes. Il se révélera très utile à tous ceux qui ont le désir de connaître de manière plus détaillée la pensée de cet immense artiste et il permet de comprendre ses postures sur la perspective, sur la lumière et son dessein secret de faire e la peinture une science.

Hiroshige en 15 questions, Jocelyn Bouquillard, Editions Hazan, 96 p., 15, 95 euro.
Les frères Goncourt ont consacré deux monographies sur d'illustres artistes japonais de l'ère d'Edo : Hokusai et Outamaro. Ils auraient pu tout aussi bien prendre Utagawa Hiroshige (1797-1858), qui s'est distingué par une suite d'estampes intitulée Cinquante-trois relais du Tôkaidô (réalisées entre 1833 et 1834) et une autre intitulée Cent vues d'Edo (1856). L'ouvrage, ouvertement didactique, permet en premier lieu de se familiariser avec le style de ce créateur qui figure parmi les plus grands de cette époque. Ensuite, à travers les questions posées, il permet d'apprendre l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur la technique de ces xylographies (l'auteur a raison de souligner que l'artiste n'était pas graveur lui-même et que ces compositions étaient donc réalisées par des maîtres graveurs -, mais en sachant toutefois qu'il les faisaient en vie d'une gravure - rares sont ceux qui, comme Hokusai, ont pu peindre en dehors de la gravure). On apprend beaucoup sur cet art porté à son point suprême au Japon, sur sa singularité par rapport au passé et ce qu'il a pu apporter de novateur dans la représentation du paysage.
L'auteur pose aussi des questions sur des thèmes utilisés par Hiroshige, comme le chemin du Tôkaidô, les samouraïs, sur les modes de représentation de la mer, de la flore et de la faune, sur le rendu de la pluie ou de la neige. Il y a là un mélange de réalisme très poussée et d'abstraction, qui fait la beauté et le charme de ces ouvrages aussi raffinés. Enfin, Jocelyn Bouquillard évoque la découverte de cette forme artistique en Occident au milieu du XIXe siècle et de son impact considérable sur l'art occidental. Peut-être la dernière question sur le fait de savoir si on peut le considérer comme un impressionniste est peut-être malheureuse ou en tout cas inutile. Mais il n'en reste pas moins que ce livre est fait avec discernement et peut vraiment éclairer qui chercherait à mieux comprendre cet art qui demeure malgré tout si loin de nous même s'il a métamorphosé en partie l'art français de Monet à Van Gogh.

Hiroshige, paysages célèbres des soixante provinces du Japon, Anne Séfriou, Editions Hazan, 184 p., sous coffret, 29, 95 euro.
Les éditions Hazan poursuivent la publication des grands livres xylographiés de la très riche période d'Edo et cela est une très bonne chose car on découvre des ouvrages moins connus. C'est le cas de celui-ci réalisé par Hiroshige entre 1853 et 1856 (terminé deux ans avant sa mort), qui s'est fait connaître et a été admiré pour ses paysages. Son style se démarque de ses plus grands concurrents par plusieurs traits spécifiques : le dégradé très accentué des couleurs, les contrastes qui en résultent, par exemple, entre le bleu et vert, le passage constant des tonalités chatoyantes à des tonalités aigres, son désir de transformer les bords d'une rivière ou le rivage de la mer comme un compendium de l'univers nippon. Il n'est pas le seul à procéder de la sorte. Mais il a été parmi les premiers à utiliser des perspectives aériennes, embrassant un vaste champ visuel, pour restituer la beauté du spectacle qui s'est offert à sa vue. La relation à l'humanité et à ses travaux est très souvent mineure même si ses personnages, surtout des pécheurs, finissent par faire partie intégrante de cette vision.
Il aime beaucoup dépeindre la nature telle qu'en elle-même, en abolissant toute trace de la civilisation. Et quand il marque la présence humaine, sur les flots comme dans les montagnes, on a toujours le sentiment qu'elle n'est qu'une fragile superposition à toutes les beautés de son monde. Dans cet album, qui compte soixante-dix planches (table des matières incluse), on voit combien il s'éloigne de la vie trépidante de la capitale, Edo (aujourd'hui : Tokyo) pour mettre en relief ce que la nature peut révéler encore de magnifique, au-delà des artifices d'un monde nouveau et industrieux. Hiroshige n'est pas un nostalgique : il ne se tourne pas vers un passé désormais mythique (d'abord celui de la littérature), mais vers un présent qui est placé sous le signe d'une contradiction intense entre la ville et ce qui l'entoure. Cela étant posé, il n'insinue aucune critique dans ses ouvrages, mais plutôt une remise en place des valeurs fondamentales. C'est là un pur chef-d'oeuvre qui a contribué à faire de la gravure un art tendant à rejoindre les sommets de l'art classique, non seulement dans la qualité suprême de son exécution, mais aussi dans ses sujets de prédilection.

Les Femmes célébrées par les grands maîtres de l'estampe, Amélie Balcou, Editions Hazan, 184 p., 29, 95 euro.
Toujours sous forme de coffret avec un album en accordéon et un opuscule nous fournissant une présentation générale et les légendes des oeuvres réunies, les éditions Hazan nous régalent d'un choix de portraits de femmes des plus grands artistes de la période d'Edo. L'auteur du recueil a choisi de commencer par des dessins de Kitagawa Utamaro, qui représentent à peu près la moitié des reproductions. C'est vrai qu'il a été un des grands portraitistes de cette période. Moi, j'aurais plutôt choisi de débuter par Harunobu, qui est sans aucun doute l'artiste qui a su insuffler le plus de sentiment dans ses figures féminines, avec une infinie délicatesse, de la sensibilité, des nuances subtiles, une grâce infinie (il ne figure pas dans ce livre, c'est vraiment dommage !). Il faut d'ailleurs noter qu'il y a peu d'artistes élus ici : Kikukawa Eizan, Utagawa Kunisada II, Ichirakutei Eisu, Chôbôsai Eishi, Yoshitoshi mais sans Hokusai, aussi curieux que cela puisse paraître.
Ce choix peut sembler curieux, et il l'est. Mais plus bizarre encore les explications historiques apportées par l'auteur, qui nous parle des réformes Kyôhô (1716-1736), qui auraient appauvri ce genre particulier par une moralisation de la société. Hors c'est justement les années où a fleuri l'art d'Harunobu ! Il est vrai qu'un grand nombre de ces portraits étaient ceux de courtisanes célèbres (mais aussi de geishas) qui, comme les grands acteurs du théâtre kabuki, diffusaient leur image en guise de publicité - des publicités bien plus luxueuses que celles des prostituées de haute volée à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Malgré les diverses répressions, l'art de l'ukiyo-é n'a jamais connu de basse marée jusqu'à la fin de l'ère d'Edo, malgré les tentatives de censure. Ce qui est en tout cas fascinant dans ce choix c'est qu'on y perçoit l'essentiel : la stylisation et la sublimation de la femme par le vêtement, le maquillage et la coiffure, sans parler de l'expression et de la pose, tout contribuant à en faire un être qui dépasse l'humanité commune. Ces femmes n'étaient pas déifiées, loin s'en faut, mais elles étaient changées en une pure beauté concrétisée dans leur manière de paraître. C'est véritablement superbe et ce livre nous procure une autre idée de la femme, hautement idéalisée et pourtant d'une extraction assez commune. La Nana de Zola, avec tous ses atours à la dernière mode, n'airait pas sa place dans cette galerie de portraits. Elle appartient à la même congrégation, mais pas à la même esthétique.

Concept-Car, Beauté pure, sous la direction de Rodolphe Rappetto, RMN Grand Palais / Château de Compiègne, 232 p., 40 euro.
L'histoire de l'automobile n'a pas été qu'une histoire technologique : ce fut aussi une grande aventure esthétique. Bien sûr, quand on voir les premières voitures sortir des ateliers, elles avaient tendance à ressembler aux landaus ou aux berlines tirés par des chevaux. Ces premières « voitures sans chevaux » imitaient encore en 1895 ces véhicules qui ont été tant aimés au cours de presque tout le XIXe siècle. Il n'était pas suffisant d'imaginer un monde qui échappe à la notion si répandue d'hippomobile, mais encore fallait-il trouver à cette invention révolutionnaire un style qui lui soit propre. Cela ne s'est pas fait très vite car il y avait de nombreuses questions techniques à résoudre, le confort du passager à respecter ou alors la capacité à transporter des charges importantes sur des routes encore peu pratiques. Quand on observe les véhicules de la fin de la Belle Epoque avec leurs hautes silhouettes, comme par exemple les fameux taxis de la Marne, on se rend compte su la production en série avait débutée, le principe initial était à peu près conservé malgré de nombreuses innovations sur la carrosserie, le moteur et les accessoires. Mais ce n'est qu'au cours des années vingt qu'on parvient à concevoir des automobiles rapides et a leur donner une forme tendant aux formes aérodynamiques que nécessitent leurs capacités techniques de plus en plus impressionnantes. Ce que l'auteur a voulu montrer dans cette exposition et dans ce catalogue, c'est la notion de « concept-car », c'est-à-dire l'idée de développements possibles de certains modèles, qu'ils soient réalisés ou non. Cette notion s'affirme vraiment au cours des années trente et épouse l'idée de la streamline, qui a beaucoup de points communs avec l'avion ou les locomotives de trains.
On crée à peu près simultanément les automobiles du présent et celle d'un futur pas si lointain, même si l'on a l'impression que ces voitures appartiennent à un univers de science fiction. Les courses automobiles ont beaucoup contribué à cette vision futuriste, car il s'agissait de mettre en scène des prototypes faisant valoir les meilleures performances d'une marque. C'est dans cette recherche permanente qui associe la technique la plus poussée, le style et le goût aussi d'une époque qu'on en est arrivé à penser des véhicules destinés à tout à chacun qui possédaient des caractéristiques assez voisines de leurs précurseurs sur les autodromes. De la « Jamais Contente conçue dès 1899 par le visionnaire Camille Jenatzy, qui a longtemps demeuré l'exemple de la voiture aérodynamique, à la Bugatti T28, qui va être dès le début des années vingt le prototype de la voiture de course, sans cesse perfectionnée et capable de battre des record et aussi de s'adapter à la vie civile. On découvre aussi la figure intéressante de Louis Bonnier, créateur de la Panhard de 1948, véritable bijou d'une modernité à portée de main.
Ce qui est aussi distrayant que passionnant dans ces pages, c'est que nous voyons défiler sous nos yeux les projets les plus audacieux et les plus excentriques, comme la voiture de Marcel Leyat dotée d'une grande hélice à l'avant (1921), L'oeuf de Paul Arznes (1942), la Chrystler-Hia Streamline de 1955, l'Alfa-Romeo Gulietta de 1956, la Fiat Stanguellini 1200 de 1957, la Chevrolet Corvisar Restudo Bertone de 1963, je ne pourrais les citer toutes. On découvrira aussi d'antiques motos, comme la Moto Major de 1950 ; des voitures ayant battus des records comme la légendaire Bugatti bleue et la De Coucy de 1948... Ce sont plusieurs histoires qui se croisent dans ce catalogue qui nous fait découvrir beaucoup de choses sur une industrie qui a parfois voulu être aussi un art.
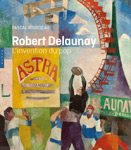
Robert Delaunay, l'invention du Pop Art, Pascal Rousseau, Editions Hazan, 336 p., 39, 95 euro.
Il m'est arrivé de temps à autre de pester contre les sous-titres des expositions ou de certains livres. Celui-ci est peut-être le plus absurde que j'ai pu découvrir : en quoi Robert Delaunay pourrait-il être l'inventeur du Pop Art ? Si vous pensez comme je pense, les auteurs de natures mortes hollandais du XVIIe siècle pourraient être tout aussi bien vus comme les précurseurs du Pop Art américain ! Que l'auteur soit un professeur d'histoire de l'art laisse pantois. Il fonde son raisonnement sur l'idée d'un darwinisme historique : tout événement artistique est légitimité par un autre événement ayant lieu ultérieurement... De plus, Delaunay n'est pas le premier artistes à avoir introduit la réclame dans ses compositions (cela a existé dans les oeuvres cubistes et futuristes, en France, en Russie et ailleurs).
Sans compter ceux qui, pendant la Belle Epoque ont été l'auteur d'affiches ou d'objets publicitaires. Robert Delaunay (1885-1941) n'a pas eu une passion décisive pour les études. De 1902 à 1904, il collabore à la création de décor de théâtre dans l'atelier d'Eugène Ronsin. Son oncle, Charles Damour, l'initie à la peinture. Mais il défendait un point de vue traditionnel et leurs rapports ont été orageux. Il a choisi la voie de la modernité la plus radicale, mais à sa façon : s'il utilise les ressources du cubisme, il le fait d'une manière qui n'est pas celle d'un disciple ou d'un suiveur. Ce qui fait l'originalité de cette étude, c'est que l'auteur a voulu montrer, avec le plus de précision possible, quels ont été les éléments publicitaires ou photographiques que le peintre a utilisé pour des oeuvres célèbres comme Les Trois Grâces (1904) ou La Ville de Paris (1914, qui est un développement du même sujet) ou L'Equipe de Cardiff (1913). C'est passionnant car tous ces panneaux publicitaires et prennent sens dans le contexte de l'époque. Mieux encore, l'auteur met en avant la relation toute particulière de l'artiste avec ce nouvel art des rues et de la presse.
Il nous apprend que Delaunay a même fait quelques tentatives (en particulier pour la marque Dubonnet). L'autre aspect intéressant est de faire apparaître son aspiration à l'abstraction, qui est forte, mais qui se produit dans une valse-hésitation. Cela est manifeste dans les nombreuses versions de L'Equipe de Cardiff, d'où toute réclame disparaît : chacune d'entre elle montre un état d'esprit bien spécifique avec la mise en acte du rayonnisme ou non. Sans doute la démonstration ne nous apprend rien de nouveau, en dehors du fait que l'artiste avait une relation beaucoup plus marqué qu'on ne l'aurait cru avec la réclame qui envahit le monde d'alors avec une rapidité et inefficacité surprenantes. Cela peut toutefois nous faire considérer son oeuvre sous une autre optique. Son incapacité à choisir entre l'abstraction ou la figuration peut sembler étrange, mais ce jeu rend son entreprise quasiment unique car on prend conscience de la tension entre des sujets qu'il souhaiterait traiter (du manège à cochons aux joueurs de football) entre de pures extrapolations formelles et chromatiques. Dommage que l'éditeur ait choisi un corps aussi petit pour le texte : c'est illisible ! Quant au Pop Art, on l'a un peu oublié chemin faisant, par bonheur.

Olivier Wickers, Proust face à l'énigme Léonard,une saison au Louvre, Editions Exils « Arts », 144 p.
Bien que Marcel Proust traite de mille sujets divers dans A la recherche du temps perdu, de la stratégie militaire à la médecine, pour ne citer que ces deux cas, il est tout de suite manifeste que l'art joue un rôle prédominant. Il est toujours difficile de comprendre dans son oeuvre, telle qu'elle est construite, la place véritable de telle ou telle figure ou tel ou tel argument. Il est indéniable que la figure de l'artiste Elstir tient une place de premier plan dans son oeuvre. Beaucoup de lecteurs l'ont assimilé au seul Monet, ce qui est faux, comme le Lentier d'Emile Zola n'est pas Paul Cézanne comme ce dernier l'a cru : c'est une synthèse de plusieurs peintres qu'il estime pour telle ou telle raisons souvent discordantes tout come le Claude Lentier de L'oeuvre d'Emile Zola (1886) : ce dernier incarnent plusieurs artistes que l'écrivain a pu connaître de son temps. Elstir est bien sûr Manet, sans l'ombre d'un doute, mais aussi Whistler, Helleu, Manet, Renoir, Boudin et vraisemblablement quelques autres. Au contraire de Lentier, il campe le succès et l'idéal. C'est presque son opposé même s'il sort de la même généalogie créative. On le comprend au fil de l'ouvrage : Elstir est une sorte de double complexe de l'auteur.
Proust parle beaucoup de peinture, dans son grand livre, comme si celle-ci était une sorte de canevas esthétique servant ses desseins. Olivier Wickers est bien conscience de cette fonction et plutôt que d'embrasser l'ensemble de la question (ce qu'ont fait d'autres commentateurs dans le passé) a choisi de prendre Léonard de Vinci comme paradigme. Déjà dans sa jeunesse, Proust possédait une reproduction de La Joconde qu'il conservait jalousement. De là à le considérer comme un amoureux de cette Florentine est un peu excessif et l'auteur a parfois de ces élans excessifs. Mais, plus important, et de loin, Léonard, s'y est démontré très fidèles à ses idées sur l'art pictural. Ce tableau est pour lui un sujet de méditation sur ce que doit être un ouvrage idéal avec tout ce que cela implique. L'auteur note que l'écrivain ne parle jamais du sourire qui vient aussitôt à l'esprit de tout un chacun. L'autre tableau qui le fascine est le Saint Jean Baptiste. L'androgynie très marquée du personnage le subjugue et l'interroge bien plus que la Mona Lisa qui est, a priori, une femme. Laissons de côté l'affaire homosexuelle, qui est bien secondaire ici. Ce qui compte c'est que la figure est placée sous l'enseigne de l'ambiguïté et que dans sa conception de la perfection humaine, Léonard voyait la conjonction des deux sexes comme l'avait conçue Platon. Si l'on fait exception des comparaison avec le présent, le parallélisme (inexistant) avec Sigmund Freud et quelques erreurs historiques (Jean Lorrain n'est pas un critique, mais un romancier à la mode, qui ne manquait pas de talent, mais avait le défaut d'écrire un peu vite), le livre d'Olivier Wickers mérite d'être lu car c'est une excellente introduction à la relation subtile de Marcel Proust avec les peintres anciens qu'il aimait, qu'il observait avec grand soin et discutait dans ses écrits romanesques.

Volume 1 : L'Avertissement de Socrate, volume 2 : Je vous écris avant l'aube, Salvatore Satta, traduit de l'italien par Christophe Carnaud, sous coffret, Editions Conférence, 892 p., 45 euro.
Le Bons sens, Michel Bernard, La Table Ronde, 208 p., 20, 00 euro.
Pour tout bon écolier français est le roi sans territoire et presque sans armée que la bergère Jeanne est venue sauver et faire couronner dans la cathédrale de Reims. Après l'échec devant les murs de Paris, Charles VII l'a abandonné aux Anglais qui l'ont brûlée à Rouen. Michel Bernard a eu l'idée de raconter la suite du règne de ce roi mal aimé. Et force est de constater que cette figure assez médiocre au caractère indécis a montré par la suite plus de résolution. Et nos livres d'histoire s'arrêtent après le supplice de celle dont le procès est révisé dès 1455 par Calixte III et encore repris en 1456 et qui sera béatifiée en 1909 et canonisée en 1920. Cette focalisation sur la jeune bergère en armure a complètement gommé l'histoire de France.
Or Charles VII chasse les Anglais de Paris, reprend Rouen (non sans s'être accordé par les Bourguignons). Et ce que l'on sait encore moins, c'est l'action militaire entreprise au sud de la Loire, qui voir l'Aquitaine retourner dans le giron de la France. En 1453, il met un terme définitif à la guerre de Cent ans et a fini par chasser les Anglais du continent. Michel Bernard fait d'ailleurs un curieux parallèle avec un autre événement majeur survenu cette même année : la prose de Constantinople par les Ottomans. Une fois de plus, la geste chevaleresque et militaire de Charles VII est minimisée par la disparition de Byzance. Mais cela nous fait comprendre pourquoi on l'a surnommé « le Victorieux ». Il n'a pas eu ces seules qualités guerrières car il est parvenu à assainir les comptes bien mal en point du royaume grâce aux conseils avisés de son grand argentier Jacques Coeur. Et avait déjà réussi à vaincre les féodaux insurgés (soulèvement qu'on a appelé « Praguerie ») contre de nouvelles formes d'impôts (ordonnances d'Orléans de 1439). Il a aussi joué un rôle dans le domaine des arts en choisissant Jean Fouquet comme peintre officiel. Outre son portrait et celui de son épouse Marie d'Anjou, il lui demande de faire celui de sa maîtresse Agnès Sorel, demoiselle d'honneur d'Isabelle Ierede Lorraine, l'épouse du roi René d'Anjou. Sa favorite a été surnommée alors « la dame de Beauté » (elle mourut en 1450). Fouquet a été le grand précurseur dans les arts plastiques de la Renaissance française et en a aussi immortalisé les étapes. Le roman est très fidèle à la réalité historique. On soupçonnerait l'auteur d'avoir voulu raconter les choses au plus près de la vérité historique sous une forme romanesque agréable, mais aussi très rigoureuse. Au fond il se permet assez peu de liberté et d'interprétations et ne trouve un allié par delà le temps qu'en la personne du remarquable artiste qu'a été Fouquet.

Soulages, d'une rive à l'autre, Michaël de Saint Cheron & Matthieu Séguéla, Actes Sud, 80 p., 25 euro.
Les monographies sur Soulages ne cessent de se multiplier car, en décembre dernier, il a fêté ses cent ans. C'est le dernier protagoniste de l'Ecole de Paris encore vivant. La disparition d'Albert Bitran, un an plus tôt n'a suscité qu'une seule publication et encore par la volonté de la famille. Le premier auteur a concentré son intérêt sur les célèbres vitraux de Conques qui, il faut bien l'admettre, sont admirables. Ils s'adaptent très bien par leur grande pureté et simplicité à l'esprit de l'abbé Oldoric qui en a fait commencer la construction en 1041. L'abbatiale Sainte-Foy constitue sans nul doute un des plus beaux exemples d'architecture romane en Occitanie et les oeuvres de Soulages s'y intègrent à merveille. Il s'est mis au travail dès 1980 et a souhaité utiliser, contrairement à la tradition, un verre non teinté dont la partie lisse est elle tournée vers l'extérieur. Il y a des nuances dans ces travaux et pas seulement du noir et du blanc. L'auteur, en voulant retracer le parcours de l'artiste depuis l'après-guerre, a tendance a le réinventer en postulant une prédilection pour le noir dès le début. Certes le noir joue son rôle dans ses compositions, mais il y a bien d'autres couleurs, comme le rouge et bleu, entre autres.
C'est une mystification qui a été l'objet de la dernière grande rétrospective au Centre Pompidou, où l'auteur a même prétendu que Franz Klein l'avait imité ! Mais en dehors de ces pieds de nez à l'histoire la plus concrète, l'auteur relate assez bien quelle a été la démarche de l'artiste au fil des ans. Dans une seconde partie plus courte, Matthieu Séguéla veut mettre en évidence les relations étroites et intimes du peintre avec l'esthétique du Japon. Il nous rappelle que Soulages a été invité à exposer au Japon en 1951. Il a éprouvé la sensation s'arriver au Japon quand il est venu à Sète juste après la dernière guerre. C'est une métaphore, bien sûr, mais qui a sa signification - un signification puisqu'il s'installe dans ce port à côté du cimetière marin. Quant au rapport avec l'art japonais il est présent, c'est vrai, mais n'a jamais eu la portée et la force que l'on trouve chez Jean Degottex, pour le citer que lui. L'auteur de cet essai s'évertue d'accumuler les similitudes supposées, les influences possibles, les conjonctions concevables, mais sa démonstration n'est crédible qu'en partie. On est bien loin d'un Mark Tobey ou d'un Brion Gysin qui ont vraiment puisé leur inspiration dans la calligraphie et les pictogrammes ! Le japonisme de Soulages n'est pas inexistant, mais n'est pas fondamental dans la genèse de son oeuvre. Mais c'est Soulages lui-même qui a souhaité cette relecture de son oeuvre qui, pour les connaisseurs, est assez différente jusqu'à dernière phase de la longue suite des Outrenoirs. Malgré ce défaut (une reconstruction phantasmatique de la réalité d'un travail plastique), cet ouvrage est une excellente introduction à la recherche de ce peintre qui a découvert sa véritable vocation qu'à la fin de son parcours !
|
