
Léonard de Vinci anatomiste, Martin Clayton & Ron Philo, Actes Sud, 256 p., 39 euros.
Assez curieusement, on n'a découvert que très tard les recherches médicales de Léonard de Vinci alors qu'il est depuis longtemps reconnu parmi les plus grands maîtres de la Renaissance. Quand on regarde les premiers traités d'anatomie, on ne peut que remarquer l'immense distance entre leur graphisme schématique qui servent à expliquer les parties du corps humain et ce qu'a pu réaliser l'artiste. Ses dessins sont très précis, très fins, mais aussi d'une indéniable beauté, ce qui commencera à apparaître dans ce domaine spécifique qu'à partir du XVIIe siècle, autant dans les planches que dans les modèles en cire. Rien que pour cela il se révèle un chercheur très minutieux avec la volonté d'aller le plus loin possible dans le rendu des différents organes. Il va beaucoup plus loin que ce qu'un peintre aurait pu faire alors pour son métier. Il a éprouvé une véritable passion pour les secrets du corps humain. Nous avons dans ce volume presque quatre-vingt-dix sujets, qui, mis à part quelques commentaires, écriture constituent une recherche très approfondie, du corps humain dans son apparence et ses proportions (question fondamentale pour lui) jusqu'aux muscles, aux éléments du squelette et aux nerfs (c'est d'ailleurs dans ce registre qu'il semble le plus novateur par rapport aux connaissances de son temps). Il étudie aussi bien les organes génitaux de l'homme et de la femme que le foetus. Les auteurs ont pris bien soin de commenter chacune de ces études du corps humain, expliquant ce qu'il a désiré représenter. C'est fait de manière claire, avec une volonté affichée de faire comprendre les questions que Léonard de Vinci quand il exécuté ces études. En sorte que ce livre présente plusieurs intérêts. Le premier est de nous faire comprendre l'état de connaissance de l'artiste et ce qu'il a eu envie de mettre en évidence. La seconde est de bien souligner en quoi il affirme une grande pénétration de la question par rapport aux connaissances de son époque. Enfin de montrer en quoi il a été un chercheur sérieux et parfois en avance sur les observations qui ont pu être faites par les anatomistes. C'est là par conséquent un travail indispensable pour que nous ayons les moyens de voir en cet homme qui incarne l'humanisme sous tous ces aspects - et dans ce cas dans le domaine de la science médicale - en quoi il a fait preuve d'un esprit scientifique très avancé car on pourra noter qu'il s'est d'abord dédié à la recherche avant d'en tirer des conclusions pour son usage personnel pour représenter l'être humain avec la plus grande acuité. Bien sûr, cette quête d'une anatomie plus exacte s'est traduite dans ses oeuvres et ne fait pas le moindre doute. Mais ce que nous apprennent Martin Clayton et Ron Philo est que sommeillait en lui un savant, ce qu'on a pu aussi bien observer dans ses travaux sur la mécanique ou les techniques.
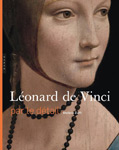
Léonard de Vinci par le détail, Stefano Zuffi, Hazan, 224 p., 39, 95 euros.
Voici un ouvrage pour le moins curieux. Il ne s'agit pas ici d'une biographie, ni d'une monographie, ni encore d'un essai sur un aspect particulier de son oeuvre, mais d'une initiation à l'ensemble de son art et de ses recherches à travers des détails, que ce soit de peintures, de dessins, de planches de ses codex. Par exemple, l'auteur nous montre un détail de La Cène qui se trouve à Milan. Il ne montre pas l'ensemble de l'oeuvre, mais en commente une partie dont il nous fournit une reproduction. Ses commentaires permettent d'approfondir différentes questions sur son style, la disposition des figures, les harmonies chromatiques, et sur toutes autres choses permettant de mieux comprendre l'esprit qui a présidé à la conception et à la réalisation de cette fresque célèbre. Mais il ne montre pas l'ouvrage dans son intégralité ; il en est de même pour toutes les créations qu'il a choisies pour permettre au lecteur de mieux de pénétrer ce qui fait l'essence de tous ces travaux qui embrassent des champs très différents, de la peinture à la quête scientifique. Ainsi découvrons-nous les multiples aspects de cet homme exceptionnel pour qui peu de domaines étaient étrangers. C'est habile et pas mal imaginé ; mais le problème reste que si l'on ne connaît déjà pas de très près ce qu'il a pu accomplir, on est privé de la référence, que ce soit un tableau ou une planche anatomique ou un projet technique. D'un autre côté, on est amené à mieux connaître la qualité de son dessin, de sa touche, et aussi de comprendre quels ont pu être ses centres d'intérêts. Ce mode d'investigation est par conséquent ambigu, même s'il est plein d'enseignements. Le néophyte pourra aisément apprécier ses dons hors du commun, mais ne pourra découvrir ses créations. En somme, ce livre ne peut s'adresser à la personne qui ne sait rien de l'art de Léonard de Vinci, ni à l'amateur avisé et encore moins au spécialiste. Il a été conçu pour des personnes possédant déjà une certaine culture artistique, mais qui ne possède pas encore un regard aiguisé au point de déceler tout ce qui constitue la beauté et la singularité de ce qu'il a laissé à la postérité. Ce volume est beau et intéressant, mais a été fait de telle manière qu'on a le droit de s'interroger sur sa finalité.

Art brut, le guide, Céline Delavaux, Flammarion, 224 p., 19,90 euros.
L'art brut est à la mode. Mais ce succès a eu pour conséquence qu'on ne sait plus précisément ce que cette dénomination englobe véritablement. Cet ouvrage est très utile, car il permet d'en cerner les contours, d'en percevoir les contours, d'en connaître la chronologie et de découvrir ses principaux protagonistes. L'auteur a eu l'excellent idée de le comparer à des formes d'expression qui entrent dans sa sphère, comme l'art des fous, l'art modeste, l'art des enfants, l'art naïf. Ces comparaisons ne sont pas inutiles, car cela va jusqu'à l'ensemble de l'art contemporain. L'auteur a aussi donné les principaux mots-clefs pour se repérer dans cet univers qui se situe aux marges de ce qu'on reconnaît comme étant foncièrement artistique. C'est très clair, très efficace et illustré avec soin. Que l'on soit passionné par ces créations hors normes ou non, le travail accomplit ici par Céline Delavaux est une remarquable introduction à ce qu'elles représentent dans l'imaginaire et dans la sphère de l'art ; de plus, cette notion a été profondément remodelée au fil du temps, Jean Dubuffet, jouant ici un rôle de premier plan pour sa reconnaissance. Le seul problème qui subsiste est son intégration dans le registre de l'art accepté par les musées et les amateurs. La question demeurent encore bien ambiguë et discutée : il existe bien depuis un certain temps un important musée de l'Art brut à Lausanne ou les collections de certains hôpitaux que l'on a récemment valorisés ; mais rares sont les institutions artistiques qui les collectionnent. En somme, ce n'est pas une affaire tout à fait simple : un aliéné peut-il être reconnu comme un artiste à part entière ? La réponse ne peut qu'être ambivalente. Donc, en conclusion, je vous conseillerai de vous procurer ce volume, qui restera un moyen de ne pas se laisser prendre au piège d'assimilations douteuses et d'interprétations spécieuses.

Van Gogh en 15 questions, Stéphane Guégan, « L'art en question », Hazan, 96 p., 15, 95 euros.
Cette collection représente à mon sens un excellent moyen d'initiation à l'art. Mais on peut toutefois être surpris par les questions choisies par les auteurs. Dans le cas présent, je ne parviens à comprendre par la première : « l'art guérit-il, », car Stéphane Guégan explique de manière concise, mais très juste la valeur indubitable du talent de l'artiste. Il insiste beaucoup sur sa lucidité et sa place imminente dans l'histoire de l'art de son temps à travers ses propres écrits et aussi les considérations d'Octave Mirbeau. C'est sans doute un piège à partir des idées reçues les plus stupides qu'on a pu avoir sur ses tableaux et sur sa personnalité. Une autre question me fait m'arrêter : est-ce le premier des écologistes ? Il est vrai qu'il a plus peint la campagne que la ville, et encore il a peint volontiers les rues et quelques bâtiments d'Arles, mais pas Paris (là, il s'est contenté de dessiné les vues de Montmartre encore bien sauvage à l'époque où il est passé rendre visite à son frère. En revanche, une chose que l'on remarque peu, c'est que souvent dans ses paysages du midi que peuvent apparaître au loin des cheminées ou de petites usines. Ces constructions sont discrètes, mais elles ont une signification que le passé de l'artiste annonçait déjà et son intérêt pour le monde de travail qu'il a tenté d'être pasteur des les borinages. Quoi qu'il en soit ce petit ouvrage d'initiation est bien fait, précis, sans rhétorique et surtout sans cette vision stéréotypée et stupide que le public a fini par accepter. Pourvu de cet ouvrage, un enfant, un adolescent, mais aussi un néophyte curieux de découvrir les premiers éléments pour découvrir ce merveilleux peintre est doté d'un très bon instrument de découverte. Au bout du compte, ce n'est pas si commun que cela !

La Ballade de la geôle de Reading, Oscar Wilde, bilingue, traduit de l'anglais par Bernard Pautrat, 64 p., 6, 2o euros.
Les Editions Allia nous régalent souvent de textes de grands auteurs qui ont paru dans d'autres éditions rassemblant tout ou partie de l'oeuvre d'un écrivain. Cette fois, elles nous proposent un poème célèbre d'Oscar Wilde, La Ballade la geôle de Reading, qu'il a écrit dans la prison où il a passé deux années après avoir été condamné aux travaux forcés à cause de sa relation amoureuse avec le jeune Lord Alfred Douglas. Adulé, admiré, connaissant une notoriété considérable, Wilde se pensait intouchable. Mais voilà, la question touchait l'aristocratie anglaise et il ne pouvait faire le poids. Il faut se rappeler qu' l'époque, l'homosexualité pouvait être punie de la peine de mort ! Cette oeuvre magnifique paraît en 1898, un an après sa libération et son exil volontaire en France où il meurt deux ans plus tard. Sans doute est-ce son chef-d'oeuvre. Il y dépeint avec force l'univers carcéral, en en décrivant toute l'horreur, mais aussi la situation physique et morale de ces condamnés, prenant pitié même du pire assassin. Il y a dans ces page quelque chose qui n'apparaît pas dans le reste de son oeuvre : il n'y a plus de mots d'esprit ni de brillantes formules. C'est une relation d'une rare densité d'un univers forclos qui ne peut que dégrader l'être humain et le rendre encore plus mauvais. Il parvient à condenser l'essence de ce lieu de désespérance, où il nous représente la vie qu'on peut y mener, l'horreur de ce que pouvait subir le prisonnier, que sa peine fût légère ou non. Il existe dans ces vers une rare tension, en même temps que la volonté de s'en tenir aux faits, sans aucune rhétorique. Son écriture est concise, intense, dépouillée, d'une force incomparable pour que nous soyons même de prendre la mesure de cet Inferno qui n'a rien de fantastique ou d'incroyable. Il s'est efforcé de se rapproché au plus près de ce qui constitue le châtiment de ces malheureux. Il n'a pas la fougue de ce qui Victor Hugo a pu écrire sur cette question : il scrute toute chose et nous la restitue telle quelle. Et pourtant, il a su donner une véritable beauté à ce poème qui touche non par ses images, mais par son réalisme qui va le plus loin possible tout en faire naître une interrogation spirituelle profonde.

Cent ballades d'amant et de dame, Christine de Pizan, présenté et traduit par Jacqueline Cerquiglini-Toulet, bilingue, « Poésie », Gallimard, 336 p., 10 euros.
Quel bonheur de trouver enfin les écrits de Christine de Pizan (circa 1364-1430) dans cette collection ! Née à Venise, son père astrologue et médecin, est appelé à la cour de Charles V. elle a pu suivre des études soignées à la cour de France. Mais on la fait se marier en 1380. Elle a trois enfants, mais son mari meurt fort jeune en 1387. Elle se retrouve veuve et connaît une longue période de dépression. Mais elle ne songe pas à se remarier. Elle décide de vivre de sa plume, ce qui était très rare à l'époque pour une femme. Elle ne tarde pas d'ailleurs à avoir des commandes et la protection de grands personnages comme le duc de Berry et le duc Louis d'Orléans. Elle a plus d'une corde à son arc, car elle écrit des oeuvres philosophiques, éthiques et même de caractère politique en plus de la poésie. Son talent est reconnu et elle semble avoir assez d'appuis pour pouvoir oser mener un combat contre l'ouvrage de Jean de Meung, Le Roman de la rose, qui connaît un grand succès dans toute l'Europe. Elle défend par ce biais une autre idée de la femme. Sa réputation s'est vite répandue et les courtisans et même les souverains faisaient appel à ses services. Vivant une époque troublée, elle écrit un Ditié de Jeanne en l'honneur de la Pucelle en 1429. Ella a laissé une trentaine de recueils, dont Les Complainte amoureuses, Les chemins de longue solitude, les Heures de la contemplation de la Passion. Elle marque une transition très nette entre le monde médiévale et celui de l'humanisme, dans la pensée, mais aussi dans l'écriture : le français dont elle fait usage est souvent lisible pour nous. Ces Cents ballades (14o2-141o) s'inscrivent toujours dans l'esprit courtois qui a marqué la littérature du passé. La dame de ces poèmes se refuse celui qui en tombe amoureux. Cela fait parti des codes en vigueur. Mais elle paraît cette fois rester maîtresse de ses choix et de ses sentiments. Le dialogue amoureux qui s'instaure fait état d'une guerre réelle et non plus d'une quête mystique. Et cet échange d'une correspondance qui devient passionnée et ne se satisfait pas d'une rhétorique convenue, mais utilise les mots les plus simples de l'amour, avec un art qui semble annoncer la Pléiade. Christine de Pizan tourne une page essentielle de l'histoire de notre littérature. Après sa disparition, elle a été oubliée. Ce n'est qu'au siècle dernier qu'elle a été redécouverte. Elle doit aujourd'hui figurer parmi nos lectures de prédilection.

Le Joueur d'échecs de Maelzel, Edgar Allan Poe, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Charles Baudelaire, Folio classique, 288 p., 7,40 euros.
C'est une très grande joie que de relire dans la belle traduction de Baudelaire ce beau texte d'E. A. Poe paru en 1836. Il est fort intéressant car l'auteur a joué sur deux registres : celui de l'essai, avec la description minutieuse de ce fameux automate créé par Van Kempelen au cours des années 1770, présenté à Paris en 1784 et racheté ensuite par Leonard Maelzen, un mécanicien bavarois, qui l'a fait voyager en suscitant partout l'étonnement. Poe a décrit tous les détails de cette machinerie et dévoile le secret de la géniale supercherie. Poe a conçu son récit de telle façon qu'on pourrait croire à une curieuse enquête très détaillée sur une question scientifique, alors qu'il s'agit et d'un fait divers célèbre et d'une grande et subtile supercherie. Cette édition est enrichie d'une préface tout à fait intéressante sur l'histoire des automates par John Graham Deuff, extraite de l'Edinbourg Encyclopedia, d'un article intitulé "La psychologie de l'intelligence", d'Edouard Claparède, en postface, ainsi que d'une chronologie détaillée et de notes. Il s'agit d'une édition tout à fait remarquable.

Max Jacob dans tous ses états, Lina Lachgar, Editions du Canoë, 80 p., 14 euros.
Contrairement aux apparences (je veux parler de sa dimension modeste et de son petit nombre de pages), ce livre est d'une incroyable richesse. Le dialogue que l'auteur a inventé avec son poète de prédilection, Max Jacob, mort en 1944 au camp de Drancy, est non seulement curieux et original, mais il est aussi révélateur de ce que Lina Lachgar entend dans les paroles et dans les écrits de ce dernier. C'est assez déroutant et en même temps parfaitement à même de nous faire comprendre qui il fut, comme elle a déjà pu le faire dans ses ouvrages précédents. Il ne s'agit d'une apologie et encore moins d'une reconstitution artificielle, mais d'un désir de mettre en relief les traits saillants de sa personnalités et de son oeuvre poétique. On y trouve aussi quinze petits dessins et puis un dossier concernant Pierre Colle, qui a été son ami. Celui-ci l'a aidé à publier ses premiers poèmes et, plus tard, en 1931, il ouvre une galerie à Paris sise rue de Cambacérès avec le soutien de Christian Dior. Elle n'a duré que deux ans, mais il a pu l'y exposer, ce qu'il n'a pu continuer à faire quand il prend un associé et s'est installé rue du Faubourg Saint-Honoré. Pierre Colle a écrit sur Max Jacob un beau texte qui reproduit avec le fac-similé du manuscrit que 'auteur du Cornet à dès avait corrigé de sa main. En somme, nous avons entre les mains un ouvrage très précieux car il nous fait mieux connaître le peintre grâce à cet inédit et l'étrange homme de lettres, ce petit Juif breton qui s'est converti au catholicisme après une vision de la Vierge. Aucun amoureux ce grand homme de la littérature française du siècle dernier ne doit se priver de ce recueil créé par Lina Lachgar que sa passion n'aveugle pas et nous donne l'occasion rare de nous murmurer à l'oreille ce qu'une biographie ne pourrait nous révéler. Et cela avec un bonheur indubitable, qui ne peut que nous toucher.

Cavalerie rouge, Isaac Babel, traduit du russe et présenté par Maurice Parijanine, « L'Imaginaire », Gallimard, 224 p., 9, 5o euros.
Isaac Babel est mort fusillé en 194o à la suite d'une dénonciation à l'âge de quarante-six ans. Ce fils de marchand juif d' Odessa a pu faire de bonnes études et en a retiré une bonne connaissance de plusieurs langues dont le français. Il s'intéresse très vite à la littérature française et éprouve une prédilection particulière pour Maupassant. Il va alors vivre Kiev et puis à Pétrograd. Ses débuts n'ont pas été couronnés de succès. Mais sa rencontre avec Maxime Gorki à la fin de 1916 a été cruciale puisque son aîné l'a encouragé et l'a aidé à faire paraître ses premières nouvelles. Il adhère aux idées de la Révolution d'octobre et entre la Tcheka, puis au commissariat au peuple et enfin dans l'Armée rouge en 192o, prenant part aux combats contre l'Armée blanche. Cet ouvrage est une série d'épisodes isolées quand il a été correspond de guerre pendant la guerre contre la Pologne de 1919 à 192o, qui s'est révélé finalement un échec cuisant pour le nouveau pouvoir soviétique, après un certain nombre de victoires et d'avoir été sur le point de prendre Varsovie. En 1921, la Pologne, qui a été soutenue par l'Ukraine, obtient des concessions territoriales importantes lors du traité Cet ouvrage a fini par paraître en 1926 et n'a pas été apprécié par le régime, qui n'y a pas vu, raison, une grande épopée bolchevique. Isaac Babel ne raconte pas le déroulement du conflit dans son ensemble, mais des épisodes fragmentaires qui mettent un ou un petit groupe d'individus, soldats, paysans, Juifs (il y parle beaucoup des populations juives prises dans la nasse de cette terrible guerre), des cosaques, des petites gens de la Pologne, des prêtres catholiques et des religieux orthodoxes. Il ne s'agit là que de petits fragments de vie, qui sont révélateurs de l'atrocité de ces affrontements, où l'on parle parfois d'un général ou encore de ce qu'on appelait la terrible bande armée de Makhno en Ukraine. C'est souvent bouleversant, mais en tête temps grotesque et même parfois comique. Babel a un don peu croyable pour ces petits récits qui, mieux qu'une longue description militaire montre ce qu'a été cette guerre qui met fin au rêve internationaliste de Lénine. On pense parfois à Gogol et on ne peut d'empêcher de faire des analogies, en dépit de différences notoires, avec Malaparte et Céline. En tout cas, il a inventé une autre façon de faire voir la guerre et d'en définir l'essence. Cette Cavalerie rouge est un pur chef-d'oeuvre. Son réalisme cru est teinté d'une sorte de surréalisme sauvage...

La Malchimie, Gisèle Bienne, "Un endroit où aller", Actes Sud, 256 p., 22 euros.
Quand on se plonge dans ce roman, on est un peu surpris qu'il commence par un éloge de Susan Sontag, non que la chose soit incongrue en soi, mais on a du mal à saisir la raison de cette référence à cette célèbre essayiste américaine qui a tant aimé la culture française. Mais on en découvre bientôt la raison : elle a été atteinte d'un cancer et a lutté de toutes ses forces pour tenter d'échapper à son emprise, en vain (c'est ce qu'elle raconte dans son livre renaître paru après son décès en 2010, mais déjà dans La Maladie comme métaphore en 1978). Hors l'héroïne de cet ouvrage, Gabrielle, relate les longs mois de traitement de son frère aîné Sylvain qui souffre d'une grave leucémie et qui finit par y succomber. Enfants, ils ont vécu à la campagne car leurs parents étaient agriculteurs. La petite Gisèle a fini par quitter l'univers de son enfance pour aller étudier, alors que son frère est resté auprès de son père et de sa mère pour suivre leurs traces. Le roman n'est pas un roman familial au sens strict, mais plutôt, comme le titre le suggère, une terrible confrontation de deux maux chimiques : celui que provoque les pesticides et le traitement de ses effets sur bon nombre d'individus, dont Sylvain. Ce que veut nous démontrer l'auteur, c'est que l'usage démesuré des produits phytosanitaires dont plus personne n'ignore plus le caractère dangereux, est devenu une sorte d'action criminelle largement connue dans le monde, accomplie avec la complicité conjuguée des grandes sociétés pharmaceutiques, les responsables politiques et les victimes elles-mêmes, qui croient que l'utilisation de ces poudres meurtrières est plus efficace et plus économique. Tout le monde contribue à ces assassinats, presque tous en connaissance de cause, les laboratoires étant les premiers responsables car leurs inventions leur permettent de faire d'énormes profits. Le mal dont est frappé Sylvain le rapproche nécessairement de sa soeur, impuissante devant ce que la médecine est encore incapable de traiter. On pourrait croire que cette fiction est un peu schématique dans son propos et même simpliste, mais l'auteur a très bien su mettre en scène ces relations intimes et tout ce qui entoure ce drame. Gisèle Bienne écrit avec beaucoup de caractère et aussi de sensibilité. Le récit est bien construit et maîtrisé et l'histoire nous touche car elle a su dépasser le domaine des idées reçues en circulation sur cette question critique.

Punir d'aimer, Octavie Delvaux, La Musardine, 368 p., 16 euros.
Les lecteurs qui suivent cette chronique ont sans doute remarqué qu'il m'arrivait assez souvent de me plaindre de la médiocrité de la production littéraire actuelle. Et je me suis aussi plaint du peu de qualité de la littérature érotique. Je dois avouer qu'après avoir lu ce gros recueil de nouvelles d'Octavie Delvaux, je me suis dit qu'il faut que je relativise mon jugement : si elle n'innove pas en la matière, si elle n'a pas la prétention d'écrire un chef-d'oeuvre immortel, à la hauteur de Pauline Réage par exemple, elle démontre de grandes qualités qui doivent absolument être soulignée et saluées. Elle n'apporte pas de grandes innovations en la matière, mais elle démontre néanmoins avec un réel talent une capacité d'écrire des histoires avec vivacité, un style soigné et pourtant déluré, et aussi d'imaginer des situations qui peuvent être libidineuses, drôles, sans aucun tabou et pleines d'esprit. Elle insuffle à ses récit un rythme qui sous-tend sa manière de narrer des rencontres ou des curiosités amoureuses ou tout simplement sexuelles. Elle fait valoir que les relations érotiques sont d'abord des moments souvent nés de la fortune que le quotidien peut offrir. Elle est aussi la propriétaire d'un vaste réservoir d'idées saugrenues et émoustillantes qui est pour le moins impressionnant. Rien n'est banal dans ce qu'elle nous raconte, et elle ne tombe jamais dans la vulgarité, même quand les relations décrites se font particulièrement osées. Elle sait aussi mesurer le temps de ses coquineries. Elle sait très bien quelles sont les limites d'un petit conte coquin : plus développés, ils deviendraient fastidieux, et plus courts, ils ne provoquerait pas la jouissance de leur lecture. Son talent consiste à introduire ce surnaturel de l'attirance, des gestes voluptueux, des fantaisies les plus exacerbées et des phantasmes les plus ébouriffés. Avec elle, tout ou presque est permis, et la pensée érotique peut se déployer sous ses mille apparences, sans pourtant qu'elle recherche absolument l'extravagant et le graveleux. En somme, elle me paraît être un des auteurs les plus intéressant de cette période si peu encline à la rêverie secrète et polissonne du second rayon d'autrefois. C'est un auteur qui a une belle énergie et la faculté de restituer, dans un esprit moderne, tout le charme des plaisirs interdits qui ont nourri notre littérature ces derniers siècles. Une vraie gageure !

Les Feux, Shôhei Ôoka, traduit du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle, préface de Maya Morioka-Todeschini, Autrement, 264 p., 19,00 euros.
Le conflit qui a opposé les Etats-Unis et l'Empire du Japon nous est connu surtout par la littérature et le cinéma américain. Très peu de livres japonais nous sont parvenus. Cette oeuvre de Shôshei Ôoka est passionnant à tous égards car il relate les tribulations tragiques d'un soldat appelé Tamura qui a perdu toute relation avec ses camarades quand les Américains ont débarqué aux Philippines, sur l'île de Leyte. Ce récit a certainement une part autobiographique, car l'auteur a écrit un ouvrage autobiographique qui témoignent de quarante jours d'errance solitaire dans la jungle. Notre héros essaye dans ce récit de retrouver son unité ou tout du moins l'hôpital. Mais il est complètement perdu. Il rencontre parfois des compatriotes aussi perdus que lui et doit non seulement faire attention à ne pas être pris par les ennemis mais aussi par la guérilla philippine. Il est animé par l'énergie du désespoir et affronte la faim, les intempéries, la maladie et aussi la peur et le sentiment d'une fin abominable. L'auteur a su, sans emphase, reconstitué l'atmosphère de ces combats dans des régions particulièrement ingrates et aussi quel a pu être l'état d'esprit de ces combattants égarés ; La mort est omniprésente et la sensation que le soldat se perd dans un monde inconnu qui va l'engloutir. Sa chance et d'avoir été réccupéré par des troupes nippones et soigné au Japon. Bien sûr, il s'agit là d'une histoire individuelle, mais elle est la métaphore de ce qu'ont pu vivre ces hommes qui ont combattu sans n'avoir plus aucun moyen de se défendre. Notre homme n'a plus que son fusil, qu'il perd au gré de ses pérégrinations. C'est un roman poignant, qui dévoile la fin d'une armée puissante et conquérante, et qui mène des batailles devenues absurdes et sans espoir. Tamura n'a rien d'un guerrier impitoyable ; c'est un homme jeune qui tente de sauver sa vie et fait face à des épreuves sans nombre. Pour comprendre ce qu'a été les derniers mois de la guerre du Pacifique, ce livre d'Ôoka est la traduction poignante de la chute dans les tréfonds de l'horreur.
|
