
Alberto Giacometti, une aventure moderne, sous la direction de Sébastien Delot & Catherine Grenier, Gallimard / LaM - Villeneuve d'Ascq, 224 p., 35 euro.
Alberto Giacometti nous a quitté le 10 janvier 1966. Célèbre dès l'après-guerre, loué par Jean-Paul Sartre, qui a écrit sur son compte des pages magnifiques, pris en charge par l'alors célèbre galerie Maeght, il n'était plus un artiste pauvre. Mais il a continué à loger avec son frère Diego dans leur repaire inconfortable de la rue Hyppolite-Maindron à Paris, derrière la gare Montparnasse. L'exposition présentée au musée d'art contemporain et d'art brut de Villeneuve d'Ascq offre aux visiteurs la possibilité de se faire une idée assez précise de ce qu'a pu être le parcours esthétique du grand artiste issu d'une famille d'artistes des Grisons. On le suit dans les différents moments de sa création : pendant les années vingt, où il crée de petites oeuvres abstraites, où le primitivisme et différentes influences antiques, auxquelles il faut ajouter la rencontre fondamentale avec Constantin Brancusi en 1927, qui s'est traduite par une recherche toujours plus exigeante et essentielle, qui se traduit par des formes ondulées ou cryptiques comme celle de La Femme couchée qui rêve (1929). Pendant ces années-là, Alberto Giacometti fait beaucoup des rencontres fondamentales ou découvre des recherches de ses aînés, comme celle de Zadkine. Il se cherche encore, mais s'est forgé tout de même une idée de la sculpture déjà bien chevillée en tête. Le surréalisme, à partir de 1931 s'est avéré son univers. Il a changé de perspective et a imaginé des objets au fonctionnement symbolique, comme sa Pointe à l'oeil (1931) ou l'Objet désagréable à jeter (de la même année). Il est passé ensuite à la création de volumes géométriques extravagants comme Le Cube (1934-1935). L'année 1935 le voit exclu du groupe surréaliste. Cette brève saison avec André Breton et ses amis est très bien décrite par Christian Alandete dans un essai intitulé « Sexe, violence, transgression ». Cette exclusion brutale l'a obligé à tout repenser : il est revenu au sujet - l'être humain -, mais d'une manière singulière puisqu'il a souvent légèrement métamorphosé ses figures. Il suffit de contempler la série des portraits de Diego pour comprendre qu'il est parti en quête d'une autre traduction de la réalité. Il en est arrivé a réalisé des sculptures minuscules placées sur des socles beaucoup grand : ce dispositif produit un effet étrange, car le buste semble une tête d'épingle posé sur un double parallélépipède. Il a développé cette idée et a imaginé de toutes petites statues semblant s'extraire de la masse compacte et informe du socle, comme dans une série de petits bustes de 1943 et de 1944 et ensuite Petite tête de Marie-Laure de Noailles (1946) qui est le résultat d'une spéculation sculpturale ayant durée plusieurs années. Après la Libération, il a réalisé la Tête du colonel Rol-Tanguy (peut-être un projet de monument). Déjà il possède l'essentiel de ce qui va devenir son style et l'esprit de son art : Simone de Beauvoir (1945) en est déjà l'ébauche très avancée. Puis il a eu l'idée de placer de petites figurines dans des cages montées sur un socle reposant sur de plus longs trépieds. Ses premières figures longilignes en bronze, ce furent Les Trois hommes qui marchent de 1946. Il lui a fallu accomplir un long cheminement pour parvenir à cette forme emblématique qui l'a distingué d'entre tous et de frapper profondément les imaginations. Dans ce catalogue, on peut voir nombre de ces petites figurines, qui ne sont pas des ouvrages mineurs, mais bien les véritables manifestations de sa pensée. Qu'elles soient ensuite agrandies, prenant une dimension monumentale, n'est pas indifférent ; mais ce sont ses premiers plâtres et ses premiers essais en bronze qui recèlent toutes ses intuitions et la somme de ses réflexions. Cette exposition et le catalogue qui en demeurera la trace, sont une belle introduction à la curieuse et fascinante démarche de Giacometti. Il y a aussi un chapitre important sur a relation avec les poètes, en particulier avec Jacques Dupin dont il a fait de nombreux portraits et une analyse importante sur son rapport avec l'art égyptien ancien avec pour première expression La Femme qui marche de 1932. Pour ceux qui n'ont pu se rendre à Villeneuve d'Ascq, ce volume est précieux pour découvrir ce qu'a été le sens assez complexe de la démarche de Giacometti.
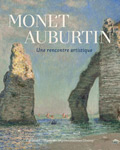
Monet - Auburtin, une rencontre artistique, Gallimard / musée des impressionnistes, Giverny, 192 p., 29 euro.
Cette exposition et le catalogue qui a été produit à cette occasion méritent vraiment qu'on s'y arrête. Ils ont vu le jour pour célébrer la création du musée des impressionnistes à Giverny il y a dix ans, là où Claude Monet a passé la fin de son existence, avec ce magnifique étang, son pont japonais et ses plantes dans un désordre soigneusement organisé qui lui ont servi de modèles, en particulier pour ses magnifiques Nymphéas. Tout cela nous fournit l'occasion rêvée de redécouvrir l'un des amis artistes de l'auteur d'Impression, soleil levant. En plus de la révélation de leur relation amicale profonde en dépit de leur différence d'âge, l'événement nous dévoile la valeur profonde de l'oeuvre de Jean-Francis Auburtin (1866-1930). Fils d'un architecte, il a eu la possibilité suivre des études sérieuses à l'Ecole alsacienne ; mais il a choisi la voie de la peinture et est parvenu à entre à l'école des Beaux-arts, où il est l'élève de Benjamin-Constant et de Jules Lefebvre. Ce passionné des rivages marins (il aime peindre aussi bien au bord de la Méditerranée qu'en Bretagne se voit confier la réalisation d'un grand projet décoratif en 1898, l'amphithéâtre de zoologie de la Sorbonne, qu'il a orné de son Fond de la mer, sorti de ses études réalisées à Roscoff et Banyuls (aujourd'hui conservé dans les dépôts de la ville de Paris). Trois ans plus tard, il est amené à décorer le restaurant de la gare de Lyon (malheureusement l'oeuvre a été enlevée et remplacée en 1905 et n'a jamais été retrouvée). Il semble avoir été très inspiré par le travail de Puvis de Chavannes - ses sujets sont toujours assez dépouillés et stylisés et son registre chromatique est réduit - tout en ayant une évidente veine symboliste, qui est alors dans l'air du temps et même consolidée. Le lieu et la date précise de la rencontre du jeune homme avec son aîné déjà célèbre ne sont pas connus. Il est indubitable qu'il a visité l'exposition conjointe de Rodin et de Monet à la galerie Georges Petit pendant l'Exposition universelle de 1889 (on a retrouvé ses carnets où il commente les sculptures de Rodin). Ce qui est sûr c'est qu'Auburtin se rend sur les lieux où a été peindre Monet : en 1895, il se rend à Belle-Île où son aîné a travaillé dix ans plus tôt (certaines de ces toiles figuraient au sein de l'exposition chez Petit). A partir de là, s'instaure un jeu étrange : Jean-Francis Auburtin va peintre les mêmes sujets que Monet et va suivre de ce dernier là où il a décidé de poser son chevalet. Comme lui, il peint des Meules (celles de Monet datent de 1889). Un critique avisé, Henri Franz fait remarquer en 1902 que le jeune homme suit les traces des impressionnismes avec discernement : il écrit à son sujet que « son art devient vraiment un art d'impression, un art tout imprégné de modernisme et qui vient à son heure après l'éclosion de l'impressionnisme... » On est tout de même trés frappé de nette similitudes entre les manière de peindre des deux hommes, qui ne sont sans doute jamais rencontrés à en croire les auteurs des essais figurant dans cet ouvrage. Le séjour de Belle-Île est sans doute une incroyable volonté de se rapprocher au plus près de son maître imaginaire, mais omniprésent. Arrêtons-nous un moment sur les calanques de Marseille exécutées par Auburtin en 1894 car on a sous les yeux un nombre assez significatif : les une sont encore un rien de symbolisme, mais la majorité sont traités dans un esprit qui n'est pas trop éloigné de Manet (il faut exclure les scènes trop oniriques avec des sirènes ou des nymphes. Les paysages côtiers de la Méditerranée peints par Monet en 1888 et ceux de son disciple les années qui suivent ont beaucoup de traits communs, en dehors du fait que le cadet a peut-être tendance à plus dessiner le contours des rocher ou la crête des vagues. Ses pins maritimes (malheureusement, beaucoup ne sont pas daté, ont une tonalité impressionniste assez remarquable eux aussi. C'est troublant ! En définitive, il est difficile de comprendre vraiment la démarche d'Auburtin pendant toutes ses années : il n'a pas cherché à copier Monet, car il laisse toujours assez d'écarts pour qu'on ne puisse pas se méprendre sur leur auteur. Toutefois, ce désir de reprendre des vues assez similaires, avec un dispositif scénique lui aussi voisin, est une curieuse affaire. C'est une excellente idée de faire apparaître ce parcours où le parallélisme est de règle, sans pourtant être le signe tangible d'une servilité d'école. Ce catalogue nous fait apparaître une enquête qui ne peut être tout à fait résolue. Est-ce le fruit d'un excès d'admiration ou le désir de relever un défi ? Je pense que ce serait la seconde hypothèse la bonne. En tout cas les réflexions des historiens d'art réunis ici sont assez détaillées pour mieux pénétrer ce mystère.

Le Marché de l'art sous l'Occupation, Emmanuelle Polack, Tallandier, 236 p., 22, 50 euro.
Cet ouvrage, attendu depuis longtemps, paraît en concomitance avec l'exposition remarquable sur ce thème présentée au Mémorial de la Shoah jusqu'à 3 novembre prochain. C'est en fait la version plus accessible d'une thèse sur laquelle l'auteur a travaillé sept ans. Il faut dire avant d'entrer dans le vif du sujet que tout repose sur les réglementations très brutales en ce qui concerne la saisie des bien juifs et sur les sort des ressortissants israélites, étrangers et puis français. Dès le 3 octobre 1940, le gouvernement de Vichy édicte une loi appelée « statut des Juifs », qui est la première du genre. Elle précède d'un jour la « loi relative aux ressortissants étrangers de race juive ». Le Commissariat générale aux questions juives en créé en 1941 et une police spéciale est affectée pour mettre en oeuvre les dispositions des lois. Le port de l'étoile jaune est décrété le 6 juin 1942. La fameuse rafle du Vel d'hiv a lieu le 16 juillet. La loi sur l'aryanisation est promulguée le 22 janvier 1943. Quant aux Allemands dans la zone occupée, ils enchaînent les mesures allant à l'expulsion d'Alsace des ressortissants juifs dès la 1er juillet 1940 aux internements à partir du 27 septembre, ils publient le premier statut allemand des Juifs, avec le recensement des biens juifs. Les règles restrictives ne cessent dès lors de s'accumuler jusqu'aux premières déportations à partir du 27 mars 1942. Toutes ces mesures, qui sont allées crescendo, visaient deux objectifs : la déportation des Juifs suivie de leur élimination physique (la « solution finale») et la spoliation de leurs biens. Adolf Hitler avait deux grands rêves : faire de Berlin la plus belle capitale du monde (Germania) et fonder dans sa ville natale, Linz, un musée gigantesque portant son nom. Pour ce faire, des dispositions sont prises pour s'emparer des oeuvres d'art dans tous les pays sous la domination du IIIe Reich. Dès l'été 1940, l'ambassadeur allemand à Paris, Otto Abetz, se voit confier la mission par Joachim von Ribbentrop de « mettre sous protection » les oeuvres importantes (ordonnance du 15 juillet), qui sont transférées à l'ambassade après un recensement. Cette opération est effectuée avec l'aide de la police française. De son côté, le maréchal Hermann Göring charge Alfred Rosenberg de former d'une section spéciale, l'ERR, chargée de transporter en Allemagne des oeuvres qu'elle aura confisquées. Son quartier général est d'abord installé à l'hôtel Commodore, puis, en 1943, dans un immeuble de l'avenue d'Iéna. Cette opération parallèle commence en octobre 1940. Les collections juives sont placées dans différents dépôts, dont celui des musées nationaux. D'autres finissent dans les caves de l'ambassade et dans plusieurs salles du musée du Louvre. A partir de l'automne 1940, bon nombre de tableaux et de sculptures sont remisés au Jeu de Paume. Celle qui appartiennent à la catégorie de l' « art dégénéré » sont remisées dans la « salle des martyrs » pour être vendues sur le marché de l'art ou échangées à l'étranger. En 1941, Göring charge Bruno Lohse d'acheter des oeuvres pour son compte en plus de ses nouvelles fonctions à l'ERR. Il est aussi chargé d'organisé des expositions des toiles et statues confisquées au Jeu de Paume. Deux ans plus tard plusieurs centaines d'oeuvres qualifiées de « dégénérées » sont brûlées. Göring profite de plus en plus des échanges pour enrichir sa collection personnelle, celle-ci ne tardant pas à devenir assez impressionnante. Emmanuelle Polack achève cette partie de son livre en parlant de figures interlopes qui écument le marché de l'art au profit du Reich et de ses dignitaires. Elle vient à parler du destin des marchands d'art juifs en France. C'est Paul Cailleux, marchand d'art et président du syndicat des négociants en objets d'art qui est chargé de la liquidation des biens juifs dans ce domaine. Le célèbre critique d'art Camille Mauclair applaudit des deux mains. Très peu d'entre eux parviennent à confier la gérance de leur galerie à un tiers, comme c'est le cas pour Kahnweiler ou Georges Wildenstein. Pierre Loeb, l'un des grands découvreurs de l'art moderne entre les deux guerres, confie la galerie Pierre à son confrère Georges Aubry. Un administrateur bloque néanmoins en mai 1941 ses comptes et réquisitionne ses tableaux à son domicile. Son stock est aussi vendu. Il décide alors de partir pour Cuba. Il essaye de rejoindre l'armée de la France libre, ce qui lui est refusé à cause de son âge. Quant à Georges Aubry, il vend des oeuvres en Allemagne et collabore au MNR (« musées nationaux récupération »). A la Libération, Pierre Loeb constate jusqu'où il a été dépouillé. Paul Rosenberg, fils de marchand d'art, n'a pas tardé à s'avérer l'un des principaux marchands de l'art moderne. Au début du conflit, il fait transporter une partie de son stock dans une propriété près de Bordeaux. En juin 1940, il quitte la France pour s'installer aux Etats-Unis. C'est dans son immeuble de la rue de la Boétie que s'installe en 1941 l'institut d'étude des questions juives. Ses clichés en verre sont vendus l'année suivante (c'est Madame Leiris qui les récupère) et sa collection personnelle est saisie. Tout ce qui lui appartient est acquis par un certain André Goux. Et même ce qu'il avait dissimulé en zone libre (argent et tableaux) est récupéré par les Allemands en 1941 dans son coffre de la banque de Libourne. Après la guerre, Rosenberg n'a pas rouvert sa galerie. René Gimpel va lui se rendre en zone libre et là, rejoindre un réseau de résistance. Son appartement parisien est réquisitionné en 1942. Il est arrêté par la gendarmerie française et est interné au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe. Il est libéré en 1943 puis de nouveau arrêté un an plus tard sur dénonciation et envoyé dans un camp de concentration, où il meurt en janvier 1945. Suit alors une partie consacrée aux salles de ventes et, bien entendu, aux ventes de biens juifs qui y ont eu lieu. L'Hôtel Drouot, après une brève fermeture, est ouvert à nouveau et formellement interdit aux Juifs. Des ventes prestigieuses d'oeuvres spoliées, comme celles de la collection Bernheim Jeune y ont lieu. Des commissaires-priseurs se spécialisent ailleurs dans ce genre de ventes. Les documents concernant ces adjudications sont très rares, on en comprend la raison. Le reste de l'ouvrage concerne un point assez sensible : la restitution des oeuvres ; ce fut un long chemin de croix et, encore de nos jours, bon nombre des affaires demeurent non résolues. Ce livre est un excellent compendium de toutes ces affaires tragiques, qui montrent que les lois raciales ont eu pour conséquence, dans le monde de l'art à des vols caractérisés et souvent systématiques, auxquels Français et Allemands ont participé en pleine complicité. Le dossier est loin d'être fermé, hélas. Mais cet ouvrage remarquable donne accès aux aspects les plus saillants ; il complète parfaitement le livre de Françoise Bertrand Dorléac, Histoire de l'art à Paris entre 1940 et 1944.

La jeunesse d'Adrien Zograffi : Codine, Mikhaïl, Mes Départs, Le Pêcheur d'éponges, Panaït Istrati, « L'Imaginaire », Gallimard, 512 p., 12, 50 euro.
Panaït Istrati en né en 1884 en Valachie. C'est le fils d'un contrebandier grec. Il écrit sa première nouvelle en 1907 et collabore à des journaux de gauche. Trois ans plus tard, il voyage, allant de Bucarest à Istanbul, à Naples et au Caire avec son grand ami Mikhaïl, un aristocrate qui mène une vie de vagabond (c'est lui qui l'initie à la littérature). Pour survivre, il exerce toutes sortes de petits métiers. Il séjourne à Paris entre 1913 et 1914. Il séjourne aussi en Suisse pour séjourner dans un sanatorium étant atteint de tuberculose. Il rentre en Roumanie en 1915 et mène sa vie dans les campagnes. Il s'installe en France en 1916. Il devient photographe sur la promenade des Anglais à Nice. Il parvient à maîtriser si bien le français qu'il va écrire toute son oeuvre dans cette langue. Mais n'ayant aucune relation, il écrit à Romain Rolland, en 1921, qui lui répond, ayant appris qu'il a tenté de se suicider et qu'il est resté blessé. L'auteur de Jean-Christophe le pousse à écrire et, trois ans plus tard a paru Kyra Kyralina dans la revue Europe en 1923 et, un an plus tard, chez l'éditeur Rieder avec une préface de Romain Rolland. Et le succès est au rendez-vous. Après cette victoire inattendue, il a continué à produire des fictions et a rédigé le Cycle des haïdoucs (le premier volume paraît en 1925), qui s'inspire de l'histoire ancienne quand ces asociaux luttaient contre les Ottomans et contre le pouvoir des propriétaires terriens. Puis il s'est employé à écrire le nouveau cycle d'Adrien Zogograffi, Codine, le premier ouvrage de la série étant publié en 1926. Roman Rolland le surnomme le « Maxime Gorki des Balkans » -, c e qui est à la fois vrai et faux. Son réalisme très cru est compensé par l'incroyable richesse et dynamisme des dialogues. Fervent admirateur de la mère-patrie du socialisme, il a fait un voyage en URSS qui l'a beaucoup déçu et, à son retour, il a écrit un livre très hostile au monde soviétique, Vers l'autre flamme (1929). Cette publication le coupe de l'intelligentsia de gauche. Il a décidé de rentrer en Roumanie et meurt à Bucarest en 1935. Cette plongée en apnée dans l'univers des pauvres, des rejetés de la société, de tous ces êtres humains que l'on ne considère pas ou qu'on exploite qui est la raison d'être de sa littérature a sans doute vieilli. Mais Istrati n'a pas disparu de la scène littéraire car il s'est révélé et se révèle encore un maître de la langue et un narrateur hors pair. L'histoire de la relation entre Adrien et Mikhaïl tient du miracle tant elle est captivante, pour ne parler qu'un seul de ces volumes.

Petit précis à l'aide d'un exemple sur l'écriture originelle, Julien Blaine, Dernier Télégramme, s. p., 25 euro.
Julien Blaine, depuis toujours, s'est diverti à nous surprendre et à nous faire des niches, en cachant sous une franche dérision rabelaisienne l'âme d'un poète, ans aucune pose, au contraire. Cette fois, il nous surprend encore, mais d'une autre façon. En effet, il commence son ouvrage par une méditation assez mélancolique sur le temps qui passe, digne des poètes de la Pléiade. Il s'est lancé dans une litanie à propos du temps qui passe, de l'âge et de ses désagréments - toutes choses qui n'apparaissaient pas dans ses écrits, sinon sous la forme d'une parodie ou d'une bouffonnerie savamment calculée. Cette méditation mélancolique le fait nous renvoyer aux origines, c'est-à-dire aux cavernes de la préhistoire, en particulier à la Vénérable de Laussel. Ensuite il nous convie à un cours de sémantique appliquée (à la mode de chez lui) en passant de l'objet à son image, puis à son pictogramme et à son idéogramme pour finir par quelques déclinaisons modernes (il, poisson, etc.). Quelques pages plus loin, il revient sur un sujet qui lui tient très à coeur : l'ovale fendu. Nul besoin de faire un dessin pour comprendre de quoi il s'agit et nous revoilà devant L'Origine du monde de Gustave courbet, qui a détrôné les Moules maliques de Marcel Duchamp. Plusieurs versions sont présentées pour la compréhension du thème ; Tout ce termine par un poème où le narrateur (adulte) songe à cette fente dont il provient. C'est à la fois émouvant et cocasse. D'Aurignac à nos jours, l'humanité ne cesse de méditer sur son commencement. Julien Blaine le fait dans son langage, avec beaucoup d'esprit, d'auto ironie, de l'humour et pourtant avec un pincement au coeur. Cet album complète l'immense et jubilante bibliographie de notre auteur, inépuisable et toujours créatif.
|
