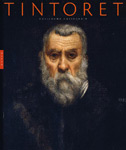
Tintoret, Guillaume Cassegrain Hazan, 320 p., 85 euro.
Tintoret, naissance d'un génie, Guillaume Cassegrain, « Découvertes », Gallimard / RMN - Grand Palais, 64 p., 9,20 euro.
Jacopo Comin Robusti, dit Il Tintoretto (1518-1594), parce qu'il était fils d'un teinturier de Venise, a laissé une oeuvre si pléthorique et si complexe qu'on aurait bien du mal à le cerner dans une définition stylistique bien précise. L'auteur insiste beaucoup sur l'influence de Michel-Ange, ce qui n'est pas à mettre en discussion. Mais cela est loin d'expliquer de tout de la grande révolution esthétique qui le distingue très nettement de ses grands contemporains, Véronèse et Titien (qui a été brièvement son maître, croit-on savoir, et dont il a cependant bien retenu la leçon en certaines choses), plus mesurés dans l'échafaudage de leurs oeuvres. Bien sûr, certaines de ses compositions sont assez proches de celles de ses principaux concurrents. Mais ce ne sont là que des cas isolés. En fait, Tintoret se distingue par deux caractéristiques majeures : d'une part, il use d'un style vif et rapide, qui transgresse les règles de l'art de la peinture jusqu'à lui ; de l'autre, ses compositions semblent la plupart du temps être entrainées par une bourrasque tempétueuses, avec une scénographie mue par une dynamique tragique où se jouent des équilibres et des contrapositions assez compliqués, mais efficaces, le tout étant renforcé par son goût de la matière et des contrastes saisissants : le mouvement frénétique des scènes envisagées, souvent le grand nombre de personnages, donnent une impression de vertige, qui préfigure certains traits dominant du barrique (mais cela étant dit, on peut aussi voir dans le baptistère de Parme peint par le Corrège des éléments architectoniques similaires). Tout cela ne veut pas dire que Tintoret était baroque. Mais il a préfiguré son avènement, qui d'ailleurs trouvera peu de résonance véritable dans la peinture avant Tiepolo. Le Paradis (1558) dans la salle du Conseil du palais des doges à Venise en est l'exemple le plus frappant. Bien sûr les documents de son époque sont très lacunaires et d'aucuns peuvent être d'une authenticité douteuse. Mais ses tableaux parlent. Et les premiers qu'il a peints prouvent qu'il avait déjà l'idée d'une autre forme de peinture, comme le prouve La Conversion de saint Paul (1544), qui est traduite par une exaspération de des événements secondaires au moment où le saint est sur le point de tomber de son cheval. La plus sage Sainte Famille, composée quatre ans plus tôt, donne déjà l'idée de cette tendance. Jésus et les docteurs (1542-1543) est un dépassement de ses maîtres, même les plus éloignés du classicisme de la période précédente : tous ces doctes figures penchées sur des livres énormes ou qui expriment leur effarement par des gestes appuyés procurent la sensation d'une scène violente, et non d'une discussion théologique. Le Christ et la femme adultère (circa 1547), donne l'impression d'une vaste scène de théâtre où se joue un drame, qui est accentué sur la gauche et la droite du tableau au premier plan : un homme nu agenouillé et un autre, nu lui aussi, de l'autre côté, qui tombe à la renverse. Guillaume Cassegrain explique très bien et avec une érudition sans faille ces traits distinctifs de la peinture du Tintoret, qui a eu sans nul doute le désir de tourner une page de l'histoire de l'art, avec fracas.
L'exposition qui se prépare au musée du Luxembourg pour le 500e anniversaire la naissance du Tintoret provoque, comme d'habitude, un nombre impressionnant de publications. Ce petit album de la collection « Découvertes », toujours écrit par Cassegrain. Dans sa préface, il fait allusion à l'essai de Jean-Paul Sartre, paru dans quatre revues différentes, curieusement jamais (à ma connaissance) réuni en volume. C'est pourtant l'un de ses plus beaux textes. Il commence par nous parler des réactions suscitées par les peintures de la Scuola Grande di San Marco, réalisées entre 1747 et 1748. L'Arétin, ami du Titien) est tout sauf enthousiaste. Il lui reproche, entre autres choses, la prestezza de sa main - cette rapidité vertigineuse de son exécution sera pourtant la marque de fabrique de ce peintre virtuose et impulsif. Guillaume Cassegrain est parvenu à exposer avec clarté la formation de ce peintre qui a brisé les normes en vigueur en son temps, même s'il y a de nombreuses zones d'ombres. Il a le don de la synthèse, ce qui est rare dans ce domaine. Après quoi, il met en évidence les principaux éléments de son art et de toute sa singularité. IL détaille les grands axes de sa « révolution », dans sa manière de peindre, mais aussi de penser la perspective, de constituer une théâtralité dynamique encore jamais vue jusque là. Il sait aussi nous expliquer comment il s'est voulu un successeur de Michel-Ange, mais sans l'imiter ou s'ériger comme son disciple, et aussi de quelle façon il a su tirer profit de l'essor du maniérisme tout en choisissant une autre voie. C'est un livre d'initiation remarquablement bien fait. Vous souhaitez découvrir le Tintoret ? Ce petit album est un merveilleux moyen de s'initier à ses principes complexes.
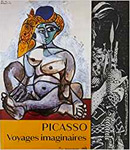
Picasso, voyages imaginaires, sous la direction de Christine Poullain et de Guillaume Theulière, RMN, Musées de Marseille, 184 p., 39 euro.
Il semble impossible d'épuiser le champ esthétique de Pablo Picasso. Cet artiste espagnol semble avoir dominé l'art de tout le XXe siècle. Et cette vision ne cesse de se renforcer d'exposition en exposition. Celle-ci est parvenue à se construire sur des fondements originaux. Ce qui est presque une gageure ! Les sections sont découpées selon des arguments connus, certes, mais pas toujours associés les uns autres. Par exemple celle-ci : « Jeux de l'oie et coquecigrues - un voyage du Japon à la vallée des Rois. » Au fond, les commissaires ont voulu revoir les connaissances que l'on a sur son art en réexaminant les influences, celles des xylographies japonaises, de l'Afrique noire et puis de l'Egypte ancienne. Chacun de ces « chapitres « sont illustrés de documents divers, de cartes postales à des dessins ou à de petites sculptures, en introduisant ainsi une vie plus intime révélatrice de sa pensée plastique. Tout cela est associé à l'ombre puissante de l'art ibérique. Cela nous fait comprendre que les apports et influences qu'il a subi de ces arts du passé ou de civilisations extra européennes sont associés à une réflexion sur le possible développement de l'art dans une direction jusque là inconnue. C'est le pari des Demoiselles d'Avignon, que l'auteur n'aura le courage d'exposer en 1907. Dans ces pages, on assez du cubisme, poussé jusqu'à ses limites formelles, au classicisme, qui a été un stupéfiant revirement de Picasso à la fin de la Grande Guerre. Mais ce néoclassicisme l'a entrainé vers une traduction sculpturale de ses figures, à leur déformation anatomique, à la fondation d'une nouvelle monstruosité, qui trouve son accomplissement dans sa phase surréaliste avec les baigneuses sur la plage. Comme l'exposition se déroule à Marseille, on a souligné sa relation étroite avec la Méditerranée. Le point le plus accompli de ce rapport est constitué par les toiles qu'il a exécutées pour le musée d'Antibes, où il conjugue une sorte d'hédonisme païen, une réminiscence de ses constructions cubistes, et une gamme chromatique très claire et très gaie à son opposé. Ainsi, nous sommes invités à parcourir les grandes étapes de son histoire personnelle (en fait beaucoup plus complexes, car des phases se superposent et parfois s'enchevêtrent), pour prendre la mesure véritable de son aventure rare et acrobatique dans la sphère de l'art. Le parcours se termine par ses pastiches des Femmes d'Alger de Delacroix : c'est l'antichambre de la période ultime de sa vie, où il met en scène une peinture qui se délite, et qui franchit encore d'autres frontières, dans la connivence érotique entre le peintre et son modèle avec un style qui se défait volontairement et qui ne sera pas comprise de son temps. C'est un travail remarquable pour sortir de toutes les idées reçues sur cet homme qui est sans cesse surprenant.

Les Gouachés, collection Dael & Grau, sous la direction de Sylvette Botella-Gaudichon, Atelier Galerie Editions/La Piscine, Roubaix, 132 p., 19 euro.
Avant de fermer ses portes pendant six mois pour les travaux d'agrandissement et d'embellissement, La Piscine de Roubaix a eu l'idée de présenter une exposition sur un art appliqué assez peu connu des profanes, le gouaché. De quoi s'agit-il ? D'une phase cruciale de la création d'un bijou. En effet, au moment où est réalisé ce dessin, le bijou est formé et donc prêt à suivre les étapes suivantes de son élaboration matérielle. C'est un travail très délicat, précis, millimétré. Il n'y a aucune place pour l'improvisation ou même une variation. Toutefois, la personne qui réalise ce projet est un artiste en son genre, car la sûreté de ses gestes procure une image définitive de l'ouvrage réaliser. En plus, surtout dans cette collection de Dael & Grau, il s'agit de petites pièces, surtout des boucles d'oreille, des bagues, des bracelets. Il n'y a pas de grandes parures et de diadèmes. Et l'on est forcé d'admirer aussi la qualité formelle des créateurs, qui doivent apporter cette finesse et cette délicatesse. Ils sont forcément astreints à une discipline artistique : ces bijoux ne doivent être ni extravagants, ni trop liés à la mode (sans lui tourner le dos). C'est là une belle initiation à un métier méconnu. Par ailleurs, c'est la mise en valeur d'une tradition locale, puisque la société Dael & Grau est établie à Tourcoing depuis le premier tiers du XIXe siècle. Les Dael ont travaillé avec les Grau, ils ont créé leur propre maison et puis se sont associés avec eux en 1973, perpétuant ainsi une longue tradition. Une photographie nous montre le magasin extravagant de Denis Grau à la Belle Epoque près de la Grand'Place de la ville. Cette exposition est une source d'enseignements et un hommage à cet art qui permet de l'exécution de bijoux de très grande qualité pour la bonne bourgeoisie du Nord.

Le Capital de Van Gogh, Wouter van der Veen, Actes Sud, 208 p., 18 euro.
Cet ouvrage m'a vraiment déconcerté. Le titre fait penser à une découverte spectaculaire, ce qui serait possible, car l'auteur est le directeur scientifique de l'Institut Van Gogh. En fait, on ne parvient pas très bien à comprendre l'objet du livre. C'est un mélange de dialogues inventés (par exemple, celui de Vincent et de Gauguin dans un café parisien), de réflexions fragmentaires sur l'éducation artistique et le marché de l'art actuel, de moments de la vie de l'artiste, un longue excursus sur la création de la République des Sept Province Unies et le rôle de l'argent pour le calvinisme (sur ce dernier point, je suis en désaccord avec l'auteur, qui pourtant cite Max Weber), et j'en passe. Il insiste beaucoup sur le fait que Vincent ait passé sept ans à travailler chez Goupil & Cie, l'une des plus importantes galeries de France, qui a eu une succursale à Londres. Et il explique aussi en détail les activités véritables de son cadet Théo, qui n'était pas marchand d'art en propre, mais employé de Boussod, Valadon & Cie. Alors, dans ce labyrinthe pour le moins bizarre, on trouve des informations très pertinentes permettant d'éclairer cette association entre les deux frères. Mais nul part je n'ai de réponse à une question qui me chiffonne depuis longtemps : pour Théo a-t-il interdit d'exposer au Café des Arts (Volpini) où Paul Gauguin avait invité plusieurs de ses amis à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889 ? Il demeure plein de mystères dans la vie tourmentée de Van Gogh. Je suis quand même surpris que lorsqu'il aborde le séjour à Paris, l'auteur n'indique pas que le jeune artiste y a appris beaucoup e choses en fréquentant les musées mais aussi les galeries, et qu'il ait assimilé l'impressionnisme si rapidement et avec une telle dextérité comme le prouvent les grands papiers qu'il a exécutés surtout à Montmartre. En fin de compte, on a l'impression que ce livre, qui devrait être sérieux, est une sorte de création conceptuelle pas toujours déchiffrable. Bien sûr, ce qu'on peut y glaner de positif est passionnant. Mais il reste des points incompréhensibles - comme quand il affirme que - Van Gogh écrivait dans un français simpliste ? Van Gogh écrivait des lettres superbes. C'était un grand lecteur, et, dans une de ses lettres, il commente avec sagacité un personnage d'Emile Zola dans l'OEuvre, un peintre qu'il croit lui ressembler. Bref, à découvrir, mais avec précaution !

La photographie mexicaine, « Photo poche », Actes Sud, 208 p., 14,90 euro.
Quand on consulte ce petit ouvrage, on peut se rendre compte à quel point nous sommes ignorants de l'histoire de la photographie dans cet immense pays, qui a une culture tout aussi immense. On y découvre le travail des grands studios de la fin du XIXe siècle, que ce soit celui de Romualdo Garcia ou l'agence de Cassola. Au fond, on ne connaît que les travaux de Tina Modotti, qui a été célèbre pour sa beauté et son engagement politique. On a aussi vu beaucoup de clichés de la révolution sans en connaître les auteurs. Dans ces pages, on commence à reconstituer une ossature de cette histoire d'une pratique qui a tenu à épouser au plus près les tragédies de l'histoire. On y découvre aussi le travail de Gillermo Kahlo, le père de Frida, qui était un photographe de très grande qualité. La conscience de la misère et les luttes sanguinaires pour l'émancipation a inspiré de grands noms de ce pays. Mais il y a eu aussi une recherche purement esthétique, comme on le constate avec Augustìn Jiménez, dont les recherches sont comparables aux plus grands créateurs européens de son époque. D'autres se révèlent de grands portraitistes ou de grands paysagistes. Lola Alvarez Bravo s'avère aussi bonne dans la composition par le cadrage et le contraste des ombres et des lumières que par sa vision très personnelle de la société. Juan Gusmàn a été autant un grand reporter qu'un merveilleux créateur, comme quand il fait, par exemple, le portrait de Diego Rivera en train de peindre une fresque d'une taille énorme. Impossible de citer ici tous les noms marquant de cette épopée fantastique de la photographie mexicaine. En tout cas, ce petit livre est une mine d'informations pour être initié à la diversité de ces pratiques et l'originalité profonde de ces photographes qui mériteraient d'être mieux connus.

Van Dongen & le Bateau-Lavoir, Somogy Editions d'Art, musée de Montmartre, 152 p., 19 euro.
Kees van Dongen (1877-1968) est encore largement sous-estimé. On a fait une figure de second plan du fauvisme et surtout un peintre mondain. Ce catalogue parle de ses années de formation et d'affirmation à Paris, où il vient la première fois en 1897, puis de nouveau en 1899. Deux ans plus tard, il se lie d'amitié avec Félix Fénéon, ce qui lui permet de s'introduire dans les milieux les plus avant-gardistes du début du XXe siècle. En 1905, il participe à l'exposition Salon d'Automne qui affait tant scandale. Il est intronisé fauve parmi les fauves. L'artiste a évolué très vite car il peint encore des paysages urbains dans un esprit impressionniste (Le Sacré Coeur, 1904). Mais il compose aussi des tableaux de facture expressionniste, comme Manège de cochons. Il faut se souvenir qu'il a été à peu près le seul à répondre à la demande de collaboration des membres du groupe allemand Die Brüke. Il est demeuré très profondément nordique et assez loin des idéaux chromatique de Matisse. Il serait plus proche de Maurice de Vlaminck. En 1906, il s'installe au Bateau-Lavoir, A partir de là, il n'a jamais abandonné sa manière de peindre, tout en la faisant sans cesse évoluer. Si Van Dongen n'a pas suivi la voir du cubisme, il n'en a pas moins fait des recherches plastiques qui peuvent avoir certains liens avec Picasso, comme le montre Jean-Michel Bouhours dans son essai : Les Lutteuses de Tabarin (1907-1908) n'ont rien à partager avec Les Demoiselles d'Avignon. Mais, pour ce grand tableau, il a choisi de s'orienter vers la monochromie, ce qui est aux antipodes de sa démarche picturale. D'ailleurs, il n'a jamais vendu cette oeuvre, mais l'accrochée en bonne place dans sa propriété de Garches. L'auteur rapproche cette composition du Harem peint par Picasso en Espagne. Il y a eu ici des liens tissés sans pourtant que s'opère un rapprochement de leurs points de vue. Toutefois, il est clair que ces Lutteuses ont été inspirées par Cézanne, librement réinterprété. Il faut dire que cette publication nous fait découvrir bien des choses méconnues du peintre. On y découvre des toiles et des papiers peu connus, différentes relations avec des artistes néerlandais qui travaillaient dans une optique plus réaliste, sa relation avec la poésie naturiste, qui ont obtenu l'intérêt des créateurs de l'époque. En somme, on découvre de cet homme un portrait beaucoup plus complexe qu'on ne l'aurait pensé. Il a conservé de ce court séjour à Montmartre une profonde nostalgie, comme le prouvent les lithographies illustrant le livre de Roland Dorgelès, Au beau temps de la butte (1949) où il montre Derain et Vlaminck à Chatou, Modigliani dans un café, André Salmon et Pierre Mac Orlan, Picasso dans on atelier. C'est un excellent travail qui permet de sortir des idées toutes faites et de l'image stéréotypée du peintre mondain.

L'Oiseau d'acier, Vassili Axionov, traduit du russe par Lily Denis, « L'Imaginaire », Gallimard, 160 p., 9 euro.
Vassili Axionov (1932-2006) passe pour être le meilleur écrivain russe contemporain. Et je le crois vivement en ayant lu ce petit roman. Ce délicieux roman, écrit aux alentours de 1965, semble bien conforter cette assertion. Il a été publié en français depuis 1963 (son premier éditeur a été Les Editeurs Français Réunis, financés par le parti communiste, bien que ses premiers livres aient été interdits en Union soviétique par la censure). L'histoire est racontée de manière savoureuse et prend un tour métaphorique pour parler des relations entre les locataires d'un immeuble, quelque chose entre Gogol et Emir Kusturica. Elle peut se résumer assez rapidement : dans un immeuble moscovite, un homme étrange, Popenkov, fait son apparition : il cherche un endroit où se loger. Mais le gardien de l'endroit, Nicolaïev, joueur de cornet à piston, lui dit qu'il n'y a plus aucune place. Mais le bonhomme a son idée : il dormirait dans l'ascenseur une fois le dernier résident rentré, et se lèverait avant que ne parte le premier de ces habitants. Nicolaïev accepte de l'aider. Le reste du temps, Pepenkov reste dans l'entrée, au farde à vous, avec son lit plié ! Mais les incidents se multiplient dans une optique tragi-comique, et Pepenkov finit par obtenir de construire un logement dans le hall ! L'enchaînement des situations devient des plus délirants. Et à la fin, l'immeuble se fissure dangereusement et doit s'écrouler dans un espace de temps très bref. A la fin on voit notre héros dans son ascenseur, qui, lui, n'est pas tombé ! Ce n'est là que la trame : ce qui compte vraiment c'est la façon dont Axionov a narré cette espèce de conte avec beaucoup d'humour et d'ironie féroce. C'est éblouissant et d'une drôlerie imparable tout en étant une critique acide du système soviétique de cette période.

Le Goût de la poésie amoureuse, Franck Médioni, « Le Petit Mercure », Mercure de France, 128 p., 8 euro.
C'est un joli cadeau à faire pour une rencontre galante ! Il y a peu de commentaires désagréables à faire sur cette anthologie minuscule et pertinente, sinon que l'auteur a privilégié les contemporains au détriment des anciens, ce qui est franchement dommage car les auteurs qu'il a retenus dans cette section ne sont pas en général des noms qui survivront. Il y a là les symptômes d'une maladie contagieuse qui gagne tous les domaines de l'art et des lettres : moins l'art et la littérature de notre époque nous intéresse et plus on nous l'impose et on la soutient à bout de bras ! Du Cantiques des cantiques à Jean de La Fontaine, nous serons heureusement surpris que par quelques auteurs arabes et un texte d'un auteur écrivant en langue d'oc, Guilhem de Cabestany. Pour Franck Médioni, la « modernité « débute avec Charles Baudelaire (Lamartine fait partie des vieux et, Baudelaire, des jeunes : mystère souverain de l'arbitraire et d'une fantasmagorie débordante !). Pas beaucoup de surprise dans cette partie qui fait défiler les grands noms de la poésie, de Stéphane Mallarmé à Pablo Neruda en passant inévitablement par Jacques Prévert et René Char, et, heureusement, Ghérasim Luca avec un magnifique poème intitulé « Passionnément ». L'érudit et le curieux n'y trouveront sans doute pas tout à fait leur compte. Mais les amoureux, peut-être y trouveront leur délectation. Il faut se souvenir que cette collection, vue sa taille et son esprit, ne recherche en aucun cas l'exhaustivité.
|
