
Magnelli et la peinture inventée, Daniel Abadie, Galerie Boulakia/Somogy Editions d'Art, 88 p., 25 euro.
D'Alberto Magnelli (1888-1971), nous n'avons au fond qu'une image très fragmentaire. On s'est surtout intéresser à la dernière partie de son oeuvre, qui a été de nature abstraite. Mais sait-on que dans sa jeunesse Magnelli a été très proche des futuristes italiens dès 1911, donc un an après la publication du Manifeste technique de la peinture futuriste ? Quand il se rend à Paris en 1914, faisant la connaissance de Picasso, d'Archipenko, de Matisse et de Léger, il découvre la réalité de l'art d'avant-garde. Cette allée-là, il trouve une voie originale dans la peinture. Mais, un an plus tard, il s'applique alors à imaginer un art abstrait, qu'il va développer jusqu'en 1918. Mais s'il redevient figuratif, il ne choisit pas de suivre ses pairs sur la voie du « retour à l'ordre ». Il s'est inventé alors une sorte de « cubisme, mais assez loin de ce qu'ont pu faire Braque et Picasso. L'essentiel de l'exposition présentée à la galerie Boulakia montre des oeuvres réalisées pendant les années 1920, et qui sont généralement assez mal connues. Il est vrai qu'il est en dehors de tout : il ne paraît même pas vouloir s'inscrire dans l'optique de l'Ecole de Paris entre les deux guerres, même si elle est très large. Et puis, on pourrait regarder ses compositions comme de curieuses parodies de Cézanne. Il privilégie les scènes rurales et le monde paysan. Tout est déconcertant dans sa manière de peindre : les couleurs, la posture de ses modèles (il n'est que de voir de voir Paysans au repos, 1922), la géométrisation des formes et des paysages. En somme, tout semble décalé dans sa démarche. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il a modifié son angle de tir et a élargi la gamme des couleurs sur sa palette, comme le montrent, par exemple, Les Trois soeurs. Il y a déjà des harmonies qui vont se retrouver plus tard, dans une autre phase de son oeuvre. Les tableaux reproduits sont complétés par une petite anthologie de ses travaux dans les différents musées du monde, ce qui rend particulièrement limpide son parcours, pas d'une grande évidence. Cela permet de comprendre les phases et les évolutions que sa recherche plastique connaît. En tout cas ce catalogue contribue à notre meilleure connaissance de l'histoire complexe et passionnante d'Alberto Magnelli et nous offre l'occasion rare de connaître cette phase figurative étrange, où il accentue encore plus sa singularité.

Corot, le peintre et ses modèles, Sébastien Allard, Hazan, 92 p., 29 euro.
L'oeuvre de Camille Corot est considérable (déjà de son temps, on disait que Corot avait peint 1.000 tableaux, dont 3.000 se trouvent aux Etats-Unis !) et l'on a surtout reconnu en lui le chef d'école de Barbizon -, en somme le paysagiste qui passe pour ouvert la voie à l'impressionnisme. C'est une vision très réductrice et qui place au second rang le reste de son travail. La très belle exposition du musée de Marmottan et l'étude de Sébastien Allard nous offrent la possibilité de revisiter son parcours pictural avec un oeil neuf. Les portraits qu'il a pu faire, plus nombreux qu'on se l'imaginerait, révèlent un autre aspect de son ambition. En effet, il a pu affirmer le caractère novateur de sa peinture, mais aussi ses liens étroits avec la grande tradition. Il n'a pas souhaité d'ailleurs effectuer une rupture radicale avec le passé, comme a pu le faire Manet, ni mettre en avant une idée velléitaire du réalisme par un coup de force comme a pu le faire Courbet. Il se situe dans une zone volontairement chargée d'ambiguïtés où l'ancien et le moderne se confondent. Toutes ces toiles ne présentent rien de choquant. Et pourtant, elles se singularisent par une succession de glissements en apparence innocents, mais en vérité très transgressifs, dans le traitement du sujet. Il y a une liberté dans le style qui est encore renforcé par une palette très libre. Sans renoncer jamais à une conception bien ancrée du dessin pour définir les figures, il n'hésite pas à une grande liberté dans l'usage des couleurs et des harmonies, avec en plus un singulier association de rendus conventionnels et d'une paradoxale liberté dans le rendu. C'est cet équilibre singulier qui fait la richesse profonde de son entreprise esthétique. La Blonde Gasconne (1850) peut être un exemple de cette tendance : le fond est traité comme un pur espace chromatique sans définition autre et la jupe de la jeune fille, monochrome, n'ai pas ouvragé dans les détails : seule compte l'impression d'ensemble. On peut faire le même constat avec La Jeune fille grecque à la fontaine (circa 1865-1970), où dominent es roses, des blancs et des gris ; la figure vu quasiment de profil est a des contours précis, mais le reste de la composition est un peu flou. Ce contraste n'est pas accentué, mais donne à l'ensemble une sorte de magie étrange et de beauté confondant le réel et l'irréel. Bien sûr, d'autres portraits sont plus « classiques » dans leur expression, mais jamais Corot ne joue la carte d'académisme. L'Agostina (1866) en est la manifestation : la belle Italienne est restituée avec sévérité, mais les nuages qui remplissent le ciel derrière elle apporte une tonalité plus suave à l'ensemble. Toutes ces pièces nous dévoilent le grand art de Corot qui ménage les principes établis de la peinture tout en introduisant un esprit inédit en tous points de la composition et de sa traduction en architecture de ses composants et le choix de ses couleurs.
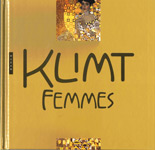
Klimt - Femmes, Angelika Bäumer, Hazan, 92 p., 16,90 euro.
Gustav Klimt est connu pour la seconde période de son oeuvre. La première, purement académique, même moins intéressante que l'oeuvre d'Hans Makart, faire valoir sa grande dextérité picturale. Mais pas la moindre originalité. La seconde, peut être qualifiée de révolutionnaire. On a le sentiment que c'est un autre artiste qui a vu le jours. La thématique choisie pour ce livre le prouve amplement. L'Amour de 1895, montre déjà qu'il éprouve le besoin d'un changement radical. Cela se traduit dans le détail, en particulier par le magnifique cadre doré orné de roses roses sur fond doré. Hygeia (extrait de sa grande composition, La Médecine, une commande officielle, 19000-1907) met en évidence une évolution profonde. Cette figure a perdu de ce réalisme convenu et commence à prendre une dimension allégorique donc de nature en partie imaginaire. En réalité, il avait déjà pris ce tournant en 1901 avec Judith, on l'on trouve déjà la quasi totalité es caractéristique de son oeuvre ultime : , une beauté sublimée, une nudité qui a une touche érotique, un visage sublime, à peine idéalisée, des bijoux flamboyant, comme ce tour du cour d'or et de pierreries précieuses. Le vêtement de ce modèle peut passer pour antique. On peut le comparer avec un tableau signé en 1898, Eau en mouvement, qui montre deux femmes nues emportées par des flots puissants, qui est de nature symbolique, mais ne présente pas encore les caractéristiques que nous venons de signaler. La mutation d'esprit et de style dans l'art de Klimt s'est donc fait en peu de temps. Par la suite, son recours à l'exemple de l'art byzantin et de ses cloisonnements en mosaïque l'a parachevée. Outlines, un an plus tard, commence à le faire, avec ces manteaux en fourrure stylisées et irréels, ces grands rais de lumière dorée, ce fond dématérialisé, qui est pur jeu chromatique... Sa Salomé (1909) est un être mythique, non plus une vraie femme de chair et de sang, avec sa robe multicolores, le fond ornementé et ces entre l'art traditionnel du portrait et sa propre conception. Les tesselles de diverses couleurs dans son ample chevelure noire. Son visage étonne car il respecte sans doute le modelé propre du modèle, mais, avec ses yeux clos, ses lèvres entrouvertes, accompagnés par ce mouvement étrange du corps qui semble tendre vers quelque chose de lointain de puissant, mais ne semble pourtant pas bouger, engendre des sentiments complexes, où le désir et le vertige se conjuguent. Quant à ses portraits mondains - dont la magnifique Femme au chapeau et boa (1909) il recherche un compromis entre la femme qui pose pour lui et l'imaginaire dont elle est entourée et qui est sa vie intérieure telle qu'il l'interprète. Le Portrait d'Adèle Bloch Bauer II (1912) est une des expressions les plus accomplies de ce compromis. Le model est respecté, mais plongé dans un univers onirique. Sa beauté est représentée et exaltée dans chaque détail de la robe, des tapisseries, des dessins du fond et de ce rose qu'il a choisi de placer autour et derrière elle. Ce volume est une superbe introduction à l'esthétique inouïe de ce peintre qui a transgressé les codes de son temps.

Gratte-ciel, John Hill, Alternatives, Gallimard192 p., 20 euro.
Il y a quelques décennies, quand on songeait aux gratte-ciel, on ne pouvait s'empêcher de songer à New York. Aujourd'hui, cette conception de l'architecture se retrouve à peu près dans tous les continents, l'Afrique restant de loin le moins bien doté. L'auteur n'a pas fait en introduction un historique de ce genre de construction, ni même une plongée dans la mythologie de ces architectures, à commencer par la tour de Babel. Il a préféré détailler une typologie, ce qui est très intéressant car les modalités techniques et même l'aspect esthétique ont connu une évolution assez prodigieuse. Il est tout de même intéressant de comprendre comment la technologie a pu se développer au point de donner la possibilité de construire toujours plus haut et d'adopter des formes innovantes et parfois surprenantes. Bien sûr, il fournit quelques exemples célèbres, comme le Flat Iron (1902) ou le Chrysler Building (1930) de New York, parce que ces exemples déjà anciens permettent d'établir des modèles pour l'avenir. Après les préliminaires, on peut découvrir les réalisations les plus spectaculaires ou les plus étonnantes. C'est ainsi qu'on a vu s'ériger à Santiago du Chili, dans une zone fortement sismique, la Torre Costanera, achevée en 2014, haute de trois cents mètres. Les bâtiments érigés à Londres sont décevants par leur manque d'audace et leur pauvreté esthétique. Seule la St. Marie Axe, achevée en 2004, oeuvre de Forster & Partners fait exception dans cette incapacité anglaise de faire de Londres une belle ville, en dépit des nombreuses rénovations entreprises depuis la fin de la guerre. On peut néanmoins signaler The Shard, conçu par Renzo Piano, qui mesure trois cent six mètres de haut qui fait exception pour ses dimensions. J'ai été un peu surpris de trouver dans ce livre la Tour Pirelli de Milan, création du grand créateur que fut Gio Ponti près de la gare centrale, car elle ne mesure que 107 mètres. Elle date de 1958 et demeure une des rares réussites dans l'architecture de cette période dans la capitale économique de l'Italie. Il est vrai qu'elle est bien plus belle malgré tout que tout ce qui a été construit à l'occasion de l'exposition universelle près de la gare Garibaldi. Le Turning Torso, inauguré à Malmö en 2005, est une incontestable réussite. Elle mesure 190 mètres, mais se caractérise par sa transformation en sculpture, l'ensemble étant soumis à une torsion en spirale. Cette idée de la torsion a été reprise dans l'Evolution Tower à Moscou, qui mesure 246 mètres et a été terminée en 2015. Mais les créations les plus extraordinaires se trouvent soit dans le golfe arabique, soit en Asie. Là, l'audace, l'ambition, la volonté de frapper l'imagination ont été plus fortes, comme le prouvent La Bahrain World Tower Center à Barhein (2008), le Kingdown Center de Riyad (2002)ou encore l'O-14 de Dubaï (2010). On voit dans ces émirats naître une autre idée de l'architecture, qui n'est pas à proprement parler révolutionnaire, mais qui brise quelques codes. Le Burj Khalifa (2010) à Dubaï est une réussite plastique incontestable et réalise un exploit : elle mesure 828 mètres de haut. La Chine a accumulé les performances dans ce domaine et il faut retenir la Tour de Shanghaï (2016) haute de 632 mètres. Cet album bien documenté nous fournit l'opportunité de voir ce que l'architecture peut accomplir quand il existe non seulement le désir de battre des records, mais aussi de faire l'architecture à la fois un objet fonctionnel et une oeuvre d'art.

Dépressions, Hanna Müller, traduit de l'allemand par Nicole Bary, Folio, 240 p., 7,25 euro.
Il me faut reconnaître que quand Herta Müller (née en Roumanie en 1953) a reçu le prix Nobel de littérature, ne connaissant rien de sa prose. J'ai fini pas apprendre ses démêlées avec les autorités roumaines (elle avait pu finalement s'installer en Allemagne de l'Ouest en 1987) et l'essentiel de son oeuvre repose sur l'histoire des Allemands souabes de Transylvanie. Dépressions (Niederungen) qui ont été persécutés quand les Roumains, après la Grande Guerre se sont vus attribués cette région hongroise. Publié en 1982, ce livre a été aussitôt censuré. Elle se voit interdire de publier dans son pays natal. Il faut dire que ce livre est une dénonciation sans appel du sort infligé à cette minorité allemande. Elle le fait dans un style rapide, tranché, sans nuance, qui fait passer le naturalisme d'Emile Zola pour une liqueur doucereuse ! Quand on lit ces pages, on a l'impression d'une vie dans un stalag. Je ne suis pas compétent pour juger de cette affaire. Mais je sais néanmoins que la Roumanie était alliée de l'Allemagne nazie et a participé à la campagne de Russie, et a exterminé ses Juifs après avoir tenté de les vendre (sic). Sans doute la vie terrible qui est faite à ces Allemagne est-elle une réalité. Mais son livre semble ne pas avoir de contexte. Beaucoup de gens ont souffert de la dictature de Ceausescu, à commencer par ses compatriotes. Ce qui est la limite de son oeuvre, c'est de faire pleurer sur le peuple allemand et n'est pas sans poser de problèmes. Elle a rejeter le communisme, soit. Mais de là à applaudir l'invasion de l'Irak par les Américains et leurs alliés me semble prouver qu'elle une vision bornée du monde. Ce livre porte bien son titre : il est déprimant. Et, d'une façon ou d'une autre, on se met à douter de plus en plus de sa véracité à mesure qu'on avance dans sa lecture. Il ya ici un excès de misérabilisme et de noirceur qui ne rend plus les choses crédibles. Et cela ne fait pas d'elle un grand écrivain. Il faut se souvenir dans ce cas d'espère que le premier prix Nobel a été Sully Prudhomme !

La Grande beuverie, René Daumal, Allia, 174 p., 6,60 euro.
Quelle belle idée d'avoir réédité l'oeuvre maîtresse de René Daumal ! On ne se souvient de sa brève existence que la fondation avec Roger-Gilbert Lecomte, Roger Vaillant et le peintre tchèque Josef Sima de la revue Le Grand Jeu.
Il s'agit là de sa première oeuvre importante en prose, publiée en 1938. Elle serait née après la révélation en 1930 de la pensée mystique de Gurdjeff. Il en retire l'idée de rechercher une écriture qui ne soit pas romanesque, mais une sorte de « métaphysique expérimentale ». La gestation de cet ouvrage fut assez longue, comme en témoignent les fragments inédits parus posthumes. Il est vraiment inclassable, d'où peut-être le modeste intérêt qu'on a pu lui porter dans les cercles littéraires. Et pourtant, quelle oeuvre étonnante ! Daumal y dépeint un monde irréel et absurde, qui ressemblerait à une sorte de pérégrination dantesque dans ce qu'il appelle la Jérusalem contre-céleste, où se mêlent l'humour, la dérision, l'absurde le plus déconcertant, qui pourrait être aussi ressentie comme une farce transcendantale. Il n'y a pas de grands fils conducteurs, mais des épisodes intriqués ou disjoints. Mais il y a une idée qui sous-tend le tout : celui delà soif, au sens propre comme au sens figuré. La quête de l'absolu comme la quête du plaisir, le voyage comme l'amour, tout est emporté comme sur le bateau ivre de sa pensée. Soif de sensualité, soif de connaissance, soif de dépassement de soi se fondent en une seule et même aspiration. Il y a une foule de personnages qui apparaissent et qui disparaissent, emporté par ce grand flux d'expérience. Ce sont des pantins ridicules et sans doute une multitude de jumeaux pathétiques de l'auteur qui prennent par à cette risible Commedia. L'entrée au paradis est spectaculaire, sublime et risible : « La porte s'ouvrit silencieusement et nous nous trouvâmes au Paradis. Une lumière! Des lustres! Des moulures dorées! Des papiers peints, qu'on aurait dit des vraies tapisseries. Des divans profonds comme des tombereaux, couverts de torrents de soie artificielle. Des fontaines lumineuses qui distribuaient verveine, camomille, menthe, orangeade, limonade [...] des bibliothèques à catalogues électriques et distribution automatique. Des pupitres en contre-plaqué avec phonographe, TSF et cinéma sonore individuel. Des brises de patchouli. Des rosées de glycérine, qui ne s'évapore pas, sur des gazons de papier paraffiné, qui ne fane pas.
Des anges en baudruche, gonflés d'hydrogène, flottaient parmi les cataractes de lumière oxhydrique, agitant dans leurs tendres mains des harpes éoliennes d'où neigeait le bruissement de valses viennoise et d'allègres chants militaires, enfin de tout pour tous les goûts. » Ces pages ne peuvent pas se résumer ni se réduire à quelques idées forces. Elles doivent être lues (ou plutôt bues avec avidité) comme une traversée fantomatiques dans les diverses sphères de l'esprit et de la géographie, d'une philosophie solitaire et d'une dérision profonde et tragique de l'univers tel qu'il apparaissait aux yeux de Daumal. A ne manquer sous aucun prétexte.

Portraits d'Italie, Laurent Bolard, Les Belles Lettres, 286 p., 23 euro.
Quand on songe au voyage en Italie, on pense surtout aux voyages effectués à la fin du XVIIIe siècle, par des écrivains, des artistes et des passionnés d'art ancien et moderne. C'est Goethe qui a incarné ce qu'on appelé le Grand et le Petit Tour, voyage dans la péninsule indispensable à toutes les personnes de culture, avec la bénédiction de Winckelmann qui a fondé l'idéal esthétique du néoclassicisme. Dans cette étude approfondie, l'auteur s'intéresse à de grands écrivains, comme Montaigne et Montesquieu et à des voyageurs cultivés, comme le président de Brosses, le plus connu de tous, mais qui se sentaient plus concernés par les moeurs, l'état d'esprit, les usages, les qualités et les défauts du peuple italien que par ses vestiges antiques ou le grand art de la Renaissance. Ce qui est vraiment intéressant ce que le portrait que les uns et les autres esquissent des Italiens est un subtil mélange de préjugés, d'observations souvent très fines, mais aussi de ce que les intéressés veulent laisser transparaître de leur caractère. Beaucoup pensent que l'amour et le mensonge seraient leurs traits distinctifs. Sans doute la présence en France des reines Médicis a-t-il joué un rôle dans cette analyse. Mais la multiplicité des points de vue permet de corriger cette image un peu trop schématique. Et là, la méthode employée par Laurent Bolard permet de pénétrer plus en profondeur dans les mentalités, d'autant plus que l'Italie ne constitue pas une entité unique comme la France (même si des différences sont très notables entre les différentes régions de notre pays). Grâce à ces nombreux témoignages qu'il a choisi de limiter à l'âge baroque, il nous donne une idée très précise de la manière de vivre dans ces nombreuses régions de la péninsule, d'aucunes étant sous domination étrangère. La partie consacrée à la dimension du sacré est particulièrement éclairante. En effet, la puissance de la religion catholique et la puissance intrinsèque des Etats pontificaux jouent un rôle de premier plan dans l'idée que les Italiens peuvent se faire du sacré, qui n'est pas exempt de diverses superstitions. C'est là un travail remarquable, qui nous éclaire sur cette civilisation et que nous ne connaissons au fond qu'à travers les littérateurs et les esprits curieux et savants du XIXe siècle, le voyage en Italie ayant pris alors un tout autre aspect : Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Gérard de Nerval, Taine, pour ne citer qu'eux, ont écrits es ouvrages fondamentaux pour cette découvertes. Mais leurs précurseurs ont fait un travail tout aussi pertinent pour une période plus reculée. Voilà un livre à la fois très savant et très plaisant à consulter. Et un moyen de laisser de côté bien des idées toutes faites.

Les livres tiennent tout seuls sur leurs pieds, Virginia Woolf, traduit de l'anglais et préfacépar Micha Venaille, « Domaine étranger », Les Belles Lettres, 224 p., 15 euro.
Je voudrai d'abord exprimer un regret : la quasi totalité des essais de Virginia Woolf ont été traduits dans notre langue, mais de manière dispersée et anarchique. Mais je me réjouis néanmoins que Jean-Claude Zylberstein ait fait ce choix car il contient des textes importants. Il nous oblige d'abord à nous rappeler que Virginia Woolf a été une grande romancière, mais aussi un critique de premier ordre. Elle a bien sûr privilégié les auteurs anglo-saxons, comme on le constate ici avec Daniel Defoe, John Keats, Joseph Conrad, Charles Dickens, Jane Austen, entre autres. Il n'y a d'ailleurs qu'un seul écrivain étranger, Tchekhov. Je ne prendrais qu'un seul exemple, celui de son compte rendu des oeuvres complètes de Lewis Carroll paru en 1939. D'emblée elle, mine de rien, avec son écriture souple et d'une grande simplicité, elle brosse un portrait du révérend Dogsdon, qui est tout à l'emporte-pièce puisqu'elle juge qu'il n'a pas eu vraiment d'existence, et puis nous conduit rapidement à comprendre que les deux livres ayant Alice ne sont pas destinés aux enfants, mais au adulte pour revenir dans le monde de l'enfance, pour le recréer. Et ce monde là est celui du sommeil et donc du rêve, d'une logique bien à soi, étrange, fantastique, le temps étant soumis à des distorsions, les personnages, à des métamorphoses. Et de nous amener subrepticement que ce retour à l'enfance est peut-être une façon de voir le monde à l'envers, mais plus spécifiquement à la lettre. La chute est étonnante car elle voit dans cette lecture la promesse d'un réveil difficile. Qui retrouve-t-on à la fin, Lewis Carroll ou le professeur de logique Dodgson ? Voilà un court article, brillant, construit avec originalité, avec une moralité surprenante. On peut aussitôt le mettre en relation avec cet autre article sur le roman de Beresford, Une mère imparfaite. Elle y décèle une volonté de décrire les stratagèmes souterrains de l'inconscient qui sont décrits avec soin. Et elle conclue : « Oui, dit la part scientifique du cerveau, c'est instructif ; cela explique beaucoup de choses. Non, se dit son côté artistique, on s'ennuie... » Virginia Woolf est très au fait de la pensée freudienne, ne semble pas en être ennemie, et s'indigne de son application vulgaire et didactique à la fiction. Il y a aussi de merveilleuses considérations sur le livre sur toutes ses facettes, comme par exemple la lecture. Elle expose dans cet article « Comment doit-on lire un livre ? » une méthode, qui n'est pas universel, car la lecture est un fait tout à fait personnel, mais indique des chemins pour ne pas se perdre dans le cosmos de la bibliothèque. C'est remarquable de sagacité. Elle a toujours été capable de condenser en peu de phrases une pensée complexe et de l'exposer avec délicatesse et une rare intelligence, et de la rendre accessible à tous. Un chef-d'oeuvre dans un genre qui peut vite se révéler ennuyeux.

Claude Debussy, Philippe Cassard, Actes sud, 168 p., 16,50 euro.
Ce n'est pas là une biographie en coupe réglée, ni une monographie savante, ni même une étude de musicologie. Il s'agit plutôt d'une vie d'artiste narrée en toute liberté, mais avec le plus grand sérieux, par un musicien passionné par l'oeuvre de ce grand compositeur. C'est un vrai plaisir de découvrir l'auteur de Pelléas et Melisandre sous la plume de ce musicien aguerri qui n'en est pas moins un érudit. Mais plus que l'érudition, c'est le sentiment qu'il «éprouve pour cette homme et sa musique qu'il entend nous faire partager. Et il est réussit à merveille. Il ne nous dit pas tout de Debussy, mais préfère mettre l'accent sur des traits significatifs de ses engouements et de ses choix. Par exemple, il parle longuement de son désir précoce de mettre en musique la poésie de Paul Verlaine (il a été le premier à le faire). On découvre ainsi la culture qui a été la sienne et qui a influé sur son art. Tout le livre est fait de cette façon, même si nous découvrions son univers familial, ses études, ses maîtres et sa formation. On y apprend vraiment beaucoup de choses. Mais comme tout n'et pas mis à plat, on découvre ce que l'auteur considère comme étant le plus important et le plus pertinent. Il l'a écrit pour faire aimer Debussy, mais aussi pour que nous comprenions quels ont été les grands ressorts intellectuels et émotifs qui ont gouverné son oeuvre. Pour ceux qui le connaissent peu, c'est une magnifique introduction. Pour ceux qui sont plus familiers de ses créations, c'est un instrument efficace pour lire ses partitions sous une lumière nouvelle, peu académique, sans être jamais extravagante ou trop la traduction d'une idée fixe de Philippe Cassard. Ainsi, il donne satisfaction à tout un chacun, avec beaucoup de finesse et une connaissance profonde de ce que et homme d'exception a pu accomplir tout en révolutionnant la musique française.

Le Goût du secret, entretiens 1993-1995, Jacques Derrida / Maurizio Ferraris, Hermann, 138 p., 16 euro.
Ce dialogue inédit entre Maurizio Ferraris et Jacques Derrida (1930-2004) permettent de faire le point sur la dernière période de la réflexion du philosophe. Il ya un grand pas entre l'auteur de De la grammatologie (1967) et de celui de l'Histoire du mensonge 2012), en passant par Glas (1974), une tentative hasardeuse d'oeuvre de fiction et au très décevant recueils d'essais sur l'art, La Vérité en peinture (1978). Et il y a aussi des changements de cap et de centres d'intérêt, des interrogations et des dérives. « Toutes les fois que j'écris quelque chose, j'ai l'impression de commencer... » : Derrida se place d'emblée aux antipodes d'une posture philosophique classique, qui est celle de continuer à creuser un sillon, à approfondir une réflexion. Ce recommencement permanent de la pensée de Derrida est sans doute une qualité en notre temps, mais c'est aussi là où le bât blesse. Il paraît suivre une boussole affolée et ne parvient jamais à tendre vers une pensée qui va en s'épanouissement. Théoricien de la déconstruction et de la dissémination, il paraît vivre ses intuitions spéculatives. Dans ces conversations, il avoue d'ailleurs (et revendique) ce qui pourrait passer comme un travers comme, par exemple, la naïveté. Ce qui frappe ici, c'est le courage de se dévoiler tel qu'en lui-même avec ses doutes et ses questionnements sans réponse. Cet ouvrage nous fait découvrir l'homme sans artifice, qui est aussi l'homme qui pense. Le dialogue final avec le philosophe italien Gianni Vattimo est très intéressant car il révèle que Derrida, dès le début, s'est posé la question de ce qui se passe. Et il peut aussi se demander ce que le beau peut apporter de négatif à un espace construit. En somme, chez lui, la curiosité et l'interrogation ont été plus fortes que la définition d'un champ spécifique de la raison. Il pressent que quelque chose échappe dans le monde et que ce monde ne peut plus être interprété avec un certain nombre de certitudes. C'est sans doute là ce qu'il y avait de plus captivant en lui.

Les Mots qui nous manquent, Yolande Zaubermann & Paulina Mikol Spiechowicz, « Le goût des mots », Points, 368 p., 7,90 euro.
Voilà un dictionnaire qui est des plus utile et, en même temps, des plus divertissant. Il répertorie les mots étrangers qui n'ont pas d'équivalent en français. On se rend compte que notre langue n'est pas simplement une boîte à outil pour s'exprimer et décrire le monde, c'est également une façon très particulière de voir les choses en fonction de notre culture. Je prends pour exemple la partie consacrée à la beauté. Le mot japonais urizanegao, qui désigne un visage jugé très beau. Rien de tel en français : il faut alors avoir recours à un adjectif. Il y a d'ailleurs un certain nombre de mots japonais qui ne trouvent pas leur équivalent chez nous. C'est que l'esthétique du Japon est très loin dans ses fondements de la nôtre. Et ces mots qui remplacent ce qui est une expression sont nombreux et appartiennent à un nombre considérable de langues Ce livre est une petite merveille. Je ne lui ferait qu'un seul reproche : ne pas avoir choisi beaucoup de mots européens. Je traduits de l'italien au français et je me rends compte que pas de mots et encore plus d'expressions idiomatiques ne peuvent pas se traduire de manière évidente. Il faut découvrir des solutions biaisées. Les auteurs ont choisi pour l'essentiel les pays africains, asiatiques, latino-américains, de la zone du Pacifique. Mais le voyage auquel ces deux dames nous invitent est un délice car il nous fait toucher du doigt les confins du français, des ses possibilités expressives, de ses nuances, et, aussi, la merveilleuse richesse de ces idiomes lointains.
|
