
OEuvres à objet, Marc Desportes, Editions du Regard, 256 p., 24,50 euro.
Le titre à de quoi surprendre. Autrefois (mais il n'y a pas si longtemps) on parlait d'assemblages, ce qui a d'ailleurs fourni le titre d'un célèbre exposition à New York qui a marqué les esprits à cette époque. De plus la construction du livre est elle-même surprenante. Elle commence par Marcel Duchamp, ce qui serait à première vue sacrifier une fois de plus à cette mythologie que fait de cet artiste le saint Pierre de la religion de l'art contemporain. Mais quand on se plonge dans cet essai, on comprend mieux l'esprit qui a guidé son auteur : chacun des créateurs qu'il a choisi n'est pas là pour refaire une histoire détaillée de l'emploi des objets dans l'art moderne dès le début du XXe siècle, mais plutôt de comprendre comment ils ont développé cet emploi et à quelles fins. Et je dois reconnaître que ces parcours sont très convaincants. Pablo Picasso et puis Georges Braque et un certain nombre de ceux qui ont adhéré au cubisme, ont trouvé une autre voie, partant des objets quotidiens collés sur le tableau jusqu'aux sculptures faites avec différents matériaux et surtout de différents choses trouvées au hasard de ce que la ville pouvait avoir jeté au rebut. En somme, chacun d'entre eux incarne une posture par rapport cette problématique. Par exemple, Kurt Schwitters incarne Dada et ses collages abracadabrants et Meret Oppenheim incarne le surréalisme, ce qui n'empêche pas Marc Desportes de mettre en évidence d'autres manière de concevoir la capture des objets. Comme celles de Max Ernst ou de Salvador Dalì. Il remonte ainsi le cours du temps pour en arriver à Robert Rauschenberg et son fameux Lit de 1955, et s'intéresse aussi Jasper Johns. Ensuite, il passe au Pop Art et Andy Warhol et puis au Nouveau Réalisme, avec Arman et César et enfin Fluxus avec George Brecht (on peut regretter vraiment l'absence de Joseph Beuys, pourtant une figure tutélaire de ce genre de fiction de l'objet). Pour les décennies les plus proches de nous, il a choisi de s'occuper de certains genres de choses : les chaises, les dentiers, les pneus, etc. Il n'est plus possible à ce stade de définir des courants et des mouvements spécifiques. Il faut reconnaître que sa méthode est efficace car, en le lisant, on parvient à embrasser l'ensemble des situations qui se sont proposées dans les arts plastiques, et qui n'ont fait que se multiplier avec l'élargissement du champ des possibles, surtout avec l'électronique. C'est donc un livre qui nous fait découvrir cette rapide introductions des objets n'appartenant pas au domaine spécifique de l'art tel qu'on la conçu depuis les temps anciens. Cela donne la faculté d'avoir une vision d'ensemble d'une grande clarté et aussi très bien définie pour les cas qu'il a mis en exergue pour servir d'exemple. En fin de compte, ces OEuvres à objet est une très bonne façon de prendre le problème bras le corps.

Le Visage nuptial suivi de Retour amont, René Char, illustrations d'Alberto Giacometti, préface de Marie-Claude Char, « Poésie », Gallimard, 128 p., 9 euro.
Le poète et l'artiste ont d'abord en commun d'avoir été proche du mouvement surréaliste et puis d'en avoir été exclus ! Mais cela leur a permis de sceller une profonde amitié, qui s'est traduite par une correspondance, un portrait de Char par Giacometti et un texte de l'écrivain sur l'artiste encore méconnu. Ce n'est qu'après la guerre, grâce Yvonne Zervos et aux Cahiers d'Art qu'elle dirige que les deux hommes ont pu envisager une collaboration. Suivent alors plusieurs oeuvres réalisées en commun dans des éditions limitées et donc précieuses, en particulier celles (mémorables) de Guy Lévy Manno. Le Visage nuptial, manuscrit, est illustré de sept dessins de l'artiste en 1963 et, deux ans plus tard, Retour amont paraît avec quatre eaux-fortes, qui sont remarquables car l'artiste a choisi pour dominante la couleur noire. Il a fallu longtemps pour que cette relation étroite donne enfin ses fruits dans la réalisation d'ouvrages réservés aux amateurs d'art. Mais le résultat est là. Cette édition dans la collection « Poésie » de Gallimard a le grand mérite de reproduire en facsimilé les pages de Char et les oeuvres de Giacometti, ce qui est une merveille car, bien sûr, les originaux sont désormais la propriété de musées ou de grands collectionneurs. Je trouve que c'est une idée formidable car elle montre comment ont peu travailler de conserver l'homme de lettres et l'homme du dessin et de la gravure. En plus de son caractère historique, telle réédition peut servir de modèle des projets futurs, renouant les liens un peu distendus entre littérature et arts plastiques.

Les Orientalistes, Christine Peltre, Hazan 300 p., 45 euro.
Contrairement à ce qu'affirme Christine Peltre, l'intérêt pour l'Orient a débuté bien avant la conquête de l'Egypte entreprise par Bonaparte. La plupart des ambassades occidentales à Istanbul avaient, dès la fin du XVIIe siècle, fait venir des artistes pour y travailler. De grandes figures sont venues travailler, certains comme Melling, à la demande des proches du sultan, ce qui leur a permis de faire des panoramas de la capitale qui n'auraient pas été autorisées à d'autres. D'autres, comme Antoine Favray, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, est allé à Malte ; de là, il a entrepris en 1762 de faire un séjour à Istanbul dont il a rapporté des tableaux assez extraordinaires. Et il ne faut pas oublier le peintre suisse Jean-Etienne Liotard qui est allé dans l'Empire ottoman en compagnie de Lord Duncannon en 1736. Il en a tiré des scènes de genre magnifiques et aussi un amusant autoportrait en Turc. Il est ensuite allé en Moldavie quelques mois en 1743. Il a dès lors voyagé en travers l'Europe vêtu à la turque ! Ce ne sont là que les peintres les plus connus. Et il faut aussi souligner la mode qui s'est imposée en Europe au XVIIIe siècle et dont les tableaux des Guardi seront l'une des expressions les plus curieuses et amusantes (ils ne sont jamais allés en Orient). Il faut regretter que l'auteur n'ait pas repris et mis à jour les travaux d'Auguste Boppe sur les peintres du Bosphore au XVIIIe siècle, publiés en 1911, qui demeure une source essentielle et qu'elle connaît parfaitement. C'est donc un choix. Sans doute la campagne d'Egypte a révélé la grandeur et la beauté de la grande civilisation antique. Mais son impact en France a plus touché les arts décoratifs sous l'Empire que les arts plastiques. A mon avis, c'est la littérature des écrivains voyageurs, de Chateaubriand à Pierre Loti qui a été un facteur déterminant dans cette mode. De plus certains de ces auteurs ont défendu ce genre nouveau au Salon, comme Théophile Gautier avec le jeune Prosper Marilhat. Quoi qu'il en soit, Catherine Peltre étudie en détails toutes les formes d'orientalisme possible, non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays de notre continent. Son ouvrage est assez complet, même si la littérature n'a pas l'importance qu'elle devrait pour comprendre cet engouement. Ce livre peut prendre place à côté de L'Univers des orientalistes (Editions de la place des Victoires). Cela étant dit, c'est un livre qui est important pour la connaissance de ce genre de peinture, qui a été bien au-delà d'un prolongement d'une vision colonialiste du monde.

Mondes tsiganes, sous la direction d'Isen About, Mathieu Pernot & Adèle Sutre, Musée nationale de l'immigration / Actes Sud, 192 p., 29 euro.
Ce catalogue remarquable relate l'histoire d'un peuple énigmatique qu'on a appelé Tsigane, Manouche, Gitan, Romanichel, Rom (c'est le terme qu'il se donne dans la langue romani), Bayache (nom dérivant du roumain ancien) autrefois Bohémien, pour les savants Kalès (dans la péninsule ibérique) ou Sintis, et qui passe aux dires des braves citoyens (pour eux, les gadgé) pour être les « gens du voyage ». On suppose que ces peuples itinérants sont originaires du sous-continent indien. D'aucuns prétendent qu'ils seraient même venu de la ville de Kannau, où ils auraient été déportés au XIe siècle. Mais d'autres pensent qu'ils sont arrivés d'Egypte, ou d'ailleurs, même de Bohème (d'où le nom qu'on leur a donné). En réalité on ne sait pas grand chose sur leur passé car s'ils ont une langue, ils n'ont pas d'écriture. Ils constituent des populations désormais hétérogènes mais avec des points communs, comme le nomadisme et le langage (avec de nombreuses variantes). Inclassables, les Allemands, sous le IIIe Reich ont vite fait de les classer comme indésirables et les ont condamnés à un impitoyable génocide, qui a fait environ un demi-million de morts. Ce massacre organisé est rarement évoqué. Evidemment, il paraît d'une dimension relativement modeste par rapport à ce qu'a été la Shoah pour les Juifs. Mais je crois qu'il serait bon aujourd'hui de remettre en mémoire cette abomination car on traite des personnes avec beaucoup de mépris, parfois avec haine. On les chasse et on ne cherche même pas à leur donner une chance de trouver leur place véritable dans nos sociétés. Ils sont boutés hors de Roumanie, traverse toute l'Europe, où ils sont très mal accueillis et finissent par aboutir en France, où ils sont renvoyés à leur point de départ. On ne les accepte, du bout des lèvres, que s'ils se résignent à se sédentariser. Des efforts ont été faits dans ce sens en Roumanie, mais avec d'assez maigres résultats. Ce grand album photographique qui va des années 1860 jusqu'en 1980 est fabuleux car on peut les voir en différentes époques et en mille lieux. On comprend à travers tous ces clichés que leur existence est bien celle de l'errance, et de la misère qui souvent en résulte, mais aussi de la musique et de la danse, qui ont influencé très profondément plusieurs cultures occidentales. Ils font peur parce qu'ils n'appartiennent à aucun pays, pas même à une région précise du globe. Ils en sont venus à partager ainsi les préjugés et la peur sourde qu'inspire le Juif errant. L'Europe ne les considèrent pas une seconde. Ce sont des apatrides devant l'éternité. Dans un passé désormais lointains, de nombreux peuples étaient nomades. Ils sont demeurés les seuls sur notre continent. Il y a une poésie dans ce mode de vie, mais qui a pris une tournure tragique à cause des maux qu'on leur impute. Cette exposition et ce catalogue devraient permettre de réfléchir sur leur sort et nous, qui prétendons, être les messagers des droits de l'homme, nous pourrions nous mettre à méditer comme les intégrer de manière honorable sans détruire leur culture propre.

El Greco, Le Corps mystique de la peinture, Pascal Amel, Editions du Regard, 144 p., 19 euro.
Domenikos Theotokopoulos (1541-1614) demeure un des grands mystères de la peinture de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe. Né à Candie, en Crète, alors possession de la Sérénissime République, il aurait commencé par peindre des icônes. Légende ou réalité, tout cela reste à vérifier (peut-être d'ailleurs ne le saurons-nous jamais). La seule certitude est qu'il s'est rendu à Venise, encore très jeune, en 1566.L'auteur avance des hypothèses sur sa formation et sur la possible raison de son départ pour la capitale de cet empire maritime bien mis à mal par les Ottomans. Mais là, il fait jouer son imagination, car les preuves sont introuvables. La seule certitude qu'il nous apporte est la vente d'une de ses oeuvres cette année-là. Il semblerait qu'il ait rejoint son frère qui s'est retrouvé dans la paroisse de San Giorgio dei Greci, comme tant d'autres Grecs qui formait alors l'une des communautés étrangères les plus importantes dans la cité des doges. En tout cas, il semble que dès 1567 il a déjà sa propre bottega, ce que prouve son Adoration des mages, exécutée entre 1567 et 1570. En 1568, il se rend à Modène pour y peindre un important polyptique. Dans ces premières oeuvres, on peut remarquer déjà deux choses : qu'il a assimilé le chromatisme savant de l'école vénitienne et, aussi, qu'il a déjà commencé à affirmer son propre style. Pascal Amel avance sur ce point des hypothèses qui sont loin d'être absurdes. On peut enfin remarquer que sa maniera est encore un peu fauche. C'est encore un peintre qui se recherche. Le Titien a parlé dans une lettre adressée à Philippe II d'un peintre grec dont il vante les dons. Il est plus que probable qu'il s'agisse d'El Greco. Ce qui est intéressant dans cet essai, c'est que son auteur multiplie les pistes et expose le contexte de l'époque. Bien sûr, on est en droit de douter. Mais rien d'absurde dans ce qu'il propose comme explications, d'autant plus que nous nous trouvons en face, comme c'est souvent le cas, d'une information très lacunaire. Les travaux qu'il réalise alors prouvent au moins qu'il était déjà apprécié. Il rapporte une lettre de Giulio Clovio (dont il a fait le portrait entre 1571 et 1572) qui le recommande au prince Alexandre Farnèse pour que celui-ci puisse travailler dans son palais. On retrouve sa trace en 1572 dans des écrits où il figure comme « peintre sur papier et d'enlumineur » à l'Académie de Saint Luc, ce qui pose la question de son statut. On sait également que Domenico Greco a condamné les fresques vaticanes de Michel-Ange (il aurait même proposé de refaire du tout au tout l'ouvrage titanesque). A Farnèse, il a en tout cas affirmé ses opinions en matière de création picturale, loin de tout ce qui est admiré ou reconnu à l'époque. Il serait parti en 1574 à Madrid et c'est là qu'il a pu affirmer sa personnalité dans ce bastion intransigeant du catholicisme le plus dur. L'Adoration au nom de Jésus de 1570 montre qu'il a su maîtriser son écriture plastique et, sept ans plus tard, sa Trinité, qui se trouve aujourd'hui au musée du Prado, est la suite logique de ses conceptions désormais bien établies. L'Espolio de la cathédrale de Tolède, conçu entre 1577 et 1579 ne fait que confirmer cette maturité acquise au prix d'efforts techniques considérables. Malgré des réticences, il est parvenu à s'imposer. Et ce qu'il a pu faire dès lors sort complètement du champ de l'art de la période. Sans doute la foi exacerbée qui a sous-tendu sa pensée esthétique l'a-t-elle aidé à parvenir à ses fins. Ce qui marque dans ces pages, c'est d'abord la finesse avec laquelle Pascal Amel décrit la facture de ses tableaux et aussi sa pénétration d'un projet qu'on ne peut imaginer à travers ses réalisations. Le profond mysticisme dont il a fait preuve (sa peinture, à de très rares exceptions près, est essentiellement religieuse) a sans doute contribué à faire admettre une façon de construire ses sujets dans une optique novatrice. C'est un beau livre, qui ne révèle pas tous les secrets de cet homme qui reste énigmatique et de sa création, dont on ne peut qu'extrapoler les intentions, qui tente avec intelligence de se rapprocher au plus près d'une tentative de pousser le plus loin possible la relation des hommes avec le divin.

De Delacroix à Gauguin, Somogy Editions d'Art / musée de Grenoble, sous la direction de Valérie Lagier, 256 p., 39 euro.
Ce catalogue accompagnant une importante exposition du musée de Grenoble, présente une grande partie de l'imposante collection de dessins qui sont conservés par ce musée. L'idée des conservateurs a été de les classer par thèmes, pour ne faire se limiter à une succession de noms connus et d'autres qui le sont moins. Après un historique de ladite collection, on commence un parcours qui débute par « l'invention du passé », c'est-à-dire par la façon dont les artistes ont pu, au cours du XIXe siècle, se représenter les siècles précédents. C'est ainsi que l'on découvre de beaux dessins préparatoires, très aboutis, de Merry-Joseph Blondel, artiste du début de ce siècle si riche. La section suivante concerne « le renouveau de la peinture religieuse ». On y découvre une étonnante Assomption de la Vierge, exécutée par Alexandre Evariste Fragonard et une étude en vue de La Vierge du Sacré-Coeur d'Ajaccio par Delacroix. Le voyage en Italie vient ensuite, avec des artistes souvent inconnus. Puis une partie entière est consacrée au voyage de Delacroix au Maroc et en Algérie avec des aquarelles et des crayons qui complètent nos connaissances des tableaux célèbres qu'il a pu réaliser en 1832 et les années suivant son retour à Paris (il y a en particulier un intéressant paysage des environs de Tanger). En tout logique, suit un chapitre sur l'orientalisme, avec un magnifique dessin d'Alexandre Decamps, peintre en partie oublié car il a détruit une grande partie de son oeuvre et de ses carnets dans un accès dépressif. Il y a de beaux paysages de Girardet, de Debelle, de Darras, de Simon, artistes mineurs, sans doute, mais de qualité. On passe ensuite dans la partie réservée aux paysages pittoresques, avec de remarquables paysages de Gustave Doté, dont on méprise encore la peinture. La caricature tient une place assez importante dans cette monstration : on y voit de nouveau Doré, mais aussi Nadar et Vogel. Viennent alors les grands courant qui ont traversé cette période et, en premier lieu, le réalisme. Auguste Pils et Nicolas Berthon sont d'intéressantes révélations. Quant à la Nature, Corot est bien entendu mis en valeur, mais aussi Daubigny et François Auguste Ravier, ainsi qu'Appian, qui sont appréciables. La fin de ce parcours est plus prévisible car on entre dans la sphère de l'impressionnisme avec Jongkind, Harpignies et Boudin, mais aussi un très beau Félix Ziem, Gros temps, qui évoque la fougue de Turner. La femme constitue également une section. Là, on voit de beaux portraits de Xavier Sigalon et de Français, mais encore un superbe crayon de Gavarni et même une belle brodeuse de Thomas Couture. La guerre et les thèmes monumentaux sont un peu décevants. En revanche, le symbolisme propose des papiers émouvants de Puvis de Chavannes et des ouvrages superbes de Fantin-Latour. Le tout s'achève avec Te nave nave fenua, une encre merveilleuse de Paul Gauguin et des carnets de voyages.

Au coeur de la création musicale, Myriam Tétaz-Gramegna, La Bibliothèque des Arts, 184 p., 19 euro.
Les amoureux de la musique moderne seront comblés avec ce volume où l'auteur a rassemblé vingt-et-un textes qu'il a obtenu de la part de grands composteurs. Le premier de ces dialogues se déroule avec Olivier Messiaen. C'est déjà l'une des pierres angulaires de cette grande métamorphose du XXe siècle. On y découvre ensuite les propos de György Ligeti, et puis ceux de John Cage, de Luciano Berio, de Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen, de Tòru Takemistsu, d'Henri Dutilleux. Il s'agit donc là d'un document inestimable. De surcroît l'intérêt de ces déclarations est qu'elles ne sont pas pléthoriques et se concentrent sur l'essence de cette musique nouvelle, parfois à partir d'une oeuvre ou d'un ensemble de créations. Ils ne sont jamais technique ou ésotériques et sont donc accessibles à tous les mélomanes, même s'ils ne sont que des amateurs. La plupart de ces auteurs sont désormais considérés comme des classiques, en considérant que ce terme signifie digne de passer à la postérité. Leurs explications nous font comprendre quels ont été les enjeux de leurs recherches dans l'espoir de découvrir les nouveaux horizons qui se présentaient à leur époque. Ces commentaires sont d'autant plus importants que certains d'entres eux, déjà disparus ou très âgés, n'ont toujours pas été admis par une grande partie des personnes qui aiment la musiques, mais ne sont pas encore parvenus à assimiler la musique dodécaphonique. Il est vrai que la musique expérimentale récente, comme celle concoctée à l'IRCAM, a pas mal contribué à ce désintérêt du public. Messiaen, Dutilleux, Boulez, les moins radicaux de ces créateurs, ont droit de cité. Quant aux autres, ils restent des noms qui personne n'ignore, mais qu'on ne goûte guère. Il s'est ainsi créé une fracture, que seuls ont pu comblé des compositeurs américains, comme Steve Reich, Phil Glass et même Charlemagne Palestine (qui ne sont pas présents ici). Voilà un ouvrage qui pourra aidé les plus sceptique à entendre d'une autre oreille ce qu'ont pu inventé Klaus Huber, Elliott Carter ou Arvo Pât. Assez curieusement l'art moderne a été mieux accepté que la musique moderne, qui lui fait pourtant écho. En ayant lu ces explications, les plus sceptiques ne pourront que faire l'effort de réviser leurs positions.
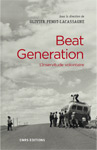
Beat Generation, Olivier Penot-Lacassagne, CNRS Editions, 392 p., 25 euro.
D'un colloque qui s'est tenu à son initiative à l'occasion de la très décevante et contestable exposition qui a été présentée au Centre Pompidou, Olivier Penot-Lacassagne ne s'est pas contenté de publier les actes dans la pure tradition universitaire. L'ouvrage est agrémenté de nombreux documents, de photographies, d'extraits de quelques uns des grands protagonistes et aussi d'entretiens avec des personnages (comme Lebel et Prigent, qui ont joué un rôle dans cette aventure ou qui ont été important pour la diffusion de cette littérature en France (point sur lequel il a tenu à insister). On est d'abord heureux de retrouver des figures marquantes qui ont tenu ce rôle comme les poètes Brion Gysin (qui n'a pas appartenu à la Beat Generation, mais y a joué néanmoins un rôle conséquent), Ann Waldman, Philip Lamantia, Bernard Heidsieck, Henri Chopin et Julien Blaine, et aussi des considérations sur des sujets jugés périphériques au groupe d'auteurs américains, comme la musique, avec Bob Dylan, Jim Morrison et Patti Smith. Il a eu aussi l'idée d'y reproduire l'entretien de William S. Burroughs avec David Bowie, qui est un témoignage intéressant des relations de l'auteur du Festin nu avec l'un des créateurs les plus intéressant de la Pop Music (l'écrivain de Saint-Louis a d'ailleurs inspiré de nombreux compositeurs ou interprètes). Il est vraiment impossible de faire la somme de la Beat Generation en un seul volume, aussi riche et copieux soit-il. Mais les interventions sont toutes intéressantes, en particulier celles de Clémentine Houghe sur la technique du cut-up, celle sur le Blues d'Oliver Penot-Lacassagne, sur le rôle des femmes d'Estìbaliz Encarnaciòn-Pinedo, sur Gary Snyder de Kenneth White, sur la performance de Hugo Daniel, et d'autres encore, qui me pardonneront de ne pas les citer tous. Je dois saluer l'inventivité du meneur de jeu et la qualité des essais produits. Il y a des manques et des lacunes évidentes, des absences regrettables (Ugo Breger, Yves Buin, par exemple) mais, je le répète, cela était inévitable. Ce volume devrait plutôt donner l'idée de prolonger ce grand travail collectif , qui apporte déjà beaucoup d'éléments pour mieux comprendre ce mouvement littéraire, qui n'a jamais existé comme tel que dans l'imagination de Jack Kerouac et un peu dans celui d'Allen Ginsberg. C'est plutôt une forme d'esprit et des recherches qui se sont croisées, ainsi qu'un choix existentiel, qui a pris des formes multiples et en apparence contradictoires. On aimerait, en lisant ces pages, voir ressurgir quelque chose de comparable dans une sphère littéraire devenu morne et surtout peu audacieuse. Pour l'est un instrument incontournable pour découvrir les significations multiples de la Beat Generation. Et c'est déjà beaucoup et même inespéré.

Champs-Elysées, Eric Rondepierre, nonpareilles, 76 p., 15 euro.
Confidential Report, Eric Rondepierre, Le Bleu du Ciel, 108 p., 20 euro.
Si j'en avais le temps et surtout le courage, j'aurais bien aimé écrire l'équivalent du Livre des masques de Rémy de Gourmont, mais pour parler exclusivement des écrivains qui n'ont pas encore trouvé la notoriété qui leur serait due. Eric Rondepierre en ferait partie de plein droit. Je l'ai découvert récemment, grâce à un cher ami, jeune écrivain talentueux, Patrick Froehlich, lui aussi pas encore connu comme il le devrait. J'ai commencé par ouvrir Champs-Elysées, livre qui m'a aussitôt captivé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois préciser que l'auteur accompagne ses proses de photographies qu'il prend lui-même. Elles ne sont ni anecdotiques ni illustratives : elles servent un dessein spécifique, qui relèvent autant de la littérature que de l'art conceptuel. Dans cette fiction, tout part de la scène finale d'un film où Pierre Clémenti où le héros s'écroule et meurt sur la chaussée. Le cinéma fait partie intégrante des histoires qui sont ébauchées : on voir Gary Grant dans un jardin. Mais rien d'autre. Une simple référence suffit à déplacer le champ de l'action et de le transporter dans un autre espace. Il y a quatre récits dans cette oeuvre. Quatre récits qui ne sont pas de véritables histoires, avec une quelconque intrigue, mais un enchevêtrement de réminiscences, celles de l'enfance, ou celle d'une rencontre. Les photographies incluses par l'auteur met l'accent sur des points précis : le guignol, une balançoires, trois petites filles et un ballon, mettant ainsi en relief des moments de chacun de ces récits. Il y a aussi des parcours, fracturés, inachevés, qui entrainent le lecteur dans des endroits fréquentés par le narrateurs (ou encore rêvés ou imaginés). Il n'y a pas de commencements ni de fins, mais des cheminements dans la mémoire, entrecroisés par d'autres souvenirs, d'autres instants, sans qu'on mesure l'importance ou la portée de tous ces nouements. Ce serait comme une promenade surréaliste qui n'aurait aucune continuité logique, mais une continuité secrète dans la projection d'une forme différente de l'art de raconter. A la fin, l'auteur s'interroge sur la photographie et sur la fugacité de ce qu'elle peut imprimer dans l'esprit. Le plus étrange de tout, c'est ce qui semble si décousu et dépourvu de liens apparents possède un attrait car ces récits finissent par engendrer des sens et des intensités qui nous pousse en poursuivre la lecture. Rien d'ésotérique là-dedans : simplement une autre manière d'envisager l'art de la nouvelle et de comment nous entrons dans un dédale mnésique qui ne nous égare pas. Au contraire, il nous fait voir de nouvelles perspectives dans l'art de la lecture.
Dans Confidential Report (auquel il a donné un autre titre - Sanshô 7909 -, Eric Rondepierre relate une affaire qui le touche de très près le dossier qui concerne la maladie de sa mère et aussi les documents qui ont trait à sa jeunesse. Cette enquête se traduit par des faits, mais qu'il retourne aussitôt sur eux-mêmes. Tous les événements rapportés, que le narrateur retrouve dans le fameux dossier 7909 et qui a éclairé ce qu'il a pu vivre pendant ses jeunes années. Il n'a de laisse de retourner le récit sur lui-même et d'en soutirer des enseignements, mais aussi de le changer en une affaire qui tient autant du romanesque que de la recherche d'une vérité insaisissable. Il s'est donné une sorte de paradigme : l'histoire de l'intendant Sanshô qu'a tourné le grand réalisateur japonais Kenji Mizoguchi. C'est une façon pour lui de retrouver la genre de reconstruction que suppose le montage du film. Et il se réfère à Aristote sur le bon usage de la fable. En sorte que son histoire, qui est la tentative de reconquête de son enfance, est traitée en sorte de fournir les clefs de sa méthode pour transmettre par l'écriture cette reconstitution d'une part essentielle de son existence. C'est bien sûr une réduction de ses intentions, plus complexes, plus denses, qui passent par l'usage de nombreuses pièces d'archives et de photographie, le tout contribuant à une mise en abysse de tous ces éléments éclatés. C'est un livre qui est un manifeste personnel en faveur d'une littérature autre, qui permet d'associer des segments brisés. Et c'est vraiment prenant.
|
