
Histoires possibles, Marc Riboud, Réunion des musées nationaux - Grand Palais / mnaag, 272 p., 35 euro.
L'exposition consacrée à Marc Riboud (1923-2016) au musée Guimet n'est pas encore ouverte, et nul ne sait quand elle le sera. C'est dommage. Le catalogue, qui est une véritable monographie, est déjà imprimé. Comme c'est un ouvrage remarquable et que vous devriez pouvoir vous le procurer, je vais vous en parler, quitte à revenir sur la question quand rouvrira ce beau musée d'art oriental. Le lien de Marc Riboud et de ce musée ? Le fait qu'il fut un globe-trotter impénitent et qu'il est beaucoup allé en Asie, en Chine, en Inde, en Turquie, en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande... Il se distinguait de ses grands prédécesseurs français par le fait qu'il s'est beaucoup plus laissé aller à saisir au vol des scènes révélatrices ou curieuses, ou tout simplement belles ou insolites, alors que Cartier Bresson a souvent fait poser les personnes qui l'intéressait : il se comportait plus volontiers en peintre qui aimait recomposer quelque chose qui l'avait frappé. Et puis il ne partait pas en ethnologie ou en anthropologue. Il aimait souvent immortalisé des vues où il montrait le contraste plus ou moins heureux, mais chaque fois saisissant, entre l'ancien et le moderne. Il a privilégié un monde en transformation, un monde qui souvent ruinait ses espaces naturels et ses merveilles exotiques. Il aimait les lieux magiques, comme les célèbres montagnes de Huang Shan en Chine perdues dans les brumes, qui constituent un des paysages les plus magiques du monde. La dynamique inéluctable di progrès, avec ses aspects désastreux, Mais son oeil n'était pas systématiquement critique : il aimait capturer des scènes où cette confrontation pouvait faire naître une poésie inattendue. Il voulait rapporter de ses innombrables voyages des « images » qui nous éloignaient des lieux communs et du pittoresque suranné et qui mettaient en évidence une autre réalité. Il se situait donc aux antipodes de ce qu'a pu faire Pierre Loti, par exemple, qui s'était attaché à cataloguer les monuments et les paysages d'Istanbul -, mais c'était une autre époque. Quand il s'intéressait aux personnes, il procédait par la saisie d'un mouvement, d'un geste saisi dans l'instant - une sorte de larcin de l'instantané. Mais il avait aussi des impératifs formels qui font songer aux recherches de l'entre-deux-guerres : il jouait sur des contrastes d'ombres et de lumières très sophistiqués. Ce n'était pas systématique chez lui, mais cela comptait beaucoup quand il saisissait un groupe d'immeubles par exemple. Et puis, il avait eu parfois le goût du local, comme on peut le constater dans ses clichés pris en Angleterre. En somme, Marc Riboud n'a pas voulu s'enfermer dans une manière forclose. Son inspiration dépendait de nombreux facteurs, aussi bien du hasard qui se présentait à lui que de scènes plus élaborées sur le plan formel. C'est en tout cas un photographe qui a marqué cette génération de créateurs dont l'oeuvre s'est développée pendant la seconde moitié du siècle. Accompagné de plusieurs textes d'écrivains, cet album est un document précieux, dans l'attente de pouvoir voir ou revoir ses travaux de visu.

Ecrits hérétiques, Daniel Dezeuze, « Collection Textes », Méridianes, 118 p., 25 euro.
Daniel Dezeuze est bien connu comme artiste, comme un des fondateurs de l'éphémère groupe Supports/Surfaces, comme théoriciens de la revue Peinture Cahiers théoriques à ses débuts). Mais on le connaît moins bien comme poète, domaine où il s'est révélé excellent (il faut dire à la décharge du lecteur qu'il a surtout publié des ouvrages à tirage limité). C'est dommage car son écriture mérite d'être reconnue comme une expérience intérieure des plus singulières. Ce bel album réunit des textes de plusieurs phases et aussi des reproductions de dessins de 1994 à 2019. Ce n'est cependant pas un florilège, mais plutôt un compendium d'une méditation labyrinthique qui a pour fondement le gnosticisme, qui l'a toujours passionné. Mais il faut ajouter qu'il imagine, à la fin de son ouvrage, une autre forme de tour de Babel, non pas celle, biblique, des langues, mais celle des religions. Il s'est beaucoup intéressé aux cathares, aux Albigeois, en somme à toutes les formes de transgression de la religion chrétienne dans le sud de la France. Tout cela l'a conduit à se forger une pensée déviante, qu'il entend manifester dans ces écrits poétiques qui sont, dans leur forme, comme dans leur contenu, en rupture avec la poésie classique et même moderne : il n'entend pas jouer à marcher dans les pas de Paul Valéry ou d'Arthur Rimbaud, mais plus imaginer comment in peut dans le langage transcrire ses idées plastiques, qui ont un soubassement iconoclaste. Mais il n'y aucune intention politique ou pseudo métaphysique dans ce qu'il compose, même si la philosophie y a sa place (dans une optique singulière qui n'appartient qu'à lui). Je ne vais pas me hasarder à décrypter ses formules, qui tiennent aussi de la poésie chinoise, pour laquelle il a une inclination forte. Sin ambition est sans nul doute de rechercher le moyen d'expression le plus prégnant pour rendre ce qui l'occupe aussi bien d'un point de vue intellectuel que d'un point de vue sensible. Il emploie d'ailleurs bon nombre d'images très saisissantes, un peu comme pendant l'ère médiéval. Il s'est construit un univers plein de paradoxes et de contradictions, de visions noires et aussi acrobatiques. Il suffit d'examiner les oeuvres sur papier qu'il a sélectionner pour cette superbe édition : elles ne fournissent aucune clef pour en percer le mystère, et pourtant elles fascinent et possèdent leur poids esthétique, qui est véritablement incontournable. Il est rare de pouvoir pénétrer dans n'univers intérieur des artistes et parfois ils s'ingénie à le dissimuler comme l'ont fait Tiepolo et à sa suite directe, Francisco Goya. Victor Hugo, quand il maniait ses encres, décrivait des paysages mystérieux et même fantastiques. Et comment faut-il interpréter L'Histoire du gant de Max Klinger ? Que dure enfin des peintures métaphysiques de Giorgio De Chirico, qu'il a traduit dans les termes de la littérature de fiction dans son chef-d'oeuvre Hebdomeros ? Oui, c'est un peu la même chose pour Daniel Dezeuze, que je me garderai bien de commenter, mais plutôt de louer, car la beauté et le laid, le sérieux et le dérisoire, la passion pour les vertiges mystiques et ésotériques vont de pair avec le rire franc et désacralisant de François Rabelais. Je regarde ce livre comme une sorte d'autobiographie, qui ne parle pas des instants de sa vie mortelle, mais ceux de son intelligence et de son intuition, de ses rêves les plus graves et des extrapolations les plus délurées. D'habitude, les artistes nous laissent leurs mémoires (comme Delacroix, avec superbe, ou Madame Vigée Lebrun avec esprit), ou racontent leurs combats, leurs amours et leurs détestations comme Maurice de Vlaminck, ou encore abordent le théâtre comme Pablo Picasso. Il y a aussi ceux qui se lancent dans le roman, tels Eugène Fromentin ou dans la critique d'art, comme Odilon Redon. Sans oublier ceux qui ont été tenté par la poésie. Dezeuze n'appartient à aucune de ces catégories, mais il a réussi à créer un identique poétique qui échappe aux prises des gens de lettres et c'est ce qui fait et sa force et son talent.
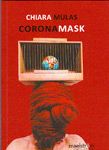
Coronamask, Chiara Mulas, préface de Serge Pey, Maelström évolution, 88 p., 15 euro.
Chiara Mulas est une artiste d'origine sarde, qui s'est exprimée en utilisant tous les moyens que lui offraient la tradition et les technologies les plus en pointes. Dans ce petit livre, il faut avouer fort divertissant et bien venu étant donné la situation actuelle, elle tient un journal qui va du début du mois de mars jusqu'à la mi-mai. Sa source d'inspiration ? Tout d'abord, l'absence de masques chirurgicaux dans les pharmacies au début de la crise sanitaire. Chaque jour, devant la pénurie insistante, elle imagine d'inventer un masque, fabriqué avec tous les matériaux possibles et imaginables, aussi dérisoire que drolatique. C'est un véritable festival de dérision, mais aussi un bel élan créateur, qui devrait nous inciter à transformer cette mascarade quotidienne en une fête transgressive. Elle démontre un don peu commun dans ce domaine en faisant feu de tout bois (je veux dire : de toutes les matières imaginables) : d'aucuns ont l'air exotiques, d'autres techniques et d'autres encore ne rappellent rien de connu. Peu importe. C'est un catalogue où un grand rire rabelaisien est de rigueur. Serge Pey a très bien exposé les procédures et les finalités de Chiara Mulas dans sa préface nourrie. Je ne veux pas le paraphraser. Il y a là une façon magnifique et caustique d'éterniser ces semaines où ont commencé les aberrations qui ont accompagné cette épidémie. De plus, elle ne met pas l'accent sur la dimension un peu tragique de l'événement, préférant scander ces longues journées d'attente de voir les apothicaires nous proposer les masques rêvés (quand je dis rêvés, je devrais dire : imposés par les autorités !). Cet opuscule délicieux, il faut absolument que vous puissiez l'offrir à vos parents, à vos amis, à vos voisins, pour qu'ils puissent eux aussi se gausser grâce à cette artiste à l'esprit piquant et un peu insolent de ce que nous avons vécu de conserve. Tous ces masques devraient être exposés en quelque lieu - même un misée de la médecine - quand cela sera possible. Ils marquent, chacun à leur façon, d'une pierre blanche le début d'une affaire qui connaîtra ensuite d'autres avanies cuisantes. Saluons donc l'humour et la pertinence de Chiara Mulas, qui a su tirer avec talent d'une actualité un peu déprimante des effets qui nous amusent et nous rendent plus capables d'affronter des situations de ce type avec un humour destructeur des idées noires.

Ödön von Horvàth, René Zahnd, « le théâtre de », Ides et Calendes, 128 p., 10 euro.
L'auteur a choisi de faire débuter sa monographie par la mort du dramaturge. Il faut reconnaître que sa fin est tout sauf banale. Ödön von Horvath se trouvait à Paris en 1938, où il s'était exile (il s'était déjà réfugié à Vienne jusqu'à l'Anschluss). Le 1er juin, il se promenait sur les Champs-Elysées. Un orage violent a fait tomber une grosse branche et a tué sur le champ le malheureux écrivain juste devant le théâtre Marigny. Il est le premier des exilés de langue allemande qui est mort dans notre capitale : il sera suivi par Joseph Roth en 1939 et par Ernst Weiss en 1940. Il a des origines curieuses puisqu'il est né à Fiume. Son père diplomate, est originaire de la Slavonie, l'actuelle Croatie, qui appartenait alors à l'Empire Austro-hongrois. Il eut une enfance nomade, la famille suivant le père dans ses différents postes, à Belgrade, à Budapest, à Munich, à Presbourg, à Muniche (où il a été en poste deux fois). Il a fait ses études primaires à Budapest (il y a appris le hongrois), puis a suivi ses études à Presbourg et à Vienne (où il a appris l'allemand). Après le baccalauréat, il a rejoint sa famille à Murnau am Staffeisee. Il est ensuite entré à l'université Ludwig Maximilian à Munich à partir de 1919. C'est alors qu'il a écrit ses premières pièces de théâtre. Das Buch der Tanze est achevé en 1920 et publié à 200 exemplaires. Après quoi, il a fait un séjour à Paris avec son frères (il a eu l'occasion d'écouter Tristan Tzara lire ses poèmes) et ensuite il a décidé de séjourner à Berlin (c'est un choix dont il s'est expliqué, sans doute parce qu'il pensait se trouver dans l'oeil du cyclone). Là, il est influencé par le théâtre expressionniste et il a commencé à définir les grands thèmes de sa création. Il a écrit en 1923 Le Meurtre de la rue des Maures. Pendant les années vingt, ses créations théâtrales prêtent à quelques équivoques : d'aucuns ont affirmé que ses pièces étaient d'obédience communiste, ce qui n'est en rien le cas. Entre 1926 et 1927, il écrit Le Belvédère, une pièce très sarcastique. Elle est présentée à Dresde en 1929. Puis il écrit Le Congrès, qui est aussi une sorte de farce aux tonalités tragiques. En somme, il développe alors une vision au vitriol de la société. Mais, du point de vue politique, il est plutôt engagé dans la question des droits de l'homme. Puis il compose un drame historique Sladek, ou l'armée noire. Après la crise de 1929, il élabore trois pièces dans le genre Volkstück - pièce populaire - très apprécié en Autriche. Il s'y montre très critique à l'encontre de la classe politique et du patriarcat. IL fait un portrait à charge du petit-bourgeois de l'époque de la République de Weimar. La satire est toujours sa marque de fabrique. Quand il crée La Nuit italienne en 1931, il est pros à parti par la presse d'extrême droite. Dès lors, même si son théâtre a du succès, ses représentations sont souvent accompagnées de polémiques. En 1933, quand Hitler est nommé chancelier, ses pièces sont interdites et ne sont plus publiées. Etant de nationalité hongroise, il n'a pas trop à craindre les foudres du pouvoir national-socialiste. Mais il finit par s'installer à Vienne en 1935. Puis il se rend à Amsterdam, devenue capitale des émigrés allemands, et puis il se rend à Paris... René Zahnd a très bien su résumer et commenter ses pièces et à mettre en valeur sa portée. Il n'existe pas grand chose en français sur cet auteur. Ce petit livre est par conséquent indispensable.

Max Frisch, Isabelle Barbéris, « le théâtre de », Ides et Calendes, 116 p., 10 euro.
Max Frisch (1911-1991) est l'un des écrivains suisses de langue allemande les plus importants du siècle dernier. Natif de Zurich, fils d'un père architecte, il est entré à l'université en 1930 pour étudier la littérature germanique. En 1933, après la mort de son père, il a dû interrompre ses études et a travaillé comme correspondant pour un quotidien. Son premier livre paraît un an plus tard. En 1936, jusqu'en 1941, il décide d'étudier l'architecture. En 1942 il participe à un concours pour la construction d'une piscine et le remporte (ce bâtiment porte aujourd'hui son nom). Un peu plus tard, il a ouvert son propre cabinet. En 1947, il fait la connaissance de Bertolt Brecht et de Friedrich Dürrrenmatt, ce qui a eu une profonde influence sur lui. Il abandonne l'architecture en 1950. Il obtient une bourse de la fondation Rockefeller en 1951 et passe une année aux Etats-Unis. A partir de cette époque, il ne s'est plus consacré qu'à l'écriture. En 1958, il rencontre la poétesse Ingeborg Bachmann, il quitte son épouse pour vivre avec sa nouvelle conquête à Rome (il l'épouse en 1968). Il retourne aux Etats-Unis en 1974, ce qu'il relate dans un récit de caractère autobiographique, Montauk. C'est un cancer qui l'a emporté en 1991. Son oeuvre et énorme et embrasse de nombreux domaines : récits, romans, journaux intimes, essais, et bien sûr des pièces de théâtre. Mais l'art dramatique ne l'a jamais emporté sur les autres formes d'écriture. Il a eu une vocation précoce et il écrivait déjà des pièces (pas très abouties) avant de passer son baccalauréat. En 1931, quand il visite l'Exposition des arts décoratifs de sa ville natale, il est frappé par la salle dédiée à Oskar Schlemmer. Quatre ans plus tard, il a rencontré Max Reinhardt, et il lui a envoyé une pièce ; celui-ci la lui a renvoyée avec un long commentaire, qu'il n'a pas pu comprendre ! Il connaît son premier succès sur les planches en 1958 avec Monsieur Bonhomme et les incendiaires, une oeuvre encore inspirée par Brecht. La collaboration la plus longue et la plus fructueuse dans la sphère du théâtre est celle qu'il a eu avec Kurt Hirschfeld, qui est devenu directeur du Schauspiel de Zurich (il a monté dix pièces de Frisch). Andorra, présentée en 1961 assure la reconnaissance définitive à son auteur, qui a connu bien des hauts et des bas dans sa carrière théâtrale. Il a aussi réalisé des pièces radiophoniques et des récits dialogués et il a même adapté Monsieur Bonhomme pour la télévision. Ensuite, Isabelle Barbéris analyse avec soin, de finesse, de jugement, et beaucoup de détails chacun des oeuvres produites par l'écrivain helvétique. Cet ouvrage est un excellent guide pour découvrir toutes les facettes de la création de Max Frisch, qui a commencé à être connu en France quand Roger Blin a monté au théâtre de l'Odéon Triptyque.

L'Île des morts, le roman d'un tableau, Jean Pichart, Editions du Canoë, 144 p., 15 euro.
Si l'art d'Arnold Böcklin (1827-1901) peut paraître bien désuet aujourd'hui (il a tout de même été la première inspiration de Giorgio De Chirico), les diverses versions de son Île des morts n'a jamais cessé de fasciner. Pour d'aucuns, il s'agit du cimetière qui se trouve dans la lagune de Venise, pour d'autres, il est question du cimetière qui se trouve désormais au milieu du périphérique de Florence (et on lui a même donné ce nom). L'auteur a rajouté une autre hypothèse inattendue. Quoi qu'il en soit revenons en arrière : le jeune Bâlois est aller étudier les beaux-arts à Düsseldorf en 1843 où il est resté deux ans. Son maître de prédilection était Johann Wilhelm Schirmer. Il retourne ensuite dans sa ville natale et il y fait la connaissance de Jacob Burchardt, qui s'intéresse à lui et l'encourage. Il l 'initie à l'art de la Renaissance et le jeune homme fait son Grand Tour. A Rome, où il réside de 1850 à 1857, il rencontre Angela Pascurri, qu'il épouse. Et il travaille dans l'esprit de la peinture ancienne. En 1860, il enseigne à l'Ecole des beaux-arts de Munich. Après quoi, il retourne à Rome et visite les fouilles pompéiennes. De nouveau à Bâle, il se voit commandé plusieurs fresques avec des sujets mythologiques. Il décide alors de retourner en Italie et cette fois, il s'installe à Fiesole, tout près de Florence. Il se lie d'amitié avec Hans von Marées. Du haut du petit bourg perché, il a eu l'idée en 1879 ou au début de n'année 1880 de concevoir le tableau qui le rendra célèbre, L'ïle des morts (Rachmaninov s'en inspirera pour son grand poème symphonique pourtant le même titre qu'il composera en 1909). Böcklin fait cinq versions jusqu'en 1886 de la même composition, avec des variations assez notables sans jamais altérer l'aspect général, avec les hauts ifs emprisonnés dans une muraille de rochers âpres. Max Klinger a tiré de cette toile une gravure assez fidèle qu'il a réalisée en 1890. Jean Pochard a rapproché l'île sans doute fictive du peintre d'une île bien réelle, Heligoland, qui a été échangé par les Anglais avec Zanzibar en 1890 (cette île a une importance stratégique puisqu'elle contrôle l'estuaire de l'Elbe). Un photographe a consacré une bonne partie de sa vie à la scruter et a réalisé d'innombrables clichés. Bon nombre ont été détruits pendant la dernière guerre. Mais ce qui a pu être sauvé montre que l'architecture de cet endroit à bien des traits communs avec l'île de Böcklin. Enfin, il a voulu nous brosser le portrait d'un Böcklin révolutionnaire pendant les événements de février et de juin 1848. Serait-ce le fruit de son imagination ? Quoi qu'il en soit, ce roman se lit avec un grand plaisir.
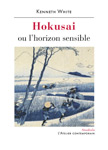
Hokusai ou l'horizon sensible, Kenneth White, « Studiolo », L'Atelier contemporain, 224 p., 8, 50 euro.
La réédition de cet essai de Kenneth White se révélait nécessaire. Ces pages n'ont pas pris une ride et il représente une entrée royale pour comprendre l'art de cet artiste japonais extraordinaire, Katsushika Hokusai (1760-1849). L'auteur rend d'abord hommage à Edmond de Goncourt qui a écrit la première monographie sur son compte en 1896 et a largement contribué à le rendre célèbre dans le monde occidental : c'est un geste rare. Son ambition a été de compléter ce travail remarquable et de tenter d'aller au-delà de du simple commentaire d'un historien d'art. Cependant, Kenneth White se montre ici très attentif au contexte historique qui a permis l'épanouissement de l'art de la xylographie et de toute une culture qui a commencé au début du XVIIe siècle et a duré jusqu'au milieu du XIXe siècle et qui a pris le nom d'ère d'Edô la nouvelle capitale (Edô est le nom ancien de Tôkyo). C'est une longue période de prospérité après la fin des guerres incessantes entre les clans les plus puissants et elle a permis l'épanouissement d'un art novateur et populaire avec la publication de nombreux livres illustrés, des affiches de acteurs connus du kabuki, des portraits de courtisanes, des ouvrages érotiques, des textes classiques revisités, etc. Cette présentation est indispensable pour comprendre la recherche d'Hokusai et elle a été faite avec un grand soin, sans néanmoins se perdre dans des dédales historiques insondables. L'auteur a ensuite choisi de mettre l'accent sur l'un des nombreux traits du travail d'Hokusai : le fantastique. Il met ces estampes étonnantes avec les nouvelles écrites par un grand écrivain Akutagawa au début du siècle suivant, ce qui est assez juste. Mais il faut aussi préciser que ce genre s'est beaucoup développé au cours du XIXe siècle et les derniers graveurs de qualités ont exploré ce domaine avec assiduité - c'était sans doute alors très à la mode.
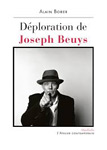
Déploration de Joseph Beuys, Alain Borer, « Studiolo », L'Atelier contemporain, 128 p., 6, 50 euro.
Il existe très peu s'ouvrage de Joseph Beuys (1921-1986) dans notre langue. Il faut aussi dire qu'il a été assez peu exposé (il y a bien eu la rétrospective du Centre Pompidou), peu connu et surtout mal connu en France. Ce petit essai d'Alain Borer est assez incomplet et ne permet pas de prendre toute la mesure de cet artiste allemand. Il peut constituer une première initiation, assez partielle, à une oeuvre considérable et complexe. La première chose qu'il faut savoir est que Beuys n'a pas, à quelques rares exceptions près, créé des oeuvres telles que nous l'entendons. Il jour d'ailleurs sur une multitude de registres, allant de la performance à l'installation, de l'objet trouvé hérité de Dada et du surréalisme jusqu'à la fondation d'une mythologie très personnelle qu'il a commentée par de nombreux discours et conférences. On s'est d'ailleurs souvent trompé sur la nature de ces conférences et tous ces textes (dont certains ont été publiés, comme ceux sur l'argent), qui sont des parodies de cours magistraux, qui échappent à toute logique, et qui sont déroutants car ils mêlent ses idées sur la nature et sur le monde, et une sorte de poésie délirante qui est néanmoins prononcée avec le plus grand sérieux. Beuys est à la fois un mystificateur et une sorte de maître à penser. Beaucoup ont choisi ce second aspect - Borer lui aussi, se trompant complètement sur le sens à donner à ses propos - en oubliant qu'il a été aussi artiste dans le discours. Ses célèbres conférences ou ses cours devant des étudiants ne sont autres que des représentations où il a mimé avec talent le langage universitaire et le jargon savant. Beuys n'a pas été un philosophe, mais il a aimé joué le rôle du philosophe et quand on l'a célébré comme le meneur du courant écologiste en Allemagne (il est bien et bien le fondateur du parti des Verts), il s'est empressé de quitter le mouvement au plus vite. Il a fait reposer sa cause sur le fait que tout un chacun peut devenir un artiste et également sur la conviction selon laquelle il serait une sculpture vivante. Et, c'est vrai, son existence s'est changée en un spectacle ininterrompu que ponctuent certaines installations marquantes comme Olivestone. Ancien pilote de la Luftwaffe, abattu en Crimée, gravement blessé, il aurait été recueilli par un tribu de nomade qui l'aurait enveloppé dans du feutre : de là l'emploi incessant de cette matière, à laquelle il faut ajouter la margarine, le miel, etc., et aussi des objets symboliques comme par exemple la luge. Dans l'édition originale, le texte de l'auteur de l'auteur accompagnait un grand nombre de reproduction en couleurs. Ici, dans cette édition économique, on manque de ces ouvrages de l'artiste. Mais, je le répète, on trouvera ici les éléments de base pour pénétrer dans cet univers, unique en son genre, particulièrement inclassable, et en tout cas très éloigné dans la forme de l'art des siècles passés (mais il faut se souvenir que dans une performance réalisée dans une galerie Schmela de Düsseldorf en novembre 1965, « Comment expliquer un tableau à un lièvre mort », il fait référence à la représentation du lièvre dans la peinture occidentale qui est presque toujours vu mort dans des tableaux de chasse). Beuys est à découvrir en France. Prenons donc ce que nous offre les éditions de L'Atelier contemporain en attendant mieux.

Géricault, généalogie de la peinture, Jérôme Thélot, « Studiolo », L'Atelier contemporain, 288 p., 9, 50 euro.
Théodore Géricault (1791-1824) a beaucoup inspiré les romancier : La Semaine sainte de Louis Aragon, paru chez Gallimard en 1958, est un chef-d'oeuvre du roman du XXe siècle, mais aussi un ouvrage qui a apporté de nouvelles connaissances sur l'artiste ; plus récemment, Jean-Marie Touratier a signé un très beau roman, où tous les faits sont exacts, Géricault, cheval-peintre publié par Galilée. Dans cet ouvrage érudit et passionnant, Jérôme Thélot a su apporter un éclairage neuf sur cette oeuvre picturale immense alors que son existence a été si brève. Ce jeune homme qui avait apporté le scandale, l'effroi, l'admiration et la sidération parmi le public et même chez ses pairs avec son Radeau de la Méduse, n'a pas été qu'un audacieux styliste, mais aussi un penseur de la peinture (ce qui signifie aussi : un penseur tout court). L'auteur, dans cette riche étude, montre qu'il a commencé par tenter de comprendre le débat entre l'homme et l'animal, en ayant pour sujet de prédilection le cheval - ce cheval qui va le tuer. Il mène avec ses dessins et ses tableaux une quête pou comprendre comme il est possible de sortir d'échapper aux contraintes de la vie par sa représentation. Il veut être la conscience de soi-même par ce détour. Il a une sorte de fascination par la violence - ce qui se traduit dans l'histoire tragique du naufrage de La Méduse devant les côtes africaines, une toile gigantesque qu'il a achevée en 1819, mais aussi dans la représentation de l'exécution d'une peine de mort, comme dans ses travaux anatomiques. La guerre, surtout les guerres napoléoniennes, l'ont pas mal occupé. A cela, il faudrait aussi rattacher sa faneuse série des Monomanes qu'il a pu voir à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris en 1821, alors qu'il revenait un peu souffrant d'un voyage n Angleterre. Je ne sais pas si, comme le pense l'auteur, Géricault était en quête d'une « généalogie » de la peinture. Mais peu importe : ce qui compte ici c'est qu'il a su montrer qu'il a poursuivi avec obstination un certain nombre d'intuitions éblouissantes et aussi une certaine manière d'envisager l'art pictural. En somme, Jérôme Thélot a souhaité mettre l'accent sur l'humanité profonde de ce peintre hors pair qui n'a jamais voulu voir dans sa pratique artistique bien autre chose que la manifestation d'une bella mano. Il y a toujours inscrit des idées avec force, mais pas à la manière d'un manifeste, mais plutôt comme la condensation d'une méditation poussée et exigeante sur un événement, sur un état des choses, sir la destinée humaine, sur notre rapport au monde qui est souvent conflictuelle, et non plus seulement contemplative. Je ne crois pas être toujours d'accord avec l'auteur. Mais son travail est remarquable et permet aux amateurs de s'interroger sur la personnalité et sur la création de ce peintre hors du commun.
|
