
Peintres femmes, 1760-1830, Martine Lacas, « Carnet d'expo », Découvertes, Gallimard / RMN - Grand Palais, 64 p., 9,50 euro.
Une fois de plus, il s'agit d'une exposition qui ne va pas encore ouvrir ses portes à la date prévue! C'est vraiment regrettable car le sujet mérite qu'on s'y arrête et qu'on découvre les femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire de la peinture de la fin de l'Ancien Régime à la Révolution de 1830.
Le format de cet ouvrage n'a pas permis à l'auteur de mettre en perspective la participation féminine à l'aventure esthétique de la Renaissance au XIXe siècle. On pourrait citer Sofonisba Anguileschi, Marisa Robusti, la fille chérie du Tintoret, dite la Tintoretta, qui l'a accompagné partout, Judith Leysler, Elisabetta Sirani et, bien entendu, l'incontournable Artemisia Gentileschi, fille d'Oreste Gentileschi - un très grand artiste - sur laquelle on a écrit beaucoup de sottises (par exemple : les thèmes bibliques où des femmes furieuses et déterminées décapitent un homme ne sont pas de son invention et étaient des sujets prisés à l'époque et son père en a peint beaucoup).
L'auteur prend appui pour étayer son discours sur l'entrée en grande pompe d'Elisabeth Vigée-Lebrun à l'Académie royale en 1783 (il faut dire, qu'en dépit de son jeune âge, elle était le peintre officiel de Marie-Antoinette. Une autre femme est intronisée cette même année, Adélaïde Labille-Guiard. Elle évoque aussi la figure de Marie Guillemine Benoist, élève de David. A cette même époque, Angelika Kaufmann s'est déjà taillé une belle réputation en Angleterre et dans les pays germaniques. Pour contrecarrer un peu les élans idéologiques un peu excessifs de l'auteur, je rappellerai qu'il y a eu pas mal d'oeuvres de femmes exposées au Salon pendant la période révolutionnaire. D'ailleurs, notre auteur fait une liste assez éloquente de femmes qui ont choisi la voie ingrate de l'art et qui s'y sont faites un nom malgré toutes les difficultés. Elisabeth Vigée-Lebrun a fait l'essentiel de sa carrière à l'étranger et s'est imposée comme le peintre le plus prisé et aussi le plus cher de toute l'Europe.
Là où Martine Lacas a raison est sur le fait qu'auparavant, les femmes qui devenaient peintres ou même sculpteurs étaient issus d'un milieu artistique. Cela change avec la Révolution. Greuze a ouvert un salon pour les demoiselles et David fera de même. Regnault a institué une section féminine dans son atelier pendant vingt ans, malgré les interdictions survenues peu avant la crise révolutionnaire. De vrais talent s'affirment alors : Aimée Brune, Hortense Haudecourt-Lescot, Henriette Lorimer, parmi tant d'autres. Certaines d'entre elles n »hésitent plus à affronter la peinture d'histoire - le grand genre - comme a osé le faire Césarine Davin-Mirvault. Mais, la plupart du temps, elles restent confinées à la pratique du portrait. Enfin, quelques une choisissent de traiter le paysage, comme Louise-Joséphine Sarazin de Belmont, qui a fait plusieurs Grand Tour en Italie.
Il est évident que la période choisie nous prive de la seconde moitié du XIXe siècle, où il les femmes se font une vraie place (et parfois de grandes réussites) avec Rosa Bonheur, Bethe Morisot, Mary Cassatt, Madeleine Lemaire, amie de Marcel Proust... Mais nous devons reconnaître que ce choix nous permet de découvrir des créatrices que nous avons jusque là ignorées. Vivement que les portes de cette exposition puissent ouvrir ses portes car ce petit livre au contenu pas si petit que cela, n'a fait qu'attiser notre curiosité.

I colori del nero, Mario Benedetti, préface de Gino di Maggio, postface de Cesare Chirici, Mudima.
Dans son propos liminaire, Gino di Maggio a raison de souligner que le noir a d'innombrables significations et que son histoire culturelle remonte au moins jusqu'à l'antiquité primordiale. Pour les anciens Romains, Saturne était noir. Et le noir n'était pas l'exact opposé de la lumière, mais la modulation d'une couleur extrême. Bien sûr, le noir a été associé à la mélancolie (qui airait pour origine la bile noire, comme l'a exposé au XVIIe siècle le médecin Richard Burton), mais ce n'est là qu'un de ses aspects. Le noir a fasciné les artistes les plus révolutionnaires du début du XXe siècle, comme Kazimir Malevitch ou Alexandre Rodchenko.
L'art abstrait pendant tout le XXe siècle et encore aujourd'hui, a conduit les artistes à s'interroger et à se nourrir de ce noir qui n'est pas seulement l'élément chromatique le plus opposé au blanc. De grands artistes ont fait du noir leur couleur de prédilection, comme Ad Reinhardt, Pierre Soulages, et plus récemment le regretté Giampiero Podestà, Umberto Mariani ou encore Massimo Arrighi. La monochromie étant devenue après la dernière guerre un mode d'expression en soi, la couleur la plus exploitée a bel et bien été le noir, et rien que le noir. Peut-être parce qu'il se rapprochait le plus des confins de la lisibilité plastique. Mario Benedetti, dans ses dessins, dans ses gravures, dans ses objets trouvés et recomposés, dans ses installations, n'a jamais utilisé que ce noir, parfois en contraste avec le bleu (et aucune autre couleur). Il est intéressant au plus haut point de constater que ce principe de base, très réducteur, lui a permis de construire une oeuvre profondément originale, qui ne peut être rapprochée de nulle autre parmi ses contemporains.
Il n'est pas un formaliste, loin s'en faut, même s'il se révèle très rigoureux. Selon les textures, selon les préparations, selon l'application de la peinture sur le matériau choisi, le noir adopte mille manières d'être, et nous offre un grand nombre de réactions rétiniennes différentes. Ce petit ouvrage rend justice à la capacité du noir d'être un langage en soi et pour soi, éloigné de toute monotonie. Au contraire. Il offre un champ de variations et de déclinaisons énorme. Il semble même presque infini. Sans règle formelle arbitraire et dogmatique, l'artiste a pu sans cesse élargir la portée de sa recherche. La merveille est que ses créations présentent des altérités profondes, qu'elles suivent des chemins spéculatifs sans cesse nouveaux. La répétition est l'inverse de sa démarche. Ce volume est un excellent moyen pour découvrir ce qui a pu motiver Mario Benedetti et quels ont été les effets de sa réflexion toujours en mouvement. Et le noir a toujours quelque chose d'imprévu à nous dire.

Margherita Palmero, carte e sculture, collectif, Mudima.
Margherita Palmero est née à Lissone où elle vit encore. Elle a travaillé dans le sens de l'abstraction, comme c'est d'ailleurs le cas dans la majorité des cas à Milan et dans sa région. Mais il n'y a rien de convenu dans sa recherche, bien au contraire. Elle, par exemple, procédé à la dissémination rythmique un peu dans l'esprit de Pino Pinelli, qui a fondé ses spéculations plastiques sur le morcellement des objets picturaux, qu'il agence selon des courbes longues et régulières. La notion de tableau disparaît et est remplacé par ce jeu sur la paroi du lieu d'exposition. Mais il demeure comme un point de départ. Ce qui fait la spécificité de la passionnante aventure de Margherita Palmero est le fait qu'elle utilise des fragments de peaux aux contours irréguliers qui est parfois couvertes de scarifications. Son idée est de rendre le support vivant, ou ayant appartenu à in être vivant. Le fait que ces formes ne soient pas droites et même paraissent animées de contorsions accentue considérablement ce sentiment d'animalité. Et cela est aussi vrai quand elle a recours à des éléments en argile qui, parfois, sont noirs. Il existe chez elle une double orientation : l'une est strictement formelle et correspond au désir de l'artiste de prolonger des considérations sur la nature même de l'oeuvre d'art, qui est en rupture totale avec le passé même récent. Mais elle ne peut le faire sans une relation étroite avec monstration de quelque chose qui a partie liée avec la matière organique.
Elle joue par conséquent un double jeu et la tension introduite entre ces deux pôles est plutôt déconcertante. Elle a une rigueur comparable à celle du Minimal Art américain, mais en le métamorphise en rendant son univers irrégulier dans sa mise en scène et biologique. Elle va jusqu'à créer des installations où les fragments sont apposés sur le mir dans un relatif désordre et en installant sur le sol d'autres fragments. Elle résiste ainsi à une tentation qui aurait celle d'un système parfaitement rodé et par conséquent prévisible. C'est aussi ce qui l'a conduit à réaliser des performances et des installations. Mais jamais elle ne s'éloigne des principes majeurs de son travail. Elle ne fait que développer ce qu'il possède de manière virtuelle et qui est un débordement volontaire de ses confins préalables. Elle a même pu concevoir des ensembles où elle énumère les instruments lui servant à atteindre ce but. Elle a eu l'intelligence de comprendre les situations nouvelles qui pouvaient se présenter à elle et à l'exploiter avec fantaisie, mais toujours avec la même exigence.
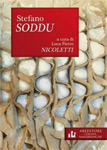
Stefano Soddu, sous la direction de Luca Pietro Nicoletti, « Malebranche », Abeditore, 156 p., 16, 90 euro.
S'il existe bon nombre de catalogues des nombreuses expositions de Stefano Soddu (né en 1946 à Cagliari - vit et travaille à Milan depuis 1956), il y a peu de monographies sur son compte. C'est vraiment regrettable. Celle-ci vient combler un vide. D'abord sculpteur, il a démontré au fil du temps sa volonté d'échapper à cette catégorie trop étroite pour lui, sans cependant la trahir. Il a excellé dans le dessin, les techniques mixtes, et même dans l'écriture, car il s'est révélé un excellent auteur de nouvelles il a déjà publié plusieurs ouvrages). Et il a aussi su multiplier les ressources techniques lui permettant de s'exprimer dans l'espace comme sur le plan d'une feuille de papier. Il a exploré un champ plastique qui est grand comme un continent, mais qui ne perd jamais sa spécificité malgré la grande diversité des matériaux, des combinaisons, et des procédures employés. Soddu ne cesse pas un instant de pousser son investigation vers de nouveaux horizons.
Il y a chez lui une impulsion créative puissante et continue une quête impatiente (et pourtant très réfléchie) qui, sans être anarchiste, est perpétuellement en gestation pour imaginer des territoires inédits. Il ne veut pas un instant se priver de ce plaisir de tenter le diable et de risquer tout ce qu'il a pu acquérir précédemment. Sa grande expérience lui a permis de multiplier les axes de sa pensée. L'essai de Nicoletti met bien en relief l'incroyable vivacité de son entreprise esthétique qui va des Totems à des combustions à désinstallations inattendues comme les Cumuli (Accumulations, 1997-2007). On serait bien en peine de découvrir un fil d'Ariane entre toutes ces oeuvres - il donne même le sentiment de vouloir être plusieurs artistes à la fois. Cette impression se dissipe lorsqu'on prend du recul et qu'on embrasse di regard l'ensemble de ses réalisations. On se rend compte alors qu'il a poursuivi plusieurs chemins qui ont chacun leur logique propre. Le Nouveau Réalisme, le Land Art, le Minimal Art l'ont inspiré, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais aucune de ces formules ne saurait le satisfaire. En réalité, il remonte le temps de l'art moderne et va chercher des points de départ qu'il se hâte de transgresser. Il sait parfaitement discerner chez ses prédécesseurs ce qu'il pourrait utiliser et surtout transgresser.
Il n'a d'ailleurs de laisse de passer d'une pratique à une autre, et aussi d'associer ce qui appartient à un registre particulier à un autre -, je songe par exemple à la Barque brûlée (1996). Ses assemblages nous font remonter à l'époque de Dada et son Parcours (2002) ne peut que nous remettre en mémoire les oeuvres de Carl André. Mais il est loin célébrer ces créations radicales : il cherche plus précisément de voir de quelle façon elles pourraient être réinterprétées aujourd'hui. Bien sûr, on peut relire un grand pan de l'histoire de l'art du XXe siècle dans ses travaux, mais avec une grande distance et surtout l'envie de les détourner de leurs objectifs premiers. Les superbes panneaux en bronze pour la porte de la petite église de Bolognano dans les Abruzzes prouvent qu'il est aussi capable de puiser dans le néoclassicisme de la Renaissance tout en utilisant des éléments figuratifs peu académiques et souvent traduisant avec humour une scène biblique. Il est chaque fois capable de s'emparer d'une forme connue pour en faire un objet jusque là inconnu et déconcertant. Il n'hésite pas une seconde à introduire un faille dans ses oeuvres, ce que Nicoletti appelle la « sculpture blessée », comme dans, parmi tant d'autre, Le Rayon de l'âme (2009).Cette altérité est une contestation de poursuite d'une perfection formelle même si elle est paradoxale. C'est un peu sa marque de fabrique. Dans son texte programmatique, Arte e entropia, Stefano Soddu souligne que « l'art, même l'art contemporain, puisqu'il se présente dans le processus qui dérive de reproductions et de mutations continues, portant en son sein des informations toujours proches, bien qu'innovatrices, des équilibres précédents, est en mesure d'arracher l'ordre du désordre. » Ces pages sont essentielles car elles représentent le discours de la méthode de l'artiste. Le reste du volume est constitué d'une anthologie critique qui permet de percevoir comment ses créations ont pu être analysées lors de leur présentation publique. Dans l'attente, d'une véritable monographie, ce livre fournit l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur les faits et gestes de Stefano Soddu.

Vivonne, Jérôme Leroy, La Table Ronde, 416 p., 22 euro.
L'auteur nous demande d'imaginer une catastrophe météorologique s'abattant sur l'Ile-de-France dans un futur pas très éloigné. Chemin faisant, il nous présente le personnage principal de son histoire, l'éditeur Alexandre Garnier, qui vit rue de l'Odéon. De sa fenêtre, il assiste au déchainement du climat, comme s'il s'agissait d'un événement irréel. En parallèle, nous découvrons un univers irréel, à mi-chemin entre l'onirisme et la mythologie. Il est difficile de comprendre la nature véritable de cet espace où rien ne paraît devoir avoir un lien avec notre histoire des religions ou même des légendes ancestrales. C'est alors qu'apparaît Adrien Vivonne, le jour de sa naissance à Rouen. Ses parents sont communistes et il a vu le jour dans une clinique où étaient appliquées les méthodes médicales soviétiques. Il deviendra un écrivain connu. Rouen a connu des événements dramatiques, qui sont ceux d'une guerre civile, mettant aux prises des mouvements régionalistes et des groupes révolutionnaires.
A ces combats meurtriers se mêlent aussi des islamistes. Mais on ne perd jamais tout à fait le fil de l'existence de ce garçon, qui découvre ses plaisirs (en premier lieu, la natation) et puis l'amour. Cette biographie en spirale ressemble à un tissage nouant les faits personnels et les récits des crises graves qu'a connues la France. En fait, c'est Béatrice Lespinasse, ancienne maîtresse du jeune écrivain, qui nous relate ces bribes de son existence au milieu des tumultes de la nature et de la politique poussée jusqu'à ses conséquences extrêmes. D'autres personnages apparaissent, surtout des femmes, qui ont appartenu au passé de l'écrivain : Chimène (ou Chimère pour d'aucuns), Agnès de Villehardouin, Estelle et Galia Nowak... Peu à peu, on parvient à reconstituer ce puzzle qui ne se délivre pas aisément. Il y a toujours en arrière-fond ces événements catastrophiques qui ont à jamais bouleversé la vie des Français. Mais impossible d'affirmer avec certitude s'ils sont réels ou le fruit d'une imagination fébrile. D'ailleurs, l'existence même d'Adrien Vivonne est une énigme, même si de nombreux témoignages viennent rappeler ses années d'études ou d'autres phases de son aventure personnelle. Rien de très original en fait pour un écrivain : des lectures publiques, des rencontres avec son éditeur... Ses ouvrages sont souvent cités comme autant de perles rares. Tout s'achève sur une île de la Grèce d'Homère dans une atmosphère spectrale. C'est vraiment un bien curieux roman, qui retrace une quête intérieure aussi curieuse et une existence improbable et pourtant bien concrète d(un auteur mystérieux, dont on ne sait si l'auteur a voulu nous mettre dans une situation embarrassante ou, au contraire, rendre compatibles plusieurs genres littéraires.

A viva voce, conversazioni con i miei allievi, Paolo Castaldi, 384 p., 30 euro.
En France, nous ne savons pas grand chose de la nouvelle musique qui s'est développée en Italie depuis les années 1970. C'est d'ailleurs réciproque : les Italiens ne paraissent pas, en dehors de cercles professionnels très fermés, connaître la nouvelle génération de musiciens français, ils se sont arrêtés à Pierre Boulez. C'est un phénomène assez curieux qui a une dimension internationale. Il est vrai que les recherches électroniques, comme celles menées à l'IRCAM à Paris, ne sont pas faites pour aiguiser la curiosité des mélomanes ! Le nom de Paolo Castaldi (né à Milan en 1930) nous est inconnu. Il faut saluer le travail superbe de la fondation Mudima qui publie régulièrement des ouvrages sur des grands musiciens du XXe siècle et en particulier sur les créateurs les plus importants dans la péninsule de ces dernières décennies. Pourtant, l'oeuvre de Paolo Castaldi est considérable, depuis les 3 images pour piano de 1948 jusqu'à Simile D pour sept instruments de 1982. L'un de ses points de départ est la musique dodécaphonique, ce - qu'il tient à souligner quand il a écrit en 1967 Schoenberg A-B-C.
Il faut partie de ceux qui veulent rompre de manière fracassante (mais sans employer les moyens « publicitaires » du scandale) avec la musique romantique et tout ce qui a pu en découler, en somme ce que nous appelons la « musique classique » (ce qui ne l'empêche pas d'avoir une remarquable érudition dans le domaine musical du passé). Dans cet ouvrage, il ne s'agit pas d'un véritable dialogue avec ses étudiants, mais plutôt des réponses qu'il a pu apporter au fil di temps aux questions qui lui ont été posé. C'est là une véritable autobiographie qu'il nous livre par fragments, par des notations parfois grinçantes, d'autres fois humoristiques (son humour est souvent au vitriol !). Il tient d'ailleurs a souvent exposer ses relations avec de grands compositeurs du passé, comme Richard Strauss (dont il divise l'oeuvre en trois phases) ou Richard Wagner. Ce livre est combe de références à ces grands maîtres d'autrefois, que ce soit Puccini, Stravinski, Ravel, Chopin, De Falla, Beethoven (auquel il attribue l'invention du néoclassicisme avec la huitième symphonie) ou encore Debussy. Il a une relation encyclopédique avec son art, ce qui semble en parfaite contradiction avec ses idées. Il dissémine un partout dans ces pages ses grands principes, des souvenirs de rencontres, des découvertes, des méditations sur les sentiments et les grands transports de l'être humain et ses aspirations.
Il évite ainsi es discours programmatiques et dogmatiques. Nous découvrons ainsi un homme animé par une passion sans borne qui passe par des allers et venus incessants entre ce qui fut et ce qui devrait naître. On ne s'ennuie pas une seconde en lisant cet impressionnant vadémécum où la mathématique (omniprésente) croise Thomas Mann (Castaldi a d'ailleurs composé en 1969 un Doktor Faust pour cinq instruments et cordes qui se réfère plus à l'auteur de La Montagne magique qu'à Goethe). Son univers se dévoile ainsi par brèves séquences où il exprime une réflexion ou développe un thème. Il surprend toujours et échappe à la représentation qu'on a pu avoir de lui jusqu'à présent au prix de préjugés absurdes. C'est un livre qui nous le faire découvrir en profondeur, mais qui est ouvert une merveilleuse introduction à l'histoire de la musique en Occident.
|
