
Giorgio Morandi, la collection Magnani-Rocca, sous la direction de Guy Tosatto, Stefano Roffi, Sophie Bernard, Alice Ensabella & Anna Malherbe, Editions in fine / musée de Grenoble, 256 p., 28 euro.
Giorgio Morandi (1890-1964) est un artiste des plus singuliers. Né à Bologne, il a vécu dans cette ville, ne l'a pas souvent quittée et y mort. Il a vécu dans la maison qui est devenu un musée, entouré par ses trois soeurs, Maria Teresa, Dina et Anna, qui lui ont été entièrement dévoué. Morandi s'est forgé un mythe -, celui du peintre solitaire et éloigné du microcosme de l'art. En réalité, il a été en relation avec les principaux conservateurs de musée, historiens et critiques d'art. Il s'est seulement dispensé de toute vie mondaine. Très jeune, il a montré de grandes dispositions pour la peinture et le dessin. En 1907, il s'est inscrit à l'Académie des Beaux-arts de sa ville natale. Il l'a fréquentée jusqu'en 1913. Déjà en 1912, il s'était forgé un style qui n'appartenait qu'à lui.
Il s'était informé sur les impressionnistes et puis avait étudié le style de Paul Cézanne. Il a consacré à ce dernier un essai qui a paru dans la revue florentine La Voce en 1910. Quoi qu'il en soit, il a étudié avec soin l'art ancien de l'Italie, de Giotto à Masaccio et à Paolo Uccello. Il a réalisé sa première eau-forte en 1912, Ponte sul Savena. Pendant les vacances de l'année 1913, il a peint ses premiers Paysages. Il entre ensuite en relation avec Marinetti et avec les futuristes et a assisté à plusieurs de leurs tumultueuses soirées. Il aussi visité l'exposition organisée par la revue Lacerba à Florence en novembre 1914, Pittura Libera Futurista. Morandi a exposé ses oeuvres pour la première fois à l'Hôtel Baglioni au mois de mars en compagnie d'Osvaldo Licini (un camarade d'étude à l'Académie), de Mario Bacchelli et deux autres jeunes artistes. L'événement a été qualifié de « sécessionniste ». Une de ses natures mortes est présentée à l'exposition futuriste de la galerie Sprovieri à Rome.
En 1915, il est devenu professeur de dessin dans les écoles élémentaires et l'est demeuré jusqu'en 1929. Il a développé ses Natures mortes, des Paysages, ses Fleurs. En 1918, il a travaillé dans l'optique de la peinture métaphysique. Aussi courte fut-elle, cette phase a été merveilleuse. Dans ce catalogue, nous trouvons les oeuvres - nombreuses - que collectionneur Luigi Magnani a réuni quelques cinquante oeuvres du peintre dans la villa Mamiano, près de Parme, où se trouve aujourd'hui la fondation. Il rencontrait l'artiste soit à Bologne, soir chez lui. Mais il tenait absolument à ce rapport personnel et nul ne choisissait les oeuvres à sa place. En consultant l'ouvrage, faut de visiter l'exposition, on se rend vite compte qu'il a désiré posséder l'essentiel de son oeuvre quasiment depuis ses débuts car on trouve deux eaux-fortes de 1912 et 1913, puis une étrange Nature morte, un huile de 1914, dont la lecture est malaisée dans un premier temps (elle est bel et bien figurative, mais les formes sont distordues. Et puis le collectionneur a possédé l'une des pus belles créations « métaphysiques » de Morandi : la Nature morte de 1918 avec la bouteille vide, la boîte en carton léger, la longue pipe et la tête de mannequin coupée à moitié dont le visage est tourné contre le mur jaune.
L'Autoportrait de 1925 est des plus intéressants, car l'homme jeune qui est représenté ne ressemble qu'en partie au peintre. Il est assis contre un mur clair où se détache son ombre décalée (en contraste avec le réalisme de la figure) vêtu d'une chemine blanche et d'un gilet ouvert brun, tout comme ses pantalons, tenant sa palette à la main afin qu'on puisse y voir ses mélanges de couleurs, le visage grave et un peu mélancolique - on ne voit rien de ce qu'il est en train de peintre, on ne ressent que sa grande concentration et sa réflexion. Il tient un pinceau à la main dans ce moment de pause tendue. Ensuite viennent les nombreuses gravures de paysages, de bouquets, d'objets de toutes sortes - des objets simples, mais qui, sous son regard, deviennent hiératiques et solennels, pleins de sens. On le ressent encore mieux dans un autre grand tableau, la Nature morte de 1936, où le blanc domine avec force et avec seulement deux couleurs, le jaune et le bleu des bols empilés, tout cela sur un fond assez sombre d'un gris brunâtre assez indistinct. Il faut reconnaître que ses natures mortes sont ses créations les plus belles et les plus saisissantes. Celle de 1939, avec ces objets de couleur marron et son petit pichet rouge au premier plan sur un fond beige indéfini, est un chef-d'oeuvre quasiment monochrome. Chacune des compositions de ce genre, réalisée sur un plan assez neutre et des objets toujours alignés avec quelques contrepoints donnant le volume et aussi l'idée d'une expression non géométrique à tout prix, finit par donner l'idée d'un univers architecturé et d'une grande subtilité. Les objets si communs se changent en combinatoires métaphysiques complexes et intrigantes. Les gravures produisent un effet très différents, car elles sont souvent très sombres. On remarquera aussi que ce sont souvent les mêmes bouteilles, les mêmes flacons, les mêmes pichets, les mêmes récipients qui sont utilisés pour ces associations préméditées avec soin. Les dessins prouvent d'ailleurs que c'est l'association et la construction des choses qui est éloquente avant même la peinture.
Ces ont des paysages intérieurs qui révèlent un état d'esprit bien trempé et des pensées sophistiquées. A la fin de son existence, il semble plus libre dans son dessin et donc dans sa manière de traiter le sujet. Ce qui rend cette collection inestimable, c'est le fait que les oeuvres choisies par le collectionneur permettent de suivre le cheminement sensible et intellectuel de ce peintre si résolu et en marge de tous les courants qui ont traversé le siècle dernier. Morandi est inclassable. Il se disait plus proche de Cézanne que de Chardin, mais au bout di compte, en travaillant avec une démarche dérivée du premier, il s'est rapproché de beaucoup du second ! C'est ce paradoxe qui fait toute sa puissance picturale. Espérons que nous pourrons voir cette exposition. Mais le catalogue donne matière à réflexion avec les essais qu'il contient et le beau texte d'André Pieyre de Mandiargues qui y est reproduit.

Avec Magritte, Louis Scutenaire, « Studiolo », L'Atelier contemporain, 224 p., 8, 50 euro.
On a beaucoup écrit sur René Magritte. Mais l'ouvrage que lui a consacré le poète belge Louis Scutenaire (1905-1987), qui a fait partie du petit cercle des surréalistes de son pays, loin des ukases d'André Breton, est sans nul doute le plus passionnant. Pas seulement parce que ce recueil de textes a été écrit par un homme qui l'a bien connu de près et qui a été son ami (il n'y a quasiment pas de références à sa vie privée ni même à sa vie publique). C'est plutôt sa fréquentation des oeuvres de l'artiste qui est mise en avant dans ces pages. Il n'a pas souhaité rédiger un essai savant, avec une démonstration linéaire. Dans son texte liminaire daté de 1933, Paul Nougé (c'est lui qui a le premier su apprécier sa poésie et qui l'a introduit dans ce petit monde peu tapageur), insiste sur le fait que Magritte ne faisait pas de la peinture. Ce qui est vrai : l'artiste ne faisait aucune recherche picturale - son « écriture » était dépourvue de style, sa peinture était neutre, sans relief, un peu comme un coloriage. Ce qui comptait, c'était sa façon de traiter un sujet et d'un introduire du mystère, de l'intrigue, un jeu mental digne d'un rébus et qui se révélait être un jeu pour l'esprit. Le fantastique était toujours omniprésent, mais sans jamais aller jusqu'aux exubérances d'un Salvador Dalì. Ce qui rend ses observations si passionnantes, c'est qu'il a voulu examiner ses compositions une à une, mais sans esprit de système. Il évoque la quête de Magritte dans une suite de réflexions qui pourraient faire songer à des aphorismes, mais n'en sont pas.
Ce sont des bribes de ce qu'il a pu éprouver et conclure en regardant ses toiles. Il a aussi inclus des citations de personnalités qui ont écrit sur Magritte, comme Paul Eluard, Pierre Mariens, Paul Nougé, Georges Hugnet, et d'autres encore. Ai fil des pages, on découvre une lettre de Magritte, où il évoque la possibilité de faire un livre avec lui qui se nommerait « Le Dernier mot » Ce recueil trahit la volonté d'explorer ce monde avec l'envie de ne rien Oublier. C'est une sorte d'encyclopédie fantasque où Louis Scutenaire, injustement oublié, a tenté de ne rien oublier, mais, je le répète, sans discours de la méthode. Elle s'adresse aussi bien à ceux qui souhaitent découvrir sa peinture comme ceux qui veulent aller plus loin dans leur connaissance de cette oeuvre. C'est indubitablement ce qu'on a pu faire de mieux jusqu'à présent pour se familiariser avec des jeux oniriques d'un artiste plus complexe qu'il n'y paraît.

Dürer, le burin du graveur, Alain Borer, « Studiolo », L'Atelier contemporain, 128 p., 6, 50 euro.
L'auteur a écrit ce livre il y a pas mal de temps. Spécialiste depuis sa tendre jeunesse d'Arthur Rimbaud, sur lequel il a écrit plusieurs ouvrages, il n'a pas de compétences particulières sur la Renaissance, ni d'ailleurs sur Albrecht Dürer (1471-1528) en particulier (il se moque des grands spécialistes et surtout de Panofsky dont il aurait pourtant d'en étudier la leçon magistrale). Dürer est, sans conteste possible, est des plus grands artistes de cette période qui atteignait alors son firmament dans le domaine des arts. S'il a été profondément imprégné par l'esprit pictural de l'Ecole du Nord, il a fait deux voyages en Italie, le premier en 1494 (il s'est rendu, entre autres, à Venise, à Mantoue, à Crémone). Sur le chemin de retour, il fait des aquarelles des Alpes qu'il a traversées. Quatre années plus tard, il a gravé la magnifique série de L'Apocalypse. Il retourne dans ce pays en 1505 : il séjourne de nouveau à Venise, puis a dû aller à Florence et à Padoue. C'est à son retour à Nuremberg, sa ville natale, qu'il a commencé à étudier sérieusement la géométrie et l'harmonie corporelle (il est d'ailleurs l'auteur d'un Traité des proportions du corps humain). Il est devenu l'un des grands théoriciens de la perspective.
Son talent a été vite reconnu et il a é »té nommé peintre officiel de la cour de l'empereur Maximilien Ier en 1512. Quand l'empereur rend son âme à Dieu en 1520, il a fait un voyage en Hollande. Il est frappant de noter qu'il a souhaité connaître à fond les deux pôles prédominants de la peinture européenne de ce temps, l'Italie di Nord et la Hollande. Charles Quint lui confirme sa charge et il siège toujours au Grand Conseil de Nuremberg Ier de Habsbourg et à la Diète de Augsbourg depuis 1518. C'est lui qui est chargé d'apporter les joyaux pour le couronnement de Charles Quint à Bruxelles. Il s'est révélé (je n'apprendrai rien à personne) un peintre hors pair, conciliant avec bonheur la tradition nordique et les techniques imaginées par ses pairs italiens. Ce caractère si fort de son travail pictural le rend unique. Mais il a aussi été un aquarelliste merveilleux et un immense graveur. Il était passé maître (le mot est faible) dans la pratique très ingrate et difficile de la xylographie. Et il avait su transposer la finesse infinie de ses dessins avec cette technique qui n'est pas faite pour autant de subtilité. Ce petit essai constitue une bonne initiation à cette oeuvre loin d'être modeste, car si Dürer n'a pas laissé une quantité impressionnante d'oeuvres peintes, il a fait de nombreuses gravures. Et l'auteur a eu raison de les faire figurer auprès de certains de ses dessins, qui montre son extrême dextérité dans ce domaine.
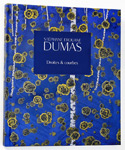
Droites et courbes, Stéphane Erouane Dumas, Pascal Bonafoux, Editions un fine / galerie Pierre-Alain Challier, 144 p., 35 euro.
Né en 1958 à Boulogne-Billancourt, ancien élève de l'Académie Julian, Stéphane Erouane Dumas a développé une oeuvre originale, qui de toute évidence est figurative, mais est constituée de telle sorte qu'on y trouve des problématiques géométriques assez évidentes et même proches de l'abstraction. Il a choisi le bouleau comme objet privilégié pour sa forme rectiligne, sa couleur blanche mouchetée de noir. Il ne travaille pas en général sur un arbre isolé mais sur un fragment de forêt plutôt dense. Enfin, il aime les représenter par un temps hivernal avec la neige et le givre. Il a accentué le contraste entre le réalisme de ses compositions et l'irréalité des alignements de troncs effilés. De plus, il ajoute parfois des éléments qui paraissent purement décoratifs, mais qui sont en réalité l'agrandissement et l'extrapolation d'éléments végétaux, comme le lichen par exemple, qui peut être blanc ou de différentes couleurs. A partir de ces éléments restreints, il parvient à tirer des effets surprenants en déclinant son sujet selon des règles qui sont souvent diverses selon les circonstances de son désir. C'est ainsi qu'il passe volontiers d'une forte impression naturaliste à une expression quasiment liée à de purs dispositifs linéaires.
S'il s'impose des règles plutôt sévères, celles-ci ne cessent de varier, permettant ainsi de libérer un sentiment spécifique ou une construction spatiale qui échappe à l'expérience commune. C'est ainsi que sa peinture se décline sur des plans et selon des perspectives qui n'ont de laisse de changer de modalités et d dimensions picturales. Il nous faut reconnaître que cette stratégie se révèle assez efficace. La distance mentale et la métamorphose des « objets » incriminés lui permettent de passer d'un univers plastique à un autre sans jamais modifier ses données de base. Il introduit parfois des plans d'eau, comme on peut tant en voir en Finlande, dans lesquels se reflètent ses arbres. En de rares occasions, il peint un grand lac qui donne une profondeur inattendue à sa composition. Mais il a réduit le plus possible le champ des éléments figuratifs afin de pouvoir jouer avec eux dans une longue suite de déclinaisons. Il peut ainsi jouer sur des combinatoires où l'on retrouve la plupart de ses choix, tout en leur donnant des rôles de nature variée. Le même et l'autre n'ont de cesse de s'échanger dans ses compositions. Si ce « décor » est sa marque de fabrique, il n'a pas une fixité telle qu'il le condamnerait à la répétition d'un système forclos. Et une certaine poésie émane de tous ces passages qui lui fait traverser des lieux à la fois semblables et très éloignés les uns des autres.
La grammaire immuable (à de rares exceptions près, comme les falaises par exemples, qui sont apparues récemment) qui le guide est un réservoir quasiment sans fond pour se renouveler de toile en toile. De ce façon, Stéphane Erouane Dumas a su échapper aux travers de ce genre de dispositif qui aurait être un frein à la création et a pu se déployer dans des genres qui n'ont pas grand chose en commun, étant parfois « décoratifs », le digne héritier d'un art naturaliste et encore un artiste qui s'oriente vers une dématérialisation à la faveur d'une géométrie ludique. Son oeuvre mérite d'être découverte et appréciée. Ce catalogue conçu avec soin fournit assez d'exemples marquants pour qu'on puisse se faire une idée précise de sa recherche qui procède par cercles concentriques.

Les Litanies de la Madone & autres poèmes spirituels, Biagio Marin, traduit de l'italien par Laurent Feneyrou, préface d'Edda Serra, postface de Laurent Feneyrou, Editions Conférence, 432 p., 23 euro.
Le nom de Biagio Marin (Grado 1891 - Grado 1985) est quasiment inconnu des amateurs de poésie français, même très cultivés, à moins qu'ils soient passionné par l'univers culturel de Trieste. Son nom est pourtant apparu sous la plume de grands auteurs italiens du siècle précédent, de Giuseppe Prezzolini à Pier Paolo Pasolini. Il est vrai qu'il a pas mal eu recours au dialecte de sa ville natale, ce qui en rend la lecture assez difficile si l'on n'est pas issu de cette région. Cette anthologie vient donc à point nommé combler un vide béant. Issu d'une modeste famille bourgeoise de ces confins de l'Empire austro-hongrois, il a été élevé par sa grand-mère paternelle après la mort prématurée de sa mère. Il a fait ses études primaires à Gorizia, puis est entré au lycée allemand et a fait ses études supérieures à l'Ecole royale de Pisino d'Istria. Il s'est installé à Florence en 1911 où il a fréquenté le cercle qui s'était constitué autour de revue La Voce. Il a eu à cette époque des relations avec Umberto Saba et Scipio Slapater. Au bout d'une année, il s'est rendu à Vienne, et s'y est inscrit à la faculté de philosophie. Il a publié son premier recueil de poésie, Fiuri di tapo. Au bout de deux ans de permanence dans la capitale autrichienne, il décide de retourner à Florence avec sa fiancée Pina Marini. Quand la guerre est déclarée en 1915, il a décidé de s'enrôler dans les forces italiennes. Il eut des problèmes de santé et a passé in certain temps dans un sanatorium en Suisse. A la fin du conflit, il est allé étudier la philosophie à Rome et s'y est diplômé.
Il a ensuite enseigné à Gorizia. Il est devenu par la suite inspecteur d'académie. En 1921, il est nommé directeur de l'Azienda di soggiorno di Grado. A cette époque, il a rejoint le mouvement fasciste et a été responsable du Fascio de Grado (il s'est détourné définitivement de l'idéologie fasciste en 1943, après la mort de son fils au combat en Slovénie et après avoir découvert de la camp de la mort de la Riseria du San Saba). En 1938, il a décidé de revenir à l'enseignement, cette fois à Trieste. Il a accepté plus tard un poste de bibliothécaire aux Assicurazioni Generali de Trieste. La guerre achevée, il a publié Le litànie della Madona en 1949, puis I canti de l'isola en 1951. En 1964, la publication de Il non tempo del mare en 1964 lui vaut le prix Bagutta l'année suivante. Six ans plus tard, il a réuni tous ses poèmes déjà publiés dans une édition très augmentée de I canti de l'isola. Son ultime recueil, La voce de la sera, paraît en 1985. La rédaction des Litanies de la Madone a commencée en 1937 et s'est prolongée au moins jusqu'en 1982. L'ouvrage est composé de poèmes en général de deux, trois ou quatre strophes, rarement de plus. S'il n'y a pas un plan général (on est ici aux antipodes de la Divine Comédie), il existe néanmoins un fil rouge qui unit tous ces textes et qui ont une résonance religieuse. Mais là encore, il convient de les distinguer de toute poésie strictement religieuse comme celle de Paul Claudel par exemple. De toute évidence, la Vierge est au centre de ses préoccupations et est omniprésente où si elle n'est pas présente, elle donne une orientation au texte. Et si la religion et ses grands principes sont au fondement de cette longue théorie de poèmes, il convient d'ajouter, comme l'explique Laurent Feneyrou dans sa postface, qu'elle est nourrie de philosophie et de principes artistiques.
Ce n'est pas tant une théologie qu'a imaginé Biagio Marin au fil de ces pages, mais une vision de l'existence et du monde qui a des fondations chrétiennes. La Madone est comme le pivot de cette géographie intérieure. Le tout doit se lire et s'interpréter selon la sensibilité et l'intelligence d'un individu qui a tenté de décanter ce qui transcende le passage des hommes sur cette terre. Vers la fin de l'ouvrage, il se montre plus résolu dans sa croyance (il commence une poésie par « Dieu seul vit... ») et il affirme avec plus de conviction sa foi. Mais rien de saint-sulpicien et de caractère scolastique dans ses oeuvres. Loin des événements qui ont ponctué cette longue période, il a affirmé la beauté d'une relation exclusive et exigeante avec le divin, qui a pris l'aspect d'une femme bienveillante.
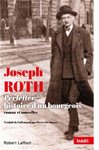
Perlefter : histoire d'un bourgeois, suivi de nouvelles, traduit de l'allemand et présenté par Pierre Deshusses, Robert Laffont, 252 p., 20 euro.
L'oeuvre romanesque de Joseph Roth a été intégralement traduite en français, à l'exception de celle-ci parce qu'elle est restée inachevée. Elle n'a été découverte qu'en 1978. Il est probable que ce roman ait été écrit pour paraître en feuilleton dans un journal, et que celui-ci y ait renoncé. Il se trouvait parmi les manuscrits que l'auteur a laissés chez un ami à Berlin avant de partir en exil en France. Les nouvelles aussi sont inédites, mais cela tient au fait que ses nombreuses histoires ont été publiées de manière décousue chez différents éditeurs (tout comme d'ailleurs ses articles). De quoi s'agit-il ? D'abord d'une histoire contemporaine, tout comme Hôtel Savoy ou La Toile d'araignée. On pourrait le rapprocher du Conformiste d'Alberto Moravia pour le thème choisi : l'histoire d'un petit bourgeois sans qualités qui, par lâcheté, accepte l'inacceptable. Le narrateur s'appelle Naphtali Kroj, qui vit dans un modeste bourg dans une région qui se consacre à la culture et au commerce du houblon et où vivent un grand nombre de Juifs. Il nous narre la vie d'un certain Alexandre Perlefter, un homme prudent, qui n'aimait pas les routes sinueuses de la contrée et préférait surtout les ponts qui lui donnaient un sentiment de sécurité et de stabilité. Il brosse de ce personnage un portrait physique (assez peu flatteur) et un portrait moral (qui n'est pas non plus très élogieux). Il rappelle ensuite les principales étapes de son existence : il quitte l'école assez tôt, n'ayant aucune attirance pour les mathématiques, travaille comme manoeuvre dans une minoterie, puis devient contremaître et monte encore en grade. Peu après, il dirige une société de céréales. Son ascension sociale est spectaculaire, d'autant plus que sa Il fait partie des figures qui comptent dans la petite ville, est bien vu des cercles financiers et l'association pour le tourisme s'approche de lui.
Il s'est marié e a eu quatre enfants. Ses relations avec son épouse malade du coeur et vaguement neurasthénique ne sont pas merveilleuses. Mais pas question de divorce. Comme il adore voyager, il en profite pour rendre visite à des dames seules dans chaque endroit où il se rend. On découvre les aventures sentimentales de sa progéniture, les projets de mariages souvent contrecarrés, les intrigues alambiquées et parfois absurdes qui accompagnent les aspirations de ces jeunes gens et celles de leurs parents, qui ne coïncident pas forcément. Cependant, toutes ces épousailles n'ont pas satisfait M. Perlefter en dehors de celle avec Kofritz, un maroquinier qui avait bien réussi. Un personnage fait son apparition à la fin du manuscrit : Leo Bidak, un pauvre diable qui avait tenté sa chance à plusieurs reprises et avait toujours échoué. Il était rentré des Etats-Unis, car il a été loin d'y faire fortune. Mais une sorte de connivence s'est établie entre ce dernier et Perlefter. Et c'est là que s'interrompt le texte. Assez atypique au sein de l'univers de l'écrivain, ce roman avait pour mission de décrire la petite bourgeoisie du début du XXe siècle qui s'efforçait de se hausser du collet et de faire fortune. La description qu'en fait Joseph Roth n'est pas balzacienne et bien loin du naturalisme. Il coud ensemble différents destins et montre comment ils peuvent s'entraider mais aussi, le plus souvent, provoquer une catastrophe. Alexandre Perlefter est un être médiocre, mesquin, plein de défauts et vaniteux qui est parvenu en partie à ses fins. Roth a fait jouer son ironie légendaire avec science et son étude sociale a d'abord été un catalogue des défauts de ce segment de la société. Quant aux nouvelles, elles sont toutes merveilleuses. Ce qui frappe le plus c'est que Joseph Roth traite de sujets d'une relative banalité.
Mais il le fait avec son art de métamorphoser le plus commun en quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, dans la première d'entre elles, où il raconte la vie sans relief d'un modeste comptable, qui rêve d'une situation nouvelle. Il pense avoir trouvé un nouveau travail plus satisfaisant. Mais avant d'aller à son rendez-vous d'embauche, son patron lui offre une belle veste : il ne se sent pas le courage de le quitter après avoir fait à son égard un geste si généreux. Le récit est curieux, certes, mais le plus beau réside dans le détail, surtout dans l'obsession des chiffres dont fait preuve l'employé, son choix de la couleur de l'encre, etc. Ce sont autant de détails ans beaucoup d'importance qui finissent par être très révélateurs et qui peaufinent son portrait et qui dévoilent ses obsessions qui sont déterminées par une esthétique bizarre. Roth est passé maître dans cette façon de changer un être ordinaire en un personnage fascinant. Et tout ce qu'il a écrit est de cette nature : une relative simplicité dans l'ensemble, et une sophistication rare dans la description des traits de caractère et des manies. Ce sont là autant de petites merveilles littéraires.
|
