
Dada Africa, musée de l'Orangerie / Hazan, 192 p., 32 euro.
L'idée qui a donné naissance cette exposition est facétieuse : elle a consisté célébrer le 1o1è anniversaire de la naissance du mouvement dadaïste à Zurich. La seconde est d'une nature plus sérieuse et surtout révélatrice d'un état d'esprit qu'on a toujours relégué au second blanc : la profonde volonté des artistes et des écrivains de ce petit groupe rebelle d'en appeler au primitivisme, surtout l'art africain et l'art océanien. Quand on pense ces formes exotiques de l'art, on les lie naturellement au cubisme, au fauvisme et à l'expressionnisme, ce qui d'ailleurs est avéré. Mais on n'établit jamais le pont avec Dada. Et pourtant ! C'est qui est révélé par cette exposition passionnante présentée l'Orangerie Paris et qui est doté d'un excellent catalogue. Hugo Ball a déclaré le 15 juin 1916 : « Je ne sais si, en dépit de tous nos efforts, nous pourrons aller plus loin que les sauvages et que Baudelaire. » Il est déjà à souligner que l'artiste Allemagne ne fait pas exclusivement référence aux arts rituels de l'Afrique noire et qu'il met en jeu les curiosités esthétiques de Baudelaire, comme une sorte de curieux contrepoids occidental. Le goût du « primitif » a envahi presque tous les arts d'avant-garde des années 1910, d'une façon ou d'une autre. Modigliani, Bohumil Kubistà, Zadkine, Gaudier-Brzeska, Jacob Epstein, Karl Schmidt-Rottluff et pour les dadaïstes Raoul Haussmann, Marcel Janco (qui a exécuté beaucoup de masques grimaçants et barbares) ont tous été marqué profondément par cette impulsion retourner ce qu'il jugeait « archaïque ». Le grand critique d'art allemand Carl Einstein a publié à Leipzig en 1915 un des livres majeurs sur l'art africain, Negerplastik. Ses études approfondies ont permis aux artistes, aux critiques et aux poètes de l'époque de mieux connaître la teneur de cet art qu'ils avaient été amenés admirer de manière spontanée et sans beaucoup de recul culturel. La publication ne se limite pas aux menées des artistes : par exemple, l'accent est mis sur l'importante collection réunie par le grand marchand d'art Paul Guillaume. De plus, les auteurs ont analysés des créations quine sont pas directement issus de cette vision du primitivisme : c'est ainsi qu'on peut comprendre comment Jean Arp ou Marcel Janco ont pu s'en servir pour élaborer une esthétique sans rapport immédiat. Quant à Tristan Tzara, il s'est intéressé à la poésie « nègre » dans la revue SIC en 1918. La poésie, avec ses excès d'onomatopées choquantes (pour les oreilles de l'époque), a subtilisé quelque chose des chants traditionnels de ces horizons lointains et la danse aussi en a été largement influencée (on le voit avec Sophie Tauber). Emmy Hemming a réalisé pour son compte des marionnettes dans l'optique sauvage, tout comme Hannah Höch a créé des poupées dans un esprit proche (mais avec des clés référentielles différentes) en 1919. En somme, cet événement doit amener le visiteur revisiter Dada dans une optique renouvelée en y ajoutant ces ingrédients qui sont loin d'être indifférents. Tout cela est passionnant et permet des découvertes vraiment déconcertantes et importantes pour comprendre cet art radical, et toujours profondément jouissives.
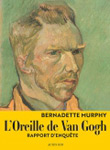
L'Oreille de Van Gogh, Bernadette Murphy, traduit de l'anglais par Christine Le Boeuf, Actes Sud, 398 p., 24,80 euro.
Je dois dire que les livres où l'auteur se met en scène pour effectuer une enquête approfondie sur un artiste du passé, transformant l'ouvrage en une sorte de roman policier ou d'espionnage, ne sont pas faits pour me plaire (il y a eu l'exemple assez récent de cet écrivain américain qui a voulu démontrer que le peintre anglais Walter Sickert était Jack l'éventreur !). Mais celui-ci a le mérite d'être très sérieux et que ce que Bernadette Murphy a tenté de faire, c'est—dire reconstituer les dernières années de la vie de Vincent Van Gogh, depuis son séjour en Arles jusqu'à sa mort survenue à Auvers-sur-Oise. Elle a eu soin de comprendre quel était l'aspect de cette jolie petite ville méridionale avant les bombardements américains de 1944 qui l'ont pas mal endommagée et qui ont détruit une partie des lieux fréquentés par l'artiste hollandais. Cette précision dans chaque détail lui a permis de mieux reconstituer les faits, en particulier cette fameuse affaire de l'oreille coupée offert à une prostituée (Rachel) peu avant Noël 1888, qui a beaucoup contribué sa légende et le faire passer pour un fou furieux. Elle nous apprend entre autres que Vincent Van Gogh n'a pas seulement séjourné en Provence qu'avec Paul Gauguin, mais avec des artistes danois, dont Christian Mourier-Peterson, avec lequel il avait peu d'affinités, mais de bons rapports. Bernadette Murphy reconstitue avec soin la vie de Van Gogh Arles, sa relation avec la prostituée prénommée Rachel, son amitié avec le facteur et surtout ses liens profonds avec des femmes mariées et plus âgées que lui. Le portrait qui se construit petit à petit du peintre modifie assez sensiblement l'idée qu'on avait pu faire de lui travers toutes les biographies passées. Cette vie passée à Arles, dans une ville qui se transformait et avait une vie culturelle (celle des Félibrige sous la conduite de Frédéric Mistral pour le renouveau de la langue provençale) prend ici vraiment consistance grâce ses patientes recherches, ainsi que la meilleures connaissances des lieux qu'il a connus. L'auteur en vient parler de la venue de Gauguin et des attentions que Van Gogh a pu prendre pour lui rendre le séjour le plus agréable. Mais son aîné ne tarde pas se rendre compte qu'il souffre de troubles mentaux sérieux et il s'en inquiète. Leurs relations en sont forcément affectées et là encore notre biographe cherche être la plus précise possible. Au fond, nous n'apprenons rien de fondamentalement nouveaux, mais nous pouvons être certains de ce qu'elle avance dans ce livre et nous fonder sur des faits avérés dans un contexte spécifique. En tout cas, il est impossible de reconstituer le geste tragique de Van Gogh, car Gauguin, qui est parti aussitôt, en a fourni plusieurs versions et qu'il n'y a guère d'autre documentation. Mais notre chercheur est parvenue trouver un document émanant du Dr Rey qui a soigné le malheureuse après son automutilation, qui prouve qu'il s'était bien tranché une partie de l'oreille. La suite est celle du constat d'une aliénation. Après un long séjour l'hôpital, il est placé dans une institution privée Saint-Rémy, où l'on qualifie sa maladie. Quelque mois plus tard, l'artiste meurt Auvers-sur-Oise. La thèse de son suicide a été contestée récemment. On a parlé d'un accident de chasse ou de gamins qui lui aurait tiré dessus. Mais l'auteur, sans trancher, souligne qu'il avait un penchant suicidaire. Cet ouvrage a le grand mérite de faire le point sur la légende qui entoure ce magnifique peintre, qui a vécu hanté par le malheur.

Villes-jardins, Anna Yudina, Ulmer, 256 p., 49,90 euro.
La notion d'utopie dans le projet d'urbanisme moderne et dans l'architecture a disparu depuis longtemps. Les années 197o aux années 198o ont été fécondes dans ce domaine, s'inscrivant dans une tradition remontant au XVIIIe siècle. A sa place, s'est largement diffusé un urbanisme idéal, plutôt de facture artistique, mais pouvant être réalisé dans les termes de l'économie moderne. On recherche plus volontiers des solutions viables apportant le plus grand confort et parfois la plus grande valeur esthétique, mais en oubliant parfois les problèmes spécifiquement sociaux et ceux qui touchent l'expansion démesurée des villes dans le monde. La notion de ville-jardin est issue de considérations souvent très terre à terre permettant de corriger les grandes erreurs d'un passé récent. Pour les architectes qui représentent le mieux cet état d'esprit, les faits sont criants : l'urbanisme est tel qu'on ne peut plus imaginer des bâtiments ayant une vaste zone verte autour d'eux. Comme les terrains valent virtuellement des fortunes, il faut envisager la question en d'autre termes : c'est l'immeuble lui-même qui devient le support de ces zones vertes. Donc le jardin devient en grande partie vertical. C'est là que réside la nouveauté car l'idée d'immeubles jardins existent depuis longtemps en Italie, aussi bien à Milan qu'à Florence ou à Rome où l'on trouve d'immense terrasses couvertes de plantes ou même des toits servant de jardins. Les White Walls de Jean Nouvel à Nicosie ne sont qu'une extrapolation des balcons agrémentés de plantes qu'on peut voir dans presque toute l'Europe. Le One Central Park qu'il a conçu Sidney est un peu plus intéressant, mais les baies vitrées de ce haut immeuble forment une frontière naturel l'expansion de la végétation, qui devient ici une sorte d'ornement des fenêtres. Ce n'est pas vraiment une création. Le 25 Green de Luciano Pia Turin est un immeuble en brique aux formes sinueuses d'où semble jaillir des arbres du coeur de l'édifice. C'est très beau et très surprenant. Beaucoup des projets réalisés sont plutôt décevant, car on a essayé de mettre le plus de plantes possible en tout lieu disponible de la construction, comme on le remarque dans le cas de la Stone House de Dong Trieu au Vietnam. On peut aussi découvrir dans ce livre des exemples de bâtiments anciens remodelés grâce la verdure, comme la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens. Quelques créations semble alliée la créativité et l'utilitaire, comme c'est le cas avec la grande et belle boutique d'Ann Demeukemeester à Séoul, où les murs aveugles sont couverts de gazon. Beaucoup d'architectes ont tenté d'utiliser les principes du jardin suspendu, comme l'a fait Stefano Boeri à Milan. Il a recherché produire une « architecture biologique ». Ce n'est ni un échec, ni un succès, mais une tentative intéressante. On voit aussi se multiplier les expériences d'anciens passages aériens, comme la très charmante Coulée verte à Paris installée tout le long des anciennes voies menant à l'ancienne gare de la Bastille, ou The High Line de New York, qui reproduit un schéma assez similaire. Beaucoup de jardins se sont installés dans d'anciens bâtiments industriels, comme le jardin de la Fonderie à Nantes. Il y a aussi des cas d'espèce, qui sont peut-être les plus intéressants, comme la House before House de Sou Fujimoto au Japon, ou la Siu Siu à Taipei, où les arbres transpercent la couverture en verre. L'Asie nous propose sans nul doute les projets les plus originaux et les plus intrigants. Mais ceux-ci ne peuvent fonctionner que dans un cas spécifique. Le livre est superbement fait et les créations qu'il nous propose de découvrir sont autant d'interrogations sur le futur de ce désir partagé de ville-jardin. Je pense qu'il vaudra encore du temps et des créateurs plus incisifs encore pour parvenir trouver autre chose que des Babylone assez pitoyables de béton armé et de verre ou des nombreuses tentatives d'interpénétration de l'extérieur (reconstruit) et de l'intérieur, déterminé par de strictes normes de construction. Mais c'est grâce un livre aussi bien documenté que peut commencer une véritable méditation sur le sujet.

Le Comité national des galeries d'art - 7o ans d'histoire, sous la direction de Julie Verlaine, 176 p., 25 euro.
Le titre et le sujet ne semblent guère attrayants première vue pour quelqu'un qui ne dirige pas une galerie ou qui exerce un métier strictement lié au commerce l'art. Mais en lisant l'ouvrage, on se rend compte que beaucoup de choses sont intéressants et même parfois passionnantes. En effet, nous ne connaissons pas toujours très bien les règles qui président cette profession. En plus, les choses ont beaucoup changé depuis l'après-guerre. Je ne prendrais qu'un seul exemple : le droit de suite. Ce droit a été accordé aux artistes il n'y a pas si longtemps pour les ventes publiques, car un collectionneur vend un oeuvre de ce dernier. Il a été question d'appliquer la même règle aux galeries qui auraient vendu des oeuvres de peintres ou de sculpteurs ne faisant pas partie de ceux qu'elles représentent. Les intéressés se sont insurgés et ont obtenu gain de cause, en prétextant les nombreux frais auxquels ils doivent faire face. Plusieurs autres questions sont assez importantes comme l'aide apporter aux galeries exposant dans des foires l'étranger ou la sans cesse plus grande importance de la photographie dans leurs expositions. En somme, ce petit manuel très technique, mais bien fait, nous permet de comprendre comment cette profession a pu évoluer au cours du temps et comment les nouvelles donnes de l'art contemporain ont pu métamorphoser leurs pratiques. Il va de soi que ces pages ne sont pas critiques et qu'elles se limitent recenser les faits. Mais nous pouvons très bien nous faire une idée de cet univers dont nous avons encore beaucoup découvre (et je ne parle pas des mauvaises actions de certains, ce qui serait un autre sujet !).

Madge Gill, Marie-Hélène Jeanneret, « Polychrome », Ides et Calendes, Lausanne, 126 p., 24 euro.
Madge Gill (1882-1961) fait partie de ces artistes qui n'ont jamais voulu être reconnus comme tels : elle toujours refusé de vendre un seul de ses dessins, le plus souvent exécutés l'encre de Chine. Donc on l'a placé dans la catégorie fourre-tout de l'art brut. Je ne veux pas me prononcer si c'est tort ou raison. Sans doute son oeuvre appartient-elle à ce registre. Mais c'est aussi une façon de cataloguer une personne qui dessine et qui peint. Bien sûr, le fait de garder ces productions de l'âme pour soi et pour soi seul peut démontrer que Madge Gill n'a pas été une artiste au sens plein du terme, car sinon elle aurait aimé partagé ces créations avec autrui. L'auteur a relaté » avec beaucoup de tact son existence et aussi l'évolution de son art, car elle ne s'est jamais arrêtée une formule figée. Elle est passé par de nombreuses phases, l'une étant décorative et plutôt géométrique (comme en témoigne la magnifique robe qu'elle a créée), l'autre par une surcharge des figures sur le papier, dans une sorte de débordement ne laissant aucune respiration ses oeuvres, une autre encore étant barrique et presque abstraites avec des volumes qui se développent dans l'espace. Elle a pu aussi faire des foules compactes, comme dans sa Crucifixion. Quand on la suit dans l'évolution de ce travail constant et assidu, on se rend compte qu'elle passe par des périodes bien marquées dans l'esprit et dans la forme. Elle a eu une âme d'artiste, mais son état de santé l'a détourné d'une authentique vocation. Maintenant on va la condamner ce curieux purgatoire de l'art brut. Elle avait un vrai talent, qui n'a pu vraiment s'épanouir que dans les arts décoratifs avec ses dessins géométriques. Je ne sais pas ce qu'un Dante moderne dirait sil la rencontrera au détour de ses pérégrinations dans ces limbes grisâtres de cet art qui n'est pas un art tout en en étant un...

Dictionnaire historique des homosexuel-le-s célèbres, Michel Larivière, La Musardine, 496 p., 23 euro.
Je dois dire que j'avais beaucoup apprécié les Femmes d'homosexuels célèbres, du même auteur, paru chez le même éditeur. Cet ouvrage-ci pose un problème de fond : n'est-il pas discriminatoire de classer les grands personnages par catégories sexuelles ? Déjà, un dictionnaire des Juifs célèbres poserait ce même genre de question. Dés que le problème est posé, on pense d'abord à des écrivains : Marcel Proust, André Gide, François Mauriac, Rudyard Kipling, Henry James, même Jules Verne, sans parler de Tennessee Williams, de Truman Capote, de Burroughs, de Genet, et mille autres. Mais en ce qui concerne les artistes, on s'intéresse moins à leur identité sexuelle sauf peut-être dans des cas très médiatisées, comme celui, comme Frida Kahlo, qui aima les hommes comme les femmes, sans jamais se cacher (elle porté des vêtements masculin, comme Rosa Bonheur, qui avait obtenu une permission spéciale, car sous Napoléon III, une dame ne pouvait pas s'habiller comme un gentleman !) dans un Mexique très catholique. L'auteur remonte dans le temps et nous parle de Luca Signorelli, de Raphaël, de Léonard de Vinci, cela va sans dire, de Michel-Ange Buonarroti, et la liste peut s'allonger à l'infini là aussi, sans compter les écrivains qui ont été aussi des peintres comme Jean Cocteau, Brion Gysin ou John Giorno. Et il ne saurait être question d'oublier Rauschenberg, Warhol et Basquiat ! En somme, tout cela reste compliqué et parfois sujet à caution dans de rares cas. Quoi qu'il en soit, c'est la découverte qui, dans ce gros ouvrage de référence majeur : Michel Larivière a traité cette question délicate avec respect et aussi avec une réelle érudition.

Qu'est-ce que l'art ? Léon Tolstoï, traduit du russe par Teodor de Wyzewa, Perrin, 1918 ; réédité par Babelio, 2oo6.
Sur la non-violence et le patriotisme, Léon Tolstoï, traduit de l'anglais et du russe par Bernard Kreise, « Carnets », L'Herne, 84 p., 7,50 euro.
Les Insurgés, Léon Tolstoï, traduit du russe par Michel Aucauturier, folio, 256 p., 7,2o €.
Le Bonheur conjugal, Léon Tolstoï, traduit du russe par Sylvie Luneau, Folio bilingue, 288 p., 8,20 euro.
Léon NikolaIevitch Tolstoï (1828-1910) est très connu en France pour ses romans et ses nouvelles. Mais on connaît assez peu ses innombrables essais, et surtout son livre intitulé Qu'est-ce que l'art ?, un ouvrage qu'il a fait paraître dans son pays en 1898. En France, il est loin d'avoir laissé indifférent, même si on a pu le lire avec une certaine défiance. En effet, il a défendu la thèse selon laquelle l'art de son temps n'était plus en phase avec la majorité des gens et était devenu d'un intellectualisme réservé à une seule élite. Il désirait un art social. Il croyait que l'art de l'avenir serait celui qui « aura pour objet de manifester la plus haute conscience religieuse des générations futures ». Et il était fermement convaincu qu'il redeviendrait un moyen de communication entre les hommes, qui pourraient partager un idéal commun. Quand on lit ce livre, on peut très bien comprendre l'influence qu'il a eu sur les artistes les plus avant-gardistes, de Malevitch à Rodtchenko, dont les créations étaient pourtant compréhensibles à peu d'initiés, mais qui luttaient activement pour le succès de la révolution bolchevick. S'il défend une conception du beau encore classique et un peu dépassée, Tolstoï était pourtant dans l'air de son temps puisqu'il préconisait un élargissement du concept d'Art, ce qui était déjà dans le cas de l'Art Nouveau et des diverses Sécessions en Europe qui ne faisaient plus de distinguo entre grand art et arts appliqués. Il a eu des intuitions étonnantes, d'autant plus qu'étant assez âgé et vivant replié dans sa propriété d'Iasnaïa Poliana, était assez peu informé sur les nouvelles formes de la création plastique de la Belle Epoque. Il a eu aussitôt un immense impact en Europe, surtout en Allemagne, où il a été lu par Kandinsky et Franz Marc.
Les articles et lettres de Léon Tolstoï réunis dans Sur la violence et le patriotisme publiés par L'Herne étaient restés inédits dans notre langue. Le premier article a paru dans un périodique anglais en 1895 et Tolstoï a choisi comme point de départ de sa réflexion un conflit qui opposait la Grande-Bretagne et les Etats-Unis propos de Venezuela. Il en a profité pour dire à quel point les idées de patriotisme et de nationalisme sont négatives pour les peuples et donc les Nations. Cette guerre-là n'aura pas lieu, mais c'est l'exemple parfait d'un conflit qui peut dégénérer. Ensuite, nous découvrons une correspondance entre l'auteur d'Anna Karénine et Gandhi entre 1909 et 1910. Tolstoï exprime son admiration et ses convergences de vue avec le chef de file de la résistance non-violente. En revanche, il écrit une « Lettre à un révolutionnaire » , lettre ouverte publiée Vilnius en 1909 en réponse aux thèses avancées par Mikhaïl Vroutesevitch. Il se montre très perplexe quant à toutes les formes d'idéologies et ne croit pas dans les idéaux révolutionnaires. Les solutions apportées par les uns et les autres pour résoudre la question de la misère et l'exploitation des hommes ne lui conviennent pas car ils lui semblent tous devoir aboutir un même résultat : une autre façon de donner naissance à une nouvelle tyrannie. Il prend pour exemple la Révolution française. Il réfute en bloc tous les théoriciens du socialisme, de Karl Marc à Jean Jaurès. Quelques soient leurs options de gouvernement, aboutissent tous un même résultat : une nouvelle violence s'imposera. Pour lui, l'homme doit apporter une réponse non-violente la violence qu'il subit. Il rejoint ici les propos de Gandhi. Dans un article paru l'année suivante, « Du socialisme », il confirme son scepticisme l'encontre des thèses révolutionnaires. Il souhaite l'émancipation des peuples opprimés et des classes laborieuses, mais dans une toute autre optique. Sa démonstration n'est d'ailleurs pas des plus convaincantes. Tolstoï recherche désespérément de trouver une solution pacifique aux conflits de son temps. Il hasarde ici de manière encore plus net une solution de caractère religieux, et chrétien de plus. Sa méfiance devant les doctrines s'est révélée des plus judicieuses. Mais ses hypothèses du vieil homme ne sont que des voeux pieux. Il meurt d'ailleurs quelques semaines après avoir écrit ces pages.
Quant aux Insurgés, nous ouvrons ici une page importante de la vie créative de l'écrivain. En effet, les événements du 14 décembre 1825, avec l'insurrection de trois régiments sur la place du Sénat à Saint-Pétersbourg, ont tourné court ont entrainé la condamnation de nombreux officiers : certains ont été pendus, d'autres, la majorité, on été condamné l'exil à vie en Sibérie. Tout est parti du fait que le tsar Alexandre Ier, lors de la restauration de la monarchie en France, avait exigé de Louis XVIII la création d'un régime constitutionnel. L'idée a vite fait son chemin dans les milieux cultivés en Russie. Les esprits les plus avancés souhaitaient en terminer avec le pouvoir absolu institué en 1547 par le premier tsar de toutes les Russie Ivan IV (Ivan le terrible), alors que Nicolas Ier devait succéder son frère après le renoncement de Constantin. Le soulèvement décabriste a laissé une trace profonde au sein de l'intelligentsia russe. Tolstoï avait songé écrire un roman au sujet de ces militaires progressistes qui avaient tenté de changer le cours des choses. Il a bien commencé les Décembristes en 1863, mais les a mis de côté pour s'engager dans l'une de ses plus grands romans, Guerre et paix, qu'il a achevé en 1869. Ce qui a été préservé de ce manuscrit, c'est le début - tout de même trois chapitres complets - déjà très élaboré. Il l'a fait après l'abolition du servage voulue par Alexandre II. Les détails que Tolstoï apporte et le rythmer du récit font songer à un assez long roman et non à une nouvelle. Il est revenu jusqu'en 1878 sur son projet, et a y apporté de nouveaux chapitres et des variantes. Mais il a renoncé le mener terme. Cette édition, qui est annotée et présentant un dossier bien fait concernant cette oeuvre importante, présente aussi une traduction nouvelle.
Enfin le Bonheur conjugal fait partie de ces Souvenirs et récits que le grand écrivain a écrits en marge de ses grandes oeuvres titanesques. Il a paru en feuilleton au cours de l'année 1859 dans Le Messager russe. La jeune Macha en est la narratrice. Elle vit avec sa soeur dans leur demeure familiale. Elle appartient à la petite noblesse. Un ami de la famille, Sergueï Mikhaïlitch, est souvent présent et porte un grand intérêt ces jeunes filles orpheline de leur mère, comme le ferait un père, car il est plus âgé qu'elles. Macha tombe amoureuse de cet homme aimable. Ils se fiancent et font un long séjour Saint-Pétersbourg. Macha est éblouie par la vie mondaine qui se déroule dans la capitale impériale. Et elle s'y impose avec succès. Sergueï n'aime pas cette vie et tente de l'en éloigner, sans y parvenir. Cela creuse un fossé entre les deux fiancés. Mais aucun n'ose franchement dire sa vérité. Le mariage se révèle assez désastreux car elle a perdu les sentiments passionnés qu'elle avait pour lui. Leur amour se métamorphose et n'est plus qu'une ombre. L'arrivée des enfants donne à Macha d'autres raisons d'aimer. Ce n'est pas le même amour. Elle finit par lui reprocher de l'avoir emmené dans la capitale. Mais il demeure entre eux une sorte de compromis qui fait de leur existence commune une entente cordiale, mais sans plus aucune illusion. Dans ce livre, Tolstoï prouve sa virtuosité et son talent de narrateur. Mais ce qui rend cette affaire conjugale forte, c'est le rythme de la narration, qui a un tempo nerveux et intense alors que tout ce qui se passe consiste à rendre supportable et vivable une désormais incommensurable séparation du mari et de son épouse. C'est magnifiquement brossé !

Il y avait des rivières infranchissables, Marc Villemain, Joëlle Losfeld Editions, 152 p., 14,50 euro.
On peut voir en Marc Villemain un écrivain qui a des qualités qu'on ressent dès les premières pages : une grande vivacité dans le style, de l'invention dans la manière de narrer son histoire, de l'invention à revendre. Il n'a pas la prétention de révolutionner la littérature, mais au moins de lui donner un caractère qui n'appartient qu'à lui. Ses nouvelles ne relatent pas des histoires extraordinaires, ni ne cherchent produire une nouvelle modalité d'écriture. Mais elles ont un charme indéniable. Ces petits récits procurent un vrai plaisir et, grâce à son originalité, s'élève au-dessus de la simple transcription d'une réalité somme toute assez banale. Il contredit cette banalité et lui procure une sorte de poésie, mais qui n'est pas une manière de sublimer ces amourettes ou ces rencontres. Son thème central est l'amour, sans un grand A. Mais pas non pus avec un petit a. L'amour révèle sa beauté, son charme, son élan par le biais d'une façon très singulière de camper un paysage, un climat, une situation. Il y a dans ces pages une fraicheur d'esprit et une grâce assez peu communes et Marc Villemain me paraît beaucoup plus prometteur que bien de sauteurs qui ont une plus grande maîtrise de leurs moyens, mais pas beaucoup de capacité de rendre des sentiments amoureux avec tant de finesse. Il a toute la concision de Guy de Maupassant sans en avoir le mordant, et tout le charme d'une Colette qui aurait été contaminée par la prose de Francis Carco ou de Roland Dorgelès. C'est une des bonnes (et donc rares) surprises de la rentrée littéraire.

Les Contes du chat perché, Marcel Aymé, Folio, 416 p., 7,70 euro.
Il était une fois Delphine et Marinette, deux fillettes qui vont l'école et vivent la campagne. Elles partagent un grand secret : celui de pouvoir parler aux animaux familiers. Le chat est le premier à faire son apparition (« La Patte du chat ») et bien d'autres vont le suivre : le loup, le chien, le petit coq noir, les boeufs, le cochon, la buse, le canard, le cygne, le cerf, et même la panthère et le mammouth, qui n'appartiennent pas vraiment à leur univers quotidien ! Ces histoires sont racontées à la manière des maîtres du genre (comme les frères Grimm), mais dans un langage moderne et dans un esprit moderne lui aussi. Les premiers de ces contes ont paru en 1963, puis l'ensemble a paru après la mort de l'écrivain, en 1969. L'auteur de la Jument verte a commencé écrire ces histoires avant le début de la dernière guerre, en 1934. A cette époque, l'artiste russe Nathan Altman se charge d'illustres les Boeufs. Visiblement, il y a pris goût puisqu'il n'a pas cessé d'en écrire de nouveau, faisant des entorses son ordre de bataille narratif en introduisant « les Boîtes de peinture » en 1941. Après bien des hésitations, Marinette a terminé le portrait de l'Âne. Ce dernier proteste car la petite fille ne lui a fait que deux pattes. Le récit se prolonge par l'apparition d'autres animaux qui commentent leurs dessins, ou espèrent avoir leurs propres portraits. Une sorte de logique débridée s'instaure et ce sera là sa marque de fabrique. C'est très drôle et sans le moindre souci de morale ou même de métaphore. Ce ne sont pas non plus des fables. Non ce sont des histoires qui sont destinées à la pure joie des enfants (et de ces adultes qui ont conservé une âme d'enfant). Et comment ne pas se laisser aller à la jubilation de récits sans queue ni tête, jubilatoires et amusants ? Marcel Aymé a été très doué dans ce registre (il n'a jamais cessé d'en composer tout le long de sa carrière d'écrivain), et je dois dire que j'ai relu ces pages, que je n'avais pas revues depuis des décennies, avec beaucoup de bonheur.
|
