
Une vie de Gala, Dominique Bona, Flammarion, 232 p., 29,90 euro.
Il est de notoriété publique de Gala, de son vrai nom Dimitrievna Diakonovna, née à Kazan en 1894, a été une femme des plus curieuses. En lisant les pages que Dominique Bona lui consacre, on se rend compte qu'elle n'a rien de mystérieux, à part son emprise singulière sur les hommes qu'elle a choisis : elle n'est pas d'une grande beauté, même si elle est assez bien faite, elle n'a aucun don particulier et se révèle discrète et plutôt renfermée. Son visage n'était pas gracieux, mais elle avait un regard de braise. Au début de l'année 1913, elle quitte la Sainte Russie pour se rendre à Davos où elle doit se soigner d'une tuberculose au sanatorium de Clavadel. C'est là qu'elle rencontre un jeune homme, un pur Parisien, fils d'un entrepreneur, Eugène-EmilePaul Grindel, qui ne va pas tarder de choisir comme pseudonyme Paul Eluard. Dans le cadre rigide de cette institution des Grisons, où l'ennuie règne en maître absolu, ces deux jeunes gens se rapprochent et ils deviennent vite inséparables. Le poète tombe follement amoureux de la jeune Russe. Mais la guerre arrive et Paul part sous les drapeaux. Ils veulent se marier à tout prix, malgré le peu d'enthousiasme des parents du promis : la cérémonie a lieu de 21 février 1917. Gala est désormais et la muse et tout son horizon. Elle donne naissance à une fille, Cécile, en 1918. Eluard publie son premier recueil en 1919. Bientôt il connaît une foule d'écrivains, dont Gide, Paulhan, Reverdy. Mais c'est la rencontre d'André Breton, de Philippe Soupault et de Louis Aragon qui est déterminante pour lui. Il se rallie aux idées dadaïstes et publie dans leur revue, Littérature, puis Dada. Et puis il vit la longue aventure du surréalisme. Dans toute sa vie poétique, Gala tient une place de premier plan, même dans la sphère privée. En public, elle ne plaît pas et se met en retrait. On ne la voit que dans un portrait où elle figure avec Paul Eluard peint par Giorgio de Chirico. Quand survient Max Ernst dans leur vie, un ménage à trois s'instaure, bien qu'Eluard éprouve une passion jamais démentie pour sa femme, qu'il ne cesse de louanger dans sa poésie. En 1924, Eluard disparaît tout d'un coup : il s'embarque à Marseille et va jusqu'à Papeete. Max Ernst et Gala le rejoignent en Indochine. De retour à Paris, le poète retrouve le groupe surréaliste . En 1927, il est de nouveau malade et doit se rendre en Suisse. Et elle, elle poursuit sa vie amoureuse débridée sans se dissimuler . En 1929, le couple se rend en vacances avec leur fille chez Salvador Dalì. L'idylle qui va se nouer entre le peintre encore inconnu et la jeune femme se traduit pas une passion sans frein. Mais cela n'entraîne pas une rupture. Longtemps Eluard croit à son retour. Mais cette fois, elle ne revient pas. Elle se fait l'égérie de l'artiste et gère son existence et sa carrière. Elle a trouvé son rôle, un rôle quelle ne cesse plus de tenir jusqu'à sa disparition. Le livre de Dominique Bona nous fait redécouvrir le surréalisme sous un éclairage nouveau et insolite. Et comme elle très peu à dire de cette femme étrange, elle nous relate une part consistante de la vie de tous ceux qui l'ont approchée de très près.

Roger de La Fresnaye, une peinturé libre comme l'air, Michel Charzat, Hazan, 256 p., 45 euro.
Voilà un artiste qui n'est pas inconnu, mais dont on connaît finalement assez peu l'oeuvre. Il y a plusieurs raison à cela : sa disparition précise en 1925 (il avait quarante ans) et aussi une difficultés à s'inscrire dans une histoire et, en même temps, une difficulté à se détacher complètement des grands courants des années 1910 et 1920. On le voit bien au long de ses études à l'Académie Julian, à l'Ecole des Beaux-arts, puis à l'Académie Ranson : il n'est pas indifférent à ce qui l'entoure, il en subit même l'influence, On voit le jeune provincial (né au Mans en 1885 au Mans), qui a une éducation stricte et religieuse, qui découvre l'impressionniste et tout ce qui a pu suivre. C'est sans aucun doute l'enseignement de Paul Sérusier qui le marque le plus en 1908. Mais il est aussi redevable à d'autres artistes et il finit par s'associer à ce cercle d'artistes qui se recommandent du cubisme, sans en adopter les formes les plus radicales. Il participe aux rencontres chez Le Fauconnier, avec Gleizes et Metzinger. Il est aussi frappé par les futuristes, qui exposent à Paris en 1912. Les premières toiles cubistes qu'il exécute restent encore liées à des principes traditionnelles : il ne va pas jusqu'au bout de cette histoire. Des toiles comme Alice au grand chapeau, la Nature morte à la théière, Les Baigneuses, toutes de 1912, montrent bien qu'il adhère à cette nouvelle conception de la peinture tout en conservant des principes plus anciens. L'Homme assis (ou L'Architecte) est sans doute son oeuvre la plus radicale. Elle est suivie d'autres peintures dans cet esprit, comme Le 14 juillet et Le Rameur (1914). Il est alors appelé sous les drapeaux. Il tente de maintenir les contacts avec ses amis et travaille un peu. Il revoit Guillaume Apollinaire et devient l'ami de Jean Cocteau. reste alors dans la veine cubiste, mais avec une certaine autodérision. Il est gazé et son état de santé va s'en trouver gravement affecté. Il se consacre beaucoup au portrait et au paysage et renonce à l'esprit du nouveau. Le Délicat, un crayon rehaussé de gouache blanche, exécuté en 1922, prouve qu'il est entré dans une phase où l'ironie tient une place majeure. Il est néanmoins revenu à faire des dessins et des toiles d'inspiration cubiste dans le même temps, ce qui rend sa démarche assez contradictoire. Il fait d'une part Le Prestidigitateur (1921) d'un cubisme plus accentué que par le passé, et, de l'autre, et La Roumaine, la même année, dans un style néoclassique. Ce jeu va se poursuivre jusqu'à la fin de ses jours. De là sans doute la difficulté à le classer dans l'histoire de l'art français de cette période. Ce beau livre s'achève avec un très intéressant échange de correspondance avec Jean Cocteau.

Ricreazioni, l'arte tra frammenti del tempo, sous la direction d'Achille Bonito Oliva, Alfabeta 2, 128 p., 15 euro.
Le célèbre critique d'art italien Achille Bonito Oliva présente ce recueil qui est une tentative d'approche pluridisciplinaire des différents arts au tournant du siècle. Il est convaincu que tout se joue entre globalisation et « tribalisation ». Il considère que l'oeuvre d'art est désormais la manifestation d'un acte de résistance des artistes contre la réalité qui les entoure. Il se demande comment l'art actuel fait pour conserver, tout en la représentant, la conscience intellectuelle, si l'expérimentation technologique a été effectuée des fins purement spectaculaires du système industriel. L'expérimentation est pour lui un symptôme de cette conscience. Ce serait donc un acte de résistance contre un monde chaotique et fragmentaire. Il en résulte un art forcément éclectique, mais tente de retrouver d'autres finalités. Il explique ensuite qu'il y a eu de ce fait une transformation complète des modes de création. Il expose alors les contradictions propres aux attitudes adoptées par les artistes, qui ont un aspect cynique. Je vous laisse découvrir la suite de son raisonnement, qui est loin d'être erroné, même si je n'en tirerai pas les mêmes conclusions. Quant aux autres auteurs, ils ne parviennent pas décrire une vision assez distanciée pour nous convaincre. Prenons par exemple la communication d'Antonello Toleve sur « L'oeuvre d'art à l'époque des new media ».La situation qu'il y décrit est exacte, mais rendue d'une manière trop vague car elle existe déjà depuis plusieurs décennies sous des formes très diverses. Il y définit l'artiste comme un « artisan de l'électronique », ce qui peut laisser pantois. Les autres essais conserve d'autres domaines comme les arts dramatique, la musique, le cinéma, l'architecture. Si on a l'intention d'avoir une vision d'ensemble du phénomène, ce recueil permet d'avoir une idée d'ensemble, mais pas assez complète.

Un homme qui savait, Emmanuelle Bove, préface de François Ouellet, « La petite vermillon », La Table Ronde, 216 p., 7,10 euro.
Etrange, vraiment étrange, la littérature romanesque d'Emmanuel Bove (1898-1045), dont la courte vie a parsemé de nombreux échecs éditoriaux : les éditeurs ont souvent refusé ses oeuvres et la préface de François Ouellet raconte avec précision les étapes chaotiques de sa carrière. Ce livre, qu'il a écrit en 1942, sans doute au cours de son séjour à Alger, n'a d'ailleurs pas paru de son vivant (il n'est sorti de presse qu'en 1980). IL faut dire que ce roman n'est pas ordinaire. Il raconte l'existence bizarre d'un homme, Maurice Lesca, qui a fait des études de médecine, rêve d'épouser la fille du professeur Peix, mais commence aussitôt à douter de la vérité de tout ce qui l'entoure. Il a créé une clinique au début de la Grande Guerre et, en 1919, il retourne à Paris et là, abandonne tout. Il va vivre chez sa soeur, qui s'était mariée. Et depuis lors, il forme avec elle un couple pour le moins curieux. Le mari de sa soeur décède et ils se retrouvent dans un face à face intenable. Lui, il lui fait des promesses et elle, ne l'écoute plus car il ne concrétise jamais rien. Il a aussi une relation tout aussi extravagante avec Mme Gabrielle Maze, la libraire, qu'il fréquent assidument depuis longtemps, sans qu'on comprenne qu'il la courtise ou entretien l'illusion d'une relation amoureuse. Le défaut de ce récit est que l'auteur répète trop les scènes où son héros ratiocine sans fin. La fin est aussi décevante : il décide de mettre à la porte sa soeur et de d'enfermer dans une solitude mortifère. Emmanuel Bove est un cas littéraire des plus intéressants, mais ne me paraît pas être un génie méconnu.

Histoire de la littérature récente, Olivier Cadiot, Folio, 16 p., 6,6o euro.
On a beaucoup parlé d'art conceptuel, et même trop. En revanche, on a peu parlé de « littérature conceptuelle », alors qu'il y a eu, depuis le début du siècle dernier une abondante littérature expérimentale, de James Joyce à Jean-François Bory, en passant par le Nouveau Roman ou les poètes du Black Mountain College. Manifestement, Olivier Cadiot s'est spécialisé dans l'étude de la nouvelle littérature en produisant des ouvrages qui se situent entre la fiction goguenarde et l'essai biaisé. Il a publié en 1988 un Art poetic, dont le titre est déjà un manifeste qui manque franchement et d'originalité et de force. On pourrait croire à la revanche d'un potache malmené pendant les cours de français ! Ce qui manque à sa prose qui, par ailleurs, est assez passionnante dans ce nouvel ouvrage, est un humour rabelaisien ou un esprit caustique à la Voltaire. Beaucoup de choses qu'il énonce sont tout fait juste et tape donc dans le mille, il y a des chapitres (ou ce qui en tient lieu), qui sont des amorces de fiction qui n'aboutissent pas. Peut-être est-ce là sa démonstration. Mais il mène un jeu dangereux car il peut être ici victime d'un effet boomerang. Bien sûr, on le lit avec plaisir, quelques fois avec délectation, mais le tout ne parvient pas à constituer un bélier assez puissant pour forcer les portes de la forteresse de notre esprit. A force de dénoncer les grosses ficelles du romans (je le répète : à juste titre), il manque ce qui pourrai faire de lui un romancier mémorable. Comme l'avait déclaré Oscar Wilde, la critique peut se révéler un art, même un art majeur, à condition que celui qui en est l'auteur soir un artiste au plein sens du terme. A vous de voir !

Lettres d'Angleterre, Karel Capek, traduit du tchèque par Gustave Aucouturier, Ibolya Viràg /La Baconnière, 184 p., 12 euro.
Karel Capek (1890-1938) a été l'une des figures littéraires les plus significatives de l'entre-deux-guerres, de la naissance de la République tchécoslovaque, jusqu'à l'annexion des Sudètes par l'Allemagne. Il se suicide alors, conscient du sombre destin qui attend son pays. Cet ami personnel du président Masaryk a fait partie des groupes d'avant-gardes qui ont commencé à s'affirmer au cours des années 1910. Et il n'a pas seulement été l'inventeur du mot « robot », apparu dans sa pièce R.U.R. (ensuite reprise comme opéra par Janacek). Il écrit de nombreux romans, dont la Fabrique d'absolu et la Guerre des salamandres, mais aussi de nombreux livres de voyages (dans le nord de l'Europe, en Italie, etc.). Il a aussi été le traducteur de Guillaume Apollinaire. Ses Lettres d'Angleterre, publiées en 1924, diverge de tous les livres anciens ou contemporains de voyages : il a choisi d'adopter une vision naïve et sans préjugés, qui porte bien sûr à rire, mais qui lui permet de faire des observations aussi judicieuses qu'iconoclastes sur le monde britannique. C'est peut-être quelque chose qui l'apparente un peu à Mark Twain qui lui, cependant, versait plus dans la caricature et l'ironie cinglante dans ses récits de voyage. On se délecte à le voir parcourir Londres de long en large, décrivant les rues qu'il parcoure et la circulation, en s'arrêtant longuement à Hyde Park, en évoquant l'institution des clubs et en visitant en détail le Natural History Museum. S'il ne nous raconte pas ses longues visites dans les grands musées conservant des chefs-d'oeuvre de l'art universel, c'est pour tirer une leçon plus générale de cette boulimie extrême de ce pays pour les collections. Il faut absolument lire ce chapitre intitulé « Le Pèlerin visite d'autres musées » : c'est une méditation plutôt caustique sur ce besoin irrépressible de posséder tous les trésors du monde, de la peinture de Rembrandt aux masques de la Côte-de-l'Or. Et cela se termine par une considération sur la vision que le visiteur peut avoir de l'architecture de cette grande métropole : l'antithèse de ses ambitions muséographiques ! Ce livre fait partie des petits bijoux que le bibliomane ne peut s'empêcher de mettre en première file sur un rayon même très surchargé !

J. C. Oates, sous la direction de Caroline Marquette & de Tanya Tromble-Giraud, Editions de L'Herne, 328 p., 33 euro.
Dahlia noir & rose blanche, Joyce Carol Oates, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christine Auché, Points, 384 p., 8 euro.
Sacrifice, Joyce Carol Oates, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Claude Seban, Points, 8 euro.
Joyce Carol Oates est née en 1938 dans le New Jersey. Elle se passionne très tôt pour la littérature et passe très vite de Lewis Carroll à Dostoïevski. Elle commence à écrire alors qu'elle n'a que quatorze ans. Sa grand-mère lui offre alors une machine à écrire. Elle commence à produire des romans quand elle suit ses études à l'université de Syracuse. Puis elle s'inscrit à l'université du Wisconsin à Madison et se marie peu après. Une fois diplômée, elle commence à enseigner d'abord au Texas, puis au Canada, enfin à Princeton, où elle reste jusqu'en 2014. Mais elle a publié que plus tard, en 1963, avec un recueil de nouvelles intitulé By the North Gate et son premier roman n'est imprimé qu'en 1967 : A Garden of Earthly Paradise (en français, le Jardin des délices). Après quoi, elle accumule les romans, certains organisés par cycle et se consacre aussi au théâtre, signe d'innombrables nouvelles, aussi des livres pour enfants, écrit des essais sur la littérature, et compose même des romans policiers sous divers pseudonymes. Elle est sans nul doute l'écrivain le plus prolifique de son pays au XXe siècle ! Ce nouveau Cahier de L'Herne contient d'ailleurs un grand nombre d'inédits, dont neuf nouvelles et plusieurs essais dont un sur la poésie et un autre sur Bob Dylan. Le plus intéressant est sans doute les témoignages qui sont réunis dans ce volume, car si on peut lire une grande partie de son oeuvre en français, on sait assez peu qui elle est. La rencontre avec son biographe, Gavin Cologne-Brookes est relatée par ce dernier avec beaucoup d'esprit et parfois un certain humour. Le personnage est assez déconcertant. Un de ses anciens élèves nous apprend comment elle était comme professeur et cela est tout à fait intéressant. Beaucoup sont surpris par le contraste flagrant entre sa vie et ce qu'elle dépeint dans ses livres. Et tous note sa pénétration de la psyché humaine. C'est d'ailleurs ce qui fait la singularité de son entreprise : ses proses sont une souvent une sorte de transcription de théories psychologiques ou d'études psychanalytiques (la plupart du temps, c'est le développement, presque en roue libre, d'un flux de conscience même à travers plusieurs personnages). Et puis on découvre également qu'elle a des passions inattendues, comme celle de la boxe, qu'elle adore : elle a d'ailleurs écrit un livre sur ce sujet en 1987, On Boxing. Etrange auteur, qui a pu à la fois recevoir le National Award Price et le Bram Stocker Price ! Quiconque est passionné par sa littérature trouvera dans ce riche volume de quoi alimenter sa curiosité à une époque où l'on voit de moins en moins paraître d'essais sur nos contemporains. Les hasards de l'édition voient la parution en format de poche de deux grands livres de Oates. Le premier est Dalhia noir & rose blanche, paru en 2010. C'est un de ses livres noirs. Il est composé de onze nouvelles. L'histoire tragique de la petite actrice débutante, Betty Short, originaire de l'Oklahoma, semble devoir connaître un destin comparable à celui de Marylin Monroe. Les deux starlettes sont amies, mais aussi rivales. La fin de l'intrigue reste ambiguë car la futur Marylin la croit morte. Toutes ces histoires sont placées à l'enseigne de la mort qui plane et des déplaisirs de la vie. Une catastrophe fatale n'est jamais loin ! Dans Sacrifices (2015), elle s'est concentre sur la révoltes des Afro-Américains, sur la discrimination dont ils sont toujours l'objets, sur la violence féroce des policiers blancs à leur égard. Tout part des violences infligées à une jeune fille, Sybilla Frye, frappée et violée. Elle accuse des agents de police. Comme l'enquête m'avance pas d'autant plus que Sybilla ne veut pas témoigner ou porter plainte , la révolte gronde dans les quartiers noirs de Pascayne dans le New Jersey. Ce livre relate, en passant d'une époque à l'autre, des grandes émeutes noires qui ont défrayé la chronique. Il faut reconnaître que c'est une oeuvre puissante, où l'auteur prend fait et cause pour la communauté noire par le biais de cette sordide affaire.
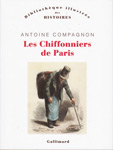
Les Chiffonniers de Paris, Antoine Compagnon, « Bibliothèque illustrée des histoires », Gallimard, 500 p., 33 euro.
Antoine Compagnon est un des grands esprits de notre époque. Et pourtant, il ne fait pas des effets de manche et ne court pas après les sujets à la mode. Ce livre le démontre amplement. C'est un petit bijou de recherche (mais de grande dimension !), où il conjugue à merveille l'histoire, la sociologie, la poésie et l'art. Il a choisi d'évoquer la figure du chiffonnier (qui n'a d'ailleurs pas tout à fait disparue, mais qui devient très rare), qui est un personnage qui existe depuis le Moyen Age et dont la mythologie urbaine culmine au XIXe siècle. On l'a souvent regardé avec bienveillance ou une certaine compassion, mais on n' a pu s'empêcher de le lier à la bourbe et à la boue étant donné l'exercice de sa profession. Les grands poètes d'alors, comme Baudelaire et Victor Hugo l'ont dépeint. Ce dernier a même souligné l'utilité e son métier pour la vie des hommes dans les Misérables. Champfleury s'y est également intéressé. Les artistes, comme Gavarni, Daumier, Charlet, Vernet, Boily, Traviès, pour ne citer qu'eux, l'ont dépeint. Dans l'ensemble on ne le perçoit pas comme un mauvais bougre, pas en tout cas comme dans le film Les Enfants du paradis, où le marchand d'habits est un Juif très méchant qui n'apporte que le malheur (le film a été tourné sous l'Occupation pour la société Continental - curieuse concession aux stéréotypes raciaux de Vichy et des Allemands). Compagnon explore les rues d'autrefois, recherche dans les écrits ce qu'on en pensait (Sébastien Mercier est très présent dans ces pages, tout comme restif de la Bretonne). L'auteur se transforme en piéton de Paris, à l'égal de Léon-Paul Fargue, en quête de ces personnages à la fois familiers et pittoresques. La chiffonnerie retrouve ses lettres de noblesse, mais aussi sa misère insondable. Et il ne cesse d'élargir le cercle de ses investigations : il parle de ceux qui 'emparaient de cadavres pour les salles de dissection, ou des animaux domestiques pour les expériences scientifiques, ou pour leur peau en ce qui concerne les chats. Nous découvrons alors l'univers des équarisseurs. Puis il revient à nos chiffonniers et en dresse la typologie :il y avait le malfaisant, le grognard, le mouchard et aussi le philosophe (cela se voit surtout au théâtre), mais aussi le travailleur utile à la salubrité des villes modernes, qui a fini par obtenir un statut. On l'a aussi associés à l'esprit révolutionnaire ou à d'anciens soldats, comme l'affirmait Jules Vallès. Compagnon nous invite, pour mieux comprendre ce personnage, à relire Balzac ou à se souvenir du grand mine que fut Deburau. En somme, des rues de Paris, le chiffonnier est monté sur scène, a joué un rôle dans l'histoire (comme Félix Pyat) et a été transformé par les grands écrivains en êtres héroïques. L'ouvrage d'Antoine Compagnon est une vraie mine d'érudition, mais avec cette qualité rare : il nous entraine d'une part à comprendre un métier des bas-fonds, mais aussi à en comprendre toutes les légendes, négatives ou positives. Il sait partager avec ses lecteurs le plaisir de ses découvertes. C'est un grand livre sur de petites gens.

De l'aborigène au zizi, Bruno Dewaele, « Le goût des mots », Points, 4oo p., 8,2o euro.
Au secours ! les mots m'ont mangé, Bernard Pivot, « Le goût des mots », Points, 98 p., 5,60 euro.
Les dictionnaires sont pour moi une source de délectation. Celui-ci ne fera pas exception, car il est fort intéressant. En effet, il catalogue des mots qui ont changé de sens, où qui sont employé mauvais escient, ou même qui ont complètement changé de sens. Les plaisantes explications fournies par Bruno Dewaele, merveilleusement rédigées, sont très détaillées et souvent divertissantes, tout en restant sérieuses. Il explique comment l'adjectif improbable s'applique depuis quelque temps des situations de plus en plus diversifiées, qui n'ont rien voir avec son sens premier. Il fait souvent preuve d'un humour certain quand il parle de la question du fond(s) de caisse : aucun dictionnaire ancien ou moderne ne donne la raison de ne pas écrire fonds de caisse, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire : il avance l'hypothèse que comme il s'agit d'argent, on parle de fonds et non du fond tangible de la caisse ! Que dire de l'usage abusif de « grandes pompes » ? Il nous avertit aussi de certaines comme celui de « chose(s) » dans des expressions familières. Chose doit rester au singulier. Mais il y a des cas où le mot devient un adjectif et pourrait alors prendre un s la fin. L'article sur pataquès est très drôle car il permet d'exhumer une série d'emplois abusifs. En somme, ce « manuel » se lit comme une suite de nouvelles bien conçues qui ont pour objet principal la langue écrite et parfois parlée. On aimerait beaucoup que Bruno Dewaele poursuit cette oeuvre salutaire et joyeuse pour se retrouver dans la langue sans trop l'écorcher... C'est digne de Bouvard et Pécuchet dans un genre un peu différent, et aussi une excellente façon de se réformer et d'apprendre mieux s'exprimer.
Le petit récit de Bernard Pivot était à l'origine destiné au théâtre. Mais il est tout à fait plaisant comme prose. Il nous raconte l'histoire d'un écrivain, depuis les temps de l'école jusqu'aux heures de sa réussites dans la République des Lettres. Depuis sa tendre enfance, il aimait les mots et avait confiance dans leur soumission à sa volonté une fois qu'il les avait domptés. Mais une fois qu'il a remporte le prix Goncourt, il lui vient le désir de raconter son histoire, sans mentir et aussi de prendre la mesure de la relation avec le langage, dont il semble maîtriser tous les secrets. Il note les tics et les répétions, et toutes les formes curieuses dont un écrivains est affligé parce qu'il n'est pas le vrai deus ex machina de sa littérature, car il est dominé par tous ces vocables qui le dépassent et qui aiment parfois se jouer de lui. Ce petit livre est délicieux et révélateur de la relations perfide que l'écrivain entretien avec son matériau, qui n'est pas un matériau comme les autres car il est un élément de la pensée. A méditer.

Rolandin, Rémi Usseil, Les Belles Lettres, 218 p., 26,90 euro.
Rémi Usseil est un écrivain très singulier et attachant. C'est un passionné et un grand connaisseur de littérature médiévale française. Il n »'ignore pas qu'il est impossible pour un lecteur moderne de s'y plonger sans se trouver face au mur de la langue : ce n'est pas comme le toscan de Dante, qui demeure à peu près lisible pour un écolier italien. Là, il faut apprendre la langue d'oïl et la langue d'oc de nos aînés. Alors lui est venu l'idée de rendre accessible ce vaste continent mal connu non en le traduisant Lemieux possible (ce qui n'aplanie pas toutes les difficultés !), mais en recherchant les nombreuses versions (parfois aussi en langues étrangères) de l'existence et des exploits d'un héros ou des faits et gestes d'une grande reine comme il l'a fait avec Berthe au grand pied. Il s'est intéressé à la jeunesse de Charlemagne avec les Enfances de Charlemagne (2015) et aujourd'hui il nous fait découvrir les jeunes années de Roland, sans doute le premier grand homme de l'ère des Francs, Roland : la Chanson de Roland est l'un des premiers textes qu'un enfant dont étudier et apprendre. Ce texte est considéré comme le premier chef-d'oeuvre dans notre langue. C'est la fin tragique de ce preux chevalier, qu'on dit victime de l'attaque par surprise des Arabes dans la gorge de Roncevaux, alors qu'il s'agissait en fait des Basques, qui voulaient se venger de la mise à sac de la ville de Pampelune ! Mais un siècle avait passé depuis les événements et l'on préparait la première croisade quand ces vers ont été couchés sur le papier. Ici, Rémi Usseil nous fait découvrir les premières années de Roland, qu'on appelait Rolandin, fruit des amours de Milon, le duc d'Anjou, et de Gisèle, la sur de Charlemagne. Ce dernier est furieux et les amants doivent fuir très loin. Il voit le jour quand ses parents se cachent en Italie. Ses premières années ne sont pas faciles car son père se fait passer pour un simple bûcheron ! Mais bientôt son caractère bien trempé s'affirme et peu de choses lui font peur. Les différents auteurs qui ont écrit en prose ou en vers ses aventures de ce gamin qui a déjà l'esprit d'un chevalier. A la fin, le bon Charlemagne pardonne à sa soeur et à son vassal et Roland reçoit la fameuse épée Durendal. Le livre procure une grande joie au lecteur et, de surcroît, il est illustré d'enluminures de l'époque en relation avec cette histoire

Conférences et discours, 1936-1958, Albert Camus, Folio, 334 p., 7,70 euro.
Le Discours de Suède, Albert Camus, Folio, 96 p., 5,40 euro.
Les essais et les conférences d'Albert concernent surtout le roman ou le théâtre, quand ils n'abordent des sujets plus vastes. Il ne semble pas s'être beaucoup passionné pour la peinture ou pour tout autre forme de création artistique. C'est tout le contraire de Jean-Paul Sartre, qui a aussi bien écrit sur le Tintoret que sur Alberto Giacometti, avec un indéniable bonheur d'écriture. En revanche, Camus est revenu à plusieurs reprises sur la position de l'artiste dans la société, de l'engagement de l'écrivain en général. Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de la remise du prix Nobel de littérature en 1957, Assez étrangement, il fait de son métier (il le nomme ainsi) un « art » et revendique la liberté d'expression. Ce discours est très décevant, car c'est une sorte d'autobiographie un peu désabusée, et non un plaidoyer vibrant pour le roman et toutes les modes de création. Dans un entretien avec M. Papanoutsos, deux ans plus tôt, il a avancé des théories sur la liberté fondamentale de l'artiste et aussi sur la vérité de son art, quel qu'il soit. Mais il veut absolument embrasser des questions d'ordre politique, comme celle de la justice. Et là, surtout quand il parle de l'Europe, il se révèle incapable d'avoir une vision d'ensemble et encore plus d'une utopie. Il se montre prudent et vertueux. Il défend les libertés, toutes les libertés, la souveraineté, et doute de l'avenir de l'Europe. Et quand il parle de la liberté de l'artiste, il la voir comme une liberté relative, prenant exemple sur les dictatures, où seul le tyran connaît la liberté absolue. En somme Camus n'a jamais pu développer qu'un existentialisme mou, un idéalisme assez formel et des idées séduisantes, mais qui n'ont pas de prise sur la réalité, qu'un engagement assez formel, que des opinions mais sans beaucoup de force par rapports aux enjeux de son temps -, celui de la guerre froide.

Construire un feu, Jack London, lu par Julie Sicard « Ecoutez/lire », Gallimard, 12,90 euro.
Ce récit puissant de Jack London nous ramène au temps de notre enfance ! Je dois dire ne plus avoir relu cet auteur merveilleux depuis cette époque ! C'est un tort ! Jack London est un maître que peu de monde a su égaler et cette aventure, si bien lue par Julie Sicard (a priori, on imagine mal une femme évoquer si bien ce monde si rude et plutôt viril !). Il sait encore nous enchanter et je crois que c'est un tort d'en réserver les plaisirs aux seuls aventuriers qui sont allés jusqu'aux confins septentrionaux enfants. C'est un préjugé dû au genre que l'écrivain a choisi. Il est aussi vrai que le monde sauvage qu'il a dépeint avec tant de force n'a pas tout à fait disparu, mais il n'est plus ce qu'il a été quand il a écrit cet ouvrage. Mais comment ne pas être sensible au destin de ces rudes de la planète avec l'espoir d'y découvrir leur Eldorado dans un monde presque totalement vierge que la civilisation n'a pas encore pu rejoindre. C'est une merveille que l'actrice a très bien su nous restituer avec beaucoup d'émotion.

Poèmes, Victor Hugo, lu par Nicolas Lormeau, « Ecouter/lire », Gallimard, 12,90 euro.
Victor Hugo est devenu un tel géant de notre littérature, qu'on a fini par le négliger. On lit encore quelque roman ou ses écrits de caractère politique. Mais sa poésie, qui a été si populaire, n'a plus cette primauté qu'elle a longtemps eue. C'est d'ailleurs normal, car la morphologie et la finalité de l'art poétique ont bien changé depuis le début du siècle précédent. Sa stature est tellement imposante, qu'elle a fini par impressionner et, paradoxalement, à être de moins en moins fréquentée. Et pourtant ! Cet homme qui écrivait cent vers tous les matins avant de déjeuner, a laissé des textes fabuleux. La lecture brillante que fait Nicolas Lormeau de poèmes tirés des Châtiments, de la Légende des siècles et des Contemplations parvient à nous redonner toute l'émotion qu'ils devraient inspirer à ses lecteurs et, dans ce cas, à ses auditeurs. Hugo possédait un sens de l'invention verbale, une capacité de produire des images saisissantes, éblouissantes, inattendues. C'est une machinerie textuelle d'une grande subtilité et d'un effet imparable. Si vous n'avez plus lu Victor Hugo depuis des lustres, procurez-vous ce disque et écouter l'acteur redonner à ses vers leur splendeur et leur étrangeté parfois. Il ne faut jamais oublier que cet écrivain a été un immense visionnaire et pas seulement un maître de la langue et de la rime. Il ne nous intéresse pas pour ses prouesses et sa capacité de dompter les mots, mais aussi et surtout pour sa représentation du monde, parfois tendre, parfois terrible.

Deux messieurs sur une plage, Michael Köhlmeier, traduit de l'allemand par Stéphanie Lux, Babel, 336 p., 8,70 euro.
Je dois saluer l'habilité de l'auteur et aussi sa roublardise : il a eu en effet l'idée de faire se rencontrer deux monstres sacrés du XXe siècle : Winston Churchill et Charlie Chaplin. Ces dialogues improbables sont composés avec une grande habilité car ils ont non seulement crédibles, mais aussi révélateurs de la personnalité complexe de ces deux êtres d'exception qui ont marqué si profondément leur époque. Köhlmeier et de retracer une partie de leur carrière. L'action commence avant guerre, au début des années 30 . Churchill n'a plus d'emploi, et il se consacre à la rédaction de la vie de son grand ancêtre, John, premier duc de Marlborough. Chaplin est alors acclamé à Londres lors de la sortie de son nouveau film ; Les Feux de la rampe. Les deux hommes se rencontrent en Californie et une étrange amitié se noue entre eux. Leurs relations, assez distendues, mais néanmoins profondes, permettent à l'auteur de montrer toutes les facettes de chacun d'entre eux. Charlie Chaplin a renié Charlot qui a fait sa gloire et Churchill attend son heure en rongeant son frein et en faisant de la peinture. Chaplin déçoit de plus en plus son auditoire. Ses films sont jugés trop simplistes et mielleux, tout le monde regrette sa figure mythique du vagabond. Quant à Churchill après avoir peu brillé comme chancelier de l'Echiquier il fait une très longue du désert. La guerre vont redonner un poids à ces deux personnages : Chaplin crée Le Dictateur et Churchill prend en main de destin de la Grande-Bretagne et l'incarne dans sa résolution à ne pas céder devant l'adversité. Cela donne un roman qui n'est pas désagréable à lire, tout au contraire, mais dont on découvre trop vite les ficelles.
|
