
La Villa des Mystères à Pompéi, Paul Veyne, « Art & Artistes », Gallimard, 92 p., 21 euro.
Ce livre vient à point nommé pour deux raisons. La première est liée à la situation désastreuse du site de Pompéi, où l'on a vu s'écrouler des constructions récentes pour le protéger ; l'état de certains bâtiments antiques est désastreux et bien des fresques sont en piteux état. La seconde concerne certaines certitudes sur les peintures retrouvées, dont celle de la Villa des Mystères, exhumées en 1911 : comme la figure de Dionysos y est présentes, les spécialistes de l'époque en ont fourni une interprétation que tout le monde a ensuite repris sans jamais s'interroger sur leur exactitude. Paul Veyne a donc décidé d'examiner ces quelques vingt mètres remarquablement conservées. Avec beaucoup de perspicacité, en s'appuyant sur le mode de vie et les croyances des Latins du Ier siècle de notre ère, il a constaté qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une représentation de caractère religieux malgré la présence du dieu. Il s'agit d'une scène de préparatifs de mariage, qui est figurée avec des codes spécifiques aux moeurs des riches habitants de la ville, les festivités qui l'entoure, la consommation du mariage et la purification qui s'en suit. En fait, on a tiré des conclusions hâtives en comparant ces figures à celles qu'on a retrouvé en Grève où pendant une période plus ancienne à Rome. L'auteur examine chaque figure avec soin, décrit sa manière de s'habiller et sa fonction sociale, tente d'établir ses relations avec les autres participants de cette cérémonie. L'auteur a préféré choisir comme point de comparaison Les Noces Aldolbrantines, qui remontent au Ier siècle avant notre ère et qui sont conservées au Vatican. Il étudie aussi le sens des mystères de l'Antiquité latine et minimise leur portée. En somme, ce livre se transforme à travers cette analyse en une exploration des croyances des Romains, qui se révèlent assez éloignées de celles des Grecs et qui ont perdu beaucoup de leur puissance au sein de cette société » plutôt pragmatique et peu portée au mysticisme. C'est absolument passionnant et nous dévoile, au-delà de l'interprétation de la Villa proprement dite, des aspects mal connus du paganisme qu'il faut désormais lire d'une toute autre façon.
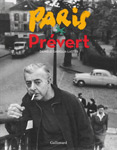
Paris Prévert, Danièle Gasiglia-Laster, Gallimard, 256 p., 39 euro.
Pour quelqu'un de ma génération, c'est le livre de toutes les nostalgies, a condition, bien sûr, d'avoir passé son enfance à Paris. Le Paris de l'après-guerre était bien différent de celui d'aujourd'hui. Les façades étaient noires, les rues sombres le soir, il y avait des bornes avec un téléphone pour appeler la police, des pissotières malodorantes, des hôtels borgnes en pagaille, des marchands de quatre saison, des camelots, des vendeurs itinérants, des chanteurs des rues, des zones industrielles assez décrépites et de grands cinémas avec des attractions à l'entracte. Le Paris de Prévert était déjà le vieux Paris, qui vivait ses dernières années avec le charme un peu triste des choses surannées qui vont disparaître. Dans ce merveilleux album, on découvre son univers, les lieux qu'il aimait au bas de la Butte Montmartre, une atmosphère qu'on retrouve dont les frères Prévert avaient écrit le scénario, comme Les Portes de la nuit, qui a été l'un des derniers films dans l'esprit du réalisme magique qui a triomphé jusque pendant l'Occupation avec Les Enfants du Paradis (1943) produit par la Continentale, société de production germanique. C'est une vraie caverne d'Ali Baba du souvenir avec de nombreux collages de Prévert (dont je conserve encore les catalogues remontant aux années soixante !), des photographies de Doisneau ou d'Izis, des portraits de ses amis, de Marcel Duhamel à Juliette Greco, de Robert Desnos à Yves Tanguy. C'est tout à la fois une biographie de Jacques Prévert (et aussi de son frère Pierre), un voyage dans le Paris surréaliste pendant les années trente, et puis ce Paris qui n'a pas sauté comme l'aurait voulu Adolf Hitler quand les troupes allemandes sont parties après les combats de la Libération. Les commentaires apportés par l'auteur sont judicieux, car ils éclairent des vues qui ne sont pas forcément parlantes à tous, et des personnages ou des situations qui appartiennent déjà à l'histoire lointaine. C'est ce genre de livre qu'on aimerait trouver plus souvent, plein de documents, avec des commentaires utiles et plusieurs histoires qui s'entrecroisent. C'est un superbe hommage à Prévert et en même temps un superbe hommage au Paris d'autrefois. Je n'imagine un lecteur qui n'aille pas en pèlerinage cité Véron, là où Prévert a fini ses jours !

Une affaire personnelle, Kenzaburô Ôé, traduit de l'anglais par Claude Elsen, Folio, 224 p., 7,10 euro.
Kenzaburô Ôé, d'homme révolté contre les aspects les plus rétrogrades de la société japonaise, chroniqueur des réactions qui en résultent, apôtre de la paix après la tragédie d'Hiroshima et de Nagazaki, a fini par devenir le scrutateur obstiné de tous les défauts qui taraudent la mentalité nippone. Ce livre est fait partie de cet aspect de son oeuvre qui n'est pas la meilleure. Il raconte l'histoire d'un couple qui a eu le malheur d'avoir un enfant anormal. Cette naissance met le mari, Bird, un homme de vingt-sept ans, dans un état de malaise profond et même de désarroi. A travers les relations du couple, on voit que la société de ce pays s'est prodigieusement transformée après la guerre, et pas seulement dans les apparences -,mais jusqu'au fond des âmes. Pendant qu'à l'hôpital on s'interroge sur l'avenir du nouveau-né, Bird vit avec Himiko une relation adultère qui n'est pas des plus heureuses. Difficile de comprendre d'ailleurs si les deux récits s'emboîtent bien chronologiquement. Ses inhibitions sexuelles semblent faire écho à sa détresse infinie à l'hôpital devant le corps de son enfant. A la fin, il finit par souhaiter la mort de cet enfant dont les médecins ne savent que faire -, l'opérer ou non ? En fin de compte, il accepte cet enfant. Mais le cheminement pour arriver à cette décision a été long et tortueux.

M/T et l'histoire des merveilles de la forêt, Kenzaburô Ôé, traduit du japonais par cRené de Ceccatty & Ryoji Nakamura, Folio, 448 p., 8,20 euro.
C'est sans doute l'un des plus beaux livres du prolixe prix Nobel de littérature 1994. Sans doute parce qu'il a recours au fantastique pour imaginer une fable, qui est une immense fresque peuplée d'une foule de personnages extravagants. Tout commence par un conte que la grand-mère veut raconter à son petit-fils, mais en introduisant l'ombre d'un doute : celle-ci peut être vraie, mais elle peut aussi être fausse. Et l'enfant accepte le jeu sans réticence. A l'école, il doit représenter le grand Japon de l'ancien empereur Hiro-Ito. Cette carte, il la transforme et installe, en lieu et place de la figure impériale, un territoire qui est celui de la vallée dans la forêt. Là il installe une géante, Oshikomé et un petit être malicieux, Meisuké, qui ne la lâche pas d'une semelle. Quant au petit garçon, il s'introduit dans ce monde imaginaire en adoptant la lettre T. Tout devient vite étrange : le groupe d'aventuriers qui avait pris la mer remonte un fleuve et décide de brûler les vaisseaux. Une fois débarqués ces solides gaillards se changent en des vieillards qui deviennent des figures gigantesques. Ils sont là, énormes et entourés de tous leurs descendants. Surgit un être maléfique, connu sous le nom du « destructeur ». Puis tous ces personnages s'évanouissent dans le néant. IOshikomé prend possession du village qui vivait paisiblement de la fabrication de la cire et y impose sa « Restauration », un régime tyrannique qui va appauvrir tout le monde. Tout un coup, on passe à une autre époque, celle de la guerre qui va opposer les derniers samouraïs et le Shogun. Cette fois c'est Meisuké qui mène la danse en fomentant la révolte des paysans, qui est brutalement réprimée. Il va être emprisonné et se donne la mort. Ainsi le récit nous fait sauter les années et nous amène à la période nationaliste où les campagnards cachent des déserteurs. Les habitants du cru rompent le barrage et noient les soldats venus les réprimer. A travers tous ces épisodes, l'écrivain nous relate à sa façon l'histoire du Japon, d'une manière discontinue et fantasque, mais sans jamais oublier les souffrances endurées par le peuple. C'est un livre qui mérite de figurer dans la bibliothèques des amants du l'art romanesque.

Les Luminaires, Eleanor Catton, traduit de l'anglais (Nouvelle Zélande) par Erika Abrams, Folio, 1244 p., 13,50 euro.
Cette oeuvre de fiction d'une dimension inusitée est d'abord un roman d'aventures qui retrouve l'esprit de ceux qui ont été écrits par le passé. Ce n'est pas un pastiche ou une adaptation moderne des formes du XVIIIe ou du XIXe siècle. Il est vrai que l'auteur a voulu retrouver ce qui faisait le charme, l'émotion et la beauté de ses grands précurseurs. Mais Eleanor Catton a trouvé Le sujet ? La ruée vers l'or qui est comparable à celle qu'a connue la Californie et qui débute dans ce lointain pays en 1866. Un héros ? Walter Moody qui, comme tant d'autres est venu tenter sa chance et espère faire fortune. Il se retrouve dans la petite ville portuaire de Hokita et il est rapidement mis au courant d'événements peu ordinaires Des indigènes lui fournissent des informations, puis il est mis au courant d'une cachette où l'on a trouvé une importante quantité d'or chez un poivrot invétéré. Un de ces prospecteurs à qui la chance a souri, a disparu mystérieusement. Une prostituée, Anna Wetherell, est retrouvée inconsciente au beau milieu de la route. Un petit groupe d'hommes sont résolus à comprendre ce qui se passe et s'allient dans ce but. Ils sont d'origines diverses. Leurs histoires se développent alors en même temps que celle de Moody et ce n'est qu'à la dernière page que tout finit par s'éclairer. Bien sûr, cette fiction est cousue de fil blanc. Mais on se laisse assez vite prendre au jeu, car on retrouve les plaisirs qu'ont pu nous fournir dans notre enfance l'Ile au trésor ou les Mutinés du Bounty. En dépit de son extrême longueur, le récit ne connaît pas de périodes ennuyeuses ou boursouflées. C'est l'anti Nouveau Roman par excellence, un livre plein de cette nostalgie d'une littérature qui vous tient en haleine et vous fait rêver. Il faut le reconnaître : c'est très bien fait. Est-ce une grande oeuvre ? Sans doute pas, car il n'y a aucune invention dans ces pages. Mais ce n'en reste pas moins un livre distrayant, bien fait, qui donne un immense plaisir de lecture.

Martin Eden, Jack London, traduit de l'anglais et présenté par Philippe Jaworski, Folio classique, 592 p., 7,10 euro.
Martin Eden est le livre le plus connu de Jack London (1876-1916). Il a paru en 1909 aux Etats-Unis et a connu un grand succès à l'époque. Ce succès ne s'est jamais démenti. C'est l'histoire d'un tout jeune homme d'Oakland qui veut échapper à sa condition sociale peu avantageuse (c'est un mousse) et qui s'efforce aussi de se faire une éducation. Et dans quel but ? Eh bien, devenir un homme de lettres. On peut donc imaginer que cet ouvrage est en grande partie autobiographique. Mais le véritable but est de parvenir à se rendre agréable aux yeux d'une jeune fille de la bonne bourgeoisie locale, Ruth Morse. Il lui fait la promesse de réussir dans un délai de deux ans. Mais Ruth n'a pas la patience d'attendre tout ce temps en dépit des efforts considérables de son soupirant et surtout sa famille est résolument opposée à cette union dégradante. L'histoire est plus complexe, car d'autres figures apparaissent, comme celle de Lizzie Connoly ou encore celle de Russ Brissenden, un écrivain socialiste, qui pourrait être une autre facette de Jack London. Alors Martin Eden s'embarque et navigue dans les mers du Pacifique. Dans ces pages, London parvient à allier une méditation sur le métier d'écrivain (sous tous ses aspects, des plus nobles aux moins glorieux) et un roman d'aventures -, l'aventure étant d'abord l'idée du voyage vers des terres lointaines. C'est vraiment un beau livre, curieux, et encore prenant plus d'un siècle après sa parution. Enfin, il ne faut pas oublier que quand il a écrit ce livre, Jack London est déjà célèbre pour ses nouvelles et ses romans.

Requin, Bernard Belin, Folio, 160 p., 6,50 euro.
Ce roman est le fruit d'une grande ambition de la part de Bernard Belin, d'une part métaphysique, puisqu'il entend nous exposer à la fois l'existence du héros et ses considérations sur la mort et de l'autre littéraire, car il a voulu associer une narration « classique » a une autre modalité qui a pour objet d'expliquer les différentes façon d'aborder la mort. L'auteur est sans aucun doute parti de l'idée reçue que lorsque la mort survient, on se remémorerait l'intégralité de sa vie dans ses phases essentielles. Voire ! Les truismes ont la peau dure ! Mais rien ne peut évidemment en apporter la preuve. Admettons que les choses se passent ainsi, l'homme qui va mourir se remémore plusieurs fois et de façons différentes les étapes de cette existence qu'il veut quitter en se jetant dans le contre-réservoir de Grosbois qui sert depuis le début du XIXe siècle à alimenter le canal de Bourgogne, devenu un lac artificiel depuis lors. Le lieu est symbolique sans doute, mais on ignore de quoi. Par ailleurs, le récit débité savamment par fragments est saturé de réflexions qui se veulent hautement philosophiques et qui sont surtout des belles phrases. Et le livre en regorge de belles phrases pour une histoire souvent métaphorisée (la pèche des douze litres de lait, par exemple), comme si un roman devait être une sorte de petit Ainsi parlait Zarathoustra ramené sur le plan de la vie commune de tout un chacun. Cela dit, il faut reconnaître que ce n'est pas mal fait et que l'auteur sait bâtir sa curieuse fiction avec un certain métier. A ce métier incontestable, peut-être aurait-il fallu une autre dimension, celle de l'art.

Le Pays que j'aime, Caterina Bonvicini, Gallimard, 320 p., 20 euro.
Curieux retour au réalisme ! C'est comme si Manganelli, Gadda, Savinio, même Calvino n'avaient jamais existé ! On revient - et c'est une tendance assez diffuse - à une forme sage, plus proche de Pavese et de Moravia que des extravagances de Malaparte. Ce livre en témoigne amplement avec son écriture sage, sa construction classique et même son histoire bien ficelée avec des oppositions bien tranchées. Nous découvrons deux enfants qui grandissent ensemble. Olivia est une riche héritière d'une famille puissante de Bologne (les Morganti) alors que Valerio est le fils de leur jardinier. Les deux enfants entretiennent des liens très forts et si les aléas de l'existence les séparent parfois, ils finissent par se retrouver. Valerio part à Rome avec sa mère ; Olivia va étudier à Paris. Malgré tout ce qui peut les unir depuis si longtemps, ils ne parviennent pas à se rejoindre. Le parcours de Valerio est pourtant méritoire, car il fait d'excellentes études et rêve d'entrer dans la magistrature. Olivia, elle, ne trouve jamais vraiment sa voie. A l'arrière plan de cette affaire, l'Italie depuis les Années de plomb jusqu'à une date récente, avec la fin de la Ière République et la naissance jamais promulguée de la Seconde marquée par Berlusconi et son parti Forza Italia, la fin du parti communiste qui devient un parti social-démocrate (PD) et l'extrême droite (MSI) qui se métamorphose en un parti des plus corrects. C'est une gentille chronique familiale et socio-historique que la presse semble avoir bien appréciée parce qu'elle ne présente aucune originalité littéraire et résume à gros traits les tribulations d'un pays de manière un peu superficielle, il faut bien le dire. Faisons une comparaison avec un livre de forme « classique » comme le Jardin des Finzi-Contini de Giorgio Bassani ; publié en 1962, et faisons la comparaison. On voit bien alors qu'il manque un fil d'Ariane fort à cette fiction qui, par ailleurs, n'est pas mal troussée.
Carthage, Joyce Carol Oates, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Claude Seban, 352 p., 7,50 euro.
En lisant ce roman de Joyce Carol Oates, les mêmes sentiments contradictoires se font jour : d'une part une admiration pour cet écrivain américain, qui manie si bien la langue et sait aussi construire des intrigues complexes avec un don indéniable, de l'autre, on est gêné par l'aspect pléthorique de son histoire. Elle l'a fait depuis ses débuts et peut-être que son succès ne l'a pas rendu consciente de cette complaisance. Quant à Carthage, je dois dire que l'histoire est belle : une jeune fille (Cressida Mayfield) disparaît dans la petite ville de Carthage, et personne ne la retrouve. On découvre des traces de cheveux, du sang, mais pas de cadavre. Son père, Zeno (curieux que l'auteur ait choisit ce nom qui est celui d'un héros d'Italo Svevo) est désespéré et prie le Seigneur de l'emporter à sa place. Un corps est découvert, mais ce n'est pas celui de Cressida. Le mystère s'épaissit. Ce qi fait la richesse du roman ne réside pas dans la dynamique de l'enquête qui suit la disparition de la jeune fille et les soupçon qui pèse sur son ancien fiancé, un caporal revenu de la guerre en Irak. C'est comment une vision du monde peut se développer à partir d'une petite localité comme Carthage et comment ses habitants perçoivent les choses qui les concernent de près, mais aussi le conflit au Proche Orient et le reste du monde. Oates s'avèrent une observatrice impitoyable de cette société de la fin du siècle dernier. Elle a la dureté du regard d'un Truman Capote, mais elle se perd dans les infinis méandres des mentalités dont elle se sert pour alimenter sa fiction. Est-ce à dire que ce roman est à rejeter. Loin de là. Il faut le lire, et être patient. Oates a su dire des choses fines et parfois obscures avec le ton des feuilletonistes du temps jadis ! Rien n'échappe à son investigation, pas le plus petit détail. Ce qui fait la richesse de son oeuvre -, une oeuvre digne d'intérêt et à lire quand on a pas de temps devant soi.
|
