
Hodler, Monet, Munch, peindre l'impossible, musée Marmottan Monet / Hazan, 176 p., 29 euro.
A mon avis, le sous-titre aurait dû être, étant donné la situation : l'exposition improbable. Que font ces trois peintres ensemble ? Mystère. De nos jours, on imagine des expositions avec des intitulés bizarres et des regroupements énigmatiques et parfois saugrenus. Je laisserai donc le soin au visiteur et au lecteur de ce catalogue le son de démêler l'affaire. Voyons plutôt les aspects positifs de l'affaire. Le premier est sans nul doute la présence de Ferdinand Hodler, peintre peu connus de ceux qui ne connaissent pas l'Helvétie. Il a rempli les lieux publics de son pays d'innombrables peintures murales qui racontent son histoire (souvent d'horribles massacres). Mais il a aussi fait de grands paysages, surtout les lacs cernés par des chaines de montagnes. Ces oeuvres sont vraiment somptueuses car l'artiste a choisi d'accentuer les bleus des eaux et du ciel, et mêmes les éminences rocheuses sont parfois bleues. Il y a aussi du blanc, pour les nuages et pour la neige. Et selon les cas, les saisons, la lumière, il a choisit d'ajouter une couleur qui modifie l'esprit de la toile : dans l'une un vert, dans l'autre un jaune, dans beaucoup des gris. C'est absolument superbe. Quant à Monet, nous savons qu'il a effectué un voyage en Norvège en 1895. Mais ce n'est pas ça qui peut nous expliquer le lien avec Munch. De plus, ses nombreux paysages de neige ont commencé en 1875, avec cette mise en avant de la couleur blanche qu'il n'avait pas beaucoup aimée au préalable. Cela a changé le visage de l'impressionnisme car certains de ses amis ont immédiatement suivi ses pas. Enfin, Edvard Munch, ce génial précurseur du fauvisme, aurait mérité une exposition à lui seul pour faire comprendre aux Français que ce ne sont pas Matisse, Derain et Vlaminck qui ont inventé cette manière de peindre ! Ce qui importe surtout, c'est de voir ces merveilleux paysages en particulier Cette toile, La Seine à Saint-Cloud qu'il a peinte en 1890 lors de son séjour en France. Déjà on voit les premières indications de ce qui va l'éloigner de manière définitive de l'impressionnisme et de ce qui se faisait alors en France. IL tire de l'enseignement de Manet de ses amis l'idée que la ligne et la couleur ne faisaient qu'un, dépassant ainsi tous les préjugés sur la question. Mais là où les artistes se sont arrêtés, il va plus loin, conserve la représentation, mais aboli le réalisme des coloris. D'une certaine manière, il est plus proche des Nocturnes de Whistler. Monet est revenu pus tard sur ce point avec ses Nymphéas, mais c'est plus d'une décennie après ces tentatives de Munch, qui sont très réussies. Cette exposition et ce catalogue sont critiquables. Mais, au bout du compte, peut-être sont-ils très utiles pour penser l'histoire de l'art en des termes moins manichéens et moins nationalistes.
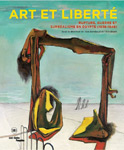
Art et liberté, rupture, guerre et surréalisme en Egypte (1938-1948), sous la direction de Sam Bardaouil & Till Fellrath, Centre Pompidou / Skira, 252 p., 35 euro.
Voilà une exposition comme on aimerait en voir plus souvent: nous ne savons pas grand chose de l'art égyptien de la période moderne. Il semble qu'il y ait eu un groupe futuriste pendant les années dix ou vingt, mais il n'y a guère de documentation sur la question. Peut-être est-ce seulement le fruit de l'imagination de F. T. Marinetti, qui est né à Alexandrie, et qui y a passé son enfance. L'idée des commissaires a été de commencer avec le mouvement surréaliste, qui a pris racine dans ce pays longtemps après la publication du Manifeste d'André Breton. L'art moderne n'était pas inconnu dans ce pays et un certain nombre d'artistes s'étaient mis à travailler dans l'esprit des peintres occidentaux. Les expositions de la Société des amis de l'art montraient les changements intervenus dans ce monde qui se trouvait loin de Paris et des grandes capitales européennes. Mais il existait en Egypte des minorités grecques, arméniennes, juives, italiennes, qui ont joué un rôle majeur dans la diffusion d'une culture nouvelle au Caire et encore plus à Alexandrie. Si le groupe Art et Liberté prend officiellement naissance en 1940 (il existait déjà quelques années plus tôt), le surréalisme a déjà profondément marqué une nouvelle génération d'artistes et d'écrivains. Georges Heinein a beaucoup contribué à la diffusion de ce mouvement à partir de 1934 par ses publications et ses conférences. C'est lui qui va être le grand passeur entre la France et l'Egypte. Ce groupe était très engagé et a sorti un manifeste en faveur de l'art dégénéré en 1938, un an après la fameuse exposition voulue par Hitler et Goebbels. Le peintre Mayo fait partie de ces artistes rebelles qui vont continuer à s'exprimer pendant le conflit, se rangeant du côté des Alliés contre les forces de l'Axe. Le surréalisme reste encore le fil conducteur de leur démarche artistique. Il n'est que de voir Jeune fille et monstre (1942) d'Inji Efflatoun. Amy Nimer a de son côté composer des oeuvres très frappantes avec des accumulations de squelettes en 1943. Tous ces créateurs arabes sont parvenus à coller à un courant d'avant-garde tout en manifestant leur identité de peintres arabes. Quant à Mayo, il a fait des corps fragmentés selon des techniques très différentes. Après la guerre, le retour à un certain réalisme n'est que très relatif. Si l'imaginaire surréaliste est moins prégnant, il reste souvent présent. Même le Groupe de l'art contemporain a une vision qui demeure largement onirique, mais en se débarrassant des excès de leurs aînés. J'épargnerai au lecteur la liste de tous ces artistes aux noms difficiles à prononcer et qui nous sont totalement inconnus. Mais je l'inciterai à aller voir cette belle exposition au Centre Pompidou qui nous apprend tant de choses, qui est très bien faite et bien installée. Le catalogue est une source d'information inestimable. Il faut se souvenir qu'on Caire, jusqu'à la chute du roi Farouk, l'élite vivait à l'occidental. C'est l'arrivée de Nasser et le triomphe du nationalisme arabe qui a changé totalement la mise.
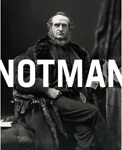
Notman, sous la direction d'Hélène Samson & de Suzanne Sauvage, Musée MacCORD / Hazan, 240 p., 45 euro.
Cet impressionnant volume nous fait découvrir l'incroyable richesse de ce que le photographe William Notman a pu nous laisser (200 000 négatifs et 400 000 épreuves). Il s'est installé à Montréal en 1846 et a fait un nombre impressionnant de vue de la ville, qui ont eu un double objectif : d'abord conserver une image authentique et précise de ses rues, de son port, de sa gare, de ses promenades, de son inscription dans une identité géographique, mais aussi d'un souligner les beautés. Cela fait de ce grand pionnier de la photographie aussi un homme de goût qui aimait déjà conscience de la nécessité de produire des clichés qui ne soient pas exclusivement documentaires. Toutefois, il ne sera pas tenté par les sirènes du picturalisme, c'est-à-dire de la photographie imitant le langage de la peinture : il la considère comme ayant un langage bien à soi et qu'il faut développer. En revanche, quand il fait des portraits dans on atelier, il aime que les expressions de ses modèles soient animés et quand il les prend de pied, il souhaite les voir s'animer dans la mesure du possible (à cause, cela va sans dire) du long temps de pause). Les groupes de gymnastiques sont particulièrement cocasses, mais aussi les familles : il respecte les codes de son époque, mais tout le monde n'est pas aligné avec une allure martiale. Cela, il le réserve pour les journaux ou pour les portraits de grandes personnalités. Il n'a pas joué à faire l'artiste, mais l'était dans l'âme. Ses paysages sont particulièrement impressionnants : il a su en montrer l'aspect le plus saisissant le lac Louise et en a souligné le caractère primordial, par exemple les petites maisons dans la prairie (il accentue l'horizontalité de la prise de vue), ou nous montre les magnifiques monts Castle en soulignant l'étagement de la hauteur des montagnes qui a choisies d'immortaliser. En somme, ses photographies ne sont pas un pur de la réalité, mais une vision de cette réalité, qu'il n'interprète pas, mais montre d'une manière qui n'appartient qu'à lui. C'est donc un album merveilleux, qui nous fait découvrir l'oeuvre magistrale d'un grand homme que nous devons ranger en bonne place dans notre histoire de la photographie.

Rembrandt, Jean Genet, L'Arbalète Gallimard, s. p., 12 euro.
Une postface concise mais très utile nous relate l'histoire de ce petit livre qui est en fait un grand livre. Jean Genet a découvert l'oeuvre de Rembrandt d'abord à Londres en 1952, puis à Amsterdam l'année suivante. Chaque qu'il a eu ensuite la possibilité de visiter une grande ville européenne, il est allé visiter son musée pour voir d'autres tableaux du maître hollandais. Il publie une première version de son texte inspiré par ce dernier dans l'hebdomadaire L'Express en 1958, la même année où il publie l'Atelier d'Alberto Giacometti. Ce texte va connaître plusieurs versions jusqu'à sa publication en deux parties dans ses OEuvres complètes chez Gallimard en 1968 et 1969. La seconde section de cet écrit est franchement étonnante : « Ce qui reste d'un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers » : il met en parallèle des pages d'un journal décousu, mais qui a sa logique secrète, qu'il tient à propos de ce que l'oeuvre lui suggère et, d'autre part, ses réflexions sur l'aspect physique, purement charnel, presque clinique, de la peinture de Rembrandt et de ses sujets. C'est assez surprenant. Quant à la première partie, c'est une sorte de biographie du peintre, en partie fantasmagorique, que Genet a voulu volontairement très elliptique, la rendant ainsi pleine de fulgurances. Bien sûr tout historien d'art digne de ce nom y trouverait à redire, mais l'écrivain fait passer des vérités sur cet art que l'historien souvent n'arrive pas à percevoir. C'est de la grande littérature, et aussi une manière de penser l'art de la peinture qui a atteint ici un véritable sommet.

Arbor, les arbres prennent la pose, Antoine Herscher, présentation de Jean-Paul Curnier, Actes Sud, s. p., 25 euro.
C'est l'arbre dans son essence que l'auteur de ces clichés a pu rechercher ? Peut-être pas. C'est plutôt l'inépuisable diversité de ses ramures et de ses troncs. La question se pose en effet parce que Saussure, si je me souviens bien, avait choisi l'arbre pour désigner la différence entre signifiant et signifié. Cela va de soi, le signifié subsiste et d'ailleurs est manifesté par le titre de cet album. Mais c'est l'interminable déclinaison formelle qui a séduit Jean-Paul Curnier quand il a réalisé ce projet. Ses photographies sont intéressantes car il cherche à nous placer devant les aspects les plus singuliers des arbres, qui ont leur langage plastique à eux, que l'homme provoque parfois, mais qu'ils savent s'inventer dans la nature sans l'intervention de qui que ce soit. Bien entendu, nous n'apprenons rien de nouveau et nous avons déjà vu souvent dans le passé ce genre d'extravagance du monde végétal. Mais peu importe : cela est fait avec rigueur et une sorte de poésie. Le plaisir est ici au rendez-vous et qu'est-ce que nous pourrions attendre de plus. Puisque l'auteur ne « truque » pas ce qu'il voit, ses possibilités sont limitées aux perceptions et aux découvertes de son il. Mais cela suffit amplement à créer l'enchantement.

Les Imbéciles, Giovanni Papini, traduit de l'italien par Sonia Broyart & Fabienne Lesage, Editions Allia, 48 p., 3,10 euro.
Giovanni Papini (1881-1956) est relativement mal connu du public français et quand il l'est, c'est pour un ou deux livres écrits à la fin de sa vie, et qui ne sont parmi ses meilleurs. Papini était l'étoile montante de la philosophie italienne -, un petit génie en graine. En 1903, il a créé avec Giuseppe Prezzolini la revue Leonardo jusqu'en 1907. En 1911, il crée L'anima, qui ne dure que deux ans. Puis de 1913 à 1915, il dirige la revue Lacerba qui, après une vive polémique à Florence, devient l'organe des futuristes. Il a déjà publié des ouvrages importants comme le Crépuscule des philosophes, le Pilote aveugles (nouvelles) et Un homme fini (1912). Il rompt pendant la guerre avec les futuristes et publie un recueil à ce sujet, l'Expérience futuriste. En 1920 il se convertit au catholicisme et publie sa Vie du Christ. Ces petits textes, ô combien délicieux d'intelligence, fait l'éloge de l'imbécillité, avec une rare pertinence. Ils ont paru successivement dans La Voce (1913), dans Lacerba (1913) et en 1949 dans le quotidien romain Il Messagero.

Les Vies multiples d'Armory Clay, William Boyd, traduit de l'anglais par Isabelle Perrin, Points, 708 p., 8,50 euro.
C'est un grand roman dans tous les sens du terme ! C'est une jeune femme qui reçoit en présent un appareil photographique. Au début, ce n'est pour elle qu'un hobbit. Mais peu à peu, ce devient un moyen d'expression. Elle quitte le champ de la photo d'art et le portrait mondain qui lui ont réussi assez bien pour traquer la réalité. Elle nous entraine dans Berlin pendant les années vingt, à New York pendant la décennie suivante, en Amérique latine par la suite et puis en France pendant la guerre. Sa vie mouvementée, déjà du point de vue sentimental, l'est aussi face aux événements qui vont précipiter le monde dans la catastrophe de la guerre mondiale. Elle se marie après le débarquement de Normandie en 1944, a des enfants, s'installe en Ecosse. Mais elle reprend son matériel en 1963 en laissant derrière elle toute sa famille pour repartir, cette fois au Vietnam. Nous découvrons cette foule de faits et gestes dans le journal qu'elle rédige en 1977, avec tout ce que cela implique de digressions, de mélange de la vie privée et des moments cruciaux de cette période mouvementée et tragique. Le talent de William Boyd est d'avoir su faire d'une histoire qui aurait pu être une sorte de feuilleton bon marché un véritable roman d'une grande force. Bien sûr, il succombe à quelques facilités car le sujet pousse à des visions un peu grandiloquentes et parfois simplistes (par exemple, la guerre du Vietnam la fascine -, mais il y déjà eu une guerre au Vietnam qui s'est achevé en 1953 par la défaite de l'armée français, et, encore avant, il y avait eu la terrible guerre de Corée). Mais son personnage tient debout malgré tout et a un peu de substance. En somme, cet ouvrage mérite des éloges même si l'on est de temps à autre déçu par des clichés historiques. William Boyd est un des rares écrivains contemporains à se maintenir sur le film du rasoir entre une fresque digne d'un Tolstoï et le roman populaire de trois sous...

Spoon River, Edgar Lee Masters, traduit de l'anglais (Etats-Unis), Editions Allia, 192 p., 10 euro.
Si vous posez la question autour de vous, pas grand monde ne saura dire qui est Edgard Lee Masters. Né dans le Kansas en 1868 et mort en Pennsylvanie en 1950, cet homme a pourtant écrit l'un des chefs d'oeuvre de la littérature américaine, le livre présent, qu'il a publié dans un périodique, le Reedy's Miror en 1914 et en 1915. Ce n'était pas ses début en poésie : il écrivait depuis un moment et avait publié un premier recueil. Ce nouveau livre connaît un succès qui ne s'est jamais démenti. Harriet Monroe, la responsable de la revue Poetry, l'aide a publié le tout dès 1915. La rivière qui adonné son titre à l'ouvrage existe bien dans cet Etats américain, mais il est probable que les lieux qu'il évoque soient nombreux. L'idée qui a présidé à ce cycle est assez simple mais d'une redoutable efficacité : les tombes racontent l'histoire des hommes et des femmes qui sont ensevelis et cela donne une sorte de fresque de la société américaine et de son histoire naissante. Ce qui frappe ici, c'est la diversité des situations, qui fait que ce système n'est jamais ennuyeux et l'extraordinaire imagination de l'auteur, qui a su résumer une existence en quelques vers avec un sens incroyable de la concision. C'est à la fois tragique et burlesque, émouvant et étrange. Bien sûr, tous ces personnages n'ont pas existé et leur biographie est construite de tout pièce avec fantaisie. Mais c'est un microcosme de l'Amérique depuis la guerre de Sécession et la conquête de l'Ouest qui se trouve recomposé dans ces pages, avec des histoires plus ou moins longues, mais toujours pittoresques et déconcertantes. Il n'y aucune visée didactique dans ces poèmes, mais il n'en est pas moins vrai que les Américains doivent reconnaître l'un ou l'autre de ces défunts comme un ancêtre dont on a raconté et magnifié l'histoire. Il faut dire que la première fois que j'ai lu ce livre, il y a bien quarante ans, j'ai été ébloui par la maestria de cet illustre inconnu (pour moi). C'est absolument superbe !

La Princesse qui descendait de la colline, Didier Naud, Vérone Editions, 242 p., 20 euro.
Ce roman présente un curieux mélange de qualités et de défauts. Commençons par ces derniers : l'auteur est assez conformiste dans la forme et, en étant conscient, il a voulu introduire dans ses dialogues des expressions vernaculaires (surtout celles empruntées aux jeunes gens), e qui engendre un sentiment bizarre ; ensuite il a eu tendance à trop vouloir maîtriser la forme, ce qui rend son texte un peu amidonné. Mais il a su par contre raconter cette histoire d'amour peu commune avec beaucoup de force et de densité, et le concevoir avec du style et de la personnalité, ce qui n'est pas fréquent. En définitive, le meilleur l'emporte sur le plus critiquable. C'est déjà un atout qui n'est pas négligeable. De plus, il s'est démontré capable d'éviter certains pièges du genre. D'aucuns pourraient lui reprocher, la lenteur du récit ou sa forme trop conventionnelle. Mais l'ensemble résiste à ces reproches et demeure le déroulement une histoire tout à fait recevable. Bien sûr, il faut aimer le roman dans le sens le plus commun du terme et en accepter les normes. L'auteur n'est pas un innovateur dans ce genre, loin s'en faut. Mais ce qui compte à mes yeux est qu'il a su mener à bien une aventure qui n'était pas évidente avec pas mal de bonheur et de réussite dans l'écriture.

Comment rester en bonne santé, Plutarque traduit du grec et préfacé par Nicolas Waquet, rivages Poche, 110 p., 5 euro.
Le titre nous ferait penser à un traité de Gallien ou d'Hippocrate. En fait, c'est un petit ouvrage de Plutarque, plus connu pour ses livres sur l'histoire de l'Antiquité et de ses grands hommes (on pense bien sûr aux Vies parallèles des hommes illustres). Mais il était aussi philosophe. Il a été un disciple de Platon et donc un ennemi de l'épicurisme et du stoïcisme. Il a beaucoup traité des questions morales et, d'une certaine façon, ce court guide de l'hygiène du corps peut être regardé comme un livre entrant dans cette catégorie. En effet, que conseille-t-il à l'homme de son temps ? Avant tout la tempérance, la modération dans ses habitudes alimentaires et même une certaine attention à tout ce qui peut être un effort physique exagéré. Un exemple ? L'usage que font les Romains du bain, qui est sans doute l'une des manifestations les plus connues de leur sens de l'hygiène et de leur culte du corps. Mais Plutarque, qu'en cas de maladie ou de faiblesse, il y pressent un danger. Et il n'as tous les torts : les personnes qui passaient d'un bain à l'autre (il y en avait trois) pouvait être la cause d'un choc violent et les accidents cardiaques n'y étaient pas rares. Sa pensée dans ce domaine est très simple et s'appuie sur quelques sources anciennes, mais sans vouloir trop faire preuve d'érudition. Les pages qu'il a écrites en 81 ont un but pratique et ne prétendent pas une seconde être un traité médical savant. Le bon sens y est la condition principale de ses conseils qui se limitent à définir les bornes d'une bonne éducation physique qui va de paire avec une bonne éducation spirituelle. Mais, sur ce point, il n'a pas l'ambition de construire une philosophe de l'homme de son temps, simplement l'empêcher de se faire du tort par différents excès.
|
