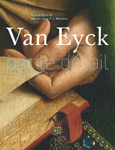
Van Eyck par le détail, Annick Born & Maximiliaan P. J. Martens, Hazan, 256 p., 19, 95 euro.
Le titre de cette nouvelle collection pouvait susciter quelques craintes. Sans doute a-t-il été inspiré par un ouvrage célèbre de Daniel Arase, intitulé justement Le Détail. Mais il me fait bien reconnaître que l'entreprise n'est pas absurde : elle nous apprend à mieux connaître une oeuvre et surtout, dans le cas présent, une oeuvre souvent complexe où se trouve regroupé un grand nombre d'objet et de formes symboliques. Jan van Eyck (vers 1390-1441) est sans nul doute le peintre le plus connu, mais aussi le plus apprécié de la Renaissance flamande. Le retable de L'Agneau mystique ou Les Epoux Arnolfini figurent parmi ses créations les plus estimées. Mais cette adulation générale pour un petit nombre de ses oeuvres fait qu'on ignore souvent les autres.
C'est la loi ingrate de ce genre de passion. Et même des compositions, complexes par définition, comme cet Agneau mystique de Gand, fait que l'on va s'attacher à certains de ses aspects en négligeant d'autres. Cet ouvrage nous fait comprendre qu'une peinture forme un tout, à la fois formel et iconographique, mais que cette totalité et cette cohérence sont construites à partir d'un architecture constitué comme un puzzle qui s'unifie grâce à une construction de l'espace très élaborée et aussi des associations chromatiques savamment agencées. La structure même du retable, surtout quand il est réalisé par un seul et même artiste, est amenée à proposer au fidèle un compendium de l'univers. Les auteurs ont par exemple choisi de mettre en avant la manière dont l'artiste traitait la nature.
Comme c'était souvent le cas à l'époque, il n'est pas rare que les arbres exotiques soient plus ou moins inventés ou copiés avec liberté à partir de livres de botanique des terres lointaines (on retrouve la même situation chez Carpaccio). En revanche, les plantes en pot ou en vase sont traitées avec une minutie et un raffinement rares. Van Eyck ouvre la voie de la nature morte dans les pays de Nord, qui sera bientôt (et pour longtemps) une de leurs grandes spécialités. C'est un étrange mélange de connaissance très poussées et d'inventions d'une grande fantaisie. Mais il en est de même dans les architectures. D'aucunes sont exactes, d'autres sont interprétées de modèles anciens ou d'ouvrages tout à fait contemporains dont il a rendu avec une minutie incroyable l'audace, la beauté et le moindre petit aspect de sa grammaire (nous sommes ici à l'ère du gothique flamboyant). Une large place est laissée au portrait, car l'artiste a réalisé de nombres peintures religieuses (comme la Vierge de Lucques), des portraits de saints (donc imaginaires) et aussi des portraits de grands personnages de son temps, des cardinaux ou des hommes d'Etat comme le chancelier Rollin que l'on voit représenté avec la Vierge et l'Enfant, avec d'ailleurs une grande liberté dans sa conception, car cette Vierge aurait pu être son épouse sans le dispositif iconographique de rigueur). Il a aussi fait d'étonnants portraits d'enfants.
En fin de compte, ce livre se révèle non seulement agréable à consulter, mais aussi d'un indéniable intérêt pour la connaissance approfondie de l'optique de l'artiste, de son écriture plastique et de son imaginaire. On le découvre comme on ne l'a jamais vraiment observé à moins d'être un spécialiste. Il faut dire que dans ce cas spécifique, les détails pullulent, sans pourtant ruiner l'effet d'ensemble : on ne se retrouve pas dans un magasins d'antiquités, ni dans un labyrinthe d'objets hétéroclites. Au contraire : tout semble chez lui avoir une place définie pour participer à une vision très précisément édifiée. Il y a aussi un désir de mettre en scène les merveilles qui sont nées à son époque. Il ne manque que les instruments scientifiques, mais on rencontre parfois des maçons transportant des pierres et les outils qui sont indispensables à leur travail. Un autre Van Eyck apparaît dans ce volume et nous fait mieux comprendre la relation qu'il entretient avec ses contemporains.
Raphaël par le détail, Stefano Zuffi, Hazan, 226 p., 39, 90 euro.
Si cette formule éditoriale est parfaite pour mieux découvrir Jan van Eyck, elle n'est pas aussi heureuse dans le cas de Raffaello Sanzio (1483-1520). Il appartient à une toute autre période de l'histoire (nous sommes à la fin de la Renaissance en Italie) et ses oeuvres picturales sont relativement dépouillées. Il faut aussi noté que l'auteur n'a pas pris en considération les dessins et les cartons de tapisseries, ce qui est dommage. De plus la brève et fulgurante existence de Raphaël, au contraire de Léonard de Vinci et de Michel-Ange, ne lui a pas permis de nous laisser un immense héritage (je parle en termes numériques). Même les fresques animées comme Héliodore chassé du Temple (1511-1512) contiennent un certain nombre de figure et du mouvement, mais ne recèlent guère de niches où auraient été dissimulées des figures qu'on ne verrait pas au premier coup d'oeil ou des scènes « subsidiaires ».
Non. Raphaël est un puriste et il se limite à l'essentiel (cela se note, entre autre, dans le Parnasse, du Vatican). Je dois dire aussi que la méthode employée par Stefano Zulfi n'est pas d'une clarté immédiate et d'une grande évidence. Pourquoi a-t-il mis toutes ces petites reproductions de tableaux du grand maître d'Urbino ? A quoi servent-elles dans ce contexte ? Et beaucoup des ouvrages considérés sont pris dans leur ensemble. Bien sûr, quelques détails nous sont présentés, mais ce sont surtout des portraits (comme saint Jean l'Evangéliste, ou encore des angelots).
On a l'impression que l'auteur a fait une sorte de monographie assez succincte de cet immense artiste et puis a choisi quelques scènes extraites d'un tableau ou d'une fresque... Bien sûr cet ouvrage pourrait servir à des personnes n'ayant qu'une mince connaissance de ses réalisations ou qui ne saurait presque rien de lui. Mais ceux qui ont déjà acquis une bonne part de ce savoir ne pourront pas en apprendre plus sur Raphaël dans ces pages et c'est fort dommage. Cela étant dit, le volume est plaisant à consulter et peut être un beau cadeau pour qui souhaite mieux connaître l'art à l'époque des papes Jules II (Borgia) et Léon X Médicis...

Je ne reverrai plus le monde, Ahmet Altan, traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes, Actes Sud, 224 p., 18, 50 euro.
Tout un chacun se souviendra de l'étrange coup d'Etat qui a eu lieu en Turquie en 2012. Les prétendus putschistes se sont rendus sans tirer un coup de feu et la foule s'est répandue dans les rues comme si elle avait été préparée à cet événement pour arrêter les forces rebelles. On n'a jamais su qui a été à l'origine de cette affaire et le président Erdogan a accusé un mystérieux exilé aux Etats-Unis qui ne s'est pas prononcé sur la question de manière convaincante. Il s'en est suivi une vague massive d'arrestations parmi les forces armées, mais aussi les professeurs, les intellectuels de tout poil, les hommes d'affaires et à peu près dans tous les milieux. Bien sûr, les derniers journalistes qui n'étaient pas favorables au pouvoir en place ont fait les frais de cette épuration sur une vaste échelle. Ahmet Altan figure parmi les personnes interpellées, emprisonnées et ensuite jugées (tout comme son père comme on le verra dans son livre).
Ce qui est merveilleux dans ce livre, c'est qu'il se limite à exposer au début ce qui a pu se passer dans son cas et comment il s'est retrouvé privé de liberté d'une manière complètement arbitraire. Mais après ce préambule et peut-être le passage où il assiste au procès de son père, il nous brosse une description de la vie carcérale qui n'a rien de purement réaliste : il y inclut les obsessions, les hantises (comme celle du miroir qui revient sans cesse), la manière de vive dans l'exiguïté des espaces, les règles arbitraires et parfois incompréhensibles qui régissent la vie des prisonniers, comment un imaginaire se constitue et même un monde onirique. Il ne raconte pas sa vie de prisonnier comme l'avait fait Silvio Pellico quand il était prisonnier des Autrichiens pendant le risorgimento, mais s'efforce de faire éprouver ce qu'un homme pris à ce piège peut vivre (et survivre) à cet état de privation de ses droits, de sa liberté et même des plus simples faits et gestes. Ahmet Altan a écrit un livre frappant et qui n'est pas un plaidoyer contre l'injustice ou contre le sort qui lui est fait, mais plutôt la révélation d'une expérience qui mêle l'absurde et la coercition, la perte de la vraie mesure du temps (celui de l'humain) et de son destin.
Il ne parle jamais de ce qui s'est vraiment passé dans son pays, des causes, réelles ou fausses, de ces incarcérations (il en dénonce l'absurdité quand il rencontre des jeunes officiers de marines qui ont été pris pour des insurgés qu'ils n'ont jamais été). Ce livre a reçu le prix André Malraux l'an passé - un geste symbolique qui est méritoire. Mais il faut aussi dire que c'est une pièce de littérature vraiment digne de l'auteur de L'Amour au temps des révoltes. Inutile de dire que ce livre n'a pas pu paraitre dans son propre pays -, on se l'imagine bien !

Transbordeur photographie, n° 4, Histoire / Société, Editions Macula, 216 p., 29 euro.
Cette revue est très spéciale car si elle représente une investigation sérieuse dans le domaine de l'histoire de la photographie, mais aussi une voyage dans l'imaginaire de ce mode d'expression déjà ancien. Et puis elle ne suit pas les sentiers battus. Et cela est d'autant plus visible dans cette nouvelle livraison, qui concerne plutôt le monde du travail et les mouvements sociaux qui ont eu lieu surtout dans les années 20t. Il aurait été facile de reprendre tout ce que l'on peut connaître de la propagande de la révolution d'Octobre par exemple. C'est ce qu'ont évité les responsables de la publication, même s'ils nous emmènent tout de même en Union soviétique.
On nous fait découvrir par exemple l'Arbeiterkalender comme exemple de ce que les courant de la gauche révolutionnaire on pu produire pendant la République de Weimar. Un autre article traite de l'image prolétarienne pendant la même période. Un autre auteur nous fait découvrir la photographie prolétarienne aux Etats-Unis. Un autre encore nous entraîne dans la toute jeune République tchécoslovaque. Il est évident qu'il ne s'agit pas ici d'avoir une vision globale, que l'ont peut trouver ailleurs, mais plutôt de découvrir des modes d'expression bien peu connus, sinon inconnus qui viennent compléter ce que l'on peut déjà savoir sur la question. L'article le plus original et donc le plus saisissant est celui qui concerne Gisèle Freund, dont nous connaissons et aimons tant les portraits des grands écrivains de son époque, qui s'est attachée à conserver des clichés du mouvement communiste des années 30. C'est une belle surprise ! Dans la section des « varia » on ne peut manquer de lire avec curiosité l'artiste pertinent d'Alessandra Ponte, « Clair de Terre, Paris, 1900 ». Il est à noter que la revue contient beaucoup plus de lectures de livres et pas seulement français... Si vous vous passionnez pour la photographie, vous ne pouvez pas manquer ce nouveau numéro de Transbordeur.

La Peur au milieu d'un vaste champ, Mustapha Taj Aldeen Almosa, traduit de l'arabe (Syrie) par Amal Albahra, avec Patrick de Bouter, Actes Sud, 208 p., 20 euro.
Cet ouvrage recueille une série de nouvelles que l'auteur a écrites ces huit dernières années. Il montre, dès la première, un don rare pour ce genre, car il a le sens de l'ellipse, mais aussi une capacité de convoquer dans un seul et même récit différents genres, qui vont du réalisme le plus pur jusqu'à l'onirisme le plus échevelé. D'aucunes sont comme des paraboles (comme dans « La Nuit de la gifle fatale ») ou d'autres sont des histoires étranges entre le conte et le cauchemar, comme c'est le cas dans la remarquable « Sous-sol humide pour trois artistes » où le narrateur découvre que dans une pièce de l'endroit où il vit, il existe une sorte d'atelier assez sale et poussiéreux.
Dans ce lieu qui semble avoir été oublié de tous, il découvre une belle jeune fille dans un réfrigérateur. Et puis il y a un rat très vif, qui suit l'intrigue. Trois vieux peintres se retrouvent devant leurs chevalets et discutent sans aménité. C'est une scène à la fois grotesque et émouvante. Un coup de vent violent et tous se retrouve par terre ; la belle jeune fille sort de son antre glacée et regarde les oeuvres si longtemps élaborées ; elle est fascinée par la troisième et l'artiste décide de partir avec son tableau (qu'il considère un chef-d'oeuvre) sous un bras et elle sous l'autre. Dans la nouvelle suivante, intitulée « Soirée prodige dans la vie d'une jeune serveuse », le lecteur découvre une jeune fille de dix-huit dans son uniforme de serveuse travaillant dans un modeste restaurant. Elle est très attirée par un jeune étranger venu déjeuner. Elle n'était pas la seule à s'intéresser au nouveau venu et elle dut chasser deux autres jouvencelles qui s'étaient assises auprès de lui sans même lui demander la permission. Un soir, il y eut une fête et elle se demanda s'il l'avait vraiment remarquée.
Depuis son départ, son ombre est là, tout près d'elle et ne la quitte pas un instant. On est émerveillé par la capacité de cet écrivain d'ébaucher des histoires si différentes avec un talent sans égal. Le livre est enchanteur, bien qu'une douleur sourde en soit le leitmotiv. C'est un recueil qui nous fait regretter de ne pas pouvoir lire les autres histoires écrites par Mustapha Taj Aldeen Almosa car son art est consomé et son esprit est à la fois mélancolique et joueur.

Prima di noi, Giorgio Fontana, Sellerio, 894 p., 22 euro.
Une fois n'est pas coutume. Je vous vous entretenir d'un livre qui vient tout juste de paraître en Italie chez l'éditeur palermitain Sellerio. Pour les amateurs de la nouvelle littérature italienne, le nom de Giorgio Fontana (né à Saronno en 1981) ne leur sera pas inconnu car il a déjà publié deux romans en France : Que justice soit rendue (Seuil 3013) et Mort d'un homme heureux (Seul, 2016). Il a remporté le prix Campiello pour ce dernier roman en 2014). Ce nouveau roman se distingue des précédents par sa dimension digne des feuilletons du XIXe siècle !
Il fait quasiment neuf cents pages. Bien sûr, c'est une oeuvre romanesque et Fontana s'est un peu éloigné de l'illusion d'une autobiographie comme dans son précédent ouvrage. Même si... nous y reviendrons plus tard. Tout commence en 1917, lors de la retraite de Caporetto. Le soldat Maurizio Sartori s'est tout simplement perdu pendant cette débandade tragique. Il risque gros, car il peut passer pour un déserteur bien que la confusion soit bien réelle dans les rangs italiens. Il s'est retrouvé dans le Frioul, dans une zone occupée par les Autrichiens. Là, se pose un autre problème : celui d'être fait prisonnier. Il a la chance de tomber sur des habitants du cru qui l'ont hébergé et fourni des vêtements civils. Pour lui, cette guerre abominable est terminée. Et s'il ne se fait pas prendre, il rentrera chez lui. C'est là qu'il rencontre Nadia et qu'il tombe amoureux.
Il l'épouse. Et quand la paix sera revenue, ils vont vivre à Udine. Leur famille prend racine dans cette petite capitale régionale. Le livre est construit par périodes. C'est-à-dire qu'on ne suit pas chronologiquement le parcours des principaux protagonistes, mais qu'on les retrouve d'un moment de l'oeuvre à un autre : la deuxième partie concerne les années 1930-1939, la troisième, celle de la République sociale et de l'omniprésence des forces armées allemandes. Mais l'auteur ne raconte pas ce qui s'est passé pendant ces deux années terribles : la déposition de Mussolini par le Grand Conseil fasciste, l'accord d'armistice du roi Vittorio-Emanuelle III avec les Alliés, l'arrivée en masse des Allemands pour prendre en main le pays, la création d'un Etat fasciste italien avec Mussolini à sa tête, mais sans pouvoir, la guerre partisane et la libération en avril 1945. On ne suit de près que le destin de Domenico, le fils, prisonnier dans un lager et qui y meurt en 1944. Au fond, tout Italien sait plus ou moins ce qu'il s'est passé tout au long du siècle dernier. Ils l'ont appris des parents, à l'école, des lectures... Il ne s'agit donc pas ici d'une saga familiale sur un fond d'histoire nationale, mais des brides d'histoires familiales sur des brides d'histoire.
Nous remontons le cours du temps et l'on comprend que chacune de ces phases correspond à un moment spécifique et parfois crucial de la lente renaissance de l'Italie quasiment jusqu'à nos jours. L'ambition de l'écrivain est considérable, car il ne joue sur aucune des clefs qui gouvernent un roman de cette dimension. On ne retrouve chez lui rien du roman réaliste ou du roman naturaliste. Il n'a pas puisé son inspiration dans l'extraordinaire réservoir du XIXe siècle. Il ne semble pas non plus se recommander d'une littérature plus moderne. Non, il a tenté autre chose. Chaque période est ponctuée par une série d'événements, de rencontres, de retrouvailles, de déménagements (après la guerre la plupart des événements se déroulent à Milan). Les mentalités changent alors que la société italienne se transforme. La famille qui s'est pas mal ramifiée, résiste à l'usure du temps et au vouloir de chacun. Malgré tout. Ce qui frappe ici c'est qu'on a l'impression que le narrateur (qui tient lieu de l'auteur) fait partie de ce cette famille et qu'il y joue un rôle qu'on ignore. Il n'y pas de grande trame et de trames mineures, mais un cycle de la vie qui se poursuit avec ses morts et ses naissances. Prima di noi embrasse un siècle entier. Avec tout ce qu'il comporte de pénible et même d'effroyable. On passe de la Grande Guerre au fascisme et puis aux Brigades rouges et à ses attentats. Il représente l'Italie comme une course aveugle vers le bonheur qui ne cesse d'échouer, pour des raisons sociales, politiques et peut-être personnelles. C'est une machine infernale où un pays merveilleux est devenu un pays saturé d'inquiétudes et d'impossibilités. C'est ce qui rend ce livre passionnant.
|
