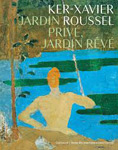
Ker-Xavier Roussel, jardin privé, jardin rêvé, Gallimard / musée des impressionnistes, Giverny, 168 p., 29 euro.
De tous les nabis, Ker-Xavier Roussel (1867-1944) est dans doute l'un des moins connus. S'il est né en Moselle, ses parents se sont installés à Paris après la guerre de 1870, car les Prussiens se sont emparés de cette partie de la Lorraine. Il a vécu sa jeunesse dans un milieu très cultivé et a pu voir des artistes et des écrivains qui fréquentaient les soirées données par son père. C'est au lycée Condorcet qu'il rencontre Edouard Vuillard (qui deviendra plus tard son beau-frère). Il fait aussi la connaissance de Maurice Denis. Il décide de devenir peintre et fréquente l'atelier Maillard en 1885. La même année, il entre à l'Ecole des Beaux-arts. Mais c'est à l'Académie Julian qu'est née l'idée du groupe des nabis grâce à leur relation avec Bonnard. Le petit groupe expose pour la première fois en 1891. Deux ans plus tard, le petit cercle d'amis expose à la Revue Blanche des frères Natanson. A partir de 1894, il montre ses oeuvres à l'exposition annuelle de la Libre Esthétique à Bruxelles et au salon des Indépendants à Paris.
Il exécute des décors pour son ancien camarade de lycée, Lugné-Poe, qui a créé le Théâtre de l'OEuvre (depuis lors, il ne cessera pas de faire des décors de théâtre). Très tôt, il s'attache à réaliser des scènes de la vie du Christ et puis des scènes mythologiques, ce qui était une sorte de défi à une époque où la peinture d'histoire, comme on l'appelait alors, était considérée comme l'apanage des académiciens honnis. Mais son style demeure fidèle à l'esprit des nabis. Il semble logique que le musée de Giverny ait choisi de montrer ses tableaux qui ont tait aux jardins, sujet qu'il a privilégié tout comme son contemporain Henri Le Sidaner. Cela étant dit, ses scènes mythologiques sont loin de déplaire : des critiques le remarquent et le louent lorsqu'il expose en 1897 chez Ambroise Vollard. Il faut dire qu'à l'époque, Roussel est très inspiré par le symbolisme (ce que prouve, en autres, Les Saisons de la vie (1892-1895 - musée d'Orsay). S'il se situe dans cet « au-delà » de l'impressionnisme, il n'en reste pas moins proche des courants novateurs de cette fin de siècle, d'autant plus que son style est très libre et fidèle à l'idéal défendu par ses amis nabi.
Mais les choses s'accélèrent dans la sphère de l'art parisienne et, de toute évidence, il se retrouve très vite en décalage par rapport aux avant-gardes naissantes. Ses Bacchus et ses bacchantes ne sont plus au goût du jour quand apparaissent le fauvisme et le cubisme. Sa Vénus et l'Amour au bord de la mer, tableau réalisé en 1908, a dû apparaître bien démodé alors. Sa première rétrospective qui a eu lieu en 1911 à la galerie Bernheim-Jeune le mettait à l'écart de ce qui intéressait les milieux les plus avancés d'avant la Grande Guerre. Mais il ne s'était pas moins attaché des collectionneurs qui l'ont soutenu sans désemparer. Le rideau d'avant-scène exécuté pour le Théâtre des Champs-Elysées en 1912, avec son cortège de Bacchus, prouve qu'il reste toujours apprécié d'un nombre non indifférent d'amateurs. Il a bien sûr, comme ses compères, peint des scènes intimistes ou d'idylliques promenades comme dans Au Jardin (1893) ou La Terrasse (1893). Mais il n'a pas tardé à peupler ses paysages et ses jardins de figures légendaires (je songe à Dryade, nymphe des bois, 1896). Et cette inclination ne cesse dès lors de prendre de l'importance. Alors que Vuillard et Bonnard cultivent la vie quotidienne pour la sublimer, il tient à ancrer sa peinture dans la nostalgie profonde d'une culture qui n'est plus au goût du jour. Même le « retour à l'ordre » amorcé pendant la guerre ne le conforte pas. Il suffit d'observer comment Giorgio De Chirico et son frère Alberto Savinio se sont emparé des thèmes mythologiques. Quoi qu'il en soit, il était plus que temps de redorer le blason de Ker-Xavier Roussel, qui a été un merveilleux peintre, original et dont la peinture est d'une sensibilité exquise. Il ne s'est jamais reconnu dans le travail de ces artistes qui ont voulu tenu à retourner aux sources de la Renaissance, de Derain à Oppi. Ses lithographies en noir et blanc montrent aussi qu'il avait un penchant pour le fantastique, qu'il a su traiter avec beaucoup de force.

Le Goût de l'Orient, Georges Marteau collectionneur, sous la direction de Charlotte Maury, Editions in fine / Louvre Editions, 120 p., 19 euro.
Il est des collections prestigieuses, avec grand nombre d'artistes célèbres ou d'oeuvres connues d'un large public, et d'autres, d'apparence plus modeste, mais qui n'en conserve pas moins des pièces inestimables. C'est le cas de la collection de Georges Marteau, un petit ingénieur de province qui est devenu en son temps un grand et riche industriel. Il est apparenté à Baptiste-Paul Grimaud, fabriquant célèbre de cartes à jouer. Il a d'ailleurs commencé à collectionner des cartes anciennes et s'est intéressé tout particulièrement à celles du monde asiatique. Il en posséda bientôt la collection la plus importante de France. Mais bientôt, ses intérêts se sont élargis. Son regard s'est toujours tourné vers l'Orient. Il a recherché des xylographies japonaises et l'on peut admirer parmi tous les livres et planches qu'il a recueillis un des plus admirables portraits de femme qu'a pu créer Hokusai, en noir et blanc, Bijin sous un cerisier en fleur. Il s'est même intéressé aux esquisses préparatoires, ce qui démontre qu'il a étudié cette technique si complexe. Mais il s'est aussi passionné pour les livres de la culture musulmane, celle de l'Empire ottoman, de la Perse, de la cour des grands Moghols. Il semble plus attiré par la calligraphie (qui peut parfois prendre des formes très singulières et devenir des oeuvres plastiques), mais il a aussi des exemples d'enluminures magnifiques. En réalité, quelque soit l'univers considéré, il s'est efforcé de saisir son essence et quel a été son rapport entre l'écriture et la peinture. Ce qui d'ailleurs fait un point entre cet Orient islamique et le Japon ancien, c'est que le texte est souvent indissociable de la représentation. Il n'a pas tardé à devenir un expert en la matière mais aussi un esthète de haute volée car il a su choisir les oeuvres les plus belles qui soient. Il a aussi acquis un oeil extraordinaire, sachant distinguer la valeur du style nasta'liq, apparu au XIVe siècle, et qui est devenu la réfère la plus considérée en Perse. Il a su aussi comprendre le génie du grand dessinateur du XVIe siècle, Muhammadi et celui de Riza-yi'Abbasi (XVIIe siècle). Cette collection est d'une telle richesse et d'une beauté si incomparable qu'on ne peut qu'être frappé par ce que ce collectionneur discret a pu réaliser au cours de son existence. L'exposition se trouve encore au musée du Louvre jusqu'au début de l'an prochain et il faut absolument ce procurer ce catalogue qui est non seulement splendide, mais source de découvertes sans fin.

Dalì, une histoire de la peinture, sous la direction de Montse Aguer, Editions Hazan / Grimaldi Diforum, Monaco, 240 p., 30 euro.
Salvador Dalì a souffert de sa très grande notoriété et de ses extravagances. On a fini par ne plus connaître qu'une infime partie de son oeuvre. Celle-ci met en relief sa relation pour le moins complexe, mais très riche, avec l'histoire de l'art. Bien sûr, tout ce qui a trait au surréalisme et à sa fameuse méthode paranoïa-critique, qu'on a eu tendance à négliger le reste. Et même dans ces oeuvres célèbres de caractère onirique, on laisse de côté de nombreuses références à l'art ancien se révélant fondamentales pour comprendre son imaginaire. Dans ces pages, on voit à quel point. Des compositions comme son Julien de Médicis, qui fait allusion clairement au tombeau de Michel-Ange, sa « Chair de poule » (1956), est directement inspiré par une Aphrodite antique, Son Saint Sébastien (1977) ressemble à une Amazone blessée attribuée à Cresilas. On pourrait multiplier à l'infini la description de ce jeu qu'il a sans cesse renouvelle entre les modèles du passé et ses propres oeuvres. Bien sûr, l'autoportrait de dos de Vermeer est l'une de ses marques de fabrique, tout comme sa reconstruction personnelle de La Cène de Léonard de Vinci, qu'il a chéri depuis ses débuts. Les essais contenus dans ce catalogue sont d'un intérêt majeur car il montre de quelle façon Dalì a pu tirer des arguments plastiques d'une nouveauté scandaleuse à partir des maîtres d'autrefois. Il suffit d'ailleurs de songer à ce qu'il a pu élaborer à partir de L'Angélus de Millet. En sorte que le visiteur de cette exposition de qualité et le lecteur de ce catalogue se voient forcés à le regarder dans une perspective bien différente de tous les clichés qui se sont cristallisés ces dernières décennies. Il a pastiché très librement Raphaël en faisant le portrait de Gala de 1945. S'il n'a jamais hésité à franchir toutes les frontières de l'art, même avec mauvais goût et excès de toutes sortes, il n'en demeure pas moins un peintre quia souhaité s'inscrire dans l'histoire classique de l'art et, en fin de compte, figurer parmi ses grands maîtres.
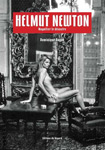
Helmut Newton, Dominique Baqué, Editions du Regard, 280 p., 29 euro.
Helmut Newton (1920-2004) fait partie de ces photographes qui ont marqué profondément l'esprit de la seconde moitié du XXe siècle. De père juif allemand, de mère américaine, il a fait ses études à Berlin où il est né. Il s'intéresse très tôt à la photographie et devient l'élève d'une professionnelle chevronnée, Else Simon. C'est dans son atelier qu'il a forgé son style dans cet art. Il doit émigrer, d'abord à Singapour, puis en Australie, à cause des persécutions raciales en 1938, l'année de la Nuit de cristal. Pendant la guerre, il s'engage dans l'armée australienne. Ensuite il va travailler pour diverses revues, surtout celles qui traitent de la mode, mais aussi pour Playboy. Il décide de s'installer à Paris en 1961. Vingt ans plus tard, il vit entre Monte Carlo et Los Angeles. Il trouve la mort dans un accident de voiture à Hollywood et il est enterré à Berlin, non loin de la tombe de Marlene Dietrich. Dans ce bel ouvrage, Dominique Baqué définit avec beaucoup de clarté et de justesse ce qu'a été l'esprit de la photographie pour Helmut Newton : son peu d'appétence pour le surréalisme, son refus du romantisme, et n'aime pas cet « instant décisif » que pourchasse Cartier-Bresson. En revanche, il en vient à aimer la photographie nocturne grâce à Brassaï. Mais toutes ces dispositions ne le font pas aller vers le réalisme qui a triomphé pendant les années cinquante. Au contraire, il a toujours aimé mettre en scène des situations parfois étranges. Il mélange dans ses compositions un traitement du sujet très puriste et des poses et des situations héritées de la culture populaire qui sont sublimées avec une pointe d'humour. Très vite, son art est devenu d'une originalité complète et on peut reconnaître sa patte dans le moindre de ses portraits. Il a aussi fait des oeuvres érotiques, avec une pointe de représentation sado-masochiste, qui est contrebalancée par une ironie sous-jacente. En somme, ce riche album retrace une carrière de ce photographe hors norme qui s'est imposé comme étant l'un des plus important de la seconde moitié du siècle dernier.

Classé sans suite, Claudio Magris, traduit de l'italien par Jean & Marie-Noëlle Pastureau, Folio, 480 p., 8,40 euro.
Claudio Magris est désormais l'une des rares grandes figures de la culture dans la péninsule transalpine. Presque tous sont partis, comme récemment Umberto Eco et puis l'écrivain hongrois, devenu Triestin, Giorgio Presburger. S'il a écrit des nouvelle superbes, comme Enquête sur un sabre, ou La Mer, il en est venu au roman que sur le tard avec A l'aveugle (paru en France en 2006 chez L'Arpenteur/Gallimard). Cette seconde oeuvre de fiction est assez prenante : elle nous fait découvrir un musée insolite, qui aurait été édifié à Trieste après la Seconde guerre mondiale. C'est une métaphore en forme de labyrinthe. Un collectionneur a décidé de rassembler des armes de ce conflit meurtrier. Il a disparu dans des circonstances tragiques et mal élucidé. Une femme, Luisa Brooks, a pu trouver un lieu pour exposer ce butin assez singulier pour en faire un musée de la Paix. D'autre part, le collectionneur avait aussi recopié dans des carnets toutes les inscriptions, écrites ou dessinées, que les prisonniers avaient laissé sur les murs de la Risieria di San Saba (un grenier à riz), au coeur de la zone industrielle de Trieste, aujourd'hui quasiment abandonnée mais encore active quand la ville a été rattachée au IIIe Reich entre 1943 et 1945. (Il est d'ailleurs vrai qu'un résident étranger a fait ce travail pour qu'on puisse identifier les personnes qui sont mortes dans ce lieu terrifiant, que l'on peut visiter aujourd'hui de jour comme de nuit dans une atmosphère spectrale.) Là, se sont retrouvés dans des cellules exiguës des résistants italiens, slovènes (la moitié de la population de la cité de Svevo est slave), des autres pays de la future Yougoslavie, des Juifs, cela va sans dire, et ont passés quelque temps dans des conditions épouvantables avant d'être anéantis. Ce musée fantasmagorique est le moyen pour Magris de nous délivrer sa philosophie de l'histoire et aussi une posture morale devant les événements tragiques que les hommes ont dû affronter pendant cette période mortifère. C'est un grand livre, où l'auteur se sert de son héroïne pour nous forcer à méditer avec lui sur notre modernité, qui est le fruit de ce conflit abominable. Quelles leçons pourrions-nous en tirer ? Tout en étant un ouvrage éthique et philosophique, l'ouvrage n'en demeure pas moins une invention littéraire, faite pour être savourée comme telle. Magris renoue avec une grande tradition surtout française, comme, par exemple, celle des Lettres persanes de Montesquieu, de Candide de Voltaire, du Faust de Goethe, mais en y introduisant une dose subtile de littérature utopique. L'imaginaire lui permet de faire apparaître les grands rouages maléfiques de l'histoire et de les examiner dans une sorte de relation passionnée et d'une folle originalité avec l'héritage de nos aînés. C'est très beau et passionnant, et plus encore.

Brouillons & ébauches, 1962-2022, Julien Blaine, « c'est mon dada », Redfox, s. p., 15 euro.
La Comète 67P/ Churrymov-Grerarsimenko : la laboureuse, Julien Blaine, Editions Vanneaux, 28 p., 10 euro.
Ces Brouillons et ébauches sont une petite anthologie de l'art de Julien Blaine depuis les années soixante (et l'auteur anticipe en se donnant trois ans d'avance !). Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en remontant le cours du temps, on voit l'auteur et artiste hésiter entre différentes possibilités. Mais s'affirme peu à peu la présence de la lettre et du mot dans ses recherches. Il est passé de quelque chose qui pouvait encore s'apparenter au lettrisme à une forme de collages (dans le sens le plus large du terme) où l'humour joue de plus en plus une fonction introduisant dérision et d'ironie mordante dans ces ébauches. De plus, il ne s'arrête jamais à une formule : il ne cesse de rechercher d'autres moyens de traduire son sentiment à propos de l'art et de la poésie. Il aime le hasard objectif (la seule chose qu'il a tiré du surréalisme), dans toujours dans une optique grinçante. Cet opuscule est un compendium de sa réflexion décapante sur l'univers de la création au-delà du modernisme. Quand on lit les textes réunis dans La Comète 67P/, force est de constater que cet amoureux et profond connaisseur de la poésie a voulu depuis longtemps donner l'estocade à ce genre avec la verve gouailleuse de L'Album zutique. Mais, derrière cette manière de maltraiter l'art poétique, on sent le poète qui se renie : il est des passages où il laisse malgré tout transparaître le créateur qui est en lui, en dépit de ses jeux de mots, de ses railleries, de ses déclarations tonitruantes. Cet hymne au soleil, et au-delà de la métaphore, de la vie dans sa splendeur - d'autant plus splendide qu'elle lui semble menacée par toutes sorts de maux. Ces deux petits livres permettent de connaître de façon plus intime cet auteur prolifique qui a sans cesse fleureté avec les confins de l'art et qui a commis l'irréparable en refermant les portes de toute vision nouvelle de notre héritage.

Mikado d'enfance, Gilles Rozier, L'Antilope, 192 p., 18 euro.
Je dois confesser que j'ai été un peu surpris par ce livre. D'abord à cause de son ambiguïté (est-ce réalité ? est-ce fiction ?), mais aussi parce que cette chasse aux souvenirs douloureux est narrée de manière plutôt curieuse. Mais, plus j'avançais dans ce livre, plus je comprenais ce qui a tenaillé l'auteur. En effet, l'on peut comprendre qu'avec la distance temporelle, l'histoire d'un grand-père emporté par les vents gelés de l'histoire de la dernière guerre et la propre histoire de ce petit-fils qui n'est pas parvenu enfant à accepter et ses origines et ce qu'il a dû paraître aux yeux des autres. Mais peu à peu, on parvient à suivre le récit qui nous est offert, qui est tout sauf simple. Pas le destin des êtres, mais plutôt comment l'enfant est parvenu à la reconstruire au fil des ans, comme si ce départ avait été l'amputation d'une partie de lui-même. Cette quête entreprise bien longtemps après les faits, donne ses fruits et le narrateur prend la mesure de ce qui a pu se passer sous l'Occupation et de ce que le IIIe Reich avait promis aux Juifs : l'anéantissement total. Cette pieuse quête se change au fur et à mesure en quelque chose d'autre, qui plonge aux racines de la judéité moderne et de ce rapport infernal avec la Shoah, qui, pour beaucoup, demeure un poids, qu'on ait eu ou non des parents massacrés par les nazis. Etre Juif aujourd'hui c'est en plus porter ce poids, qu'on soit observant ou non, préoccupé par ses origines ou non. Prendre conscience de ce simple fait d'être juif est un châtiment intérieur. Car nous assumons tous la faute de ce massacre de masse, au-delà du deuil. Ce livre, qui est une affaire familiale, et qui n'a aucune prétention philosophique, donne matière malgré tout à réflexion. Et quelque soit ce que nous pensons de ce héros parti à la recherche de son ancêtre perdu devient très proche de nos sentiments à plus d'un demi-siècle de la tragédie et émouvant.

La vie silencieuse de la guerre, Denis Drummont, Editions du Cherche-Midi, 320 p., 18 euro.
Ce livre s'attache à remémorer les derniers grands conflits qui ont marqué notre histoire récente. Les deux figures centrales de ce roman son Gilles et Jeanne. Un beau jour, ils reçoivent un gros paquet que leur avait expédié leur meilleur ami, Enguerrand, un grand reporter qui a toujours aimé faire la chronique et photographier au plus près les guerres sur tous les continents. Le paquet contient les négatifs de ses photographies et aussi ses carnets, où il relate tout ce qu'il a pu vivre pendant ces périodes de son existence où il était sur le terrain. Il évoque d'abord le Rwanda et ses hallucinants massacres. Il ne porte pas de jugements, Mais son témoignage écrit suffit à fournir la dimension monstrueuse de ce qui a pu se passé dans ce pays d'Afrique où une ethnie a pu désirer en éliminer une autre, avec une fureur insensée. Les guerres tribales d'un passé lointain se sont changées en génocides modernes. Puis il se retrouve au coeur de ces combats effrayants qui déchirent l'Ex-Yougoslavie. Il se rend en Bosnie-Herzégovine pendant l'été 1995. Il a vu comment un différent nationalisme s'est changé en une haine religieuse ou raciale (dans le cas en question, il s'agit d'un affrontement entre Serbes orthodoxes et d'autres Serbes, qu'on appelle les « musulmans ». Gilles remarque qu'il n'a jamais dépeint les massacres, mais la vie qui tentait de se préserver dans ce contexte abominable. Après quoi, il prend l'avion pour se rendre en Afghanistan en 2001. Les troupes soviétiques sont parties, mais la guerre n'a vraiment pas cessé les années suivantes. Les talibans parviennent même à s'emparer du pouvoir. Les Américains parviennent à convaincre l'ONU de se lancer dans une campagne de pacification et d'éradication de l'Islam radical. Enguerrand se rend bientôt sur place et une fois encore raconte « sa » guerre. Deux ans plus tard, il décide d'aller observer les événements en Irak. De nouveau, ce sont les Américains qui sont à la tête d'une sorte de croisade, bien maigre, pour punir Saddam Hussein, qu'ils tiennent pour responsable des attentats des Tours jumelles de New York. C'est dans ce pays, une fois qu'il se soit rendu à Babylone, son récit s'interrompt. Il est mort au combat -, un combat pour l'humanité, ce qu'il a célébré dans ses photographies. Tout cela nous est rapporté dans une optique originale, bien loin de tous les clichés qu'on nous inocule.

Alger, journal intense, Mustafa Benfodil, Editions Macula,
Dès les premières pages, force est de constater que l'auteur de ce journal a éprouvé le besoin de sortir des chemins tracés par ses prédécesseurs. Avec lui, nous sommes bien loin des journaux d'Amiel ou même d'André Gide ou de Jean Cocteau. La forme n'est pas conventionnelle et même très attachée aux aspects de la vie moderne (il écrit une sorte d'ode à Google !). Il ne singe par ses grands prédécesseurs et fait un usage du langage vernaculaire très libre. Il n'en est pas moins un grand admirateur de Fernando Pessoa. Et ses pages sont le fruit d'une grande douleur : la perte douloureuse de son ami l'écrivain Karim Fatimi. Chaque jour, il compte les jours depuis sa disparition. Il mêle les faits les plus anodins ou des choses plus sérieuses et illustre ses carnets de dessins de sa petite fille. Il évoque souvent l'histoire récente de son pays, l'Algérie, mais ne s'applique jamais à rappeler les heures tragiques de cette guerre terrible. Non, les événements surgissent de temps à autre, en pénètre le flux de sa mémoire. Parfois, il rédige un poème. Parfois, il est séreux, d'autres fois, non. Il aime beaucoup plaisanter, mais en pudique pour tout ce qui le touche affectivement. C'est complètement anticonformiste, drôle, tapageur, tout sauf académique ; et l'auteur ne prend pas la pose du grand homme de lettres qui laissent des propos immortels. C'est tout le contraire. Il a tenté de relater l'histoire d'un homme simple, qui a une vie simple à Bab El Oued, mais qui a une profonde passion pour la littérature, qu'il exprime avec des mots et des formules de notre temps, dans toute leur nudité et leur crudité. C'est là un livre assez déroutant, hors norme, qui engendre des sentiments contraires. Mais on ne saurait rester indifférent devant ce que Mustafa Benfodil a pu consigner dans ce journal en apparence débraillé et railleur. Il joue à mi-chemin entre la culture populaire et la « grande culture ». Et l'on sent qu'il a pas mal de ressources qui, je l'espère, il saura rendre dans toute leur mesure dans un prochain ouvrage.

Nouvel An, Juli Zeh, traduit de l'allemand par Rose Labourle, Actes Sud, 192 p., 14,99 euro.
Juli Zeh nous est présentée comme l'étoile montante de la nouvelle littérature allemande. Ce roman nous fait tomber de haut car il ressort d'un réalisme très terre à terre, sans relief, sans originalité et avec une curieuse inclination de l'auteur à tout compter et calculer, (les nombres sont omniprésents, même le numéro de la table où dînent les personnages !) histoire de rendre les choses encore plus concrètes qu'elles ne le sont ! Le personnage central de cette histoire est un homme vraiment sans qualités. Pourquoi pas ? Ce qui surprend est qu'il n'acquiert pas d'intérêt à mesure que progresse la narration. Notre héros, Henning, a une femme et des enfants, qui sont loin d'être en bas âge. Mais lui et son épouse travaillent à mi-temps pour s'occuper d'eux. Lui travaille dans une librairie. Sa passion semble être le vélocipède, moyen de locomotion très à la mode, si je m'abuse. Il y a au milieu de tout cela un mystère : notre personnage est hanté par ce que l'auteur désigne comme étant « la Chose ». On découvre dans la seconde partie, qui est d'une toute autre facture car on revient en arrière dans le temps et des faits traumatiques nous sont rapportés. On glisse alors dans une psychanalyse à trois sous. Ce roman est fastidieux et ne donne pas de grandes satisfactions. Je suis un peu surpris des éloges adressés à son auteur car cette littérature là ne représente pas à mes yeux l'avenir de l'art romanesque en Allemagne - tout du moins, j'ose l'espérer !

Les Ardents, Nadine Ribault, Le Mot et le reste, 212 p., 19 euro.
Si vous aimé l'histoire ancienne et surtout les légendes qui l'entourent, ce roman de Nadine Ribault est fait pour vous. Elle nous plonge au coeur de la période médiévale, en plein XIe siècle. Nous sommes dans les Flandres, non loin de la mer, dans le château de Gisphild. Dame Isentraud y gouverne son fief. Son fils, Arbogast, a des origines étrangères et cela le perturbe au plus haut point. Dans sa rage, il fait enfermer son épouse Goda. L'histoire qui nous est narrée est digne d'une romance anglaise : les passions se déchainent et les preux chevaliers sont parfois d'effroyables personnages. L'intrigue tourne autour de l'enfermement de Goda, la femme du fils d'Isentraud, qui lui voue une haine sans nom. Celle-ci va partir à s'enfuit et puis à revenir la tête haute sur ses terres. Dans un monde qui est dominé par les dures réalités du climat, de la guerre meurtrière, de la religion, de la superstition, des épidémies dévastatrices, les héros de cette aventure fantasmatique semble sorti d'un vieux grimoire, mais ils ne se comportent pas comme ces chevaliers qui accomplissent des exploits mirifiques et partent en quête du saint Graal. Non, ils ont bien des failles et se retrouvent dans des situations souvent dramatiques, comme si une malédiction s'était abattue sur eux. Donc, nous sommes loin ici des archétypes du Moyen Âge tels que nous les rapportent les grands poètes et romanciers de cette époque, qui chantent les louanges du roi Arthur, de Lancelot ou de la malheureuse Guenièvre. On est aussi très loin de ceux qui ont idéalisé bien longtemps après cette période les faits et gestes de ces cavaliers, comme l'ont fait l'Arioste ou Le Tasse. Et l'auteur n'est pas une version féminine de Don quichotte : elle réinvente cet univers avec tout ce qu'elle peut représenter de superbe et de terrifiant, où la sorcellerie est omniprésente et ou la mort arrive à pas de loup ou en grande pompe, comme on voir le squelette foudroyant brandissant sa faux tel qu'on le voit dans la magnifique fresque de Palerme. C'est un roman bien curieux qui, je le crois, saurait séduire les amateur de ces fantaisies qu'apprécient tant les Anglo-Saxons et qui a ses adeptes de ce côté de la Manche.
|
