
Adolf Menzel, Werner Bush, Hazan, 304 p., 75 euro.
Le nom d'Adolf Menzel (1815-1905) n'évoquera certainement pas beaucoup de choses aux amateurs d'art français à part ceux qui connaissent bien l'Allemagne. Il a pourtant été un peintre et un graveur très réputé en son temps. Déjà de son vivant, nos critiques n'ont pas conçu un amour profond pour cet homme qui a été célébré surtout pour ses tableaux et ses estampes sur la vie de Frédéric II de Prusse ! Toutefois, il y a eu un grand poète, Jules Laforgue, qui s'est passionné pour son art. Devenu lecteur de l'impératrice Augusta à Berlin, il est parti dans la capitale prussienne et y est demeuré jusqu'en 1886. Passionné d'art (une passion qui s'est renforcée quand il a été secrétaire de Charles Ephrussi, grand collectionneur mais aussi auteur d'une remarquable étude sur Albrecht Dürer, il a envoyé plusieurs compte rendus des grands événements artistiques qu'il pouvait voir. L'art contemporain allemand ne lui plaisait guère et ses articles parus dans La Gazette des Beaux-Arts sont souvent caustiques. Mais il a fait deux exceptions, la première pour Max Klinger, dont il adore les gravures, et la seconde pour Menzel, déjà âgé. Son article sur le Salon de Berlin de 1883 est très clair à ce sujet : « N'ayant pas encore digéré le présent en art, l'école allemande devra se surmener encore avant de nous donner une peinture de l'avenir. » Quand est présentée l'exposition commémorative de Menzel, Laforgue n'hésite pas à affirmer : « Comme toujours l'impression dominante et obsédante est celle d'un génie dont la raillerie est impitoyable... » Et le nom de Menzel revient régulièrement sous s a plume. Il est vrai que quand on parcourt la monographie de Werner Bush, on peut être surpris d'une part par la quantité d'oeuvres exécutées par ce peintre, mais aussi par la diversité confondante de ses choix esthétiques. Ses innombrables compositions inspirées par Frédéric le Grand ne sont pas seulement une apologie de ce prince qui a fait de la Prusse une puissance redoutable, mais aussi un homme des lumières, musicien, philosophe et ami de Voltaire. Ces portraits expriment son admiration, mais aussi parfois une pointe subtile d'ironie. Grand « imagier », il possède malgré un énorme registre et aucun genre ne le rebute. Il connaît aussi des phases dans sa longue vie. Ses séjours à Paris lui font découvrir Barbizon et les peintres impressionnistes. Il fait d'ailleurs à cette époque des paysages tout à fait étonnant par rapport à son propre contexte culturel. Si l'histoire a tout de même été son principal réservoir iconographique. Mais quand survient la guerre austro-prussienne en 1866 et que les armées du général Falkenstein bat les Autrichiens à Bad Kissingen, il dessine des blessés et des mourants, et non des scènes héroïques. Et sur le tard, il change radicalement d'orientation. Il peint s'intéresse à la vie urbaine, surtout aux scènes de rue, mais aussi le monde du travail et La Forge (18672-1875) est sans doute l'une de ses toiles le s plus connues. L'auteur a très bien su décrire la fantaisie du personnage en plus de son talent, ses innombrables contradictions (s'il est attiré par les nouveau paysagistes français, il devient l'ami d'Ernest Meissonier, le peintre militaire dont il a fait un beau portrait en train de travailler. En somme, ce livre sera une révélation pour les amateurs de l'art du XIXe siècle. Il est très surprenant et ses scènes d'intimité sont charmantes alors que son obsession pour dessiner des armures est assez mystérieuse.
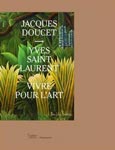
Jacques Doucet/Yves Saint Laurent, Vivre pour l'art, sous la direction de Jérôme Neutres, Flammarion, 192 p., 39 euro.
Pour la dernière exposition présentée à la fondation Yves Bergé/Yves Saint Laurent, ce premier a voulu faire un parallèle entre deux collections d'époques différentes. Celle qu'il avait constituée avec le grand couturier nous a déjà été présentée et a fait l'objet d'une vente. Elle était très belle et exclusivement motivée par l'engouement, le goût, l'hédonisme que peut procurer une oeuvre d'art. Celle du grand couturier Jacques Doucet (1853-1929) était aussi motivée par les mêmes raisons. Mais il y avait une grande différence : il s'était entouré de conseillers d'un certain poids - André Breton pour l'art (c'est lui qui l'avait convaincu d'acquérir Les Demoiselles d'Avignon de Picasso et aussi des De Chirico, entre autres) et Louis Aragon pour les éditions. Dans le décor très Art Déco de la rue Saint-James, il avait réuni des chefs d'oeuvre de l'art moderne, et constitué une collection d'ouvrages assez impressionnante, qui fait rétrospectivement notre admiration. Les photographies qu'on peut voir dans ce bel album en témoigne. Yves saint Laurent et Yves Bergé ont été eux plus sollicité par le coup de coeur. Quoi qu'il en soit, le parallèle entre eux est tout à fait légitime. Il faut dire que l'exposition fait éprouver au visiteur la nostalgie du temps où l'on faisait une collection pour le plaisir et la délectation des sens et de l'esprit. Bien sûr on aurait souhaité des pages un peu plus développées sur Doucet, pour expliquer le développement de cette collection qui était alors unique. Mais nous n'avons pas à nous plaindre : ce volume est une trace sublime de son aventure et aussi de celle des deux hommes qui ont suivi ses traces. Peut-être pourra-t-on titrer la morale de la fable et se dire qu'on peut avoir réussi et avoir gagné beaucoup d'argent et demeurer humble et respectueux devant l'art, ans le transformer en une source potentielle de profit - la jouissance du privilège rare de pouvoir posséder ce qu'il vous plaît et qui vous touche.

Pour le septième art, Elie Faure, édition et préface de Jean-Paul Morel, L'Age d'Homme, 376 p., 36 euro.
D'Elie Faure, on connaît tous son histoire de l'art (dont la parution débute en 1910) qui est un ouvrage qui est une autre manière d'envisage les métamorphoses des formes au fil du temps. Mais qui a lu ses écrits sur le cinéma ? Je dois avouer humblement que je n'en avais même pas la moindre idée. Et ce qu'on trouve dans ces textes et ses relations épistolaires est tout à fait passionnant. De toute évidence, première passion a été Charlie Chaplin, dont il fait l'éloge de son célébrissime personnage de Charlot dès 1919. Ce dernier d'ailleurs écrira tardivement pour le saluer car il a été à ses yeux le premier à reconnaître le cinéma comme un art véritable. Mais c'est surtout sa relation avec Abel Gange, avec lequel il noue une solide amitié, qui est au centre de ce livre. Il a voué une admiration sans borne pour le créateur de Bonaparte et a eu avec lui des échanges passionnants. Sans être toujours d'accord, les deux hommes s'estiment et leur correspondance s'étale sur de nombreuses années. En annexe, on découvre avec surprise les lettres échangées entre Louis-Ferdinand Céline et Gance, car celui-ci avait eu l'envie d'adapter le Voyage au bout de la nuit. Mais comme beaucoup des projets de Gance, celui-ci n'aboutit pas. Sa démesure et ses exigences font qu'il ne parvenait pas à se plier aux nécessités économiques du cinéma, surtout quand il est devenu parlant. On pourra aussi lire avec grand intérêt ses remarquables essais sur le machinisme, qui sont à mettre en corrélation à son engouement pour la photographie et le cinéma. Après les futuristes, il a voulu magnifier cet aspect de la modernité. En somme, Elie Faure a été parmi ceux qui ont plaidé la cause de l'âge industriel, sans en accepter pourtant les conséquences sociales et humaines. A noter aussi ses papiers sur Eisenstein, qu'il a connu au Mexique quand il a tourné Che viva Mexico !, et aussi ses conceptions assez révolutionnaires sur ce qu'il appelle la « cinéplastique ». A lire aussi ses deux écrits sur la question de la peinture, dont il prédit la fin. Sur ce point il s'est trompé. Mais ses considérations ne sont pas dépourvues de sagacité. Il comprend que le cinéma, la reproductibilité de la photographie, changent la donne dans les arts et en cela il n'a pas entièrement tort. En somme, une vraie mine d'or pour qui veut comprendre ce qui a bougé au XXe siècle et comment cela a bougé. Et c'est aussi un moyen pour découvrir l'étonnante personnalité d'Elie Faure.

A la découverte des chefs-d'oeuvre de la peinture, Michel Butor, Flammarion, 256 p., 39 euro.
Michel Butor a beaucoup écrit sur la peinture (ancienne et même contemporaine) après avoir abandonné le roman. Ce livre est un peu surprenant car c'est le classique livre d'étrenne qu'on offre à quelqu'un qui n'a pas de grandes connaissances en matière artistique. Et l'écrivain joue le jeu, se faisant souvent plus pédagogue que poète ou amateur d'art. Cela produit un ouvrage curieux, qui sur certains aspects est assez instructif (cela dépend du peintre traité). Certaines notices sur brillantes et riches d'information sur le tableau envisagé, comme c'est le cas pour le Pa ysage avec les funérailles de Phocion de Poussin. Le Nain, Hogarth, par exemple, sont traités avec beaucoup d'intelligence. On reste sur notre faim avec Canaletto ou Ruysdael (Le Cimetière juif). Cette inégalité dans les commentaires est assez troublante. Quant à Liotard, il est surprenant qu'il est choisi l'un de ses autoportraits et non une de ses merveilles peintures turques. Tout laisse pensé que l'entreprise s'est faite un peu à la hâte set sans recul, en tout cas pour l'auteur. Autre curiosité : la partie baptisée « technique » : on commence par Turner et on continue avec Renoir, Manet, Monet Degas, etc. Tous ces peintres ont-ils été choisis parce qu'ils ont apporté des innovations techniques à l'art pictural ? Dans ce cas là il fallait commencé avec Cimabue et Giotto, passé par les Bellini et Mantegna, et ne pas oublier Vélazquéz et Véronèse ! Mais ne nous plaignons pas trop : c'est tout de même mieux fait que d'habitude avec des fiches rébarbatives de conservateurs ou d'auteurs qui donnent de vagues impressions nuageuses. Dommage que l'histoire se termine avec Basquiat, qui ne me semble figurer parmi les auteurs de chefs d'oeuvre. Mais avant, il y a De Chirico, Balthus, Klee, Kandinsky, Rothko. Rien à dire !

L'Art italien, André Chastel, «Les essentiels/Art», Flammarion, 656 p., 18 euro.
Malgré le temps qui passe et les travaux entrepris par les nouvelles générations d'historiens de l'art, l'ouvrage d'André Chastel demeure une référence incontournable. Difficile de se passer de ce vade-mecum de ce que la Renaissance a pu créer à travers ses différentes écoles et c'est d'ailleurs sous cet aspect que ce grand connaisseur a envisagé la composition de son étude. Bien sûr, un livre tel que celui-ci, qui embrasse tous les domaines de la création, ne peut examiner dans le détail tous les aspects de cet art d'une richesse insondable, avec cette capacité rare de pouvoir condenser l'esprit d'une oeuvre en peu de mots et dans un style impeccable.. Mais tout de même il procure, aussi bien au néophyte qu'au lecteur averti, la possibilité de se familiariser avec ces mondes qui se sont créés dans telle ou telle cité italienne, qui ont tenu à préserver leur spécificité, malgré les échanges constants entre elles et aussi avec le reste de l'Europe. Ce la reste la meilleure approche possible de la peinture, delà sculpture, de l'architecture et des arts appliqués de cette phase miraculeuse de l'activité artistique. Chastel nous entraine même jusqu'au XVIIe siècle, mais là les commentaires sont trop sommaires. Donc un livre indispensable, comme peut l'être le Littré ou le Grevisse pour la langue française. Tout un chacun se doit de l'avoir dans sa bibliothèque, quitte à ensuite à compléter ses connaissances sur tel ou tel artiste, ou sur telle ou telle région.

Secrets, Claudio Magris, traduit de l'italien par Jean-Noël et Pastureau, Rivages Payot, 60 p., 12 euro.
Ces dernières années, Claudio Magris n'a pas mis de côté ses chères études littéraires, mais s'est consacré à des questions de morale. Ses articles dans le Corriere della sera en témoignent, tout comme différents petits ouvrages. Celui-ci fait partir de ces réflexions qu'il entend partager avec le lecteur. Sa démarche est singulière : il pose le problème, nous le soumet, mais ne cherche pas à apporter des réponses définitives. Il ouvre un champ d'investigation et nous le propose afin que nous y méditions à notre tour. Le secret est une question qui a ses innombrables entrées. Historiques et conceptuelles. Claudio Magris par du secret d'Etat, qui concerne tous les régimes, dictatoriaux ou démocratiques. Puis il va plus loin et recherche dans l'histoire et donc le passé ce que ce terme peut impliquer. C'est un voyage passionnant, qui nous conduit de l'antiquité avec les mystères d'Eleusis jusqu'à une période récente avec ceux qui cultivent le mystère, comme l'avait fait Mircea Eliade, avec un arrière-plan philosophique assez contestable et même suspect. Il nous présente Torquetto Accetto, auteur de l'ère baroque bien oublié de l'Honnête dissimulation, qui croit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, pour des raisons de sensibilité ou de rejet d'une possible tragédie, jusqu'à l'écrivain espagnol Javier Marìas, qui a mis en scène les ambiguïtés du secret. Et l'on va et vient dans le temps d'un mot, d'une pensée et d'une multiplicité de significations. Chaque auteur enrichit le thème, nous en fait voir d'autres facettes, nous montre la grande complexité de traiter le secret comme une entité unique. Balthasar Gracián, l'auteur du Courtisan, vient nous éclairer tout comme le fait un dictionnaire de théologie morale. En somme, nous voilà maintenant aux prises avec tant de facettes et tant de points de vue contraires que le secret se transmue en une question sans cesse plus vaste. Ce livre est une merveille : il devrait être lu par tous les élèves des classes de philosophie au lycée. Mais aussi par nous tous pour savoir comment penser. Penser, ce n'est pas seulement réfléchir, c'est savoir discerner qu'une idée, qu'un simple vocable, peut avoir mille et une interprétations. Mais que dans tous les cas reste le libre arbitre et la clause éthique qui doit s'y associer - le libre arbitre, logiquement, conduit au libertinage (mental, non à la débauche !), il doit donc être corrigé. Diderot l'avait d'ailleurs fait dans son esthétique (en se trompant sans doute, mais le fait est là). Magris est passé maître dans cet art de révéler les choses avec simplicité, mais aussi avec une immense culture et un sens prononcé de la modernité.

Voltaire, François Jacob, « Folio biographies »,336 p., 9 euro.
Disons-le sans attendre c'est une excellente biographie. Ecrite avec fluidité, mais bien écrite, et intelligemment écrite. On apprend beaucoup sur le sieur François-Marie Arouet, ou plutôt, on remet beaucoup de choses à leur place. Pas tant sur ses origines un peu obscures (il a toujours prétendu être le bâtard d'un gentilhomme), mais sur ses ambitions, ca carrière et l'évolution de son écriture. Le jeune révolté, qui a aussitôt changé son nom en Voltaire, qu'il a été s'est vite assagi car il avait soif d'une ascension sociale, qu'il va obtenir par des ouvrages flatteurs pour le pouvoir royal. Il a bien tâté de la Bastille une première fois pour un libelle en vers contre Philippe d'Orléans, le Régent, et une seconde fois pour un différend avec un noble. Il appris la leçon. Il va alors commencer une carrière de dramaturge, qui va souvent être couronnée de succès, contrairement à ce qu'on a pu souvent faire croire. Biens sûr, les acclamations ne sont pas toujours au rendez-vous, mais sa réussite dans ce domaine est plutôt extraordinaire. Tout comme sa prolixité ! L'auteur met aussi en avant sa poésie, qu'on a pas mal oublié, et surtout sa Henriade (1728), qui est en réalité la version définitive d'un poème écrit bien plus tôt, La Ligue. La Vie de Charles XII fait de lui un historien de premier plan, mais il révèle en 1751 tout son talent avec le Siècle de Louis XIV, qui ne plaît guère à la Cour et le met en disgrâce, à sa grande surprise. François Jacob montre bien les deux aspects assez contradictoires du personnage : d'un côté le courtisan, de l'autre, le philosophe qui veut en découdre avec les idées reçues et les injustices. Ses Lettres philosophiques l'ont contraint à la fuite en 1734. Il est élu à l'Académie française et obtient une charge officielle. Mais son démon ne le quitte pas ! Dommage que la dernière partie de sa vie soit narrée aussi brièvement car elle est celle de ses grands ouvrages. Mais on ne peut se plaindre : le biographe a êtres bien raconté son séjour en Angleterre et ses relations compliquées avec Frédéric II de Prusse, son guerre personnelle contre Jean-Jacques Rousseau. Mais s'il explique bien ce qui l'oppose au clergé, pas un mot sur son antijudaïsme présent dans le Dictionnaire philosophique et dans son Essai sur les moeurs. On le retrouve aussi dans sa correspondance et d'autres écrits : on ne peut donc pas l'expliquer seulement par sa façon détournée d'attaquer les dogmes chrétiens en se prenant à la Bible et à ses aberrations morales. Quoi qu'il en soit, cette une excellente manière de découvrir cette figure majeure de l'Ere des Lumières.

L'Enchantement du monde, Olivier Weber, Flammarion, 448 p., 22 euro.
Quelle déception ! Un si beau sujet, qui nous entraîne dans la Venise du XVe siècle et dans l'Istanbul à peine conquise par les Ottomans ! Et puis l'atelier des Bellini, avec le père Jacopo, les frères Gentile et Giovanni et aussi le beau-frère, Andrea Mantegna ! Mais la couverture avec la reproduction d'un des nombreux harems peints par Gérôme pouvait faire craindre le pire... C'est une sorte de roman feuilleton, avec des paires de phrases en guise de chapitre, des dialogues niais et surtout une superficialité vertigineuse. L'auteur n'a pas choisi un point de vu. Il survole son sujet, ne s'arrête sur rien, ni sur la personnalité de ses personnages, ni le rythme de l'action qui pourrait donner de l'élan à l'ensemble, ni sur les architectures fastueuses, ni sur ces populations bigarrées aussi bien d'un bord de la Méditerranée à l'autre. Ce roman n'a pas de consistance. Ni dans le récit, qui se traîne en longueur - le départ de Gentile Bellini pour se rendre jusqu'à la Sublime Porte dure 150 pages environ, et même là il ne se passe pas beaucoup de choses, sauf que son compagnon de voyage veut à tout prix l'entraîner au bordel ! La requête de Mehmet II le Conquérant n'était pas banale car il avait fait venir de la Sérénissime République, à l'aube de son déclin entrainé par la découverte de l'Amérique, pour la première fois un peintre chrétien pour faire son portrait. Ce sera d'ailleurs un phénomène unique dans l'histoire de cet Empire qui a fait tremblé l'Europe qu'il avait déjà commencé à conquérir, même si d'autres artistes venus d'Occident ont pu par la suite aller y travailler. Avec un tel programme, l'écrivain était contraint de nous offrir une merveille. Il ne nous a procuré qu'un gros livre un peu en creux et pas très exaltant. Pas d'intrigue, pas de vision sur ces deux arts si opposés, rien de très palpitant sur la cour de Topkapi ou sur les moeurs turques. Et, je le répète, une écriture peu inspirée, sans nerf et sans ces ingrédients qui rendent une prose passionnante.

En d'autres mots, Jhumpa Lahiri, traduit de l'italien par Jérôme Orsini, « Un endroit où aller », Actes Sud, 160 p., 16,50 euro.
C'est un livre vraiment passionnant et plaisant. Il prend appui sur le désir un peu singulier de l'auteur de pénétrer la langue italienne. D'apprendre l'italien n'a rien d'insensé ou d'extravagant. Elle nous narre ses premiers, pas, ses premières leçons, nous fait rencontrer ses premières enseignantes. Elle le raconte d'ailleurs avec beaucoup d'esprit et parfois de drôlerie. Mais cela devient une sorte d'obsession. Elle fait plusieurs voyages dans la péninsule. Elle ne se munie pas d'un guide de la ville qu'elle veut visiter, mais d'un petit dictionnaire de poche avec une couverture en plastique. Elle fait des listes de mots qu'elle ne comprend, tente de les apprendre, échoue, tente une autre façon de parvenir à ses fins. C'est pour elle aussi la source de réflexions sur la langue et sur l'écriture. Ses progrès sont scandés de l'arrive de nouveaux problèmes et de nouvelles difficultés. J'ai oublié de dire que Jhumpa Lahiri est un auteur anglophone (elle est Américaine). Cette conquête de la langue est pour elle une quête quasiment impossible, mais aussi la confrontation à ses propres limites : elle ne fera pas un chef d'oeuvre en italien ! Cela dit, des auteurs l'ont fait : Casanova avec le français, Conrad avec l'anglais... Quoi qu'il en soit, il en est sorti ce petit ouvrage qui est délicieux, merveilleusement écrit et qui nous fait partager cette lutte bizarre avec son démon du langage. C'est une petite merveille, qui n'a pas la prétention d'être plus que le journal d'une aventure intérieure, mais qui se révèle une très belle méditation sur le rapport compliqué que nous avons avec les mots et leurs agencements.

République-Bastille, Melpo Axioti, préface de Lucile Arnoux-Famoux, postface de Mairi Miké, Editions de la Différence, 192 p., 18 euro.
Colette Lambrichs a mis la main sur un beau manuscrit inédit (conservé à la Bibliothèque d'Athènes) d'un auteur grec, Melpo Axioti (1905-1973), qu'elle avait écrit en François lors de son séjour à Paris entre 1948 et 1949 avant d'être expulsée en Allemagne de l'Est. Cet ouvrage n'avait jamais paru ni en France ni en Grèce. Sans doute lui avait-il été commandé par Louis Aragon, qui recherchait des ouvrages exaltant l'action militante. Quoi qu'il en soit, ces pages sont assez étonnantes. Si elle raconte l'histoire d'une femme grecque, Lisa, qui était venu à Paris pour travailler pour le Parti communiste grec. Elle raconte son arrivée dans la capitale française, la découverte de son port d'attache, la station Jean-Pierre Timbaud, du monde parisien, de la vie qu'on y menait après guerre. Elle relate aussi la vie de cette femme, de cette émigrée qui se met à observer tout ce qu'elle peut voir avec une sorte de boulimie joyeuse. Dans son récit d'une vivacité rare, d'une tonalité rare, elle glisse des souvenirs de ce qu'elle a pu connaître pendant les années sombres dans son pays d'origine, des luttes de la résistance contre l'occupant, puis de la guerre civile, mais aussi des années plus heureuses de son enfance et de son adolescence. Et puis les foules, les luttes sociales se mêlent au destin singulier de cette femme qui v a longtemps dormir sur sa valise. Que le texte soit lacunaire ne gêne pas (on ne peut qu'exprimer des regrets) car cela n'en gêne absolument pas la lecture. C'est une écriture tonique, vivifiante, intense qui sous-tend cet apprentissage de la France, qui semble dans l'esprit de la narratrice un bienfait permanent en dépit des difficultés matérielles. Au milieu du bric à brac un peu monstrueux et désespérant de cette rentrée littéraire, toujours plus pléthorique et décourageante (pourquoi publier tous ces mauvais bouquins !), République-Bastille nous donne une splendide bouffée d'air. En dépit de son âge, ce roman n'a pas pris une ride -, il semble posséder une fraîcheur éternelle. Cet hymne à Paris se double de souvenirs douloureux sur la Grèce emportée par la tourmente du dernier grand conflit mondial et de ses conséquences. Et ce va-et-vient permanent entre la joie et l'affliction ajoute au charme profond de l'art de Melpo Axioti.

Le Feu de Jeanne, Marta Morazzoni, traduit de l'italien par Marguerite Pozzoli, Actes Sud, 192 p., 18,50 euro.
Ce n'est pas un roman à proprement parler, mais une sorte d'enquête et de rêverie sur un personnage qui est devenu une icône et une sainte : Jeanne d'Arc. L'auteur associe des données historiques, sa propre imagination car on est loin de tout savoir sur la vie de la petite paysanne de Domrémy, De plus, elle a entrepris un voyage dans tous les lieux où elle est passée : son village natale, Orléans, Compiègne, Reims, Paris, Rouen. Mais cela nous donne une sorte de récit où Marta Morazzoni reconstitue son existence (que nous connaissons tous plus ou moins) et des considérations de nature historique sur la guerre entre Anglais et Français pour s'emparer de la France et ses impressions des lieux qu'elle découvre. Je veux bien que les Italiens connaissent moins bien que nous cette grande affaire et qu'ils soient majoritairement catholiques, mais tout de même ! C'est visiblement un montage astucieux pour toucher le coeur des croyants qui n'en savent pas très long sur la vie de la Pucelle. Ce n'est une oeuvre de fiction et ce n'est pas une oeuvre de connaissance. C'est quelque chose de bâtard qui s élit facilement mais où la substance est assez maigre. Une sorte de carême sur le plan littéraire !
|
