
Geneviève Asse, peintures, Centre Pompidou/Somogy, 164 p., 29 euro
L'exposition de Geneviève Asse (au Centre Pompidou a été absolument remarquable. Bien sûr, on aurait préféré une belle rétrospective, car il est plus que temps de la faire en ce musée. Mais les deux grandes salles qui lui ont été réservé résume bien son histoire : dans la première, on découvre ses débuts et le développement de son oeuvre. On peut y contempler de belles compositions figuratives, comme La Cuisine (2946-1947), qui dénote déjà l'esprit de son esthétique : dépouillement, réduction des couleurs à l'essentiel, harmonies sombres et sourdes et pourtant séduisantes. Puis elle passe à une peinture à mi chemin entre les deux pôles opposés de l'époque : ce sont, dans la Nature morte bleue (1955), des objets posés sur un pan (une table ?) vu en perspective très accélérée. Ici les choses perdent leurs spécificités pour en obtenir une autre - celle d'objets purement esthétiques, décollés de la réalité, avec une imperceptibles relation avec elle. Puis elle passe au début de 1960 à un art strictement abstrait avec La Porte-fenêtre (plus qu'un hommage à Matisse, c'est une toile de ce maître qui lui donne accès à un autre univers). Depuis lors, c'est le blanc, le gris et le bleu qui dominent. On aurait pu dire qu'elle a été dès lors minimaliste. Mais elle est tout sauf une personne obsédé par la construction de la forme : elle a toujours désiré que ces plans chromatiques soient sources d'émotions, de sensations ambiguës et souvent sensuelles en dépit de l'apparente rigueur de ses mises en scènes. Ce fut un très longue et complexe cheminement. Plus sa peinture se dépouille, plus elle se fait complexe, plus en joue sur des registres subtils, dans les nuances de ses bleus gris par exemple. On a aussi le bonheur de voir dans ses carnets, commentés par Christian Biend et Silva Baron Supervieille, des carnets sans notes écrites strictement plastiques mais d'un raffinement exquis et sans fioritures pourtant. Les oeuvres sur papier qui ont été ensuite présentés à la galerie Catherine Putman complète cette manifestation et cette publication. Je le répète en attendant une rétrospective digne de ce nom.
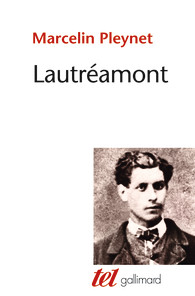
Lautréamont, Marcelin Pleynet, « Tel », Gallimard, 222 p., 12 euro
Paru pour la première fois en 1967 dans la collection « Ecrivains de toujours » (Seuil), l'essai de Marcelin Pleynet n'a pas vieilli trop. Seule les considérations sur la biographie de l'auteur sont datées et se ressentent des excès théoriques de « Tel Quel ». Pour le reste, tout ce qui concerne les sources des Chants de Maldoror et la difficulté à fournir une interprétation monolithique de cette oeuvre demeure passionnant et bien documenté. Cette étude sérieuse constitue une excellente introduction à une entreprise unique en son genre et fournie un riche matériau pour quiconque souhaite mieux connaître les tenants et les aboutissants d'une littérature qui n'a pas de référent en son temps. Pleynet insiste beaucoup sur l'influence de Charles et de son Melmoth The Wanderer. Mais il évoque aussi l'ensemble des hypothèses avancées par ses prédécesseurs. Et la liste paraît interminable. Il ne réfute pas la thèse d'un pastiche généralisé, mais en relativise les effets. A mon sens, il aurait pu mieux illustrer les emprunts à la poésie et aux romans de Victor Hugo. Là où le bât blesse un peu plus est quand il analyse les Poésies qu'il fait passer pour un contrepoint négatif des Chants de Maldoror. Cette théorie n'est pas absurde d'ailleurs, mais elle me semble un peu limitée. Quoi qu'il en soit ce Lautréamont est un ouvrage utile et intéressant, sans doute une bonne initiation à ce monde hors norme.

Jean Raine. Revoir la question, Gwilerhm Perthuis, Michel Descours, 64 p.
Le Belge Jean Raine (1927-1986) est s'est fait connaître comme poète. Ce n'est que tardivement qu'on a fini par connaître son oeuvre graphique. Cette exposition présentée à Lyon a réuni surtout des encres (dont de très beaux dessins d'animaux) et des compositions à l'acryliques, qui sont d'une violence autant dans la facture que dans l'enchevêtrement des couleurs. Je dois avouer éprouver une plus forte attraction pour ses dessins des années soixante qui allient un charme profond et une drôlerie irrésistible. Il s'est fait l'héritier (sauvage) d'Ensor et de Cobra, que l'auteur a réalisé pendant son séjour en Amérique. Jean Raine a depuis longtemps été apprécié par un petit groupe d'amateurs. Espérons maintenant qu'ils sortent de ce cercle étroit.
|
