
Picasso, les années Vallauris, sous la direction d'Anne Dopfer & Johanne Lindskog, Réunion des musées nationaux - grand Palais / ville de Vallauris, 256 p., 39 euro
Picasso - Picabia, la peinture au défi, sous la direction d'Aurélie Verdier, Somogy Editions d'Art / musée Grenet, Aix-en-Provence, 280 p., 35 euro
Le séjour de Pablo Picasso dans la petite ville provençale de Vallauris entre 1948 et 1955, correspond en partie la période pendant laquelle il a vécu avec Françoise Gillot et, à la fin de laquelle, il fait la connaissance de Jacqueline Roque. Cette période coïncide dans sa recherche avec le moment où la sculpture le passionne de nouveau (c'est alors qu'il a conçu La Chèvre). Cependant, la présence d'une petite industrie locale de céramique l'a incité s'intéresser de près à cette technique ; il a alors collaboré avec les ateliers Madoura et a produit un grand nombre de vases, de plats, d'assiettes, de bouteilles, de Gus et aussi quelques petites sculptures, toutes merveilleuses. Ce ne sont pas là des oeuvres majeures, mais elles sont le témoignage de son désir d'alors de revenir des choses simples, artisanales, et donc d'une manualité ancestrale. Il ne se veut pas novateur ou expérimentateur : il adopte la forme simple de ces objets. Cela ne l'a cependant pas empêché de produire des pièces remarquables, obtenus par les moyens les plus simples possibles. C'est un Picasso humble et soumis aux lois de la matière première et de la tradition. Il sait en tirer des effets parfois surprenants et tout aussi archaïsants que modernes. C'est aussi le temps où il se lance dans la linogravure, une autre technique simpliste par rapport à l'eau-forte. Il y excelle. A chaque fois, le monstre Picasso s'empare d'un moyen nouveau ou d'une technique ancienne et parvient à la faire sienne. Il ne faut pas oublier que c'est aussi le temps où il réalise la chapelle de La Guerre et la Paix qu'il peint à Vallauris en 1952 et qu'il complète en 1958 avec Les Quatre parties du monde. Les auteurs nous rappellent aussi que c'est une période d'engagement politique assez prégnant (on se rappelle de l'épisode mouvementé du portrait de Staline paru en première page des Lettres françaises la demande de Louis Aragon lors de la mort du dictateur). C'est enfin le temps où il accepte l'idée d'un musée Picasso Santiago de Lozoya, l'initiative d'Eugenio Arias. Peu après il va aussi accepter de peindre les toiles pour le musée qui lui sera entièrement consacré à Antibes. Ce catalogue est très bien fait, magnifiquement documenté et illustré et nous éloigne des considérations folkloriques sur la vie du peintre.
Singulière idée que de confronter au musée Grenet d'Aix-en-Provence ces deux artistes du début du siècle dernier, mais finalement, c'est une idée qui permet de comprendre les choix esthétiques les plus radicaux qui ont pu se produire alors. Le commissaire de l'exposition fait tout commencer par cette citation de Picabia qui a écrit en 1920 : « Picasso est le seul peintre que j'aime. ». La date est fondamentale : Picasso avait tourné le dos un temps à ses explorations cubistes pour en revenir à un style néoclassicisme virtuose. Quant à Picabia, il avait terminé sa période avec ses machines imaginaires, mais a continué à produite des compositions avec des formes abstraites et insolites (je veux dire par là qu'il n'a pas voulu aller dans le sens du formalisme). Picasso, à la même époque, a renoué avec le cubisme, mais dans une optique bien diverse, avec des assemblages eux aussi insolites et peu figuratifs. En somme, ce que démontre ce catalogue c'est que le chemin de ces deux hommes si dissemblables : certaines oeuvres dénotent une parenté indiscutable (mais il ne faut pas oublier que Picasso était un ogre et qu'il s'emparait volontiers des créations d'autrui pour les remodeler selon sa fantaisie gourmande). On ne peut s'empêcher d'être frappé par un tableau de ce dernier, Paris (1919), qui semble pasticher les portraits grotesques de Picabia ! Si ces « rapprochements » n'ont pas duré très longtemps, ils n'en sont pas moins révélateurs d'une communauté d'esprit, quelque soit la raison de ces curieuses similitudes pour l'un ou pour l'autre. Ce jeu va continuer jusqu'au moment où Picabia va réaliser ses chromos, qui sont le comble de l'auto ironie, à la fin des années trente. Mais leur communauté esthétique n'est déjà plus depuis un certain temps, car Picasso va vouloir s'affirmer comme le plus grand des surréalistes avec ses baigneuses sur la plage, sans rien devoir à Breton et au mouvement. Nous avons affaire à l'exposition d'art moderne la plus audacieuse et la plus enrichissante de l'année. Le catalogue est un atout précieux pour comprendre les deux artistes et quelles ont été leurs relations pour le moins déroutantes.

L'Ecole de Nancy, art Nouveau et industrie d'art, Somogy éditions d'Art /musée de l'Ecole de Nancy, 216 p., 25 euro
Il y a déjà longtemps qu'on a redécouvert et présenté les travaux des maîtres de l'Ecole de Nancy. Mais cette exposition et ce beau catalogue nous raconte l'histoire dans une optique différente : il s'agit de mettre en évidence pas seulement la création, mais aussi les modes de production et de diffusion de tout ce que les artistes ont pu créer, sans parler des magasins qui ont été édifiés. C'est d'ailleurs logique car il s'agit d'art appliqué. L'on n'ignore pas qu'Emile Gallé a donné vie à des oeuvres qui sont des pièces uniques. Mais, comme ses confrères, il a aussi produit des ouvrages qui ont été fabriqués à des tirages assez élevés pour ce genre de pièces en verre. Grâce à ce beau volume, on apprend quelles sont les entreprises qui ont participé à cet incroyable essor et aussi de quelle manière elles commercialisaient leurs produits, par un système de distribution et par la publicité. On découvre que Gallé avait un véritable atelier de verrerie (mais aussi des meubles très sophistiqués). La manufacture Daum a joué aussi un rôle essentiel dans la décoration d'intérieur (surtout des vases et des lampes) et la manufacture Keller et Guérin produisait de la faïence au tout début du XXe siècle dans un esprit imitant le Siècle des Lumières. Quant à l'atelier Vallin, il s'était spécialisé dans la conception de meubles aux formes très originales, mais sans indication du nom de ceux qui les avaient dessinés. Enfin, on peut voir de beaux travaux de textiles (comme ceux de Léon Dugand et de Thérèse Martin, sans oublier les imitations de chinoiseries par Charles Fridrich en velours), des vitraux et des pièces de ferronnerie, qui nous montrent quelle a été la vitalité de cette période à Nancy. Même des architectures ont été planifiées et réalisées, ce qui n'est pas l'objet de ce volume bien documenté et bien illustré.

Pastels du musée du Louvre XVIIIe - XVIIIe siècle, Xavier Salomon, Louvre Editions : Hazan, 360 p., 39 euro
Cette année semble dédiée la redécouverte de l'art du pastel avec les exposition du Petit Palais à Paris et de l'Hermitage de Lausanne. L'ouvrage contient une histoire très détaillée de ce genre dans les collections de ce grand musée, qui est sans conteste l'une des plus belles en Europe. Mais, en fin de compte, la réunion de ces oeuvres a suivi le mouvement de réforme des collections royales en 1793 et en 1794 et leur fusion en une seule institution. Quoi qu'il en soit, cette collection n'a pas cessé d'être enrichi au cours des décennies suivantes. La partie la plus intéressante de ce catalogue est sans aucun doute la première car elle concerne une période mal connue dans ce domaine ; on y voit les différents portraits de Louis XIV exécutés par Charles Le Brun, d'autres portraits et des pièces réalisées dans son atelier qui sont d'une grande beauté, plusieurs portraits de la main de Robert Nanteuil, une Vierge en prière de Sassoferrato, ainsi que des portraits signés par Joseph Vivien et Pierre Simon. Ces pièces nous font la démonstration que le pastel était encore confiné à un office très précis : la représentation du visage humain. Le siècle suivant, il en est tout autrement. Pour s'en convaincre, il suffit de voir les oeuvres de François Boucher, qui sont souvent de charmants divertissements. Bien sûr, l'art du portrait est encore dominant, comme on le constate avec les Autoportraits facétieux de Chardin et les portraits somptueux de Maurice Quentin de La Tour. Et Madame Vigée-Lebrun atteint des sommets dans ce domaine. Mais il faut prendre aussi en considération les paysages pittoresques de Jean Pillement. Les études de Prud'hon marquent aussi un renouveau dans les genres abordés. Mais ce n'est encore là que l'ébauche d'un élargissement du champ accordé çà cette technique. Malgré tout, on peut observer l'évolution du portrait avec une plus grande liberté dans le traitement des sujets. Plus de sensibilité et plusieurs manières de faire poser la personne. C'est absolument merveilleux, car cette collection est immense avec des ouvrages de premier plan. On regrette seulement qu'il n'y ait pas plus de pastels de la Vénitienne Rosalba Carriera, l'une des plus douées dans cette sphère.

Rodin et la danse, Hazan / musée Rodin, Paris, 192 p., 35 euro
Auguste Rodin fait partie de ces artistes dont l'oeuvre est incommensurable. Il est presque impossible de la connaître dans son ensemble, car il a été explorer des régions les plus diverses qui soient. Mais ce grand créateur, souvent d'une audace rare pour son époque (il suffit de songer à la statue de Balzac qui se dresse au carrefour Vavin, qui a été brocardée en son temps), avait toujours des désirs à satisfaire dans l'art de la sculpture. Et le plus impératifs de tous sans doute été celui du mouvement. S'il a su à merveille animer ses Bourgeois de Calais, cela n'aurait pu le satisfaire. Il voulait aller plus loin. Et la danse lui a apporté le paradigme nécessaire à sa quête toujours plus ardente de la vie qu'il entendait imprimer à ses sculptures. Il a été admirer les chorégraphies de Loïe Muller, d'Isadora Duncan, de Valentine de Saint-Point, qui s'est voulue futuriste, de Hanako, de Ruth Saint-Denis, de l'acrobate Aida Moreno, entre autres. Il a aussi été sensible aux danses folkloriques et populaires. Mais il a surtout été émerveillé par les danseuses javanaises qui se sont exhibées lors de l'Exposition universelle de 1889 et par les danseuses cambodgiennes qui sont venues à Paris en 19o6 (il a exécuté beaucoup de dessins les représentant). Tout ce que pouvait le conduire là où il tendait l'avait intéressé au plus haut point. Ses Mouvements de danse (des plâtres accompagnés de superbes dessins, réalisés vers 1911 - un bronze a été fondu cette même année) sont des études importantes à nos yeux car elles nous permettent de voir à quel point il cherchait là une issue à son aventure artistique (c'était alors un homme déjà âgé). Malheureusement la recherche a pris le pas sur la concrétisation dans la pierre, le marbre ou le bronze. Cette partie si importante de sa pensée sur l'art ne subsiste pour nous qu'à travers des planches en couleurs ou en noir et blanc et des modèles en plâtre. Mais ce catalogue nous fait découvrir que Rodin vieillissant était encore loin d'avoir donné toute la mesure de son art. Voilà un instrument indispensable pour méditer sur la dynamique de l'esthétique du grand sculpteur.
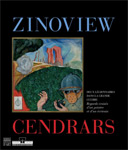
Zinoview / Cendrars, deux légionnaires dans la grande guerre, sous la direction de Patrick Carantino, Somogy Editions d'Art /musée de la Légion étrangère, 128 p., 25 euro
Le 2 juillet 1914, un appel rédigé par le Suisse Blaise Cendrars et Riccioto Canudo paraît dans Le Matin : le poète et le critique italien appellent les étrangers s'engager dans la Légion étrangère pour combattre pour la France. 8.ooo hommes venus des quatre coins de la Terre répondent cet appel. Bientôt ils sont trente mille ! Dans ce très bel album, sont mis en relation les textes de Cendrars, en particulier ceux tirés de J'ai tué, de La Main coupée, de Moravagine, de L'Homme foudroyé, de La Vie dangereuse, sont mis en regard avec les dessins et les huiles sur carton ou sur bois du peintre russe Alexandre Zinoview, dit Zito (né Moscou en 1889, mort à Paris en 1971). Ce dernier a combattu dans la Légion étrangère dès la fin août partir de au sein de la Légion étrangère jusqu'au printemps 1915, quand l'ambassadeur russe contraint ses compatriotes à rentrer en Russie ou dans l'Ambulance russe. Il choisit cette dernière solution. Comme peintre, il a déjà exposé au Salon des Indépendants en 1911 et en 1913, année où Guillaume Apollinaire le remarque dans un article. Il parvient à réaliser quelque chose de très singulier et aussi de très saisissant : il est parvenu rendre le spectacle de la guerre, avec tout ce que cela comporte, avec un réalisme assez cru, tout en ne renonçant pas à une composition picturale ou graphique de caractère moderniste. Ce qui fait de ces oeuvres d'une part un document saisissant sur la vérité des combats et de la souffrance des hommes appelés sous les drapeaux, mais aussi un ensemble qui en fait une sorte d'historien talentueux. Il ne dissimule rien de l'horreur de ces années sous le feu. Mais il ne dramatise pas non plus. Il veut rendre hommage ses frères d'arme. Il le fait non seulement avec humanité, mais aussi avec une certaine poésie, pour montrer que les combattants n'ont pas perdu leur âme malgré les souffrances et la violence extrême du conflit. Il ne veut pas donner une leçon de morale, mais laisser la trace de tous ces hommes pris dans ce piège infernal. C'est une création inoubliable.

Cedrix Crespel, Somogy Editions d'Art /Montresso Foundation, 252 p., 29 euro
La conception graphique de cet ouvrage a de quoi surprendre. Le premier cahier consiste en une accumulation de reproduction de tableaux en noir et blanc sur un fond rose. En dehors de l'aspect esthétique douteux, c'est impossible à comprendre. Par la suite nous voyons, heureusement des oeuvres de Cedrix Crespel, qui semblent être un lointain avatar de la figuration narrative, avec une légère touche de surréalisme. C'est un univers très coloré avec des lignes épaisses de couleurs qui ajoutent une pointe d'abstraction un travail figuratif très appuyé, mais avec un traitement chromatique qui le rend excessif et irréel. On est plus près d'un travail de graphiste que d'un travail de peintre. Selon les cas, la proportion entre le figuratif et l'abstrait est très disproportionné, ce qui rend la production pictural de Cedrix Crespel plutôt décoratif, en dépit de la relative violence du geste et des traces imprimées la surface de la toile. Il est évident que l'artiste a recherché une certaine originalité dans une sphère d'expression déjà datée (on songe aux années 197o). Les textes ne nous aident pas car leur typographie est tellement minuscule qu'il n'est pas possible de lire les essais qui devraient nous éclairer sur la démarche de ce peintre que nous ne connaissons pas. Il ne manque pas de qualités, mais il a voulu jouer des cartes déjà bien usagées et qui ont fait leurs preuves en les mélangeant et en en tirant une sorte de synthèse faite pour étonner mais surtout pour flatter le goût des amateur de ce genre de courant esthétique. Il n'y a pas de biographie ni de liste des expositions, rien pour aider le lecteur savoir qui est véritablement ce personnage ? Etrange, n'est-ce pas ?

Abbaye Notre-Dame de Tournay, Jean-Loup Ménochet, Editions du Regard, 12o p., 29 euro
Il existe en France un tourisme très ancré des cathédrales, des abbayes et des églises. L'abbaye de Tournay fait partie de ce pèlerinage qui n'est pas nécessairement religieux : bien que ce ensemble désormais imposant soit moderne, les amoureux de l'art médiéval y trouveront le plaisir d'y trouver les trace de cette culture dont Auguste Rodin a si bien su parler. L'histoire de cette abbaye n'est pas banale car elle est l'héritière d'un prieuré bénédictin qui a été fondé à Madiran et qui a existé jusqu'au XVIIe siècle. Il dépendait de l'abbaye de Marcilhac, remontant au XIe siècle celle-là et qui est devenue une simple église avec la Révolution française. Ce sont des moines de l'abbaye d'En-Calcat (cette communauté a vue je jour au XIXe siècle dans le Tarn) qui ont racheté ces bâtiments en ruines et s'y sont installés en 1934. Puis toute la communauté s'est transférée à Tournay et un noviciat y a été adjoint en 1941. Le monastère proprement dit a été construit en 1952 et terminée en 1952. L'église a été édifiée en 1958. Un alumnat y a été instauré et des cours y ont dispensés jusqu'au début des années 1970. Dans ce bel ouvrage, le lecteur peut suivre les étapes de cette création. L'architecte Jacques de Saint-Rapt, déjà responsable de l'urbanisme de la région, accepte de s'occuper du chantier sur les bords de l'Arros. Ce vaste ensemble respecte scrupuleusement les règles de saint Benoît. Il donne de loin l'impression d'un édifice du Moyen Age. On se rend compte, surtout quand on observe de plus près l'église que tout est moderne, mais réalisé au plus près de l'esprit des bâtisseurs d'autrefois. Ce projet a été imaginé par des bénédictins avec l'architecte dans le but de retrouver l'essence de édifices anciens. En revanche, les cellules ont été construites dans une facture moderne, comme d'ailleurs l'intérieur de l'église. Le maître-autel, conçu par l'architecte est de facture moderne comme tout le mobilier liturgique. Les vitraux verticaux et étroits de Jean Lesquibe ont aussi ces mêmes caractéristiques : respect de la tradition, mais conception moderne. Dans le réfectoire, une fresque intéressante a été peinte par un des frères. Voilà une aventure mal connue et qui doit être considérée comme un des rares exemples d'une synthèse entre deux époques lointaines très réussie.

Quand la Suisse ouvre ses coffres, trésors de la Visitation de Fribourg, Somogy Editions d'Art / musée de la Visitation, 32o p., 42 euro
Freiburg, en Nuithonie, capitale du canton suisse du même nom, est une ville bilingue, aux confins de la Suisse romande et le Suisse alémanique. Elle a été fondée en 1157 par le duc Berthold IV de Zaehringen au-dessus de la Sarine. Elle st passée la Savoie en 1452 et est redevenue indépendante par les guerres de Bourgogne et a rejoint la Confédération helvétique en 1481. Enclavée dans le canton de Berne, elle est catholique et francophone. Elle a connu une expansion démocratique et urbanistique au cours du XIXe siècle. Fribourg a conservé l'un des plus riches patrimoines médiéval en Europe. Dans ce somptueux catalogue, on découvre quelque chose de peu connu : l'église des Visitandines et le monastère de la Visitation, qui a été fondé en 1635 dans l'ordre voulu au début du XVIIe siècle par saint François de Sales et Jeanne de Chantal par des soeurs chassées d'Annecy à cause de la Guerre de Trente Ans. Elles y ont créé une école et puis un pensionnat et elles se sont adonnées aux travaux de broderie de linge de maison. Si la communauté existe encore de nos jours, elle possède un musée d'une richesse incroyable. L'exposition nous fait découvrir les bâtiments, qui n'ont cessé de s'agrandir au fil du temps. On peut y voir des portraits anciens des soeurs, et ensuite des photographies. Mais on découvre aussi et surtout de merveilleux exemples de vêtements ecclésiastiques et de pièces de tissu servant l'office (les motifs floraux y sont privilégiés), la sacristie étant devenu le réceptacle des travaux d'aiguille des membres de la communauté et de leurs élèves. On peut aussi découvrir des livres enluminés de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, qui sont d'une qualité exceptionnelle étant sonné l'époque où ils ont été réalisés. Ce qui est frappant que les meubles et objets qu'on trouve dans l'église ou dans les autres corps de bâtiments sont anciens, comme les poêle en faïence, mais d'autres sont très récents : la tradition instituée en ces lieux se prolonge encore de nos jours, dans un ordre d'idée qui n'est pas dérisoire et saint-sulpicien. C'est assez surprenant et d'un intérêt indéniable.

La Grotte de Clamouse, Philippe Crochet & Annie Guiraud, Somogy Editions d'Art / la grotte de Clamouse, 1o4 p., 13 euro
La nature offre le spectacle de la beauté. Kant distinguait la beauté, née de l'artifice de l'esprit humain et le formidable, fruit du spectacle de la Nature. Ce distinguo n'est pas entièrement faux, mais il peut conduire à penser que le monde qui s'offre à notre contemplation n'est grand que par la démesure. Dans le cas présent, ces gorges de l'Hérault que Philippe Crochet a magnifiquement photographiées, conjugue ces deux notions. Il y a quelque chose d'impressionnant et de démesuré dans ce que les roches et l'eau peuvent produire au gré des siècles. Mais il y a aussi quelque chose de profondément esthétique, qui fait songer à des sculptures irréelles. Des stalactites aux fistuleuses, en passant par les plus insolites effloraisons minérales, on se faufile dans une oeuvre en perpétuelle métamorphose aux formes les plus insolites et aussi les plus fascinantes. La variété infinie des inventions plastiques qui ont été engendrées par le jeu des éléments sous terre est rendu ici avec une rare qualité. Après avoir vu l'univers pétrifié de Clamouse on ne peut qu'être frappé par cette beauté si étrange qui échappe à la faculté de l'homme d'inventer des espaces aussi puissants et fantastiques.

Vincent Bebert, sous la direction d'Yves Michaud, Somogy Editions d'Art/ galerie Pome Turbil, 12o p., 25 euro
Je dois avouer que je ne connais pas l'oeuvre de Vincent Bebert. Cet artiste âgé de quarante-huit ans travaille à rebours de ce que l'art contemporain nous présente le plus souvent l'heure actuelle. Mais, mesure qu'on la découvre, on se rend compte qu'elle est d'une relative originalité. Une toile, au début du livre, m'a frappé plus que toute autre : Le Grand frêne (2o1o). La reproduction ne présente qu'un détail de la toile où l'on voit un grand ciel bleu sombre avec un soleil sans éclat et une terre labourée (semble-t-il) bordée l'horizon s'une rangée d'arbres. Le contraste des bleus obscurs du ciel et des arbres et de la terre brun sombre est assez frappant. Mais le ciel est aussi sujet à des mouvements et des turbulences peu réalistes qui font penser à la fois au Greco et à Van Gogh, à Turner et à Nolde. C'est aussi irréel que poétique, émouvant et sourdement violent. L'artiste n'est pas naturaliste : on voit bien des arbres, par exemple, mais ses arbres sont traités de telle sorte qu'ils sont déréalisés en partie. Ils deviennent de troublants objets picturaux. Manifestement, le peintre aime jouer sur cette ambiguïté, qui place chacun de ses sujets aux limites du visible ou, plus exactement, fait du visible une zone intermédiaire entre ce qui est de l'ordre de la représentation et ce qui est de l'ordre de l'imaginaire. Ses paysages de montagnes sont troublants, car on ne perd pas l'idée du massif rocheux, mais on perd par endroit la limite entre le minéral et le céleste, entre les couleurs propres à la végétation, au ciel et à la pierre. Il ne capture le regard du spectateur que par une lente pénétration dans son univers plastique. En fin de compte, on est conquis. C'est là un brillant tour de force chargé de poésie.

Studiolo, dossier Le Désir, n° 17, revue d'histoire de l'art de l'Académie de France à Rome, Villa Médicis / Somogy Editions d'Art, 392 p., 29 euro
Cette luxueuse et copieuse revue publiée par la Villa Médicis de Rome a choisi comme thème son dernier numéro « le désir ». Joli argument s'il en est ! Et le premier article signe Maurice Broch nous fait découvrir un petit livre qui ne parle pas d'art du Florentin Agnolo Firenzuola (1493-1543) et qui a pour titre : Dialogo delle bellezze delle donne intitolato Celso, écrit à Prato en 1541. Pour l'auteur cet écrit trouverait ses sources dans Lucien de Samosate, qu'il cite, mais sans parler de ses Portraits. Dans ces pages qui ont paru après sa disparition, l'auteur ne traite pas de la beauté idéale, ou d'une beauté précise, mais de différents types de beauté. L'auteur s'applique dans un premier temps à expliquer les six critères de la beauté féminine et développe ce qu'il entend par « vaghezza», qui tire de Pétrarque et de Boccace. C'est ici une nouvelle conception, qui s'impose dans le regard porté sur la gent féminine. Ces définitions, difficiles à déchiffrer aujourd'hui, marquent néanmoins un tournant dans la représentation de la féminité et ouvre la voie au maniérisme. D'autres études ont retenu notre attention, celle sur Winckelmann, celle sur la jeunesse du Bernin (il s'agit ici de ses sculptures) et celle d'Alessia Rizzo sur les expositions de la place Dauphine (qui sont devenues le salon de la jeunesse). Ce numéro énorme (je crois que cette revue aurait tout à gagner être moins pondéreuse car un numéro comme celui-ci pourrait en faire aisément deux déjà bien nourris) est d'une richesse peu commune et constitue la meilleure revue d'histoire de l'art ancien qui existe en France. Dommage qu'elle paraisse un peu en catimini.

Orlando, Virginia Woolf, traduit de l'anglais et présenté par Jacques Aubert, Folio classique, 416 p., 6,6o euro
Virginia Woolf (1882-1941) a publié Orlando en 1928. Cet ouvrage a été traduit trois ans plus tard en français. Son titre original est Orlando : A Biography. Elle en parle comme d'un « livret », ce qui est un peu surprenant. Mais, comme le titre l'indique, la volonté de l'écrivain a été de faire le portrait très détaillé d'un personnage, ce qu'elle avait déjà un peu fait dans Mrs Dalloway, publié trois ans plus tôt, où elle évoque de manière transparente des figures de sa famille proche. La construction de l'oeuvre est assez complexe et Virginia Woolf a pris des risques calculés en le composant : elle fait des expériences non seulement dans l'écriture en mêlant plusieurs genres (le livre se lit comme un roman d'aventure et un roman picaresque), mais aussi dans le choix de la figure centrale, Orlando, qui est un androgyne. Celui-ci est aussi en révolte contre la structure traditionnelle du cercle de famille : elle conteste le pouvoir paternel. D'une certaine façon, c'est un autoportrait déguisé et déformé. Ce n'est que trop évident de par la dédicace à Vita Sackville-West avec laquelle elle a une relation amoureuse. Un autre aspect fondamental de ce roman est qu'il traverse plusieurs siècles. Tout commence à l'époque d'Elisabeth I, dont le jeune aristocrate Orlando devient le favori ; On le retrouve au tout début du XVIIe siècle. Cette fois, il tombe amoureux de la fille de l'ambassadeur de Russie. Il souffre de la rupture avec la jeune femme et se lance dans une curieuse campagne de rêves, puisqu'il décide dormir pendant une semaine d'affilée. Il décide de partir comme ambassadeur en Orient et répète cette plongée dans le sommeil ; il se réveille sous l'aspect d'une femme. Il partage alors la vie des Tziganes pour jouir de la même liberté qu'eux. Il rentre en Angleterre et se consacre alors l'art poétique. Il vit entre deux mondes opposés : celui de la haute société et celui des filles de joie. Puis il tombe amoureux d'un lord. Tout s'achève en 1928, quand Orlando redevient femme et connaît une certaine fortune avec sa poésie. Ce roman sommairement résumé est d'une incroyable audace, par le thème chois et par sa conception qui reprend une grande tradition littéraire anglo-saxonne pour la transposer dans un univers moderne.

Du style de Léon Bloy, suivi d'un glossaire de ses mots rares, Daniel Habrekorn, DMM, 168 p., 15, 5o euro
Daniel Habrekorn est depuis longtemps un passionné de Léon Bloy. Il a édité ou réédité plusieurs de ses livres, sa correspondance avec Villiers de l'Isle-Adam et sa revue, Le Pal dans a propre maison d'édition, Thot. Cette fois-ci, il expose en détail l'attitude stylistique de l'auteur du Salut par les Juifs. Celle-ci s'inscrit dans la ligne des grands écrivains du XIXe siècle. Théophile Gautier, Gustave Flaubert, Jules Barbey d'Aurevilly J.-K. Huysmans, ont été, pour ne citer qu'eux, de grands inventeurs dans l'écriture. Leurs inventions verbales sont assez extraordinaires, surtout quand on songe à la transparence recherchée entre la langue et la pensée le siècle précédent. A l'égal de Léon Bloy, il n'y a guère qu'Arthur Rimbaud, dans un registre bien différent, pour avoir osé tant de tels baroquismes. L'auteur illustre quelques uns des principaux registres de cet art de la création d'une langue qui excède les bornes de la langue telle qu'elle est consignée dans les grands dictionnaires qui paraissent en son temps, le Larousse et surtout le Littré, référence incontournable encore de nos jours. Il nous montre de quelle façon cet écrivain hors norme s'employait à mettre en liaison des mots qui formaient des images insolites, très curieuses ou franchement choquantes (il explique comment le discours ordurier et même excrémentiel entrait dans cette savante reconstruction du langage). Habrekorn montre que, d'une certaine façon, il avait précédé les surréalistes dans ce penchant à produire des « peintures » inédites et il souligne le fait que Bloy était peintre -, pas la façon de Gautier (qui avait vraiment été artiste ses débuts), mais dans la transformation d'un essai en un virtuose agencement de figures parlantes dans une sorte de boulimie où il adorait forcer le trait. Quand il parle de ses contemporains, il a pris un plaisir fou à les définir en quelques mots foudroyants parfois. Par exemple, voici ce qu'il disait à propos d'Emile Zola : « le Christophe Colomb, le Vasco de Gama, le Magellan, le grand Albuquerque du Lieu commun. » Pas d'outrances ici, mais un panégyrique à rebours. George Sand connaît en sort encore pire : « cette vieille chaussette bleue. Cette fille trouvée du cuistre Jean-Jacques». Mais c'est dans sa prose extravagante et mal embouchée qu'il parvient à être d'une incroyable modernité stylistique. Son aigreur, son iconoclastie et sa rage furieuse, sa foi hyperbolique et ses convictions bizarres l'autorisent à des formules invraisemblables, mais qui font mouche. On lira aussi avec délectation ce long glossaire des mots élus de Bloy, qui ne sont pas nécessairement inventés, mais peu usités, qui emplissent ses textes et les rendent inoubliables. C'est un livre à la fois plein d'enseignements, mais aussi d'une lecture jouissive.

Fils d'Adam, nostalgies communistes, Benoît Rayski, « récits », Exils, 112 p., 15 euro
Plus qu'une lettre (c'est la forme choisie par l'auteur), c'est un hymne, un chant, parfois un poème lyrique adressée (ou en son honneur) à son père. Tout repose sur la confusion de deux états : d'abord celui d'être Juif (qui est un don ou une calamité, selon le point de vue adopté) et le fait d'avoir choisi d'être communiste. Dans le récit de cet homme qui s'est en réalité appelé Abraham sa naissance, originaire de Bialystok en Pologne, qui a participé à la Résistance en France dans les rangs des FTP-MOI. Le fils rend hommage à ce père courageux et écrit ce long texte pour relater son histoire et l'histoire du monde qu'il a connu, mais pas selon une chronologie stricte : il recompose comme un puzzle les moments de son existence entre deux pays, celui de ses ancêtres et celui qui l'a adopté tant bien que mal. C'est plus que l'histoire d'un individu qui a vécu l'antisémitisme virulent des Polonais ou l'aventure des adhérents au PCF pendant la période stalinienne (chacun ayant vécu sa façon la relation la patrie du socialisme et au Petit père des Peuples : avec beaucoup d'illusions ou peu, avec une certaine utopie ou avec une détermination aveugle, souvent en rêveurs. Et ce père est retourné en Pologne et y a eu de gros ennui après en avoir eu aussi en France, où il a été condamné par un tribunal militaire. Il a connu les heures héroïques et tragiques du militantisme dans le maquis et aussi les persécutions antijuives dans son pays devenu communiste. Il résume en partie les vicissitudes souvent paradoxales de cet engagement, avec toutes ces contradictions qui sont devenues difficiles comprendre de nos jours. Son parcours est singulier et le fils le relate avec passion. C'un beau parcours mouvementé, semé de mille embuches et chacune des épreuves affrontées est narrée en détail, mais sans jamais entré dans les arguties sur le pour et le contre du régime dictatorial ou des orientations du parti. Comme son père est enterré au cimetière du Père Lachaise, il songe aux insurgés de la Commune dont les derniers ont été fusillés devant le mur où a été apposé une énorme plaque leur mémoire (la mémoire d'un massacre de masse). C'est un beau livre, qui touche le lecteur, qui lui fait découvrir cette époque si étranges en dehors des traces qu'elle a laissées dans notre histoire. C'est un livre d'amour et de reconnaissance qui ouvre les yeux sur la vérité de la politique en un temps où le fascisme a tenté de conquérir tous les esprits et puis le monde entier.

La du Barry, Edmond et Jules de Goncourt, préface de Jean-Claude Bonnet, « Petite Bibliothèque », Rivages poche, 480 p., 10 euro
Jules (183o-187o) et Edmond (1822-1896) de Goncourt n'ont pas seulement écrit des romans ou leur célèbre Journal. L'essentiel de leur oeuvre est même consacrée l'histoire et l'histoire de l'art. Leur période de prédilection est le XVIIIe siècle, et ils ont écrits de nombreux ouvrages sur cette période dont Portrait intimes du 18e siècle, Histoire de Marie-Antoinette, La Femme au dix-huitième siècle, Madame de Pompadour, L'art du XVIIIe Siècle. Cette histoire de Mme du Barry est d'ailleurs issue de leurs Portraits intimes et augmente considérablement cette biographie. Anne Bécu de Cantigny, qui a été la fille de Fabien Bécu (cuisinier) et de Jeanne Husson, a été la mère de Jeanne. Mais on ignore qui en a été le père. Celle enfant naturelle est devenue vendeuse dans une boutique de mode à Paris et se faisait appeler de Vaubernier, nom de son père présumé. Elle st devenue la maîtresse du comte de Barry-Cérès. Elle est présentée en secret au roi par l'intermédiaire du maréchal de Richelieu. Louis XV voulut la marier et elle a dû épouser le frère cadet de son amant, Guillaume Dubarry en 1768, qui a été aussitôt renvoyé dans ses terres languedociennes. C'est un an plus tard que la présentation officielle est organisée et elle est alors devenue la favorite royale. Mais elle ne s'occupa pas des affaires politiques. Les amis de Choiseul l'ont attaquée avec virulence et Pidensat de Mairobert l'a brocardée dans ses Mémoires secrets. La jeune dauphine, Marie-Antoinette ne lui adressait même pas la parole. Toutes ces tracasseries et dénigrements ont fini par irriter le roi au point de renvoyer Choiseul en 1771. Bonne dessinatrice, elle s'est intéressée aux arts, prit parti pour le néoclassicisme et finit en sorte que Ledoux construisit son pavillon de musique à Louveciennes. Elle apprécia Fragonard et Greuze. Elle prisait les beaux meubles et, ayant bon goût, elle a été à l'origine du styler Louis XVI. A la mort du roi, Louis XVI a fait délivrer une lettre de cachet contre elle, a été conduite dans un couvent et on a saisi ses papiers. En 1776, elle est retournée au château de Louveciennes. Elle y a reçu Madame Vigée-Lebrun, qui a fait trois portraits d'elle. Elle partit en Angleterre pendant la Révolution, revint en France, elle fut arrêtée et enfermée à Sainte-Pélagie. Elle fut exécutée le 18 frimaire de l'An II. Les Goncourt ont étayé leur récit sur des documents publiés en annexe de leur livre, des lettres, les commandes d'articles de mode faite par la duchesse (avec tous les comptes, qui donnent le vertige), l'affaire du vol de bijoux chez elle en 1791 et aussi tout ce qui concerne son procès. Ils ont voulu réhabiliter cette femme calomniée depuis son arrivée à la cour et dont on avait largement déformé le caractère et les agissements.

Infidèle, Joyce Carol Oates, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Claude Seban, « Points », 618 p., 8,90 euro
Joyce Carol Oates est un des auteurs les plus prolifiques des Etats-Unis de ces dernières décennies. Son talent n'est pas à mettre en question, mais il y a quelque chose dans sa relation à la littérature de fiction qui la fait outrepasser les bornes de la raison. Elle n'est pas bavarde, mais a une fâcheuse tendance à délayer son propos et comme elle n'est pas dans le même registre que James Joyce quand il a composé Ulysse, cela devient son péché mortel ; quoi qu'il en soit, Infidèle est pour moi l'une de ses meilleurs oeuvres de fiction. En associant parfois son penchant pour l'enquête de nature psychanalytique, un goût prononcé pour le réalisme qui est cependant accompagné d'une plongée dans le monde onirique et le fantastique (dans ce livre, elle déclare son grand amour pour les contes d'Edgar Allan Poe) elle donne naissance à un genre qui n'appartient qu'à elle. Ces vingt-et-une nouvelles condensent son art narratif et en montre toutes les facettes, qui prouvent qu'elle capable d'aborder toutes sortes de questions dans des optiques différentes. Elle n'a pas eu l'ambition de traduire la face obscure de l'American Way of Life, mais elle a néanmoins moins éprouvé le désir d'exhumer tous les démons qui l'animent et la corrompent et qui se traduisent d'abord par une relation perverse et biaisée à la sexualité. L'histoire centrale qui est celle de cette jeune femme mariée qui disparaît en laissant derrière son mari et ses deux filles est superbe : ses deux enfants recomposent en grandissant, chacune à leur façon, l'histoire de cette mère pécheresse. Elle examine leur manière de réagir à cette perte douloureuse avec une pénétration exceptionnelle. En somme, voilà un recueil qui mérite notre attention, en sachant quels sont les défauts propres à cet écrivain, qui possède assez de qualités pour qu'on ne lui en tienne pas rigueur.

Afrique, les religions de l'extase, Somogy Editions d'Art / musée d'Ethnographie de Genève, 234 p., 32 euro
Ce catalogue constitue une sorte de micro encyclopédie des pratiques religieuses en Afrique. On peut être surpris que tout commence ici avec le christianisme avec l'orthodoxie en Erythrée, le catholicisme dans les anciennes colonies françaises et les sectes protestantes, qui ont pris une importance considérable depuis la période coloniale. Ce n'est qu'après qu'on découvre les religions natives comme l'animisme et le vaudou. Les textes d'explication sont très courts (trop courts à mon goût) mais les photographies sont souvent très belles et très judicieuses. La partie la plus belle est sans aucun doute celle qui concerne les objets rituels, des masques aux objets rituels magiques, des statuettes aux peintures de Mami Wata jusqu'aux minikisti, ces objets forces des Kongo. L'ouvrage est vraiment passionnant dans cette partie là, qui aurait dû, à mon sens, être bien plus développées. Mais le tout constitue une bonne introduction à la mystique sous toutes ses formes qui s'est développée de mille façons différentes en Afrique.

Journal d'un étranger à Paris, traduit de l'italien par Gabrielle Cabrini, « La Petite Vermillon », La Table Ronde, 36o p., 8,9o euro
Après la dernière guerre, Curzio Malaparte (1898-1957) a passé deux années à Paris (1947 et 1948). Il fréquente des milieux intellectuels qu'il avait connus avant le conflit (d'Emmanuel Berl à François Mauriac). Il jette un regard amusé et caustique sur la manière dont ce petit monde se représente le monde. Il s'amuse de l'énorme influence de Sartre, qu'il voit se limiter aux frontières de l'hexagone et surtout sue concentrer au Café de Flore. Il observe avec un curieux mélange d'admiration et de franche critique comment les François ont conscience d'eux-mêmes et de leur histoire. Il est exaspéré par certains modes de pensées : quand il parle de l'insurrection de Varsovie, ses interlocuteurs lui rétorque qu'il y a eu le soulèvement de Paris ! Il a aussi une réflexion très pertinente sur la campagne de 194o : il est convaincu que les soldats français se sont bien battus, mais que leur Etat-major les a abandonné, par stupidité ou même par d'obscurs desseins. Il fait ailleurs l'éloge de la femme française. Aucun sujet ne lui est étranger et ses impressions sont vraiment passionnantes car il connaissait bien notre pays et y avait de solides amitiés. Ces pages ne sont pas celles d'un sage, mais d'un homme passionné et donc peu porté l'objectivité. Il s'enflamme et parfois s'égare. Mais peu importe : ses réflexions sont toujours intéressantes. Et il défend souvent les Italiens, accusés de tous les maux à cause du fascisme : il souligne par exemple que les écrivains de la péninsule, même adepte du fascisme, comme Pirandello, n'ont jamais écrit en sa faveur. Et je dois dire que c'est vrai. Seuls quelques futuristes, dont Marinetti, ont fini sur le tard par soutenir par la plume le régime. En somme, c'est un document que tout Français doit lire avec soin pour comprendre de quelle façon il a été perçu par un étranger qui était un auteur de tout premier plan.

Judas, Amos Oz, traduit de l'hébreu par Sylvie Cohen, Folio, 4oo p., 7,8o euro
On peut être surpris qu'un écrivain israélien comme Amos Oz ait pris pour sujet une figure éminente du nouveau Testament, Judas Iscariote. Judas est la figure du traître pour les chrétiens (pas par tous d'ailleurs, car un évangile de Judas apocryphe du IIe siècle en fait le disciple initié l'ultime secret du christ : sa mort terrestre et sa résurrection. Le jeune étudiant Shmuel, la toute fin des années 195o se retrouve dans une situation des plus ennuyeuses : son père lui retire les subsides pour ses études et sa fiancée l'abandonne. Alors il trouve un travail chez un vieil homme qui s'appelle Wald. Avec lui vit Atalia, une belle jeune femme, veuve du fils de Wald, un soldat mort pendant la première guerre israélo-arabe en 1948. Il apprend au fil des conversations que le père d'Atalia était Shealtiel Abravanel, un homme condamné pour ses relations amicales avec les Arabes. Il est apparu alors comme la figure du traître par excellence, alors que c'était d'abord un homme de paix. Comme toujours dans les romans d'Oz, ce dernier est un peu trop prolixe et aurait dû cristalliser sa pensée avec plus de force. Mais il n'en reste pas moins vrai que ses interrogations sur la traîtrise sont celle d'Israël aujourd'hui : la recherche delà paix ne peut être un acte de trahison. Hélas, cette idée s'est ancrée dans les esprits avec toutes ces décennies d'affrontement. Cela en fait une oeuvre à méditer et à commenter au su et au vu des événements contemporains.
|
