
Picasso, l'atelier du Minotaure, Palais Lumière, Evian / Somogy Editions d'Art, 2oo p., 35 euros
Pablo Picasso en 15 questions, Vérane Tasseau, préface de Jean-Louis Andral, « L'Art en question », Hazan, 96 p., 15,95 euros
La relation de Pablo Picasso avec le mythe du minotaure est bien connue, ne serait-ce que par la célèbre Suite Vollard. A ce thème envahissant dans son univers, encore faut-il ajouter son goût prononcé pour la corrida qui s'est traduit par de nombreux tableaux et dessins et d'aussi de nombreuses gravures. Mais l'optique de l'exposition du Palais Lumière d'Evian a été de vraiment de cerner la question du mythe crétois où le fils des amours de Pasiphaé (femme du roi Minos) et d'un taureau blanc envoyé par Poséidon (d'autres pensent que ce serait un des travestissements de Zeus), en partant de la statuaire, de la céramique et de la mosaïque jusqu'à des maîtres plus récents comme Gustave Planche. Le monstre a porté autrefois un autre nom : Astérion. C'est le Pseudo-Apollodore dit Apollodore le Mythographe qui a introduit cette histoire dans la littérature dans sa Bibliothèque rédigée au Ie siècle de notre ère. Mais on ignore la plupart de ses sources et donc on ne peut pas dire si l'histoire du Minotaure est ancienne ou est de son invention ! Mais ce qui nous importe ici c'est la puissance de ce mythe qui a été exprimée dans les oeuvres les plus diverses, allant de celles de Gustave Moreau à celles de Joan Mirò, en passant par Auguste Rodin, Ossip Zadkine, André Masson (qui illustre le texte de Georges Bataille, Sacrifices, aux éditions GLM en 1936), dont les oeuvres sont ici omniprésentes car il a été sans doute l'un des créateurs le plus inspiré par ce thème. Si les artistes choisis pour accompagner le parcours impressionnant de Picasso ne sont pas toujours la hauteur, il faut reconnaître la qualité du travail effectué en ce qui concerne l'auteur de Guernica. C'est une belle étude historique et aussi une manière passionnante d'aborder l'imaginaire insondable de Pablo Picasso.
Véronique Tasseau a-t-elle posée les bonnes questions propos du pléthorique Picasso ? Quinze questions pour un artistique aussi prolifique, c'est bien peu et très difficile à formuler, je l'admets (je ne sais d'ailleurs comment je me serais sorti d'un tel défi). Les cinq premières me paraissent logiques et en tout cas utile pour comprendre les débuts du maître et son entrée en grande pompe dans l'esprit d'une modernité tapageuse. Mais la sixième sur le classicisme est décevante et la septième demeure franchement incompréhensible : quel rapport entre le surréalisme selon Picasso et l'architecture ? Se demander si Picasso est l'inventeur de nouvelles mythologies est encore concevable. Mais la dixième est mal posée : « Guernica, la peinture comme "instrument de guerre" » peut induire le néophyte ou le jeune lecteur une interprétation erronée de cette composition célèbre. Et s'interroger pourquoi Picasso n'est jamais allé aux Etats-Unis ne semble pas pertinente. Et devrait-on se demander s'il a métamorphosé l'art de la sculpture - on peut en douter, même s'il a laissé des oeuvres fascinantes. Est-ce pour autant un mauvais livre ? Non, de loin, je ne dirai pas ça ; Véronique Tasseau s'est souvent fourvoyée, mais elle permet le plus souvent de permettre au lecteur inexpert de se confronter à cette gigantesque entreprise esthétique qui a dominé le XXe siècle. Peut-être est-ce le lecteur qui fera les meilleures questions et cet ouvrage d'initiation devrait l'y aider.

Même pas peur ! Collection de la baronne Henri de Rothschild, Fondation Bemberg, Toulouse / Somogy Editions d'Art, 176 p., 35 euros
On ne peut imaginer collection plus étrange ! Et pourtant ce n'est certainement pas le goût du macabre qui a conduit la collectionneuse à rechercher des objets et des tableaux avec des sujets où la tête de mort est le point commun. Personne n'est capable de fournir une explication à ce penchant étrange de la baronne de Rothschild (née Mathilde de Weisweiller, issue d'une famille aristocratique et protestante) ; elle épouse de baron Henri de Rothschild en 1895 au temple de la rue de la Victoire). Le baron était lui-même collectionneur, amoureux des peintres du XVIIIe siècle français. Après la Grande Guerre, il a financé en partie la construction du théâtre des Champs-Elysées et a même ouvert une galerie d'art. D'aucuns pense que la jeune mariée a été marquée par le caractère austère de l'abbaye cistercienne de Vaux-de-Cernay, dans la forêt de Rambouillet, achetée par la baronne Charlotte et restaurée par l'architecte Félix Langlais. Mathilde va continuer à la décorer dans le style Renaissance. Mais rien de tout cela n'apporte d'éclaircissement sur l'esprit de cette collection. Cette hantise de la tête de mort est bien entendu dérivée des natures mortes sur le thème du Momento mori. Elle posséda quelques uns de ces tableaux et même une petite tapisserie. Mais le plus impressionnant est qu'elle ait acquis des montres, des cannes à pommeau, des chapelets, des brûle-parfums, des ombrelles, des épingles de cravate, des bijoux, des tabatières, des livres reliés, et aussi des objets ethnographiques comme des têtes réduites. L'ensemble est particulièrement déroutant car elle a poussé très loin le goût pour les Vanités. Toutes ces pièces insolites demeurent donc un mystère. Cette jeune femme a cultivé un penchant morbide mais qui met en lumière une curieuse et inclination de la Belle Epoque. Il faut découvrir cette extraordinaire collection pour prendre toute la mesure de ce qui est sous-jacent la culture chrétienne.

En couleurs, la sculpture polychrome en France, 1850-1910, musée d'Orsay / Hazan, 192 p., 45 euros
S'il avait su que les sculptures grecques étaient peintes, Johann Joachim Winckelmann, le plus ardent défenseur de la tradition antique, l'auteur de Geschichte der Kunst des Altertums (1764) en aurait été gravement choqué car il n'a jamais cessé de vanter la blancheur de la pierre ou du marbre. Pourtant, il devait bien savoir que les deux grandes oeuvres monumentales de Phidias, le Jupiter d'Olympie et l'Athéna du Parthénon étaient recouvertes d'or et d'ivoire. Le Corbusier commettra la même erreur quand il a écrit Quand les cathédrales étaient blanches. Quoi qu'il en soit, il y a un grand débat la fin du XVIIIe siècle, conduit par les amis néoclassiques d'Antonio Canova et il s'est prolongé au XIXe siècle.Mais les découvertes archéologiques ont peu à peu sapé les bases théoriques des disciples de Winckelmann : on se mit donc refaire des statues polychromes. Ce beau catalogue montre comment ce renversement de tendance s'est produit et avec quels artistes. L'exposition commence parla présentation de quelques exemples de la Renaissance, comme Della Robbia ou le portrait de machiavel au XVIe siècle. Le premier sculpteur à avoir franchi le pas est Honoré Daumier avec ses terres cuites peintes représentant des hommes politiques : ce sont des portraits charges qui rappellent ses caricatures et ne sont donc pas caractéristiques de l'esthétique de son temps. En réalité les premières réalisations datent du début de la IIIe République avec un petit maître de qualité comme Henry Cros à redécouvrir et surtout Jean-Léon Gérôme, l'orientaliste le moins scrupuleux de la vérité de la vie orientale, mais un académicien très côté. On peut admirer le Jeune prince de la famille Médicis de Jean Désiré Ringel d'Illzach (circa 189o) ou le Saint François de Zacharie Astruc (1873-1874). Charles Cordier et Charles-Octave Lévy se sont spécialisés dans ce genre dès le milieu de leur siècle. Théodore Rivière, Jean Dampt, Louis-Ernest Barrias, Georges Lacombe, pour ne citer qu'eux, ont adopté cette pratique à la Belle époque. Peu de grands maîtres se laisse tenter, à part Rodin dans un cas précis : une collaboration avec le verrier Jean Cros pour un portrait de Camille Claudel. Antoine Bourdelle se lancera dans cette même expérience toujours avec Jean Cros pour le Portrait de Madame Millett (1916-1923). Il existe deux petites pièces de Camille Claudel. Autre singularité : Renoir a fait le portrait de sa femme en mortier peint en 1916. Quoi qu'il en soit, le seul grand créateur qui ait abordé de front cette question est Edgar Degas dans ses Petites danseuses en 1881. Au fond, il faut attendre les premiers feus de l'art moderne pour que la sculpture soir vraiment de toutes les couleurs !
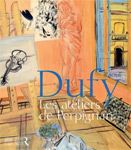
Dufy, les ateliers de Perpignan, musée d'art Hyacinthe Rigaud, Perpignan / Somogy Editions d'Art, 200 p., 25 euros
Raoul Dufy (1877-1953) est sans doute l'un des artistes les plus énigmatiques du XXe siècle en France. Sans avoir été ni cubiste, ni fauve, il est parvenu à s'imposer comme l'un des artistes les plus importants de l'Ecole de Paris. Sa production pléthorique et parfois un peu expéditive ne l'a pas empêché de jouir d'une solide réputation. Mais il s'est démontré d'une originalité profonde dans la conception de tissus. Il a démontré dans ce domaine l'âme d'un grand créateur plus que dans la peinture. Dans ce domaine, il s'est révélé l'un des meilleurs. Aujourd'hui encore, il est apprécié et figure parmi les grandes figures tutélaires de la modernité. Quoi qu'il en soit, cette exposition imposante et ce catalogue bien documenté nous font découvrir une période tardive de sa production : celle des années 1940. Comme la plupart des Français épouvantés par l'avance rapide des troupes allemandes, il a décidé de se réfugier dans le Midi, à Perpignan. Là, il en profite pour soigner une polyarthrite dans la clinique du docteur Pierre Nicolau. Il finit par s'installer dans cette ville et y travaille beaucoup malgré ses conditions de sans assez précaires. La guerre terminée, il y est demeuré ; il ne l'abandonnera qu'en 1950 pour aller aux Etats-Unis. Il est d'abord resté chez les Nicolau jusqu'en 1941, puis il a pris pendant trois ans un atelier rue Jeanne d'Arc, enfin il s'est installé rue de l'Ange. Son style ne change guère. On peut néanmoins observer qu'il dépouille de plus en plus les intérieurs qu'il aime représenter et qu'il réduit aussi sa gamme chromatique, privilégiant les roses, les bleus et les jaunes, les rouges et les verts devenant secondaires . Il se remet avec bonheur au paysage, toujours avec une grande économie de moyens, et utilise de plus en plus le noir. Il s'amuse aussi à pasticher les grands maîtres d'autrefois comme Botticelli et Tintoret, et même Renoir et Picasso à ses débuts ! Il se consacre aussi beaucoup à la tapisserie dès 1941 avec l'aide et la complicité de Jean Lurçat à la céramique à partir de 1943 avec Jean-Jacques Prolongeau. Il a fait un séjour à Vence en 1945, mais est vite revenu auprès du docteur Nicoleau à cause de ses douleurs. Sa vie et son art sont dictés alors par les vicissitudes de la maladie.
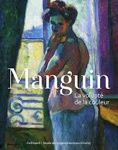
Manguin, la volupté de la couleur, sous la direction de Marina Ferretti Bocquillon, Gallimard / Fondation de l'Hermitage, Lausanne, 168 p.,
Henri-Charles Manguin (1874-1949), bien qu'il ait fait parti des premiers fauves, n'a pas été bien traité par la postérité. Ayant arrêté ses études secondaires pour étudier le dessin l'Ecole des Arts décoratifs de Paris partir de 1889, où il rencontre Rouault, Marquet et puis Matisse. Il passe avec succès le concours de l'Ecole des Beaux-arts, et se retrouve dans l'atelier de Gustave Moreau avec ses anciens amis et Valtat. Il quitte l'Ecole quand décède Gustave Moreau en 1898. Il découvre les Nabis et les apprécie. Il prend un atelier aux Batignolles. Il expose au salon des Indépendants à partir de 19o2. Il prend part au premier Salon d'Automne en 19o3. En 19o4, il travaille dans son atelier avec Puy, Matisse, De Mathan et Marquet, partageant ainsi le coût de la location d'un modèle. L'année suivante, Leo Stein lui achète un tableau. Il participe aussi des expositions de groupe chez Berthe Weill. En octobre 19o5, il participe à la salle 7 du Salon d'Automne que Louis Vauxcelles surnomme « la cage aux fauves ». Sa carrière connaît un certain élan partir de cette date. Il se lie d'amitié avec Félix Vallotton, dont le frère, marchand de tableaux, achètera ses oeuvres pendant la guerre. Il a sa première grande exposition personnelle chez Druet en 191o. Une seconde exposition a lieu en 1913. Il demeure surtout en Suisse pendant la guerre ayant été exempté de service et il rentre Neuilly en 1919. S'il demeure un peintre apprécié, il ne fait plus partie des cercles d'avant-garde en France. Il a encore un cercle de collectionneurs et la veuve Druet lui est restée fidèle. Sans s'en rendre compte, il est devenu une gloire du passé. L'exposition et par conséquent le catalogue s'arrêtent l'année 1918. Il contribue la fondation en 1937 du musée de l'Annonciade à Saint-Tropez où il séjourne de plus en plus. En tout cas, cette publication, nous permet de redécouvre la première partie de son oeuvre qui fait de lui un peintre attachant, mais qui n'a pas éprouvé le besoin de dépasser les premières étapes tapageuses du fauvisme.

Claude Monet en 15 questions, Marianne Mathieu, « L'Art en question », Hazan, 96 p., 15,95 euros
Pas aisé de résumer une oeuvre vaste comme celle de Monet en 15 questions. Sans doute toutes celle proposées par l'auteur ne sont pas très judicieuses : par exemple le rapport de l'artiste avec l'argent, qui ne me semble pas un sujet de méditation pour un débutant. Mais, en fin de compte, on s'y retrouve un peu avec le travail de Marianne Mathieu : certaines de ses demandes sont impertinentes (en particulier propos du jardin que l'artiste a créé à Giverny), mais elles ouvrent la voie à d'autres questionnements. La dernière est sans aucun doute la plus curieuse et même insolite : est-il le père de l'expressionnisme abstrait américain ? Peut-être que notre auteur a poussé les choses un peu loin ; cela étant dit, il faut tout de même se demander s'il n'est pas tout simplement le père putatif de l'art abstrait tout court. Pour deux raisons : la première parce que Vassili Kandinsky, ne comprends pas le sujet des meules, a cru qu'il s'agissait là d'un motif non figuratif, la seconde est quand, au milieu des années 191o, souffrant d'un grave disfonctionnement de l'oeil, il s'est mis à peindre des toiles dont le sujet n'est plus perceptible ; déjà avant, il avait peint des tableaux avec des dominantes rouges qui se trouvent au musée de Marmottant et qui sont presque de purs jeux chromatiques avec le cycle du Pont de Waterloo en 19o3. Ce petit livre initiatique offre la possibilité de voir la peinture de Monet avec un oeil neuf ou de le découvrir avec quelques instruments pour le comprendre.

Musique thérapeutique, Frédéric Acquaviva, Editions Acquaviva, 2o euros
Musique algorithmique, Editions Acquaviva, Editions Acquaviva, 2o euros
The 12o Days of Musica, s. p., 15 euros
Du singe au porc, Frédéric Acquaviva, CD, £ @ ß, 2o17.
Mess (2o15-2o17) for mezzo, mouths, skis and buchla, with Loré Lixenberg, 33 tours, £ @ ß, 2017.
Quand j'ai fait la connaissance de Frédéric Acquaviva, il s'intéressait de très près au lettrisme, avec une rare passion, qui m'avait un peu surpris, je l'avoue. Mais sa compétence était remarquable. Depuis lors, nous nous sommes vus plusieurs fois et nous avons fini par un peu mieux nous connaître ; et j'ai découvert l'ampleur de sa recherche musicale : près de cent ouvrages et enregistrements ! Il s'est déjà produit dans de nombreux musées, réalisé des pièces pour la radio (dont France Culture) et la presse artistique s'est intéressée à lui depuis un bon moment. Pour comprendre sa démarche, je conseille au lecteur de lire d'abord The 120 Days of Musica. On peut y saisir les différents aspects de sa relation à l'art musical, qui est profondément iconoclaste et se présente soit sous une forme graphique, soit sous l'espèce de la performance. Le public joue souvent un rôle important dans ses créations. Quand il publie ses oeuvres, ce ne sont pas des partitions, mais des saisies informatiques qui peuvent sembler déconcertantes première vue, mais qui rendent concrètes sa volonté d'aller bien au-delà des conception de la musique, même de la musique électronique ; écoutez ses enregistrements : vous serez sans doute déconcertés, mais vous saurez qu'il existe un espace radical qui dépasse les expériences assommantes de l'IRCAM ! Il paraît être entrainer par le désir fou de passer outre toutes les limites de la composition et n'hésite pas à passer par-dessus la tête de ses maîtres, associant la technologie la plus avancées et la poésie sonore et concrète. Bien malin sera celui qui saura où cela va le conduire et nous conduire. Mais il est grand temps de le découvrir pour ne pas rater un moment peut-être clef de la réforme musicale de notre époque.
Roland Cognet, Quand à peine un nuage, Olivier Delavallade, Domaine de Kerguéhennec, 92 p., 2o euros
Le domaine de Kerguéhennec a commencé par être un parc de sculpture. Puis, peu à peu, c'est devenu une structure qui peut présenter plusieurs simultanément plusieurs expositions et abriter des artistes pour des stages. Cette année, Olivier Delavallade a choisi de nous faire connaître un artiste discret mais d'une qualité profonde, Edmond Quinche, qu'il a placé en regard d'oeuvre de son ami Tal Coat : c'est une véritable révélation. En outre, au premier étage du château, a été placée une très grande installation de Lévi Van Velew, un jeune artiste hollandais, qui nous fait monter dans un train fantôme intériorisé, nos pas nous conduisant dans des salles obscure où l'on découvre des lieux qui font de la multiplication d'objets identiques jusqu'à l'illusion de machines dignes de Picabia ou des vorticistes anglais. C'est une expérience à la fois ludique et métaphysique. On peut aussi découvrir aussi les carnets de Jean-Pierre Vielfaure qui ont été revisité par Illès Sarkanryu. Dans la petite chapelle, perdue au milieu du parc, Marc Couturier a réalisé un paysage gigantesque sur le choeur, dont la composition repose sur un paradoxe singulière qui fait écho la création dans la Genèse : d'un côté, il nous propose une immense vedute avec une perspective assez conventionnel, de l'autre, l'impression d'une chute dans le vide de la représentation ; c'est une vision magique qu'on contemple dans la pénombre. Mais il pezzo forte de cet ensemble est sans aucun doute l'exposition de Roland cognée, qui a choisi un ver tiré d'un poème de Théophile Gautier « Quand à peine un nuage... » le principe de ses sculpture est d'associer des matériaux hétéroclites (bois et acier, du plâtre aussi)et d'introduire aussi des éléments figuratifs, comme le loup, qui est ici un rôle emblématique. Cognée ne cherche pas à trouver des solutions plastiques inédites, mais plutôt engendrer de nouvelles relations entre des éléments déjà usités. Cela engendre un univers assez poétique et original.

L'Image en morceaux, sous la direction d'Evelyne Artaud, Villa tamaris / Tohubohu Editions, 96 p.
Bien sûr, depuis le cubisme et le dadaïsme, l'image a subi mille outrages et s'est trouvé mise à mal avec Picasso, Lipchitz, Boccioni ou Kubista. L'idée d'Evelyne Artaud a été de comprendre comment la déconstruction de la représentation dans l'art de notre temps. Et là, on est surpris de contempler la multiplicité des points de vue. On peut en effet voir des collages de style classique avec Jean Le Gac, Philippe Cognée, ou encore Errò dont toute l'esthétique repose sur l'accumulation de fragments arrachés différentes réalités et le monde mystérieux de Jacques Monory. Ivan Messac a ici toute sa place avec son Empire des sens (2005). On peut aussi prendre connaissance des cas beaucoup plus rares comme la composition de Gilles Ghez avec ses Tweed Mysteries de 2002. D'autres appartiennent à l'univers de l'électronique, comme les pièces d'Eric Rondepierre, dont les pièces les plus récentes sont des images de films décalés ; un artiste nommé Jev a fait une série intitulée Ombres et lumières, qui pastichent les clichés d'autrefois ; quant à Patrick Chambon, il recompose des éléments naturels à partir de collages de plages iconographiques légèrement décalées. Le commissaire a choisi aussi des pièces plus anciennes (années 196à) de Louis Pons, qui sont des assemblages partir de matériaux divers ou représentés par le dessin l'encre de Chine. Bien sûr, nous n'avons ici qu'un choix limité, loin de montrer tous les aspects de cette thématique très vaste. Mais elle est suffisamment bien faite pour qu'on puisse avoir une idée assez claire de cette manière de mettre en scène le monde sensible par le biais de cette « déconstruction » plus ou moins prononcée. A noter un texte intéressant et assez inattendu de Robert Bonaccorsi, « L'Image, morceaux choisis », qui joue d'une façon assez nostalgique, par le biais de bandes dessinées, avec l'univers de Jean-Luc Godard.

Familles à l'épreuve de la guerre, Somogy Editions d'Arts / musée de la Grande guerre, 200 p., 23 euros
Ce catalogue est admirable pour deux raisons : la première est le choix très judicieux de l'iconographie car pour chaque sujet traité (et il y en a beaucoup), des photographies, d'affiches, de lettres et des documents de toutes sortes éclairent merveille la question ; la seconde est d'être un ouvrage très complet sur la société français avant, pendant et après cette guerre, avec un sens très prononcé de la synthèse. Mais rien n'est écarté : par exemple, il y est question des enfants pendant cette longue période, celle des prénoms qui sont donnés, le problème douloureux du deuil et ses codes, et celui du veuvage, mais aussi la question des divorces, qui augmentent alors, le travail des femmes, etc. avec cet ouvrage qui n'est ni bavard, ni absolument exhaustif, nous pouvons avoir une idée très précise de la vie privée des Français, vu des foyers, vu du front et vu des camps de prisonniers. Il est évident que chaque chapitre mériterait un développement beaucoup plus ample. Mais tel qu'il est construit, le cataloguez permet d'embrasser peu près toute cette réalité quia touché les familles et ont marqué de façon définitive leur destin. Pour beaucoup d'historiens, la Grande Guerre marque la fin d'une période, celle de la Belle Epoque. La société de notre pays ne sera plus tout à fait la même après, dans presque tous les domaines. Le monde qu'a décrit Marcel Proust a quasiment disparu et la Belle Epoque apporte des transformations considérables. Maintenant que le dernier Poilu a disparu, il me semble important de comprendre ce monde qui se trouve cent ans de distance. Sans doute ne me paraît plus tout à fait utile de commémorer la victoire (c'est presque anachronique en un temps où l'Europe se construit tant bien que mal), mais il est plus que jamais nécessaire de se remémorer ce qu'ont été ces quatre années effroyables et qui ont bouleverser l'histoire de la France, bien sûr le plus de l'Histoire, mais aussi de la vie domestique.

Le Dieu de Kairos, Didier Laroque, Editions Champ Vallon, 228 p., 2o euros
Avant toute chose, je dois dire avoir été séduit par le premier roman de Didier Laroque, la Mort de Laclos, paru chez le même éditeur en 2o14. Et cette seconde oeuvre ne fait que confirmer cette première impression. Cette fois, il ne s'attache à une grande figure littéraire, mais à des personnages qu'il a inventés de toute pièce. Il y a toujours chez lui une sorte de nostalgie, très profonde, du passé : il a choisi cette fois le début du siècle dernier. Mais une grande rigueur, mais aussi du charme et une sensibilité très contenue, il nous rapporte les menées un peu picaresques de deux êtres qui ne se ressemblent en rien et pourtant s'assemblent curieusement. Ce qui est fabuleux dans son histoire, c'est qu'il a voulu mélanger différents genres, l'orientalisme, le roman moderne à la manière de Paul Morand et même le roman d'aventure populaire, comme ceux d'Alexandre Dumas. Son écriture très policée et très maîtrisée contraste pas mal avec le goût manifeste dans ce livre de brouiller les pistes et lui donne toute sa saveur. C'est sans doute son goût pour les intrigues complexes et mouvementées ce qui donne cette impression. Il a aussi un amour immodéré pour l'histoire et ses secrets parfois déroutants qui ajoute une note de mystère dans ce roman très singulier. Son écriture très épurée, très maîtrisée, très fluide, contraste beaucoup avec ces récits enchevêtrés et souvent compréhensibles qu'au bout d'un certain temps. Il y a chez lui une sorte de quête occulte, qui n'est ni religieuse ni ésotérique : c'est le goût du romanesque qu'il veut retrouver en utiliser des moyens qui peuvent sembler classiques, mais qui sont en fait un détournement du genre. Je ne veux pas résumer ici cette affaire compliquée pour ne pas gâcher le plaisir du lecteur : c'est l'enchaînement et l'entrecroisement de ces destins en des lieux et des situations a priori discontinues qui font tout le charme captivant du Dieu Kairos. C'est une sorte de labyrinthe qui nous donne l'occasion de retrouver l'émotion un peu juvénile qui demeure graver en nous pour les fictions. Car la question n'est pas : « que peut le roman ? », mais : « quel besoin en avons-nous «. Ce jeune auteur nous a séduit et je suis persuadé qu'il va continuer à nous séduire.

La Terre est ronde, Gertrude Stein, traduit de l'anglais par Marc Dachy, préface de Chloé Thomas, Rivages poches, 112 p., 4 euros
La préface de Chloé Thomas est partiale et partielle. Elle oublie le travail qui a été accompli par les éditions Christian Bourgois, qui a publié plusieurs livres du grand l'écrivain américain, et par la revue L'Ennemi, qui lui a consacré un dossier très nourri. Elle oublie aussi tout ce qui a été publié par Denis Roche dans sa collection « Fiction & Cie » aux Editions du Seuil. On peut aussi s'étonner que la traduction de la regrettée Françoise Collin ait été délibérément mise de côté, alors qu'elle a paru la même année que celle du personnage sujet très controversé que fut Marc Dachy. Mais on savourera avec délice ce merveilleux petit livre de Gertrude Stein qui était censé s'adresser aux enfants. Il est vrai quand on le lit à haute voix, il est d'une drôlerie irrésistible. Chaque petite histoire est un conte autonome plus ou moins court, où l'auteur joue avec les sonorités des mots C'est une petite merveille où l'expérimental est dépassé par les mélodie de son texte, d'une haute poésie, surtout dans la langue originale

Mac Orlan : frange et paillette, Ilda Tomas, préface de Giovanni Dotoli, « Vertige de la langue », Hermann, 3o2 p., 228, 28 euros
Cette monographie de Pierre Mac Orlan (de son vrai nom Pierre Dumarchey, 1882-197o) est assez déroutante. En effet, on ne sait trop s'il s'agit d'une biographie conçue d'une manière peu académique ou d'un essai classique, mais dont le plan n'est pas clair. Disons qu'il peut s'agir d'une sorte de portrait assez décousu. Le plus intéressant est sans aucun doute la relation que l'écrivain a eue avec la peinture. Malheureusement, cet aspect des choses n'est développé qu'en partie. On comprend bien en lisant Ilda Tomas qu'il n'a pas poursuivi une carrière artistique qui s'annonçait prometteuse. De plus, aucune illustration ne nous donne ici l'idée de ce que le jeune homme faisait. Très jeune il a fréquenté des établissement anarchistes comme le Zut et Le Lapin Agile à Montmartre et s'est mis à écrire de la poésie. Mais tout cela ne lui rapportait pas un sou et il a dû travailler dans une imprimerie. On sait peu de chose de ses débuts car tout a disparu ou a été détruit, par ses soins et par ses héritiers. En fait, l'auteur nous offre plein de détails sur la vie et l'oeuvre de cet homme difficilement classable, mais ne parvient jamais à donner une idée forte et de sa personnalité et de l'évolution de son oeuvre littéraire, essentiellement romanesque. C'est un livre où puiser des informations utiles, mais sans espoir de voir peu à peu se former une image très claire et surtout précise de l'écrivain.

Une jeunesse perdue, Jean-Marie Rouart, Folio, 192 p., 6,9o euros
Peut-on parler de roman au sens strict ? Peut-être pas. Est-ce une pochade pleine de fantaisies et de passions ? Oui, c'est probable, car les figures féminines qu'il campe avec sa plume ont quelque chose de démoniaque, d'impudique, de fantasque, au milieu des tourments de la jalousie et de l'amour. Le lecteur n'aura pas de mal à reconnaître l'Académicien, qui est pris au piège de l'ivresse des sens, s'exhibant devant des femmes impudique et curieuses, ressentant les affres de la séduction, dont il ne parvient pas à se défaire. C'est ainsi qu'il remonte le cours de son existence d'homme marié, quand cette épouse le torture. D'un dîner mondain à une soirée savante, il se hâte de écrire des portraits de ces dames qui lui deviennent de plus en plus inaccessible. Toutes ces belles dames qui l'entourent. Alors que penser de cet ouvrage ? Il choisit Valentina, la plus terrible de toutes et de loin la plus dangereuse. Jean-Marie Rouart est un merveilleux parleur, mais un modeste auteur, qui ne renonce pas à ses folies. Il veut continuer à plaire, et refuse l'usure du temps sur son corps. Devant cette Valentina, il éprouve le besoin de ne jamais abdiquer, il combat jusqu'à son dernier souffle ! Sans doute n'aura-t-il pas cette superbe écriture qui serait la contrepartie de son esprit, de son originalité et même de son courage dans certains engagements contre-courant. Ce roman manque beaucoup de toutes ces qualités qui font l'homme. Tout y est assez laborieux et sans ressort.

L'Egypte intérieure, ou les dix plaies de l'âme, Annick de Souzenelle, Albin Michel, 224 p., 7,7o euros
L'introduction est un peu confuse, mêlant problèmes de translitération et de traduction de l'hébreu, interprétations de la Genèse et présentation d'une expérience intérieure du peuple juif au lieu d'une expérience historique. Cela est ce qui paraît le plus intéressant. Mais notre auteur précise, on ne sait trop pourquoi, qu'il entend parler de la vie des Hébreux à une époque reculée, entre le XIXe et le XIe siècle avant notre ère, ce qui est plus qu'intriguant : dates improbables et, de plus, la Torah n'est pas encore écrite et personne ne peut certifié que les Juifs se sont retrouvés en Egypte cette période. La très longue période pharaonique avait une caractéristique : celui de l'obsession de laisser des traces écrites, très précises, de l'histoire de l'empire. Il n'est question des Juifs absolument nulle part ; mais, au moins, Souzenelle nous épargne l'idée absurde de l'esclavage, ce qui reste un mystère mes yeux car les Egyptiens antiques n'avaient pas d'esclaves ! Autre question cruciale : Annick de Souzenelle semble oublier que l'ordre des parties dans la Torah ne correspond pas l'ordre de leur rédaction. Mais au moins il a le grand mérite d'échapper une lecture au premier degré qui ne repose sur rien et d'examiner ces dix plaies d'un point de vue purement intériorisé. Ses interprétations peuvent certes prêter à discussion, mais elles ont le mérite de prendre un authentique cheminement spirituel. Ce faisant, l'auteur reprend quelques orientations radicales de la théologie protestante, qui refuse toute réalité historique à la Bible en dehors de son message sacré.
|
