
Foujita, peindre dans les années folles, sous la direction de Sylvie Buisson & d'Anne Le Diberder, Culturespaces / Fonds Mercador, 192 p., 3o euro.
Léonard Tsugouharu Foujita (1886-1968) fait partie de ces peintres de l'Ecole de Paris qui sont connus, certes, mais qu'on ne connaît pas si bien que cela, faute d'ouvrages sur leur compte et faute d'expositions importantes. Il faut donc être reconnaissant à Sylvie Buisson (auteur du catalogue raisonné de Foujita et de beaux livres sur Montmartre et Montparnasse), commissaire de nombreuses expositions en France et l'étranger) et Anne Le Diberder (directrice de la Maison-Atelier de Foujita à Villiers-le-Bâcle, auteur de plusieurs ouvrages sur l'artiste) d'avoir réuni un ensemble d'oeuvres important sur cet artiste japonais qui a choisi Paris comme tant d'autres au début du XXe siècle. Même si cette manifestation a pour objet les Années folles, on peut suivre l'itinéraire de ce dernier depuis son arrivée en France en 1913, il est presque aussitôt au coeur de la nouvelle bohème de Montparnasse : c'est le peintre Manuel Ortiz de Zàrate qui l'entraîne chez Pablo Picasso. Ce fils de haut gradé a très vite voulu se consacrer aux arts. Il commence par apprendre le français et puis étudie la peinture de style occidental l'Académie des Beaux-arts de Tokyo. Il en est sorti diplômé en 191o. On se rend compte, quand on voit les premières oeuvres qu'il ait faites Paris, on est bien forcé de constater que le jeune homme a bien du mal utiliser la perspective et se plier aux normes de l'art occidental. En revanche, il utilise les fonds or, ce qui est très rare à cette époque, ce qui lui permet d'associer l'art du début de la Renaissance l'art ancien japonais. Ces petites gouaches sont non seulement très raffinées, mais aussi révélatrice de son état d'esprit : la modernité va de paire chez lui avec la nostalgie de l'art d'autrefois. Et ils font très bon ménage. La Mère à l'enfant de 1918 est un bon exemple : il n'a pas suivi un des grands courants de l'époque (cubisme, futurisme, fauvisme, etc.) et on peut seulement y déceler un lointain cousinage avec Modigliani. Il va continuer faire des oeuvres de ce type pendant toutes les années 192o (par exemple, le beau portrait du lutteur de sumo de 1928). Mais il peint parallèlement des paysages urbains, au début pas très éloigné du Douanier Rousseau et puis, très vite, dans un style qui n'appartient qu'à lui, avec une poétique touchante. Il a aussi exécuté des portraits de femmes, très stylisées, qui n'ont pas leur pareil. Peu à peu, il évolue et se met faire des paysages plus proches de l'esprit du temps, mais toujours avec un décalage très marqué. C'est à Cagnes-sur-Mer qu'il a commencé trouver une voie plus construite, on l'on discerne une lointaine influence de Cézanne. Foujita est un artiste qui fait plusieurs expériences picturales en parallèle, comme on le voit dans Les Intellectuels la Rotonde de 1916 : d'aucuns ont affirmé qu'il s'agirait d'Apollinaire et de Marinetti, mais rien ne le prouve. En revanche, la facture de cette toile est moins orientalisante. Au tout début des années 193, il peint des scènes avec des femmes, qui sont élaborées dans une autre optique, comme les Trois femmes (193o) et Luparnar Montparnasse (circa 193o) : es figures sont un peu grotesques et ont un caractère un peu expressionniste. Il se rapproche alors de Pascin, de Kisling, de Pinchus Krémègne, mais tout en restant bonne distance de leurs manières respectives. Depuis longtemps, Foujita était venu une des figures emblématiques de ces Années folles, dandy, amateur de la vie de café et des fêtes échevelées d'alors, grand amateur de femmes. Il est considéré comme une des grands créateurs de Montparnasse et il est la mode. Un de ses traits les plus étranges est son goût prononcé pour le blanc : plusieurs tableaux et dessins sont quasiment monochromes, comme Les Deux amies (1926), le Nu assoupi sur la table (1927) ou le Nu allongé (Madeleine) de 1931. Il aime aussi faire des portraits de femmes avec un fin trait noir sur fond blanc. En somme, Foujita, si l'on fait exception de certains portraits d'enfants un peu mièvres (Picasso lui-même n'a pas échappé à cette mièvrerie) se révèle un peintre et un dessinateur extraordinaire et original. L'exposition nous dévoile la richesse étonnante de son parcours. Une des grandes révélations ici sont ses Grandes compositions de 1928 : celle au chien ou celle au lion. La même année, il signe deux Combats, eux aussi de grandes dimensions. Dans ce catalogue, nous pouvons enfin comprendre la véritable valeur de Foujita et de sa curieuse posture au cours de ces lustres où l'on tente d'oublier une guerre terrible. Il oblige l'historien d'art comme le simple amateur à revoir sa vision de la période.

Zegma, Gérard Garouste, Galerie Templon, 88 p., 25 euro.
Trois expositions de Gérard Garouste ont ouvert leurs portes à la mi-mars et donnent toute la mesure du chemin accompli par cet artiste, qui s'avère sans nul doute possible le plus déconcertant de tous et aussi le plus imaginatif. Son univers a toujours été figuratif. Mais condition d'admettre que les modalités qu'il a choisies sont loin d'être conventionnels, même dans les termes de « l'esprit du nouveau ». Je commencerai par l'Ecole national des beaux-arts de Paris, qui a choisi d'être une forme de rétrospective. Elle commence en effet avec ses Indiennes, créées la fin des années 198, toiles formant un volume, essentiellement inspirées par la Divine Comédie de Dante. On peut ensuite y découvre La Dive Bacbuc (1998) installation extravagante, qui sort tout droit du Cinquième Livre de François Rabelais, qui est une sorte de camera obscura ou machine pour voir les images en mouvement, ancêtre du cinématographe, où ésotérisme et esprit ludique se confondent. Puis le visiteur peut voir Ellipse, une installation présentée la Fondation Cartier en 2oo1, puis les Saintes Ellipses, oeuvre de très grande taille et aérienne, qui avait été présentée à la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière en 2oo3, représentation octogonale de l'univers travers le prisme de la Torah. Ce sont là parmi les créations les plus impressionnantes qui lui ont été donné de faire. Au musée de la Chasse et de la Nature, il a traité le thème de Diane et d'Actéon. Ce sont toutes des oeuvres élaborées pour cette exposition. Gérard Garouste recompose à sa guise les termes de cet épisode mythologique souvent repris par les maîtres d'autrefois. Il utilise les métamorphoses tant décrites par Virgile et réinvente l'histoire tragique du chasseur selon ses fantasmes. Je citerai Actéon rouge (2o15), Diane (2o17) et Opportunité (2o17), mais de nombreux dessins et oeuvres de plus petites taille constituent un ensemble Il y a de grandes compositions, qui sont des merveilles, et qui d'anamorphoses en désarticulations des figures proposent une lecture inédite de cette histoire tragique de la vengeance d'une déesse sans pitié. Depuis quelques années, l'artiste a entrepris une peinture délibérément autobiographique. Tout ce qui a constitué son existence, son éducation, ses origines, ses lectures, ses rêves (souvent sous un aspect digne du cauchemar). Les tableaux accrochés aux cimaises delà galerie Templon, occupant ses deux espaces, regroupés sous le titre de Zeugma, prolongent cette aventure assez peu commune, car elle est violente et sans aucune compromission. Ce qui les différentie des précédentes, c'est que le peintre a considérablement ouvert le champ des possibles de ses représentations. Si le sujet principal est toujours son propre personnage et son entourage (surtout son épouse Elizabeth), il a engendré d'autres espaces plastiques et aussi intensifié son registre plastique et chromatique.
L'autodérision est toujours de mise et un humour noir y domine. Pinocchio et la partie de dés est une oeuvre truculente première vue, et puis on se rend compte qu'elle est aussi tragique. C'est dans cette région plus obscure que claire que se déroulent ses contes cauchemardesques où il ne cesse de confronter beauté et laideur, ces deux pôles du goût finissant par s'échanger ou de se mélanger complètement. Gérard Garouste cultive le monstrueux, mais est guidé encore et toujours par ne notion paradoxale de la beauté qu'il a en partie soustrait la culture hébraïque et à la grande littérature universelle. Cela avec une liberté absolue, une force incomparable et accomplissant une introspection qui se change en ne plongée vertigineuse dans les coins les moins fréquentables de l'esprit.
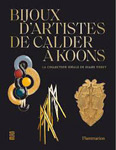
Bijoux d'artistes, de Calder à Koons, la collection idéale de Diane Venet, Flammarion / MAD, 224 p., 39,9o euro.
Les peintres du temps jadis ne dessinaient guère de bijoux. C'est sans doute l'Art Nouveau et puis toutes les Sécessions d'Europe centrale qui ont, en abolissant la frontière entre grand art et arts appliqués, qui ont incité les créateurs modernes s'intéresser à la joaillerie. Quelques uns des modernes, comme on le voit dans ce bel album, ont imaginé des pièces délicieuses comme Jean Arp, Fernand Léger, Jacques Lipchitz ou Georges Braque. Giacomo Balla a fait des bijoux futuristes après avoir conçu son « costume anti-neutre » (mais ils ont été édités bien après sa mort). Man Ray s'y est consacré dès les années 192o. La très abstraite Louise Nevelson a pensé des pièces avec une dominante noire. Les surréalistes Meret Oppenheim, Max Ernst et Leonor Fini ont réalisé un superbe collier en émail. Alexandre Calder a utilisé les spirales qu'il a beaucoup utilisées pour un grand collier en cuir, en laiton et en bronze doré. La liste est impressionnante. Après la dernière guerre, les choses vont en s'accélérant. Ce genre d'oeuvre porter sur soi a séduit une foule de peintres et aussi de sculpteurs produire des broches, des boucles d'oreille, des colliers ou des bagues. Mêmes les plus radicaux d'entre eux, comme Asger Jorn n'ont pas rechigné à le faire. Du côté du Nouveau Réalisme, on trouve des pièces intéressantes d'Arman, de César, de Daniel Spoerri, de Mimmo Rotella ou de Raymond Hains. Les artistes du Pop Art ont eux aussi sacrifié ce rite comme Roy Lichtenstein ou Robert Indinana. Plus près de nous encore, on trouve des pièces vraiment curieux de Miquel Barcelò, d'Anish Kapoor, de Mimmo Paladino ou même Jean Dubuffet. En somme, ce volume est une sorte d'annuaire de l'essentiel de ce qui a pu être pensé et mis en oeuvre dans ce registre loin d'être indifférent. On se rend compte qu'il s'est produit une grande fracture entre le bijou conventionnel des grandes maisons de joaillerie et ce que les artistes ont voulu concevoir. On se rend compte qu'ils ont eu des idées qui enrichissent profondément cet art encore régi par un grand nombre de stéréotypes. Salvador Dalì a visiblement pris un plaisir fou y travailler avec son imaginaire qui ne semblait pas avoir de limites.

L'Avant-garde hongroise à la galerie Der Sturm, Kristina Passuth, Galerie Le Minotaure / Galerie Alain Le Gaillard, 280 p.
Que savons-nous des avant-gardes historiques de l'Europe centrale et orientale ? En réalité peu de choses. Il y a bien eu une exposition sur le cubisme tchèque au Centre Pompidou, assez décevante, il faut bien le dire. Quant à la Hongrie, il n'y a eu qu'un ouvrage d'ensemble de Kristina Passuth, aujourd'hui difficile à trouver. Sur la Hongrie de manière spécifique ? En fait, rien, ou presque. Car, somme toute, nous ne possédons qu'une idée assez incomplète de l'oeuvre de Làszlò Moholy-Nagy et aussi un choix de ses écrits, surtout parce qu'il a enseigné au Bauhaus de 1919 à 1928. Ces deux magnifiques expositions viennent combler un vide. Et ce pondéreux catalogue est un document de grande valeur pour les esprits curieux. Il est vrai que nous avons encore une vision égocentrée de la création du début du XXe siècle : on a redécouvert l'expressionnisme allemand assez tard et le futurisme italien avec aussi un grand décalage temporel. Et nous sommes encore loin de bien connaître le vorticisme anglais ou même les avant-gardes espagnoles et portugaises ! Bien sûr, nous n'ignorons pas le rôle important de la revue Der Sturm, fondée en 191o, et de son directeur, Herwarth Walden (1878-1941). Mais il avait une vision cosmopolite que nous n'avions pas à Paris, parce que le monde entier y a afflué ! Cela est dû en grande partie au mépris que nous avions pour notre ennemi héréditaire, l'Allemand ! Après ce conflit, la Hongrie est devenu un pays qui avait perdu une grande partie de son territoire et n'était plus qu'une de ces petites nations qui n'avait plus d'importance à nos yeux. Et pourtant, elle a continué à avoir de grands écrivains, de grands musiciens et de grands artistes. Pour ce qui est des arts plastiques, après la belle saison de la Sécession au début du XXe siècle, différents courants d'avant-gardes ont pu germer. Il y a eu plusieurs courants abstraits, dont surtout le constructivisme. La revue Ma a été l'un des principaux véhicule de cette tendance. La galerie Der Sturm a présenté des travaux de Moholy-Nagy, mais aussi d'autres peintres représentatifs de cette recherche comme Làszlò Péri ou encore Sàndor Borrnyik, qui n'a pas tout à fait renoncé à la figuration. Il convient aussi de s'arrêter devant les belles compositions de Jànos Mattia Teutch, qui évoluait dans un espace qu'on pourrait situé entre celui de Kandinsky et celui de Kupka, pour donner une idée de ce qu'il a pu accomplir. Et il faut se souvenir de l'un des lus radicaux et talentueux créateur de cette période, Lajos Kassàk, qui était aussi poète et essayiste, auteur, en 1926, du Livre de la pureté, après avoir écrit avec Moholy-Nagy le Livre des nouveaux artistes, à Berlin. Enfin, reste à signaler Lajos Ebneth, plus proche du néoplasticisme néerlandais. Ce ne sont pas des artistes mineurs, loin s'en faut. Les peintres et sculpteurs figuratifs sont aussi talentueux. Alfred Réth est resté très marqué par l'expressionnisme et puis s'est orienté vers un style qui se rapproche de Feininger. Quant à Béla Kadar, il a su découvrir un style original, qui est une synthèse de diverses influences qu'il a eu la faculté de dépasser.

Fiebig, le peintre au couteau, Bernard Baas, Hermann, 7o p.
Cette petite monographie nous fait découvrir Frédéric Fiebig (1885-1953), d'origine lettone (il voit le jour à Talsen) qui, come beaucoup de ses compatriotes à l'époque, fait ses études artistiques à Saint-Pétersbourg, peu après son mariage, il a décidé de s'installé Paris, fréquente l'Académie Julian et expose au Salon d'Automne et au Salon des Indépendants entre 19o9 et 1912. Il fait un voyage en Italie puis expose chez Berheim Jeune fin 1912. S'il commence par être influencé par le fauvisme, il est marqué par les écrits sur l'art abstrait, en particulier ceux de Vassili Kandinsky. Mais il ne s'orienta pas dans cette direction. Il choisit plutôt de chercher un compromis entre les deux, qui ne lèse aucune des parties en lice. Il y parvint pendant les années 193o, quand il commença à peindre des montagne : leur géométrique lui a servi a trouver une expression abstraite tout en préservant l'apparence de l'art figuratif. Puis il a opté pour le maniement du couteau, qui a encore plus accentué ses formes aigues et tranchées. En somme, ce volume nous fait découvrir un peintre méconnu et de comprendre un parcours assez tortueux, mais qui possède et sa logique et son sens.

La French Touch : Cinéma, Anne Bourgeois & Damien Paccellieri, CNC / Somogy Editions d'Art, 296 p., 39 euro.
Aimez-vous le cinéma français et voulez-vous en savoir plus ? Etes-vous plutôt un néophyte en la matière ? Dans un cas comme dans l'autre ce livre est fait pour vous (même si le titre est assez surprenant et assez contradictoire par rapport au sujet ; mais il faut préciser que l'ouvrage est traduit en anglais : il peut donc s'adresser à des cinéphiles ou des professionnels étrangers). Ce qui fait l'originalité de ce volume, c'est de ne pas raconter l'histoire du cinéma français, mais plutôt d'expliquer de quelle façon il se fait au jour d'aujourd'hui. Il y est question, travers cinquante portraits de figures majeurs du cinéma français dans tous les registres possibles, de la mise en scène, de la production, du montage, de l'image de synthèse, des institutions, des écoles, jusqu'aux organisateurs des différents grands festivals de l'hexagone en somme de toutes les professions qui ont partie liée avec le septième art. Le livre est bien conçu et nous propose des entretiens loin d'être superficiels pour comprendre comment toutes ces personnes envisagent leur métier. C'est une excellente manière de pouvoir comprendre la réalité artistique, technique du cinéma français, mais aussi sa manière d'envisager les moyens modernes de promotion et de diffusion. On découvre que la France, dans ce domaine spécifique, a conservé une place de premier plan (à l'inverse de l'Italie, par exemple, ce qui est regrettable étant donné la qualité des oeuvres reliées depuis la guerre). Tout amateur du film français trouvera donc ici de quoi approfondir ses connaissances sur un milieu dont les rouages et ses stratifications fonctionnelles se révèlent assez complexes et toujours en perpétuelle mutation. Bien sûr d'aucuns regretteront qu'ils n'y soient pas plus question de la création pure. Mais sans ce système technique et économique, il ne pourrait guère avoir de création cinématographique.

Laurie Karp, Seven Lakes Drive, musée de la Chasse et de la Nature / musée de la Céramique, Desvres, 78 p.
Laurie Karp est une artiste d'origine américaine que les amateurs n'ont pas encore reconnue à sa juste valeur. Et pourtant elle est pleine de talent et follement originale. Serait-ce parce qu'elle a choisi comme mode d'expression les arts du feu ? Peut-être. Mais à une époque ou tous les médiums sont utilisés, il me semble que ce ne ce soit pas une bonne raison. Quoi qu'il en soit après sa belle exposition au musée de la Céramique de Desvres, qui a donné lieu à un catalogue qui permet enfin d'avoir une vision assez large de sa récente production, le conservateur du musée de la Chasse et de la Nature de Paris lui a offert tout l'espace de l'hôtel particulier qui l'abrite pour y disséminer ses oeuvres dans presque toutes les salles (abritant déjà de belles oeuvres contemporaines qui se mêlent aux tableaux anciens et aux armes et trophées du temps jadis). L'univers de Laurie Karp est d'abord ludique et ensuite fantasmatique. Pour certains, ses créations pourraient sembler issues d'un cauchemar, mais le jeu et l'humour se mêlent à ces visions étranges et parfois inquiétantes. IL y a aussi de temps à autre une touche érotique, mais tout simplement parce qu'elle transpose l'organique et le charnel dans un registre onirique. Quand on se promène dans ce superbe musée tel que l'a imaginé son conservateur, on peut découvrir son interprétation du Terrier, nouvelle de Franz Kafka : elle soutire à ce texte une vision, qui est catastrophique et qui n'est pas dans l'esprit de l'écrivain pragois. Kafka y décrit une posture animale (celle de la taupe qui est pris dans paradoxe, trouver un lieu sûr en creusant des tunnels sous terre, et toujours en changer de peur ne pas s'y trouver réellement à l'abri, ce que décrit Buffon dans son Histoire naturelle en détail, et qui devient, sous la plume de Kafka, le mouvement de l'esprit à la recherche de la paix, donc du calme, du repos, de la plénitude, mais qui est animé par son dynamisme intrinsèque, qui consiste à toujours chercher -une autre position, le mettant face à une guerre. On peut aussi voir de nombreuses chasses, entre la mythologie (celle de l'artiste) et l'imaginaire débridé, des armes à feu, qui sont en partie faites d'un os d'animal, et des belles pièces de Sèvres recomposés selon sa volonté. Tout est lié à l'art de la chasse sous peut-être la salle du deuxième étage qui est dédiée à des créations d'un autre styles souvent dérivées de ses vases floraux pour devenir des tuyauteries surréalistes ou des images de personnages grimpant le long d'une paroi abrupte, comme animés par une pulsion impérieuse. Elle possède une capacité de mettre le visiteur dans l'embarras, mais aussi dans une sorte de jouissance des sens et de la méditation. Tout ce qu'elle fait, même ses broderies, est frappé au sceau de l'ambiguïté et d'une sorte de jeu entre éros et thanatos. Il faut espérer que cette incroyable mise en scène lui offre enfin la reconnaissance qu'elle mérite amplement.
Maxime Zhang, Gérard Xuriguera et Lydia Harambourg, Somogy Editions d'Art, 104 p., 25 euro.
Ce peintre d'origine chinoise, né en 1967, est venu s'installer en France en 1987. Dans une certaine mesure, c'est un peu le disciple de Za Wou Ki ; Il est abstrait et joue sur des contrastes chromatiques puissants. Mais Maxime Zang se distingue de son illustre aîné. S'il tient à faire paraître des allusions à l'art chinois ancien, ce n'est que le soubassement de sa peinture. Celle-ci n'appartient qu'à une vision qui n'a pas de frontières. Il faut ajouter à cela qu'il ne s'inscrit pas non plus dans l'optique orientale, tout du moins dans les effets recherchés. Cependant, sa peinture est encore dérivée de l'art de la calligraphie : la peinture est déposée et mise en abysse avec cette manière spécifique de former les caractères ou de composer un paysage ancien. C'est là et exclusivement là que se niche son origine orientale. Ses jeux chromatiques sont d'une grande finesse, mais ne sont pas dépourvus d'une certaine violence : il n'a pas peur des contrastes forts et des confrontations tonales. Cela l'éloigne nécessairement de l'esprit des artistes zen, pour ne citer qu'eux. Il faut d'ailleurs lire les deux pages où Maxime Zhang raconte avec simplicité mais avec éloquence son histoire personnelle. On comprend que, sans rompre ses liens intimes et profonds avec l'Empire du Milieu, il s'est ancré dans le monde occidental. De cette double nature est née une peinture qui ne peut être confondue avec les peintres abstraits de l'Ecole de Paris, ni d'ailleurs d'aucune autre école d'Europe ou d'Amérique. Il tient son pinceau et le met en mouvement de telle sorte qu'il donne naissance une galaxie sans pareil et que les belles reproductions de sa monographie donne envie de découvrir de visu. En effet, ce livre incite à pousser plus loin la recherche : ses tableaux sont séduisants car s'il ne sont pas orientaux, il laissent filtrer l'esprit si fin de l'art oriental.

M Train, Patti Smith, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nicolas Richard, Folio, 34o p., 7,8o euro.
Patti Smith, d'abord connue comme chanteuse, s'est consacrée à la littérature depuis un certain temps. M Train est une petite merveille. Bien sûr, c'est une autobiographie. Mais c'est un peu plus que ça. Et c'est surtout un long périple qui n'obéit pas aux lois de la chronologie. Chaque chapitre est une étape où elle développe les circonstances d'un moment de sa vie, mais plus encore, de sa manière de contempler le monde, de lire, de lire beaucoup, goulument (la liste des auteurs est considérable et d'une grande variété, de Musil à Murakami, en passant par Boulgakov) et de vivre l'esprit de certains lieux. Ce qui est le plus frappant, c'est que ses lieux d'ancrage sont surtout des cafés, comme le Café Ino à New York, qui paraît avoir été son quartier général, et beaucoup d'autres dans diverses villes des Etats-Unis. Il faut ne pas oublier qu'elle est une caféinomane notoire et que sa connaissance dans le domaine du café est étonnante. Elle voyage aussi à l'étranger et nous raconte par le détail sa visite de la maison de Frida Kahlo et de Diego Rivera, la Casa Azul à Mexico. Elle relate aussi un séjour au Japon. Mais ses plus grands voyages, elle le fait en compagnie des poètes et des romanciers, parmi lesquels assez peu d'Américains. La finesse de son écriture est remarquable et elle a su placer sur le même plan ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a pu imaginer ou rêver. Sa vie est faite de ce besoin irrépressible de se plonger dans la culture et d'y puiser des forces pour mener sa propre existence. Si elle nous dévoile des pans de sa vie privée, il est impossible de reconstituer son déroulement. Elle veut surtout faire partager ces heures de délectation ou de contemplation, ou de réflexion, plus encore que ce que le destin lui a réservé. C'est un livre enchanteur. Avec M Train, Patti Smith a rejoint la légion légendaire des grands écrivains de notre temps.
|
