
Chefs-d'oeuvre de la collection Leiden, sous la direction de Blaise Ducos, The Leiden Collection : Louvre Editions / Somogy Editions d'Art, 80 p., 18 euro.
Cette collection rassemblée par Thomas Kaplan et Daphné Recanati, pour ce qu'on peut en découvrir au musée du Louvre en ce moment, est une vraie merveille. Ce ne sont pas seulement les grands noms réunis autour de la figure tutélaire de Rembrandt qui forcent l'admiration, mais le choix très avisé et sensible des tableaux que ces deux personnes cultivées ont acquis. L'oeuvre de Jan Stevens (1626-1679), Le Sacrifice d'Iphigénie, est une merveille dans sa composition très équilibré, mais néanmoins vivante, et puis il y a cette nature morte au premier plan, avec un plateau en osier et des pièces d'étoffe, que Delacroix adaptera plus tard à ses propres tableaux. Et il faut admirer ce Gerard Dou (1613-1675), cet élève de Rembrandt dont on peut contempler Un savant interrompu dans on écriture, qui rappelle son maître avec un jeu très subtil d'ombres, un grand livre (la Bible, telle que la voyait Rembrandt) et puis quelques objets sur la table (une mappemonde, un crâne, un sablier, etc.), mais avec de notables différences comme la plus grande netteté des formes, moins d'empâtement, et une sorte de dépouillement presque ascétique. Enfin, arrêtons-nous devant Eliézer et Rebecca au puits de Ferdinand bol (1616-1680) car l'artiste a su y imprimer un rythme et une harmonie inégalables sans forcer l'effet. Bien sûr, les tableaux de Rembrandt sont spectaculaires, comme La Minerve de 1633, majestueuse et imposante, devant le fameux énorme livre qui hante l'artiste dans toute son oeuvre, un de ses autoportraits jeune (1634), dont les yeux ont une expression douce et vaguement mélancolique, Le Portrait de l'homme au manteau rouge (1633) est remarquable comme d'ailleurs celui d'Anthonie Coopal (1635). Et je dois avouer avoir eu une faiblesse pour Etude d'une femme à la coiffe blanche (circa 1640), qui fait partie de ces portraits qui rendent le modèle dans sa vérité, mais, en fin de compte, en lui attribuant une certaine beauté, bien que le réalisme soit cruel et que le modèle n'ait pas des traits très séduisants. Cette visite a été un enchantement et le catalogue est la mémoire de cet enchantement en plus de nous fournir de précieuses indications sur les pièces présentées au Louvre.

Un art de l'éternité, l'image et le temps du national-socialisme, Eric Michaud, Folio « Histoire », 432 p., 7,70 euro.
Ce livre est certainement ce qui a été écrit de plus passionnant sur l'esthétique du nazisme et ses visées. Eric Michaud a été capable, de manière extrêmement claire, solidement documentée et bien structurée, de développer les différents aspects de l'art et de l'architecture sous le IIIe Reich. En premier lieu, il nous fait comprendre qu'Adolf Hitler avait une vision de l'art et une vision très précise : il devait apparaître lui-même comme une oeuvre d'art. Cette opinion, Benito Mussolini l'avait exprimée dans le discours de présentation de la première exposition du groupe d'artistes appelé Novecento à Milan : il est persuadé que la politique est aussi un art. Mais cela étant posé, fascisme italien et nazisme allemand divergent : pour Mussolini, il Duce ne doit pas interférer dans les arts (promesse qu'il tiendra jusqu'à la fin), mais il a ajouté que la politique est aussi un art. Hitler, au contraire, est convaincu que l'art est au service du peuple, de l'Etat et de son guide (Führer). Et, a contrario de ce qu'on a tendance à répéter, Hitler n'était pas inculte. Il avait des conceptions bien précises sur la question. Une des premières mesures qu'il prend en 1933 est l'édification d'un Temple de l'art allemand à Munich, où seraient rassemblées les meilleures expressions de l'aryanité. Un défilé assez surréaliste est organisé, allant de l'Antiquité grecque jusqu'au présent glorieux de la nouvelle Allemagne. A lire les descriptions (et d'ailleurs en voyant les fragments de documentaires sur l'événement), on a sous les yeux le summum du kitsch. Sur ce projet spécifique il y avait des divergences parmi les chefs nazis : Goebbels soutenait les créations expressionnistes, Rosenberg et Himmler défendaient la tendance volkish, le vernaculaire national en somme. Hitler a critiqué ces deux postures. Le volkish convient pour l'habitat privé, mais pour les constructions publiques et les monuments, il faut un art noble inspiré par le néoclassicisme. Et bien sûr par les Grecs : en 1938, il a tant admiré une copie de Myron que Mussolini lui en a fait cadeau et il en a ensuite parlé dans un discours qu'il a fait pour la seconde exposition d'art allemand. Hitler a imposé sa volonté dans tout ce qui concerne les arts. Michaud remarque que le dictateur avait une passion pour les grands édifices industriels et il déclarait qu'ils avaient leur beauté propre avec tout ce verre, cet acier et ce béton. En somme, il avait aussi un goût marqué pour la modernité, mais seulement dans ce registre. Eric Michaud explique comment l'extension, la généralisation même, des théories ponctuelles avancées par Hitler et par le régime ont contaminé tous les domaines jusqu'à se demander si Beethoven n'était pas franc-maçon et à discerner dans l'écriture gothique une évolution de l'écriture runique (certains iront jusqu'à la faire dériver du grec ancien !). Michaud ne parle pas de l'autre aspect de la question, je veux dire la persécution des artistes modernes avec l'exposition de l'art dégénéré en 1937 et son aspect financier (la vente de la plupart des oeuvres à Zurich deux ans plus tard). Mais ce n'est pas son sujet et il y a déjà une abondance littérature sur cette question. Ce livre est le meilleur instrument pour comprendre ce qu'a été le nazisme au-delà du simple point de vue des arts.

Après Babel, traduire, sous la direction de Barbara Cassin, Mucem / Actes Sud, 264 p., 35 euro.
Je dois avouer que j'ai une prédilection pour ces catalogues qui sont de vrais ouvrages. Et c'est bien le cas ici. Je dois dire que qui n'a pas pu se rendre à Marseille pour voir l'exposition a pu en jouira travers ce bel ouvrage. La traduction, c'est une question qui ne s'épuise pas car elle est inépuisable dans son essence même. C'est à en perdre son latin ! Il n'y a jamais de solution miracle dans ce domaine puisque plusieurs options se confrontent selon la personnalité et l'état d'esprit du traducteur. Quoi qu'il en soit, le commissaire général de cette exposition a eu la bonne idée de choisi de commencer sa présentation en utilisant une citation d'Umberto Eco qui dit : « la langue de l'Europe, c'est la traduction » . En effet, chaque pays a voulu conserver précieusement sa langue et cela a donné des discussions absurdes sur, par exemple, la question langue du commandement militaire (le flamand et le slovaque, j'invente pour le seconde, mais c'était de ce ressort). Bien qu'un grand nombre d'idiomes disparaissent dans le monde, la babélisation est toujours à l'ordre du jour. Les questions que soulève la traduction sont innombrables. Tout l'intérêt de ce volume n'est pas de répondre à toutes, mais au moins d'aborder de question, selon les cultures et l'époque qu'on peut considérer. On y découvre un intéressant essai sur Babel, bien sûr, qui n'est pas banal, car M.-J. Mondzain a tenté de traiter cette partie de la Genèse de manière originale et très pertinente. Il ne prend pas appui sur les écrits (superbes) de Borges, mais sur une réflexion de Stefan Zweig, qui ne l'envisage pas comme une calamité linguistique, mais une calamité historique de son temps. Quant à Anthony Vidier, il l'aborde d'un point de vue strictement architectural, et nous renvoie à la pensée du regretté Aldo Rossi, qui parlait d'une « allégorie du pouvoir séculaire de l'humanité à construire la rationalité ». Et il choisit comme paradigme les ouvrages de Boullée, qui voyait dans la tour la forme suprême du langage de l'architecture. Tatlin et son célèbre Monument à la Troisième International est ce qu'étudie Pätricia Falguières en élargissant la question de ce genre de représentation dans l'art. Il faut aussi saluer les pages rédigées par Roland Schaer, qui évoque les tentatives de création d'une langue universelle à partir du XIXe siècle. Il rappelle ce que Leibnitz pensait des langues, voyant du génie en chacune d'elle, appliquant ainsi sa théorie de la monadologie à ce domaine, ce qui est assez vrai, car chaque langue sa beauté propre et sa « nature « propre. Je ne saurais ici parler de toutes les interventions contenues dans cet excellent catalogue. Il y est aussi question de la volonté française de détruire les patois, de la francophonie, qui naît avec les doctrines d'O. Reclus, de l'institution du scriptorium, qui commence à partir du XIIIe siècle à développer la pratique plus ample de la traduction, ce qui a permis la redécouverte d'une partie de l'oeuvre d'Aristote, l'introduction du théâtre antique à la fin du XVIe siècle... C'et une somme où rien n'est à écarter, ce qui est rare dans un ouvrage collectif. J'en reviens toujours (pardonnez-moi de me répéter) -à l'idée ce la bibliothèque de l'honnête homme ou de l'honnête femme : Après Babel, traduire est un livre de référence irremplaçable.

Petit manuel de la campagne électorale, Quintus Cicéron, suivi de Lettre à son frère Quintus, Marcus Cicéron, édition bilingue établie par François Prost, « Commentario », Les Belles Lettres, 248 p., 27 euro.
Nul ne peut ignorer que Marcus Tullius Cicero (106-43 avant notre ère) ait été un homme politique après avoir été un très brillant avocat (il faut se souvenir des Catilinaires) et un auteur fort respecté: il accédé à la magistrature suprême en étant élu au Sénat. Mais les turbulences entraînées par la marche sur Rome qu'a entrepris Jules César avec ses légions, les troubles politiques qui s'en sont suivis, l'assassinat de César et puis la rivalité féroce entre les trois prétendants, Pompée, Marc-Antoine et Octave, lui ont été fatales : il a fini par prendre le parti d'Octave et a été assassiné sur ordre de Marc-Antoine. Ses mains furent clouées sur la porte du Sénat ainsi que sa tête. Dans cet ouvrage, on découvre les recommandations que lui a faites son frère aîné Quintus. Il lui explique les règles de la vie politique, la manière de se comporter avec ses amis et avec ses ennemis, comment paraître en public, comment user de ses dons qu'il juge plus que suffisants. C'est absolument fascinant, car à travers ses explications, on comprend avec clarté le mécanisme de la vie politique à Rome juste avant l'Empire. La réponse du jeune frère qui désire se jeter dans la mêlée est une sorte de panégyrique de son frère, qui a déjà une solide expérience de la chose, assorti de commentaires sur ce qu'il a voulu lui faire entendre. Le copieux essai de François Prost éclaire de façon parfaite les propos tenus par les deux frères, mais fournit mille éclaircissements très précieux sur les moeurs à Rome dans ce domaine. En effet, il n'est pas compliqué de connaître le système dans ses grands principes, mais il est plus difficile de savoir comment il est vécu par ceux qui ont décidé d'en faire leur métier et quelles sont leur relations avec la plèbe, la classe équestre, les autres membres consulaires, etc. Bien que tout cela soit très éloigné de ce que nous vivons aujourd'hui, la campagne elle-même n'est pas bien différente dans son esprit ! La nécessité du cortège reste à rendre plus carnavalesque en notre temps !

Le Chant des morts, Pierre Reverdy & Pablo Picasso, préface de François Chapon, « Poésie », Gallimard, 160 p., 9,90 euro.
Après la guerre, Pablo Picasso accepte d'« illustrer » le long poème de Reverdy. C'est une décision rare dans sa vie, car, jusqu'alors, malgré de nombreuses et profondes amitiés avec des poètes comme Apollinaire, Max Jacob, Cocteau, il avait déjà accepté de réaliser en 1922 des eaux-fortes pour Reverdy et son livre Cravates de chanvre, se pliant à cet exercice en 1922 pour les Editions Nord-Sud. Le poète a tenu à spécifier que ce nouveau livre publié par Tériade en 1948 et tiré à 150 exemplaires n'était pas « un livre illustré, mais un manuscrit enluminé par Picasso. » En effet, le texte est entièrement manuscrit et Picasso n'est pas intervenu sur le sens du texte, qui est une sorte de Requiem pour tous ceux qui ont perdu la vue dans les camps de concentration et dans les camps de la mort et plus généralement pour tous les hommes et les femmes qui sont tombés au cours de cet effroyable conflit. Picasso n'apporte pas un commentaire à ce texte déjà intense et chargé d'une émotion palpable. Il n'a fait que tracer dans les marges des formes abstraites, toujours en rouge. S'il ne ponctue pas le texte poétique ni ne souligne sa gravité et son caractère douloureux, l'artiste a néanmoins donné à l'ensemble une sorte de fil d'Ariane graphique qui n'atténue pas la portée dramatique de ces lignes, mais qui lui offre une réalité formelle qui en souligne les phases. C'est une conduite assez extraordinaire pour ce peintre qui a toujours imposé sa griffe sur tout ce qu'il touche. Il a renoncé à sa maniera (aux aspects innombrables, mais toujours reconnaissable) pour entrer dans la sphère de l'abstraction à laquelle il ne touchera jamais, sinon de façon collatérale. En somme c'est une démarche unique pour un texte assez unique par son intensité et la force des mots qu'il ajuste avec une sorte de grand désespoir qui ne sombre cependant jamais dans le pathos. Il y a quelque chose de magique dans cette collaboration, qui dénote une véritable complicité
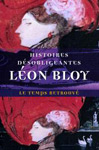
Histoires désobligeantes, Léon Bloy, édition présentée par Sandrine Fillipetti, « Le Temps retrouvé » Mercure de France, 300 p., 6,80 euro.
Ces derniers temps, l'oeuvre de Léon Bloy (1846-1917) a été un peu négligée, et on ne trouve plus ses oeuvres quasiment complète au Mercure de France. Il faut le déplorer, car c'est un écrivain peu banal, inclassable, à la fois fascinant et irritant, et ce recueil de nouvelles le prouve, tout comme le prouve son ouvrage paradoxal, réponse cinglante au sordide livre antisémite de Drumond (la France juive) le Salut par les Juifs. Les Histoires désobligeantes ont un titre qui en dit long sur l'esprit de l'auteur. De plus, ce sont des nouvelles d'un genre spécial, car Bloy y a glissé pas mal de notes personnelles. C'est ainsi qu'il fait souvent référence à son ami Jules Barbey d'Aurévilly, lui aussi maître des postures paradoxale, monarchiste invétéré mais polémiste virulent qui s'en prend avec virulence aux académiciens et aux institutions littéraires et politiques en général. Bloy est lui aussi catholique, mais très franchement anticlérical. On peut considéré ce livre impertinent comme un mélange de journal intime, de remarques sur le société de son temps, un jeu de massacre assortis d'une poétique stylistique et de réflexions plus ou moins à fleur de peau sur les sentiments, l'amour, les relations humaine, et toutes les bizarreries qu'offrait la vie d'alors. C'est très noir mais aussi souvent très drôle, d'une drôlerie irrésistible et parfois grinçante. Léon Bloy n'avait pas la langue dans sa poche, mais son écriture d'une subtilité rare et même d'une certaine préciosité compensait ce penchant pour l'humour virulent. La préface de Sandrine Fillipetti nous introduit très bien à l'étrangeté du parcours de cet homme de lettres majeur et à ce qui l'a animé dans l'écriture de ces textes éblouissants, qui n'ont pas pris un ride même s'il nous entretient beaucoup des personnes et des moeurs qu'il a connues.

Pli âge, Poëme amen âge, Julien Blaine, « C'est mon dada » numéro 111, Redofoxexpress, s. p.
On ne se lasse pas des fantaisies et des excentricités littéraires (et artistiques) de Julien Blaine. Auteur prolixe, et fier de l'être, il n'est pourtant pas saisi par une boulimie de publications. C'est dans la nature de son OEuvre, qui fonctionne selon une logique bien à lui. Cette fois, il nous propose une composition typographique assez particulière puisqu'il s'agit 'idéalement) de reconstituer un texte écrit en grandes majuscules et dont les lettres se chevauchent. Entreprise assez délicate, il faut bien l'avouer, qui semble plutôt une sacrée niche plutôt qu'un quizz ardu. La légende pour chaque planche occupant une double page en formant une sorte de compositions avec cette énorme lettrine intraduisible. Il est bien possible qu'il existe un moyen caché de découvrir le sens du texte (il en est capable, le bougre !), amis peu nous chaut. La beauté de l'affaire réside dans cet enchevêtrement de pleins et de déliés en noir sur fond gris. C'est là un livre-objet délicieux qui entre dans la catégorie de la poésie visuelle et un peu concrète aussi. Blaine reste toujours à l'affût des frontières de la poésie : c'est le garde-chasse de la transgression poétique, qui s'est changé par enchantement en un braconnier aguerri qui pose des pièges à ceux qui savent de quoi il retourne. Derrière la drôlerie souvent rabelaisienne de ses propositions, Julien Blaine dissimule de bien sérieuses méditations sur le devenir de cet art qui cherche à repousser sans cesse plus loin les limites de l'acceptable. Il n'y pas de véritable fin à cette quête - c'est une sorte d'infini indéfini qui laisse chancelant : on ne sait trop s'il faut encore avancer ou revenir à la case départ. C'est pour lui une sorte de voyage mental où la plaisanterie (parfois calembourgeoise) accompagne nécessairement la pensée sur une sphère qui est sur le point d'exploser comme une étoile morte pour devenir une nova inconnaissable.

Histoire d'Irène, Erri De Luca, traduit de l'italien par Danièle Valin, Folio, 128 p., 5,90 euro.
Je fais tous les efforts du monde pour avoir une vision impartiale de la littérature d'Erri De Luca, mais c'est à chaque fois la même chose : je ne parviens pas à entrer dans son jeu. Son style est efficace, simple, dépouillé (mais un peu comme Job sous son tas de cendres), avec des phrases qui sont transformées en paragraphe. Ça se lit comme on boit du petit lait. Mais il y a quelque chose qui m'empêche d'y trouver une réelle satisfaction. L'histoire de cette jeune fille de quatorze ans enceinte et abandonnée sur son île grecque, vivant dans une grange, mal vue des habitants de son voisinage est déjà du ressort du mélodrame un peu forcé. L'arrivé de cet homme qui s'intéresse à elle et parvient à nouer avec elle une sorte de complicité ne fait que faire empirer les choses : ils vont nager avec les dauphins et se retrouver dans une sorte de rêverie mythologique qui devient une sorte d'idylle fantasmée où passent tous les clichés possibles et imaginables. En revanche j'ai trouvé assez belle l'histoire du père de l'auteur, Aldo, un jeune militaire qui a eu une permission pour retourner chez lui à Naples quand il a appris que sa maison avait été bombardée (par les alliés; par contre, les Allemands ont fait sauter tous les immeubles bordant le golfe). Aldo se retrouve dans une bergerie avec d'autres réfugiés, dont un Juif qui ne cesse de se plonger dans un livre, s'abîmant dans un univers presque mystique au milieu de la tourmente. Et, ensemble, ils prennent la même pour aller trouver un refuge plus sûr dans la péninsule de Sorrente. En dépit du portrait un peu caricatural du vieux Juif, ce récit est bien mené, étant une sorte de métaphore d'un tournant de la guerre en Italie.

Tango de Satan, Làszlò Krasznahorkai, Folio, 400 p., 8,20 euro.
Souvent, très souvent, j'ai été émerveillé par l'extraordinaire richesse de l'art romanesque hongrois. Et ce livre, conçu par un auteur appartenant à la génération née pendant le régime communiste, ne déroge pas à cette règle. J'ai été littéralement envoûté et emporté par cette langue dont l'ampleur est infinie. Presque aussi infinie que la très morne plaine où vivent les personnages de ce roman. Mais peut-on parler ici de roman ? Non, certainement pas, en tout cas pas dans le sens traditionnel. C'est plutôt une succession d'histoires qui s'enchaînent, se chevauchent, s'enchevêtrent, disparaissent et puis réapparaissent comme le font d'ailleurs plusieurs de ces personnages qui ressemblent plus ou moins à des spectres à l'apparence banale. A ce sujet, ce livre qui parle d'une campagne désolée avec sa ferme collective et ses champs monotones, de toutes ces vies sans horizon et de tous ces horizons sans vie, est mis en mouvement par des forces gigantesques qui dépassent les êtres humains -, des forces divines ou maléfiques, nul ne le sait. Mais il y a du transcendant qui traverse de part en part ces grands espaces. Et tous ces personnages, du médecin qui se prend pour Diogène aux deux petites prostituées, des femmes sans espoir, et les hommes qui ont renoncé malgré leur caractère violent et impulsif. Le retour de deux personnages que tous les villageois croyaient disparus à jamais, Irmirias et Petrina, apporte de grandes perturbations dans cet univers plus que confiné. Ils parviennent à prélever un impôt sur leur misère, car ils croient qu'il est le porteur d'une nouvelle apocalyptique. C'est dans une atmosphère de kermesse endiablée que se déroulent tous ces événements incongrus et délirants, qui donnent à ce livre sa tonalité si sinistre et pourtant jubilante, comme si les grands malheurs finissaient par enflammer le coeur et l'âme des protagonistes qui, sinon, ne seraient restés que des petites gens d'une province perdue. C'est absolument à couper le souffle, car cette langue qu'emploie l'auteur ne cesse d'enfler et de gronder comme une tempête avec des épisodes tragiques et d'autres comiques, les deux se confondant la plupart du temps. Un bal des morts vivants ou des vivants morts comme on voudra. Contemporain et médiéval à la fois.

Le Point de Schelling, David Rochefort, Gallimard, 224 p., 18,50 euro.
Que peut-on reprocher à ce roman ? En réalité pas beaucoup de choses. C'est construit convenablement, ce n'est pas trop mal écrit (on pourra faire quelques menues réserves, mais vraiment presque rien), l'histoire n'est pas inintéressante. Et pourtant je ne suis pas parvenu à prendre plaisir à la lecture de ces pages. Pourquoi diantre ? A la vérité le personnage de Nissim est trop stéréotypé. En voulant en faire un désaxé (un « misfit »), l'auteur a fini par tomber dans le vieux stéréotype du bohème. Et Nissim est plus bohème que bohème : c'est l'essence même de la chose ! A force d 'hésiter à faire des choses absurdes en les corrigeant pour en faire d'autres encore plus absurdes, en en faisant un écrivain qui serait une caricature inconsciente de Rimbaud (ou plutôt de tous les clones modernes de Rimbaud), le personnage n'a plus aucune consistance. Son histoire d'amour avec Alba ne donne pas plus d'intérêt à cette prose. Sans parler de l'apparition du double de Salvador Dalì qui est ridicule. La description des milieux intellectuels parisiens n'est pas vraiment convaincante (trop ou pas assez). Bref rien ne va, alors qu'au fond tout est concevable et bien réglé. C'est peut-être là le problème du roman français depuis quelques décennies (depuis peut-être plus longtemps !) : il y a une qualité moyenne qui fait que le livre soit publiable, bien qu'il n'apporte rien à notre littérature. Comme le nombre de grands auteurs s'est réduit de manière considérable, ces livres apparemment potables ne font que se multiplier. Au fond, toute personne un peu cultivée et dotée d'un petit talent peut écrire un livre tel que celui-ci. Ecrire l'Idiot ou le Procès demande du génie. Mais même sans demander aux écrivains d'avoir du génie, demandons leur d'avoir de l'invention et de la curiosité, un style et une forme qui soit unique.

Le Parfum de l'innocence, Pariza Reza, Gallimard, 304 p., 20 euro.
C'est un roman qui, bien qu'il sous-tende une démonstration de caractère politique et désormais historique de l'histoire récente de l'Iran, s'affirme comme une oeuvre qui est originale et souvent poétique. L'histoire début à Genève, dans une ville où l'on ne risque pas de voir éclater une révolution ou naître un pouvoir dictatorial bien que ce petit canton helvétique ait été une dictature théocratique à ses débuts ! Ces premières pages sont très belles, car elles évoquent une sorte de contraste entre deux cultures et deux représentations du monde. L'histoire que nous raconte Pariza Reza commence par un drame : la disparition mystérieuse de l'épouse de Bahram, un professeur d'université. Il va élever seul leur petite fille, Elham. Cette dernière devient une jeune fille de son époque, qui accueille les formes du modernisme venues d'Occident. Mais elle n'est ni une rebelle, ni véritablement une militante acharnée. Elle croit en des valeurs nouvelles et en une vie éloignée des conceptions traditionnelles. Elle finit par tomber amoureuse d'un jeune homme, Jamshid, qui est le fils d'un militaire haut gradé de l'armée du shah. Tout cela paraît assez banal, mais ne l'est jamais de la façon dont l'auteur nous le rapporte. Les chapitres sont courts et elliptiques. Beaucoup de choses sont suggérées ou simplement amenées par une situation donnée, sans grands discours sur les événements tragiques qui entrainent le départ du shah et puis la venue au pouvoir d'un impitoyable gouvernement islamique. Bien sûr, le changement radical de régime est la clef de voûte du livre, mais n'est pas sa seule finalité. L'histoire d'amour se confond avec l'Histoire, mais n'en reste pas moins belle et restituée avec bonheur. Pariza Reza a su associer étroitement l'esprit de la littérature persane (où le roman tel que nous l'entendons n'existe pas) et l'esprit d'un ouvrage romanesque contemporain. C'est dans cette étroite symbiose que le Parfum de l'innocence peut être perçu comme une oeuvre singulière et toujours charmeuse et qui sait nous faire comprendre les tensions nées dans la société iranienne depuis le coup d'Etat de 1953.

Le Calice des secrets, Bernard Duvert, La Différence, 238 p., 17 euro.
Ce livre évoque une question de société qui est devenu une sorte d'obsession moderne : la pédophilie. Il n'y a pas si longtemps, l'amour entre un homme mûr et un adolescent était considéré comme chez les Grecs anciens quelque chose de très normal. Des éditeurs réputés n'ont jamais rechigné à publier des fictions de cette nature. Je ne parle pas de temps anciens, mais, au contraire d'une période proche de nous : il y a trente ou quarante ans au plus. Ce qui a renforcé ce sentiment violent d'hostilité a sans doute été la multiplication des cas dénoncés dans le monde ecclésiastique catholique. Il est vrai que ces faits ont pris des proportions considérables et, aussi, on a noté que, souvent, les rapports étaient subis et non consentis. Dans le Calice des secrets, Bernard Duvert, qui est lui-même prêtre, a raconté une affaire et l'a traduite dans les termes de la fiction. Et cette fiction, sans nul doute, est une histoire vraie. Les agissements de l'abbé Loysel, et la prudence chafouine de son évêque, peu disposé à voir éclater un autre scandale. Ce qui est vraiment intéressant c'est le rôle joué ici par un avocat, Maître Berthier. Celui-ci veut défendre l'accusé en se référant au manuel des confesseurs, ce qui peut paraître étrange, mais qui est pourtant une démarche qui s'inscrit dans la perspective cléricale. Il va jusqu'à rechercher des textes rares dans les archives du Vatican. Et ses arguments, en fin de compte, correspondent à des réalités historiques assez récentes : le Catholic Revival de l'Angleterre du XIXe siècle, prenant racine à l'université d'Oxford en 1833, a été embrassé par nombre d'homosexuels, dont certains sont des célébrités, en particulier dans le monde littéraire. C'est un livre écrit avec sobriété, mais aussi avec d'infinies subtilités pour que nous puissions comprendre la vérité de l'univers religieux actuel et des tensions non indifférentes qui s'y exercent. Ce n'est pas un document, ni un plaidoyer ni une mise en accusation. C'est une méditation sérieuse et exposée avec soin, sans aucun excès et avec la volonté de révéler tout ce qui est en jeu dans cette question, qui dépasse le simple cadre de l'acte pédophile.
|
