
Tauromachie, de l'arène à la toile, Ozvan Bottois, Hazan, 336 p., 59
Ce livre d'une taille assez imposante, nous permet de visiter la copieuse galerie d'oeuvres d'art que les courses de taureau ont pu inspirer aux artistes. La première constatation que l'auteur nous inspire est que la représentation picturale de l'art tauromachique s'est développée très tard, au XIXe siècle. En sorte que le magnifique portfolio de gravures (posthume) de Goya peut faire figure de précurseur en la matière. Avant lui, il n'y a eu que quelques graveurs, comme Antònio Carnicera qui a exécuté la série baptisée Suerte de bandilleras (1788) puis la Collection de principales suertes d'une corrida de taureaux (1790). Parmi ces artistes, qui nous sont pour leur grande majorité inconnus, il faut citer Eugenio Lucas Vélàsquez, Manuel Castellano. Parmi les français, on découvre Victor Adam et Pharamond Blanchard pendant les années 1830-1840, et puis Gustave Doré en 1874. Au XXe siècle, Ignazo Zalongo, artiste réaliste, Daniel Vàsquez Diaz, qui a décrit des combats, mais immortalisés de célèbres matadors lui aussi réaliste et portraitiste de grands toréadors, José Guttiérrez Solana, lui aussi disposé à magnifier ces grandes corridas, ou comme l'a fait Roberto Domingo ; quant à Dario de Regoyos, il a choisi de montrer l'envers du décor. Il y a aussi les funérailles de es demi-dieux qui ont représentés en grande pompe par José Villerga Cordero et Diaz. Et il ne faut pas oublié ce qu'a fait Joachin Sorolla et Mariano Fortuny. Edoardo Zamacois nous dépeint des enfants qui jouent à la corrida (1863), comme l'a fait à son tour Ràmon Bayeu y Subias. Les plus beaux portraits sont sans aucun doute ceux peints par Julio Romero de Torres pendant les années 1910. Bien sûr, les tableaux et les oeuvres sur papier d'Edouard Manet, de Pablo Picasso, d'André Masson, de Fernando Botero sont là et demeurent les pierres angulaires de cette galerie imaginaire. Parmi les curiosités qu'il nous offre, il y a un portrait de la fameuse Teresa Bolsi (1874), une des premières femme à être descendue dans l'arène, ce Portrait d'Ambroise Vollard vêtu en toréro (1917) d'Auguste Renoir, La Corrida de Francis Picabia (19412-1942), ou ce Toréro hallucinogène de Salvador Dalì (1970), la composition du groupe espagnol Equipa Cronaca. Et il se trouve ce magnifique tableau qui s'intitule Offrande à l'esprit du toréro de Julio Romero de Torres (1929) ; cet artiste étrange et merveilleux a également exécuté La Consécration de la copla en 1912. Vincent Van Gogh a aussi exécuté Les Arènes de Nîmes en 1888, un tableau rarement exposé. Après la dernière guerre, c'est Luis Fernàndez qui s'illustre dans un esprit proche de celui de Picasso. Plus tard, ce seront des artistes come Antonio Rodriguez Luna, Julian Pacheco, Oscar Dinguez et Edoardo Arroyo qui ont traité ce sujet, parfois avec ironie ou un esprit critique. Plus près de nous, il faut admirer les compositions de Miquel Barcelò. En plus de ces reproductions nombreuses d'oeuvres d'art, l'auteur n'a pas oublié non plus les photographes. Son livre a été conçu nous dans une optique historique, mais thématique (la dernière partie est consacrée à la poétique). Les amateurs d'art et les aficionados ne sauraient se dispenser de ce livre qui a été conçu avec un soin immense.
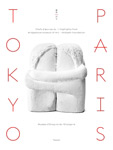
Chefs-d'oeuvre du musée du Bridgestone Museum of Art, Tokyo-Paris, sous la direction de Cécile Girardeau, Yasuhide Shimbata & Kyoko Kagawa, musée de l'Orangerie / Hazan, 176 p., 35
Ce n'est pas souvent que nous pouvons avoir la possibilité de voir cette importante collection fondée par l'homme d'affaires japonais Shôkirô Ishibashi. On apprend dans la préface qu'un artiste dans le style yôga (c'est-à-dire : occidental), Takeji Fujishima, a joué un grand rôle dans la constitution de cette collection importante. Après avoir visité de nombreux musée en Occident, il décida la construction du musée Bridgestonee (société qu'il dirigeait) qui a été achevé en janvier 1952 à Tokyo. La Fondation Ishibashi est créée quatre ans plus tard. Il a été décidé qu'une autre partie du musée serait bâtie dans la ville de Kurume. Cette collection qui a vu ses débuts en 1927 n'a jamais cessé de s'enrichir. Et cette passion s'es t transmise de père en fils : aujourd'hui, c'est le petit-fils, Hiroshi qui a repris le flambeau. Il y a eu quelques autres grands visionnaires de l'art qui ont eu le courage de rassembler des oeuvres, comme Tadamasa Hayashi à partir de 1890 (il a acheté des tableaux de Claude Monet peu après son arrivée à Paris).Un article vraiment instructif d'Atsushi Miura nous dresse un tableau à la fois assez complet et vivant du collectionnisme japonais depuis l'ère Meiji. Mais ces collectionneurs avisés ont aussi soutenu la création ans leur pays. Et l'exposition présente d'abord des maîtres nippons comme Shigeru Aoki, Hanjirô Sakamoto, Takeiji Fujushima (qui a adopté les principes du symbolisme), Tsuguharu Fujita bien sûr. Quant aux artistes européens, elle commence par une belle marine de Monet, montre un des Don Quichotte de Daumier, Millet, Corot Courbet, Pissarro, Sisley, Edouard Manet (avec un Autoportrait à la calotte, 1878-1879) Eugène Boudin (une charmante Scène de plage aux environs de Trouville), Caillebotte, Renoir, puis Gauguin, Toulouse-Lautrec, Gustave Moreau (une superbe Toilette, circa 1885-1890), Van Gogh, Cézanne, Rodin et enfin Matisse, Dufy, le Douanier Rousseau, Maurice Denis. Mondrian Picasso ferme la marche de cette période. Pour terminer, le visiteur ira d'un très beau Jackson Pollock à un inévitable Soulages en passant par Hartung. Ce choix qui nous est présenté à l'Orangerie des Tuileries n'est qu'une petite partie de cette collection. Mais elle suffit à nous faire comprendre la valeur de s pièces réunies par cette dynastie de collectionneurs à l'oeil très exercé.

La Saga Maeght, Yoyo Maeght, Points, 432 p., 7,95
L'histoire de la galerie Maeght est tout autre que banale. Ce couple originaire des Flandres françaises, d'extraction relativement modeste, est parvenu à se hisser dans le monde de l'art grâce au talent et à l'ingéniosité d'Aimé, qui de graphiste (comme on le dirait aujourd'hui) d'affiches, de publicités et de faire-part est parvenu à créer sa propre entreprise d'imprimerie, Arte, en 1930, dans le Midi de notre hexagone. La rencontre avec Pierre Bonnard a été décisive pour lui, car celui-ci lui avait demandé de tirer une lithographie. Une amitié profonde s'est nouée entre les deux hommes. Ce fut le point de départ de sa relation profonde avec les créateurs de son temps. Il a connu alors Henri Matisse à Nice. Marguerite, son épouse, surnommée Guiguite, a été un modèle de diplomatie et de stratège, épaulant son mari avec sagesse, ce qui n'a pu qu'aider à développer son grand et ambitieux projet. Pendant la guerre, Aimé Maeght a continué à porter à Paris des tableaux de Bonnard, malgré le passage de la ligne de démarcation. Il a eu une conduite exemplaire, contrairement à d'autres, et a permis, par exemple, de mettre le célèbre marchand Bernheim et les siens à l'abri en Suisse. Ces gestes courageux et généreux lui ont permis d'avoir des aides importantes quand il a repris le bail de la galerie de la rue de Messine et commencé l'aventure de la galerie, qui est devenue l'une des plus importante d'Europe après la Libération. L'histoire des petits-enfants (Florence, Isabelle, Jules et Florence, qui a été surnommée Yoyo) est aussi racontée avec beaucoup de charme, un peu comme un conte de fée (en fait Yoyo Maeght s'est remise dans l'optique de son enfance). Le seul regret qu'on puisse avoir est qu'elle consacre près de cent pages aux différends qu'elle a eus avec sa soeur, son père, même son petit frère, racontant par le menu les batailles familiales autour de la fondation de la maison d'édition, de l'imprimerie et de la galerie. On aurait préféré qu'elle parle plutôt des artistes de la galerie, et pas seulement de Mirò et de Giacometti, mais aussi des plus jeunes comme la brillante Hélène Delprat, qui n'est même pas citée et des collaborateurs, comme moi par exemple (et parmi d'autres !), qui ait quand travaillé six ans pour cette antique institution de l'art parisien !

Masciarelli, Tracce, sous la direction de Marco Mariuacci, Fondation Mudima, 96 p., 30
J'ignorais jusqu'à présent l'oeuvre de Gino Masciarelli, né en 1940 à Chieti, dans les Abruzzes. Il est sculpteur et rien que sculpteur. A ses débuts, il était purement figuratif. Puis sa démarche esthétique l'a fait rapidement évoluer vers l'abstraction - mais pas une abstraction radicale, car il joue souvent sur des réminiscences morphologiques ou à sur des références minérales, florales ou animales. S'il aime construire de volumes monumentaux, il a aussi le désir de « trouer » ses volumes, d'y ménager de nombreuses ouvertures et, au fond, de ne se ranger dans aucune école connue. Il y a quelque chose qu'il a emprunté aux futuristes italiens, d'autres à Henry Moore ou à Fausto Melotti mais il s'est bien gardé de trop se rapprocher des uns ou des autres. Le prouve, par exemple, une pièce comme Atterraggio (1996), une oeuvre qui fait plutôt songer à une plante sous-marine. Il éprouve une prédilection marquée pour le bronze mais cherche toujours à en donner différentes apparences, par le patinage ou l'introduction d'une couleur comme dans Caos del caffè (2001). Il n'y a pas chez lui une rigueur formelle qui le conduise à produire des oeuvres possédant une même typologie et utilisant les mêmes procédés. Et pourtant, malgré la très grande diversité des solutions visuelles qu'il adopte, il existe une ligne de tension qui réunit toutes ces créations les unes aux autres. On dirait néanmoins que l'artiste a voulu échapper à l'imposition d'un style, d'une empreinte impossible à confondre avec une autre. Chaque oeuvre réalisée est pour lui une aventure nouvelle et imprévisible. Dans ce volume, il a aussi réuni des textes critiques qui vont de Roberto Sanesi à Carmelo Strano, en passant par Del Guercio et Fernanda Pivano.
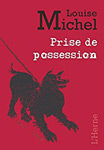
Prise de possession, Louise Michel, édition présentée par Claude Rétat, L'Herne, 86 p., 7,50
Cet essai de Louise Michel n'est pas inconnu. Mais depuis sa première publication en 1890, les rééditions qui ont été effectuées ont apporté de nombreuses coquilles et erreurs au point de rendre le texte inintelligible. L'édition de Claude Rétat nous restitue donc ces pages telles qu'elles ont été écrites par la fameuse révolutionnaire et, de surcroît, apporté des précisions importantes pour sa compréhension aujourd'hui en établissant des notes indispensables. Prise de possession peut être considéré comme son manifeste. Elle refuse le vote et toutes les compromissions et entend bien que puisse s'instaurer une société véritablement juste. Ce que est curieux dans ces pages, ce ses référence, pas à celle au mythe de Prométhée, qui est d'un clarté évidente, mais aux révoltes survenues en Hongrie autrefois et la révolution brésilienne qui a permis la formation d'un Etat central englobant tous les Etats. Mais elle ne fait aucune allusion au projet de Simon Bolivar, qui voulait arriver à unifier toutes les anciennes colonies espagnoles, en ayant pour noyai central le Venezuela et la Colombie. Mais la Colombie ne voulait se fondre dans le Venezuela et la réciproque était aussi vraie ! Même union prévue entre l'Argentine et ce qui a été appelé provisoire la République orientale de l'Uruguay n'a pas pu se faire et l'Uruguay porte toujours son nom provisoire, mais si les rues de Montevideo porte encore le nom des quartiers qui devaient naître de ce grand saut politique. Quoi qu'il en soit, les écrits de Louise Michel montre quelle a été sa passion pour la liberté des hommes et aussi la dose de naïveté qu'elle avait pour croire à ce qui est devenu une pure utopie. Mais les transformations que nous connaissons aujourd'hui, bien au-delà de la seule politique, nous conseillent de relire ce genre de brûlot idéologique, car nous devons réfléchir sérieusement à notre avenir à l'âge de la révolution électronique et donc de nous inspirer de son esprit. Elle est inspirée. Elle peut encore nous inspirer. Nous devons trouver une inspiration analogue selon nos propres aspirations.

Les Hôtes de la nation, Frank O'Connor, traduit de l'anglais (Irlande) par Edith Soonkindt, « La petite vermillon », La Table Ronde, 256 p., 8,70
Etrange littérature que celle de Frank O'Connor (1903-1966) ! Les nouvelles rassemblées dans ce volume racontent toutes des histoires qui, à nos yeux, ont un tour pittoresque car tout est vu dans une optique spécifiquement irlandaise. C'est écrit avec beaucoup de vivacité et les dialogues sont construits avec une science digne d'un auteur aguerri. Mais les récits se rapportent à des petites affaires familiales dont le véritable sujet est justement l'esprit irlandais sous tous ses aspects, les meilleurs comme les plus déplorables. D'un côté, elles sont intéressante d'un point de vue quasiment ethnographique (qu'on me comprenne bien : l'ethnographie peut ne pas concerner que les peuples sauvages des continents éloignés !) pour des Français comme nous (surtout ceux qui ne connaissent pas ce pays et es manière de considérer l'existence), de l'autre, elles sont un peu décevantes car elles n'ont pas le cachet des courtes nouvelles de Guy de Maupassant quand il décrit la mentalité des paysans de sa Normandie natale. L'ouvrage est d'une lecture plaisante, les histoires sont bien menées, mais elles ne peuvent vraiment être appréciées que par les autochtones ou par des connaisseurs amoureux de ce monde si particulier. Pour nous, ce sont des affaires parfois dramatiques, parfois amusantes, traité avec un sens de l'humour (souvent noir) qui est remarquable. Mais ce monde est d'une nature trop étriquée pour pouvoir nous satisfaire pleinement. A recommander donc aux amoureux de l'Irlande ou à ceux qui éprouvent l'envie de la découvrir. Ce n'est ni William Butler Yeats, ni George Moore, ni James Joyce, qui ont une valeur universelle (même Yeats, qui traitent des légendes ancestrales de cette île fertile en ce domaine, peut nous toucher). Frank O'Connor ne démérite pas. Loin s'en faut. Mais il reste trop ancré dans la culture de son pays sans nous en donner les clefs.

Chroniques politiques des années trente, Maurice Blanchot, édition de David Uhrig, « Les Cahiers de la nrf », Gallimard, 560 p., 29
Peu à peu, un portrait plus précis de la personnalité de Maurice Blanchot se dessine. La publication, dans la même collection, de ses écrits littéraires pendant la guerre y a déjà beaucoup contribué. Cette fois, c'est sa réflexion politique avant la Seconde guerre mondiale que nous délivrent tous ces articles écrits dans de nombreux périodiques, comme Le Rempart, Aux écoutes, La revue universelle, L'insurgé, Combat, etc. La préface de l'auteur de cette compilation est assez décevante car elle ne fournit aucun indice sur les opinions du futur auteur de Thomas l'obscur. Il dit bien qu'il a commencé par travailler pour La Revue universelle dirigée par Henri Massis. Mais qui se souvient vraiment de qui fut ce personnage ? Il nous dit bien qu'il avait noué des liens solides avec L'Action française de Charles Maurras, mais reste dans le vague. Et j'irai jusqu'à dire dans l'opacité. Proche en effet de Maurras (et il le restera) il défend l'Italie fasciste lors de la conquête de l'Italie et soutient le régime de Salazar. Favorable à Franco, il a aussi produit deux livres sur le siège de l'Alcazar (le second a été préfacé par Robert Brasillach). Il est l'auteur d'un Manifeste des intellectuels français pour la défense de l'Occident et de la paix (1935). Après l'armistice, il installe sa revue à Vichy et devient membre du conseil National. Il est décoré de la francisque (comme Mitterrand !). Il est aussi l'organisation d'une organisation de « jeunesse unique ». Bref, il a été un collaborateur consciencieux. Tout cela l'a fait terminer sur la liste du Comité National des écrivains à la Libération. Mais cela ne l'a pas empêché d'être élu à l'Académie française, alors qu'il a continué à collaborer avec Maurras et ses fidèles. Le premier article que lui a demandé d'écrire Massis est sur Gandhi. Pourquoi l'a-t-il fait ? Parce que Gandhi est présenté comme un exemple par Romain Rolland considéré alors comme l'écrivain le plus considéré par les progressistes. Blanchot se tire assez bien de sa tâche (en dehors du fait qu'il confond bouddhisme et hindouisme) et produit une critique du grand homme qui est conduite avec art. La même année, il s'en prend à Paul Valéry, qui vient de publier Regards sur le monde actuel. Puis il rédige une courte mais cinglante critique de la Technique du coup d'Etat de Curzio Malaparte. Les années qui suivent, il parle de Daniel-Rops (sur lequel repose l'essentiel de sa réflexion), de Duhamel, s'en prend aux pacifistes et s'interroge sur l'engagement politique des écrivains. S'il ne s'émeut guère de l'arrivée au pouvoir du chancelier Hitler, il est indigné par les premières persécutions contre les Juifs. Quant à la France il n'a de laisse de reprocher aux différents gouvernements leur apathie et leur absence de vision. Pendant cette année 1933, Blanchot se révèle extrêmement prolixe. Il évoque la lente dégradation de la situation politique française, les rapides décisions de l'Allemagne nazie, et décrit le jeu diplomatique de la Petite Alliance. Les années suivantes, le nombre de ses articles s'est réduit considérablement. Il critique le gouvernement de Léon Blum comme il a critiqué vertement celui d'Edouard Daladier. Ce qu'il écrit de vraiment intéressant concerne l'Allemagne dont il analyse assez bien les intentions politiques et bientôt militaires. Après la défaite de juin 1940 et l'armistice, il produit quelques petits billets qui en appellent à la « révolution nationale ». Là, il n'a pas vu le piège se refermer sur lui.

Rédemption, Esther Ségal, « théâtres », L'Harmattan, 116 p., 13,50
Esther Ségal est d'abord une artiste plus que prometteuse. Mais elle est aussi femme de lettres : elle est l'auteur d'un essai chez le même éditeur, De l'un-précis (2016), et d'un roman écrit avec un de ses amis écrivain, encore inédit, ainsi que d'un récit composé pour un livre en l'honneur d'Umberto Mariani (Fondation Mudima, Milan, 2016). Le théâtre exerce sur elle un pouvoir de fascination immense. Elle est déjà montée sur scène et s'est employée maintenant à écrire des pièces comme celle-ci, qui porte un titre chargé d'ambiguïtés, Rédemption. Car il s'agit ici de la rédemption de Satan ! Le thème n'est pas nouveau (John Milton l'a déjà évoqué dans son Paradise Lost) et la théologie a pris considération de cette question depuis longtemps, tout comme Victor Hugo l'a traduite dans son langage poétique. Son intention n'est pas de créer un sujet inédit, mais plutôt de le traiter d'une manière qui soit originale. Et elle l'est vraiment ! Jésus et Satan dialogue. C'est le premier qui a le plus de doutes et Le prince des ténèbres lui explique son rôle. Petit à petit leurs points de vue se rapprochent et Satan, l'ange rebelle, finit par monter au Ciel avec le Christ et reprendre a place auprès de Dieu. La figure de Judas tient une place importante dans cette affaire. Pour l'auteur, il est un instrument qui a accompli son rôle dans cette thaumaturgie. Son sort n'est pas enviable. Et il devient le témoin de ce que l'humanité est capable de faire dans une perspective des plus inhumaines. Enfin l'Homme et la Femme apparaissent dans la seconde partie de la pièce. Ils se retrouvent en dehors du monde de la sacralité, donc exclu aussi bien du Paradis que de l'Enfer, dans un monde qui n'a plus aucune dimension spirituelle. Le décor de cette pièce est constitué par le métropolitain parisien. De nombreuses photographies de l'auteur en noir et blanc illustrent (avec des variations allant du pur réalisme jusqu'à une quasi abstraction) l'ensemble de l'ouvrage et donne l'esprit de ce décor. Le tout a quelque chose de mystérieux et de tragique. Mais le texte n'a pas cette tonalité sombre et images et écrit constituent donc un contraste assez singulier. Esther Ségal nous prodigue une belle écriture, à la fois tendue et intelligente, fruit d'une réflexion pertinente. Et la pièce est relativement concise et construite de façon dynamique : on est ici aux antipodes de Paul Claudel !

Cicatrice, Sara Mesa, traduit de l'espagnol par Delphine Valentin, Rivages, 224 p., 22,50
Ce roman reflète assez bien l'esprit de la nouvelle littérature, fascinée par tout ce qui peut lui sembler contraire, en particulier tous les moyens de communication offerts par internet. Archiviste, Sonia aime utiliser les ressources de la communication virtuelle. Elle rencontre sur un site un homme qui l'intrigue et qui, de surcroît, dit se nommer Knut Hamsun. Au début, leurs relations sont purement littéraires et il lui fait office de cicérone, lui conseillant des lectures et puis en lui envoyant certains volumes. Il y avait quelque chose d'intriguant dans ces envois car il lui offrait les ouvrages, mais lui faisait payer les frais d'expédition. Tout cela reste virtuel assez longtemps. Aux livres, il ajoute bientôt d'autres choses, plus personnelles, du parfum par exemple. Puis leurs lettres sont de plus en plus intimes et une sorte de liaison s'ébauche par le biais de ces moyens virtuels. Par la suite, il lui envoie de la lingerie fine, des chaussures. Il avoue les voler (comme il dérobe aussi les livres !) à son intention. Ils finissent par se rencontrer et elle accepte de le laisser aller à ses obsessions fétichistes. Mais jamais il ne la touchera. Au fond, voilà un homme qui vit doublement dans la virtualité. Il lui avoue alors avoir rencontré une autre femme dans une autre ville, sans donner aucun détail. Ce n'est pas la jalousie qui assaille Sonia, mais plutôt cette trahison dans leur histoire qui reste en grande partie irréelle. Et là, elle lui fait sentir que depuis longtemps, c'était elle qui menait le bal. Il faut bien reconnaître que ce roman est bien ficelé et, s'il est divertissant et d'une lecture divertissante, il touche aux mécanismes complexes des échanges entre les individus de nos jours, échanges faussés par la technologie, mais aussi faussés par l'inexistence relative des anciennes conventions. Sara Mesa a un certain talent et sait parfaitement manipuler tous les éléments qui peuvent servir à construire ces semblants (ou faux-semblants) de frelations intellectuelles ou amoureuses. Car son héroïne va jusqu'au bout du jeu : elle laisse son interlocuteur satisfaire ses fantasmes et, elle, elle joue avec ces fantasmes sa propre comédie et sa propre sensualité. C'est une réussite indéniable.

La Beauté malade, D. H. Lawrence, 80 p., 6,20
Avant de commenter cet essai de l'auteur de Femmes amoureuses et de l'Amant de Lady Chatterley, il faut que le lecteur sache qu'il a été également peintre, d'ailleurs pas un mauvais peintre, et que cette passion, en dehors de l'Angleterre, ne semble encore pas beaucoup intéresser ses lecteurs les plus passionnés. Ces pages concernent essentiellement l'art, mais dans ses relation à l'être humain et encore plus précisément au corps, avec tout ce qu'il implique. Au début, il explique certains comportements anglo-saxons dus, selon lui, à la peur de la syphilis. Il reconnaît d'ailleurs ne pas connaître grand chose à la médecine. Si cela avait été le cas, il aurait su que cette malade était absolument épouvantable et conduisait, étape par étape, à une dégradation abominable du corps et ensuite de l'esprit, le portant jusqu'à la folie et la mort. Je ne crois pas que cette maladie effroyable ait eu quelque chose à voir avec la représentation du corps. Il s'en prend à la Vénus de Botticelli, puis à des peintres plus proches dans le temps comme Millais et G. F. Watts. En littéraire, il est condamne presque tous les grands poètes, de Keats à Shelley (oubliant que ce dernier avait été un matérialiste convaincu) et ne préservant que William Blake. Il considère que les Hogarth, Gainsborough, Lawrence, et autres peintres des XVIIIe et XIXe siècles ont plus été des couturiers avisés que des artistes représentant l'être humain (en fait, il pense qu'il n'y a rien eu de conséquent dans ce domaine depuis Holbein). Il faut donc traverser la France et trouver des oeuvres plus charnelles avec Courbet, Daumier, Degas. Il y a un artiste qui retient toute son attention, c'est Paul Cézanne, en qui il voir le retour à la réalité des choses. Il entreprend une analyse très fine des oeuvres de ce peintre solitaire et met aussi en évidence ses échecs. Sans doute cet amour pour ce dernier lui a-t-il été inspiré par ses amis du Bloomsbury qui étaient tous des dévots de Cézanne, aussi bien Roger Fry que Clive Bell. C'est là une prose toute à fait intéressante de Lawrence car, au-delà de ses obsessions quelque peu fatigantes (et souvent injustes, car personne en Angleterre n'a peint rien déplus sensuel que D. G. Rossetti quand il faisait des portraits de femmes), conduit une réflexion sur le peintre d'Aix-en-Provence.

Nous étions cinq, Karek Polàcek, présenté et traduit du tchèque par Martin Danes, Editions de la Différence, 304 p., 19
Enfin ! Je dis enfin, car Karel Polàcek (1892-1945) est sans doute le dernier écrivain tchèque du siècle passé à ne pas avoir été traduit et publié en France. Il y a bien eu une belle anthologie de la littérature tchèque préparée par Catherine Servant et puis ce récit que j'ai intégré au livre-catalogue Métamorphoses de Kafka (Editions Eric Koehler, 2002). Et puis, plus rien ! Deux mots sur l'auteur : il est né dans une famille de négociants à Rychod na Knznou et a fait dans cette ville une grande partie de ses études secondaires qu'il a terminées à Prague. Il s'inscrit à l'université Charles pour apprendre le droit. IL se retrouvé employé dans une étude pour un court moment : la Grande Guerre lui vaut d'aller en Serbie travailler pour le comité d'import-export. Cette expérience lui inspire un recueil de nouvelle intitulé le Carrousel. En 1920, Josef Capek lui offre de collaborer à son journal satirique Nebojsa. Il y écrit de courts récits sous le pseudonyme de Kockodan. Mais il a travaillé pour bien d'autres journaux. Il a publié son premier en 1928. Ce n'est que le début d'une prodigieuse production. Comme l'explique très bien Martin Danes, le livre que nous avons entre les mains est le dernier qu'il a écrit. Il l'a pensé et rédigé pendant l'occupation allemande. Il a pu travaillé pour la communauté juive jusqu'en 1943, puis a été déporté au Nord de la Bohème, à Teresienstadt, puis à Auschwitz, avant de finir ses jours Gleiwitz. Son oeuvre est prolifique. Je me souviens avoir vu ses oeuvres complètes (12 ou 16 volumes, je ne le rappelle plus avec précision) qui trônaient sur un rayonnage bien en vue de la libraire « Kafka » (était en fait l'ancien magasin du père de Franz Kafka) donnant sur la place de la Vieille Ville. Ses textes étaient lus à l'école primaire. Les Tchèques, bien qu'il fût juif, adorait ses écrits. Et je pense qu'il l'adore toujours. Il s'était fait une spécialité de raconter la vie des petits Juifs, surtout les provinciaux, et il a laissé un nombre considérable de nouvelles avec des dialogues à mourir de rire. Ses livres raconte de toute façon la vie des gens simples, les tourne en dérision, mais sans la moindre méchanceté. A travers lui, les Tchèques peuvent se reconnaître et voir tous leurs travers. Dans ce dernier livre, Nous étions cinq, il raconte sans nul sa propre enfance. Ce sont des gamins de l'école élémentaires qui scrute le monde des adultes et tout ce qui les entoure. Et l'auteur nous relate toutes leurs découvertes, leurs promenades aux alentours, leurs bêtises (nombreuses) et aussi leurs rêves : la vue d'un cirque avec des animaux exotiques a excité leur imagination et notre petit héros se met à rêver que le petit éléphant Jumbo est resté avec lui au village et qu'il a pu voyager en Indes où se prépare un mariage fabuleux avec la fille du maharadja. Ce livre de l'enfance se termine dans une atmosphère onirique et ludique absolument merveilleuse. Paru après la guerre, Nous étions cinq a connu un grand succès même pendant la période communiste. C'est désormais un classique au même titre que Hasek ou Capek. Un bon conseil : allez sans attendre vous procurer ce livre et vous vous y retrouverez vous aussi, car on y retrouve d'aborde la magie de l'enfance. Qu'elle soit française ou tchèque.
|
