
Olga Picasso, sous la direction d'Emilia Philippot, Joachim Pissarro & Bernard Ruiz-Picasso, musée Picasso / Gallimard, 336 p., 39 euro.
Edward Quinn, Picasso sans cliché, sous la direction de Jean-Louis Andral, Hazan, 168 p., 30 euro.
On connaît d'innombrables portraits de Pablo Picasso, surtout ceux de Brassaï et d'André Verdet. Et l'on pourrait faire une liste sans fin de ceux qui ont voulu immortaliser le grand artiste sur la pellicule. Ce qui est intéressant, c'est qu'Edward Quinn a tenté de restituer le Picasso le plus intime, sans mascarade ni la moindre pose. Il nous entraine dans son univers, dans celui de Jacqueline, sa dernière épouse, sans vouloir faire de l'art ni chercher le cliché qui restera le plus significatif ou le plus aimé. C'est tout le contraire : il recherche l'homme dans sa vérité, sans avoir non plus l'ambition de l'examiner de pied en cape pour en tirer les meilleurs apparences et d'en révéler les secrets. Non rien qu'un témoignage, avec affection et sans rien rajouter, sinon sa capacité de trouver le bon moment, le bon angle et le moment juste. Personne n'a d'ailleurs été capable de percer le « mystère Picasso ». Ce que nous apporte ce catalogue, qui permettra de voir à distance ceux qui ne pourrons pas se rendre au musée Picasso s'Antibes avant le 2 juillet de se faire une idée précise de ce qu'a pu faire ce grand photographe avec son modèle, sans jamais le déranger, et qui l'avait rencontré en 1951. Quelques cent trente photographies nous donne une idée de ce patient travail d'approche, comme un chasseur dans un sous-bois, qui ne tient pas à effrayer son gibier. Que ce soit chez lui ou pendant une corrida, avec son épouse ou avec des amis, Picasso reste naturel. Quinn a opté pour le noir et blanc la plupart du temps, sans doute pour ne pas tomber dans le reportage des magazines de l'époque qui se gavaient de couleurs à l'américaine. Il travaille ou bavarde avec ses amis sous nos yeux, sans effets de quelque nature. L'artiste ne cache pas l'homme, mais l'homme ne cache pas non plus l'artiste.
Les femmes de Picasso sont à l'honneur en ce moment ! Christian Parisot vient juste de publier en italien les mémoires de Fernande Olivier parue chez Comedia, avec une iconographie rare et des documents de la main de la première compagne de l'artiste. C'est un magnifique volume. Même pour ceux qui connaissent l'édition française, qui n'est pas illustrée. Mais, bien sûr, le musée Picasso de Paris vient, pour sa réouverture, de rendre un hommage vibrant à Olga Khokholva, (1891-1955), qui fut la première épouse de Picasso (ils se sont mariés le 12 juillet 1918) et ont un fils en 1921, Paulo). Les biographes français du « monstre sacré » ont tous considéré que ces épousailles ont été un désastre pour l'a rtiste, car la petite danseuse des ballets russes de Diaghilev, aurait voulu en faire un chien savant dans les milieux mondains. En 1935, elle découvre la liaison de Picasso avec Marie-Thérèse Walter et demande le divorce, ce que Picasso ne lui accordera jamais. Sans doute cette exposition et ce très beau catalogue nous fournissent une image d'Olga un peu différente des légendes inventées par Pierre Daix et tant d'autres. Tout d'abord elle a été son modèle à de nombreuses reprises. Sans doute a-t-elle été liée à une période de l'artiste qui a coïncidé avec un retour (très partiel et très provisoire) au classicisme. On la voit représentée dans leur appartement dans des poses familières, en train de lire ou d'écrire. Il ne l'exalte pas dans ses dessins. Et il ne tarde pas à lui faire connaître les premières métamorphoses qui engendrent un décalage saugrenue dans ses compositions classiques (il n'est que de voir les Trois danseuses de 1919-1920. Mais ce n'est pas encore la règle : songeons un instant au groupe formé dans son atelier rue de la Boétie avec Olga, Cocteau, Erik Satie et Clive Bell, le critique d'art anglais, mari de la soeur de Virginia Woolf, Vanessa. L'artiste nous la montre souvent pensive et mélancolique, avec une sorte de gravité et de tristesse. Il fait un nombre important de maternités en 1921, mais on ne voit pas que c'est elle qui figure sur le papier ou la toile, sauf en de rares occasions. Picasso a fait de ses femmes des déesses de la fécondité. Et son oeuvre plus avant-gardiste ne poursuit en parallèle de cette phase quasiment ingresque. En 1925, il retrouve Diaghilev à Monaco. Sans doute Olga regrette-t-elle d'avoir renoncé à la danse. Mais ce n'est que pure conjoncture. Il est vrai que Picasso se dirige vers un art très radical, qui réduit à néant les critères essentiels de l'anatomie. Cette date marque un tournant décisif. Les Femmes qu'il a peintes en 1927 par exemple, sont presque des abstractions. Puis il s'est orienté vers un surréalisme tout à fait personnel dès l'année suivante avec ses femmes en maillot de bains jouant sur la plage. Le Peintre et son modèle de 1926 ne peut en rien dévoiler Olga : elle serait de toute façon méconnaissable. Toutes les compositions sur le face à face entre le peintre et le modèle, surtout à partir de 1928, désincarne les personnages ou les rendent caricaturaux, comme le montre Le Baiser. C'est maintenant l'époque du Minotaure qui commence, avec aussi des corridas furieuses, multipliant les styles, du plus sage au plus débridé, et celui de la fameuse Crucifixion (1930). Cette phase si féconde à nos yeux, Picasso l'a jugée jugé la « plus terrible de sa vie ». Il a même arrêté de produire pendant un certain temps. D'où sans doute la légende qui frappe Olga, alors que Picasso était préoccupé du fait que Marie Thérèse était enceinte de lui !

Chagall, sculptures, sous la direction de Johanne Lindskog, Réunion des Musées Nationaux, Grand Palais, 144 p., 35 euro.
Le catalogue de l'exposition qui se tient au musée national Marc Chagall est doublement intéressant. D'une part, il a le mérite de nous faire mieux connaître un aspect assez mal connu de son oeuvre (il est vrai qu'il n'a pas fait un nombre prodigieux de sculptures et aussi qu'il a commencé fort tard, au cours des années 1950), de l'autre de mettre en valeurs les différentes influences qui ont pu guider sa main. On peut remarquer, surtout dans ses premières oeuvre, qu'il s'est souvenu de Brancusi (je pense bien sûr au baiser), à Modigliani (qui se voulait d'abord sculpteur !) - cela est évident dans Les Amoureux au bouquet (1951-1952) -, et aux grands créateurs de l'âge d'or de l'art moderne, comme Zadkine ou Lipchitz. Mais tout cela a été associé à d'autres sources d'inspiration, comme la statuaire romane, par exemple. Nous le voyons un peu tâtonner dans cette discipline qui n'est pas la sienne, avec une certaine humilité même quand il taille le marbre (il n'est que de voir La Femme au poisson de 1952). Le premier ouvrage où il se révèle plus sûr de son projet est sans nul doute La Bête fantastique (bronze avec, en regard, le modèle en plâtre, 1952). Il s'éloigne d'ailleurs de ses contemporains (à l'époque de Montparnasse). La notice nous dit que cet animal aurait été inspiré par la louve capitoline. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, on retrouve l'esprit de son bestiaire, mi moyenâgeux, mi surréaliste. Son propre surréalisme, qui transforme chaque tableau ou chaque dessin en fable. On ne sait trop ce qu'est cette bête-là, mais ce n'est ni un loup, ni un âme, ni un cheval. C'est une invention de l'artiste ! Le Coq, créée la même année appartient pleinement à son iconographie, comme la vache ou le violoniste. Il a voulu aussi, comme dans ses toiles ou ses tapisseries, traités des grands sujets bibliques, et aussi la vie du Christ, lui aussi omniprésent dans son univers. La même chose pourrait être dite des deux Oiseaux qui décorent la cour Chagall de la fondation Gianadda à Martigny. Il développe ensuite l'idée de bas relief, qui lui convient mieux et ne lui fait pas craindre le volume pur dans l'espace. Il ne s'arrête jamais à une solution formelle : son Sacrifice d'Abraham le montre bien : il est plus proche de sa peinture que de ses options en sculpture. C'est une révélation, en ce qui me concerne...

Comment regarder la sculpture, mille ans de sculpture occidentale, Claire Barbillon, Hazan, 336 p., 24,90 euro.
Cet ouvrage richement illustré sera d'abord d'une utilité évidente pour les étudiants qui s'initient à l'histoire de l'art. Mais il le sera également pour tous ceux qui s'intéressent aux arts plastiques et s'efforcent de mieux les comprendre. Bien sûr, l'histoire y tient un rôle de premier plan. Mais ce n'est pas la seule manière de consulter le travail de Claire Barbillon : il est question des différentes techniques, les matières employées, des styles et des formes, des grands thèmes dans le monde païen et dans le monde chrétien, et aussi des objectifs fixés à la sculpture quand elle est monumentale (elle peut être édifiante, éducative, symbolique, ou purement décorative. En somme, en croisant toutes ces voies d'accès, le lecteur trouvera sans peine son chemin pour mieux connaître ce vaste univers de la sculpture, dont certains aspects sont mal connus du public. Par exemple, en France, on connaît peu ou mal la sculpture néoclassique et celle qui accompagne le mouvement romantique alors qu'on admire la sculpture romane ou gothique. On ne sait trop pourquoi, cette discipline est moins bien appréciée que la peinture, en dehors de quelques noms célèbres. Enfin l'auteur a eu la bonne idée de mettre quelques textes de grands écrivains au terme de son volume, dont Octave Mirbeau et Rainer Maria Rilke qui, comme on le sait, a été un temps le secrétaire de Rodin. En somme, il y a tant de raisons d'acquérir ce livre indispensable qu'il est inutile de les énumérer. C'est d'abord un livre pratique - un « usuel » -, mais, si on le manie avec soin, il peut devenir un livre initiatique.

Les Peintres italiens de la Renaissance, Bernard Berenson ; traduit de l'anglais par Louis Gilet, introduction de John Pope-Hennessy, édition de Neville Rowley, « Le monde de l'art » , Les Belles Lettres, 432 p., 21,50 euro.
Dans sa préface, John Pope-Hennessy, nous rappelle les étapes de la carrière de ce grands connaisseurs de l'art italien, qui a non seulement été un historien considéré en son temps, mais aussi un conseiller avisé, car il avait la réputation d'avoir un oeil presque infaillible. Ce livre est le plus connu de tous ceux qu'il a écrit. Il a été réédité maintes fois depuis sa parution en 1896 à Londres. En France, c'est Louis Gillet qui l'a fait connaître en 1931. C'est une étude incontournable et cette réédition était nécessaire. Bien sûr, de nos jours, ce livre peut paraître très bizarre, de part sa construction d'abord parce qu'il commence par les écoles du Nord de la péninsule et par Venise alors que la seconde concerne Florence et le Sud. Personne n'ignore que l'histoire de l'art italien de la Renaissance commence plutôt du côté de la Toscane, des Médicis et de l'école néoplatonicienne, qui fait débuter l'histoire de la peinture par Cimabue et Giotto. Il faut aussi dire, ce d'autres ont déjà remarqué avant moi, que les appréciations de Berenson sont parfois lapidaires et lacunaires. Il maltraite Corrège et traite Le Parmesan en quelques lignes expéditions. En revanche, il traite bien Moroni, longtemps resté dans l'ombre, même en Lombardie, et trouve des qualités à Giambattista Tiepolo. Ce qui amène la Renaissance jusqu'à une date très tardive. Mais sa Renaissance à lui, elle est plutôt celle du Quattrocento et du Cinquecento, et traite ce qui précède encore dans l'optique des « primitifs ». On pourrait épiloguer sans fin sur cette question, comme on pourrait discuter sur son rôle très important de courtier. Il n'en reste pas moins vrai que cette oeuvre, avec ses mille défauts, demeure un monument de l'histoire de l'art, qu'il convient de replacer dans son contexte. Il a eu une grande importance pour l'étude cette phase clef de l'histoire de l'art européen. Pas question bien sûr de prendre au pied de la lettre, mais pas question non plus de le dénigrer parce qu'il est dépassé par les connaissances, les découvertes, les recentrements historiques ou les apports de nombreux spécialistes quant à la signification des oeuvres ou même sur les diverses attributions : il a tracé une voie et doit être regardé avec l'idée que c'est un travail initiatique qui conserve toute sa place dans l'histoire de l'histoire de l'art.

Tokyo, Catherine et moi, Pierre Notte, « Le sentiment géographique », Gallimard, 192 p., 17 euro.
Dans sa très courte préface, l'auteur déclare qu'une fois arrivé à Tokyo, la gigantesque métropole ne fournit aucun point de repère, comme si c'était un lieu hors de tout. Je ne partage qu'en partie ce sentiment, car j'ai fait un voyage comme lui et j'ai eu l'impression de voir ce que nous montre de la capitale nippone : de grandes avenues, des panneaux et seule originalité (à l'époque) d'immenses panneaux publicitaires électroniques. Somme toute, une sorte d'entrée en matière à une ville ultramoderne, mais impersonnelle. A mesure qu'on la découvre, c'est tout autre chose. On découvre des quartiers avec des rues sinueuses, - un entrelacs inextricable pour un étranger - presque comme au Moyen Age et des maisons toutes différentes les unes des autres, et toutes construites avec une insolente originalité. Chaque quartier possède sa spécialité : le plaisir, l'électronique, les geishas (là où j'ai résidé). En dépit de sa modernité forcée (il faut aller au musée national dans le grand jardin d'Ueno au centre pour voir une rue tokyoïte d'autrefois !) après les bombardements qui l'ont rasée au sol (il ne reste que quelques rares et modestes vestiges dans le quartier d'Akusawa chéri par Kawabata), cette cité présente les traits les plus insolites du monde. On peut être de toute évidence frappé par les habitations troglodytes au Nouveau Mexique ou en Cappadoce. Mais Tokyo est presque aussi insolite et indéchiffrable et aussi fascinant pour un voyageur européen. C'est tout le contraire du Berlin actuel : tout est fait pour sanctifier une architecture contemporaine souvent assez médiocre. Ici, tout est fait pour exalter la singularité, l'unicité. Le tout est purement fonctionnel. On suit donc avec plaisir les déambulations de l'auteur dans un monde dont les codes nous étonnent, nous échappent, semblent même fait pour nous nier. Aux nombreuses anecdotes judicieuses de Pierre Notte, je pourrais rajouter les miennes, et d'autres voyageurs, les leurs, car il est impensable d'épuiser en peu de temps la richesse infinie des paysages urbains, leurs modes d'emploi, leur incroyable diversité de leurs formes d'expression dans l'espace ou par l'écriture, d'un point de vue général, comme par le petit bout de la lorgnette. C'est tout sauf un guide. Oui plutôt c'est un guide pour savoir qu'on ne comprendra pas beaucoup de choses dans un pays aux antipodes du nôtre et qui compte bien le rester derrière ses façades de béton et de verre.

Lettres choisies, Voltaire, édition de Nicolas Cronk, Folio classique, 688 p., 9,30 euro.
Si Madame de Sévigné représente un grand modèle de l'art épistolaire, Voltaire en représente un autre, presque un siècle plus tard. Celui de Voltaire est plus incisif et plus insidieux car, sil est privé, il ne l'est qu'en partie. Le sieur François-Marie Arouet n'ignorait pas qu'en écrivant aux personnages les plus puissants de son temps, comme le roi Frédéric II de Prusse ou l'impératrice de Russie Catherine II, ou aux plus remarquables par l'intelligence, comme les autres encyclopédistes et les esprits éclairés de cette époque, il gravait son nom dans le marbre de l'histoire des idées autant que par ses publications. Il considère sa correspondance comme une arme, qui complète son oeuvre philosophique et théâtrale (on a tendance à oublier qu'il a écrit un nombre impressionnant de pièces et de livrets d'opéra). C'est un stratège, qui fait fi des formules de rigueur et qui va assez directement au but, mais avec souvent de subtils détours, qui ne sont pas formels, mais plutôt une manière d'accentuer la curiosité de ses lecteurs. Il a écrit dans sa vie pas moins de 23.000 lettres ! S'il avait la plume assez facile et la plupart du temps acérée, ce n'est pas un graphomane. Ses combats pour la justice, il les a souvent exposés dans ces courriers. Mais il a su aussi être un charmeur par son sens aigu de la narration et par des formules surprenantes. A Pierre Desinnocends, le 19 avril 1765, il évoque l'affaire Calas et il lui illustre toute l'injustice de ce cas judiciaire. Il avait changé sa retraite de Ferney en une sorte de quartier général d'où partait des missives dans tout le royaume de France et dans toute l'Europe en diffusant ses idées avec ferveur et efficacité. De plus, il ne faisait que renforcé un réseau de personnalités pouvant être favorables à ses convictions. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la relation épistolaire était primordiale. Il suffit de songer à la Correspondance littéraire de Grimm, qui était une revue rédigée à la main et recopiée à quelques exemplaires (c'est là que Diderot publie ses Salons). Son impact a été considérable. Les livres ont été les machines à diffuser des idées. Les lettres ont été pour Voltaire des instruments puissants pour les défendre auprès d'une élite. En dehors de la valeur historique et idéologique de tout ce courrier, il faut en distinguer la valeur strictement littéraire, car il avait la faculté rare de se renouveler dans cesse, de trouver de nouveaux angles d'attaques, de transformer un objectif précis en un conte ou une fable. En somme, Voltaire peut rester quelqu'un de proche de nous, même si les sujets abordés demeurent bien lointains.

Chers monstres, Stefano Benni, traduit de l'italien par Marguerite Pozzoli, Actes Sud, 304 p., 22,80 euro.
Je crois avoir lu pour la première fois un roman de Stefano Benni à la fin des années 1980, donc à ses début dans le monde de l'édition. J'avais trouvé alors que c'était un très habile fabriquant qui savait utiliser les quelques dons que la nature lui avait légués pour écrire. Il a joué la carte de l'écrivain benêt, qui jouait dans ce monde ou austère ou collet monté (ou les deux à la fois) le rôle d'un gentil pitre. Au fil du temps, le succès étant au rendez-vous en Italie, il est devenu un auteur prisé, entre Carlo Collodi et Boris Vian. Il ne se prend pas trop au sérieux mais, tout de même, il a revêtu les habits de l'homme de lettres. Comme le prouve ce recueil de nouvelles, il a progressé en variant les sujets et en ouvrant largement la gamme des genres. Il passe allégrement du passé au présent, du conte ou récit d'horreur, mais en employant toujours un style léger, très léger, presque impalpable. C'est assez plaisant à lire et doit être pris pour un simple divertissement. Mais quelque soit la temporalité et le lieu choisi, c'est toujours la même ritournelle. L'idée de mettre au premier plan des figures monstrueuses pouvait être bien intéressante. Il suffit de songer à The Elephant Man, le film de David Lynch.Stefano Benni est bien loin de ce genre de méditation tirée de la vie de Joseph Merrick, qui avait été écrite par le docteur Treves. Tout y passe, de Grimm à Edgar Allan Poe, en n'oubliant aucun des grands auteurs imaginables. Mais si certaines d'entre elles sont divertissantes, on ne parvient jamais à trouver une manne philosophique. La plus amusante de toutes est sans doute celle qui raconte les démêlées d'un homme avec sa carte de crédit et les distributeurs automatiques. Mais d'autres, comme celle du magicien passant le contrôle avant de prendre l'avion est cousue de fil blanc. On ne peut pas, sauf cas vraiment exceptionnel, toucher M. Tout le Monde et faire de la haute littérature. Mais il n'a pas non plus la verve incroyable d'Alexandre Dumas ou d'Eugène Sue. Il n'a pas l'étrange science de l'intrigue d'un Conan Doyle ou d'un Maurice Leblanc, qui ont fait naître de leur esprit des personnages immortels. Il a trouvé une veine qu'il exploite jusqu'à la dernière pépite. Mais il n'a pas trouvé sa vérité, comme d'ailleurs Conan Doyle, qui voulait être un grand écrivain et un grand philosophe. Mais si vous avez envie de passer un moment et de paresser en sirotant de charmants cocktails au bord d'une piscine ces Chers monstres peuvent vous plaire.
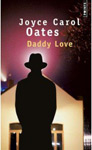
Daddy Love, Joyce Carol Oates, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Claude Seban, Points, 288 p., 7,50 euro.
C'est sans doute l'un des livres que je préfère dans l'immense production de Joyce Carol Oates. Au fond, cet écrivain qui a beaucoup de qualités s'est prise elle-même au piège d'une modalité de travail qui serait celui d'un flux narratif qui ne connaît aucune limite. Cela donne cette fluidité peu ordinaire dans la narration, mais fait que ses romans sont souvent interminables et parfois inutilement bavards. Rien de tel dans ce roman qui est l'histoire d'un petit garçon, Robbie Whitcomb. La scène se déroule sous les yeux de sa mère. Il est enlevé à l'âge de cinq ans par un homme qui se fait appelé Daddy Love, dont le vrai nom est Chet Cash. Il l'élève comme son propre fils, le rebaptise Gideon et l'enfant parcourt les Etats-Unis avec ce faux parent qui est un pasteur itinérant de l'Eglise de l'Espoir Impérissable, comme il y en a tant dans ce vaste pays. Elle nous décrit de façon assez savoureuse les relations que l'enfant doit établir avec cet inconnu et reconnaître en lui l'autorité. Si l'individu est un homme astucieux qui sait parfaitement enjôler son audience et ceux qui l'approchent dans sa vie privée, s'il est estimé dans sa petite ville de Kittanny Falls, il parvient à faire entrer l'enfant dans son monde imaginaire et accepter son sort. En effet, le petit garçon finit par entrer dans son jeu et le regarder comme une véritable figure paternelle bien qu'il soit maltraité et obligé de travail sans relâche pour lui. Au bout de sept ans aux mains de cet individu, vient la libération : le kidnapper est arrêter et Robbie retrouve sa famille. Mais plus rien n'est pareil. Il ya désormais un monstre qui sommeille en lui. Il y a une pointe de Dickens dans cette affaire d'enlèvement et sur son caractère un peu mélodramatique (heureusement que l'auteur possède l'intelligence de la mise en scène des situations), mais dans une perspective très américaine car Joyce Carol Joyce est passée maître dans le jeu des dialogues et, de plus, elle sait bien donner vie à ses personnages à travers le langage parlé. Cela donne un rythme à sa prose et du tonus à son histoire. C'est un roman digne d'être lu même si le trait est un peu forcé à la fin.

Rêves de machines, Louisa Hall, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Hélène Papot, Gallimard, 384 p., 22 euro.
L'on peut regarder ce roman comme une réflexion sur la mémoire, ou plutôt sur différentes sortes de mémoires, les unes historiques, les autres artificielles. Et puis sur la confrontation entre ces deux formes antagonistes. Cette réflexion s'accompagne d'une étrange remontée dans le temps du pays de l'auteur, presque jusqu'aux Pères Pèlerins. Et l'action se termine dans le futur en 2040. En somme, Louisa Hall se recrée l'histoire de sa Nation à travers cette problématique. L'aspect le plus étrange de l'affaire est cette réfères aux premiers colons qui ont fui l'Angleterre à cause des persécutions religieuses. Mais ce n'est pas que de l'histoire dans le sens admis : c'est un fait de mémoire et d'une mémoire qui a pesé sur des générations d'Américains pour édifier un pays nouveau. Et ces réformés radicaux pensaient pouvoir parler directement à Dieu. En tout cas, c'est ainsi que je le perçois. La suit est une autre histoire, scientifique celle-là. Nous faisons un saut dans le temps et nous nous retrouvons en 1928, quand Alan Turing jette les fondements de l'électronique. Il est convaincu de pouvoir reproduire les mouvements de l'horlogerie cérébrale par la technologie. Il a ouvert la boîte de Pandore. Puis nous voici en 1968, l'année où Karl Dettman invente un logicien de discussion. Il baptise ce logiciel Mary. C'est une réussite totale. Son épouse l'incite à aller plus loin et à faire en sorte que sa machine possède une mémoire puissante. Il s'y refuse, car il a peur des conséquences. Mais les versions successives de Mary sont dotées de mémoire et son devenues les plus proches des enfants. Les autorités comprennent que c'est une situation dangereuse pour la société et décide de les supprimer car les jeunes enfants comme les adolescents n'ont plus de rapports entre eux. Enfin l'on retrouve un personnage très intéressant, Stephen R. Chinn qui a été condamné à purger une peine de prison parce qu'il a conçu des machines androïdes (qui avait un aspect de petite fille) auxquelles il a pu donner une vraie conscience. Ce livre est une saga d'une haute découverte technologique, dont nous ne sommes pas très loin aujourd'hui. Les robots accomplissent des gestes et ont des ébauches de pensée. Louisa a su montrer à quel point les hommes jouent avec le feu et aiment le faire.

Vladimir m., Robert Littell, Points, 288 p., 7,40 euro.
Une chose me chiffonne pour un écrivain qui se pique d'histoire comme Robert Littell : comment peut-il faire croire qu'un étudiant américain puisse évoluer en URSS en toute liberté la dernière année de la vie de Joseph Staline ! En dehors de cela, la présentation sous forme de tragédie grecque de ce texte avec les trois maîtresses plus une (une aristocrate, bien sûr, qui a refusé de se donner à lui !) du grand poète quelque chose non seulement d'invraisemblable (ce ne sont pas les trois Grâces de la mythologie !), mais aussi d'un peu simpliste. Mais passons. Le problème est bien ailleurs. Il en ressort une image d'Epinal de cet immense écrivain, sans doute le plus grand poète russe du XXe siècle. Qu'il se soit leurré sur l'évolution du régime soviétique, c'est possible, mais il n'a jamais eu à se plaindre de Staline, qui l'a laissé en paix. Son suicide à Moscou pourrait peut-être sembler suspect. Mais rien ne prouve et depuis qu'il a possible de fouiller dans les archives du NKVD, il y a de trace d'une requête d'exécution de l'auteur du Nuage en pantalons. Il était conscient qu'il servait ce régime à l'intérieur du pays comme à l'étranger et son succès restait énorme. Il plaisait et sa poésie plaisait. Mais, à ce que je sache, jamais il n' a été censuré ou brimé, même le s'il était le dernier représentant de l'avant-garde soviétique et du LEF. Les autres avaient disparu ou avait été muselés. Tout cela sent le vieux truc des magiciens aguerris de la plume pour un public forcément peu informé. Qui connaît la vie et l'oeuvre de Maïakovski ne peut admettre une telle caricature, terriblement grossière !

Umami, Laïa Jufresa, traduit de l'espagnol (Mexique) par Margot Nguyen Béraud, Folio, 318 p., 7,70 euro.
Ce roman nous permet de découvrir la nouvelle littérature mexicaine car l'auteur est née en 1983. L'histoire se déroule en vase clos, dans un groupe de maison qui sont toutes liées aux différentes saveurs, du plus sucrées aux plus amères (umami signifie saveur en japonais, mais une saveur particulière, mais qui est neutre au palais). C'est un livre du souvenirs, car chaque demeure est le siège d'une histoire particulière, celle d'un être disparu. Tout commence dans la maison de ses grands-parents, ou plus à sa place, car c'est là qu'on a construit les nouvelles demeures de ses descendants. Chacune avait un nom (acide, salée, sucrée, amère). Et chacun contient un drame humain, qui est l'histoire de la famille de la narratrice. C'est assez bien fait et aussi très captivant : Laïla Jufreda a réussi à narrer ces tragédie sans tomber dans un pathos pitoyable. Au contraire, elle a restitué l'esprit mexicain en relation avec la mort. Et en parlant de ces morts, elle a parlé aussi de leurs destins respectifs avec beaucoup de verve et de charme. Ce n'est donc pas un livre noir, mais un livre qui mêle le sucré et l'amer avec une sorte de jubilante revendication de la plénitude de l'existence. Une mère disparaît, une petite enfant se noie dans le lac à cinq ans, le père de Marina, passionnée par les arts, le père est un alcoolique invétéré. Oui, c'est un beau roman, moderne dans son écriture, mais assez liée à la tradition romanesque pour ne pas la brutaliser. Il vous faudra adopter Laïla Jufresa et découvrir son roman, qui est une manière de découvrir le Mexique loin de tous les clichés qui l'accompagne.

Ça aussi, ça passera, Milena Busquets, traduit de l'espagnol par Robert Amutio, Folio, 192 p., 6,60 euro.
Je ne connaissais cet auteur de Barcelone (où elle est née en 1972). Et je dois reconnaître qu'elle a un style vif et enjoué. L'histoire elle-même fait un trop penser aux films d'Aldomovar. C'est un peu déjanté, abracadabrantesque, comme dit quelqu'un de fort connu, avec une foule de personnages de sa famille, mais aussi des amis, des connaissances en plus de ses deux anciens maris, en somme il y a dans cette maison de Cadaquès une foule de personnes dont les paroles et les pensées s'échangent, s'entrecroisent et finissent par complètement s'enchevêtrer. Il faut dire que notre jeune héroïne, Blanca, vient de perdre sa mère. Elle a préféré vivre son deuil au sein de cette maisonnée affolée, très vivante et somme tout très gaie. Mais elle n'en demeure pas moins hantée par l'absence de sa mère et en souffre terriblement. Ce bruyant remue ménage permanent peut la distraire un peu de ses idées noires, mais parvient pas à les dissiper. Loin s'en faut. L'auteur s'en sort pas mal, parce qu'elle a de l'esprit et une forte vitalité ? Mais ce n'est pas un roman à susciter une admiration sans borne. Cela suggère une reconnaissance pour avoir su raconter de drame avec tant de fougue.Milena Busquets y fait preuve de talent, même si elle a tendance à le dévoyer au nom de la mode et de l'air du temps.

Lettres choisies de la famille Brontë, 1821-1855, traduit et annoté par Constance Lacroix, Quai Voltaire, 640 p., 25 euro.
La fratrie Brontë (rien que des femmes, Emily, Charlotte et Anne, car leur frère, Brandwell est mort prématurément en 1848 à l'âge de trente ans, et n'a pas participé aux Juvenalia) est un des cas les plus singuliers de l'Angleterre de la première moitié du XVIIIe siècle. Dans le pays de l'individualisme et l'habeas corpus, on aime faire de la littérature en petit groupe. Qu'on songe aux clubs de Boswell, du poète Alexandre Pope, le romancier Daniel Defoe, qui a lancé plusieurs périodique, Samuel Johnson, pour ne citer qu'eux, aimait à se réunir dans des clubs fermés qui se trouvaient dans les cafés leur époque. Lors Byron, Shelley, son épouse Mary, le docteur Polidori, se sont affrontés en Suisse dans un concours de littérature fantastique. Les préraphaélites ont eux aussi eu une vie commune dans l'art et la poésie, et même le roman avec Swinburne. Et puis, plus tard, au début de l'ère edwardienne le groupe de Bloomsbury s'est constitué autour de la figure de Virginia Woolf et de son mari Leonard, avec Vita Sackville-West, David Garnett, Lytton Strachey et D. H. Lawrence à ses marges. Mais ils n'ont jamais formé des groupes qui avaient des vues littéraires communes. Sauf peut-être les Brontë, qui vivaient en vase relativement clos du modeste presbytère de leur père, Patrick, à Haworth. Elles sont isolées et n'ont pas de belles dotes à offrir à un prétendant. Charlotte, l'auteur de Jane Eyre, meurt un an après son mariage avec un vicaire, Arthur Bell. C'est Elizabeth Gaskell, une autre grande plume de l'époque, qui a écrit sa première biographie. Toutes ont eu bien du mal à se faire publier et toutes sont mortes relativement jeune (Emily en 1949), Anne en 1849). Elles ont toutes suscité beaucoup d'éloges, mais ont néanmoins dû publier sous des pseudonymes masculins. Mais si tout a été si difficile pour elles, elles n'ont cependant pas tardé à devenir célèbres et le pèlerinage au presbytère d'Haworth, peu après leur mort, n'a plus cessé d'attirer des foules d'amoureux de leur littérature. Leur correspondance est monumentale (Charlotte a envoyé quelques trois mille lettres !). chacune à leur façon, elles ont enrichi le monde de la relation épistolaire, en écrivant à des gens de lettres, comme Mrs Gaskell ou la romancière Harriet Martineau, William S. Williams, George Smith, l'éditeur de Charlotte et, bien sûr, à leurs proches. On peut aussi confronter les traits de caractères de ces trois femmes qui se ressemblaient peu et comprendre comment elles organisaient un univers intense autour d'elles.

Dante, Enrico Malato, traduit de l'italien par Marilène Raiola, Les Belles Lettres, 384 p., 29,50 euro.
Depuis que Boccace a écrit son Tratetello in laude di Dante et sa paraphrase de la Commedia en lacets enchaînés, on n'a plus cessé d'écrire des biographies de Dante. Récemment nous avons eu celle de la regrettée Jacqueline Risset. De plus, et c'est l'évidence même, chaque époque a produit sa propre interprétation de son oeuvre. L'ouvrage qu'Enrico Malato vient de lui consacrer est donc le dernier d'une longue suite de travaux savants. Il est inestimable à plus d'un titre. D'abord, il replace bien Dante dans le contexte politique, social et religieux de son époque, marqué à Florence par les affrontement entre les Noirs et les Blancs. Comme il a choisi le mauvais camp, il s'est vu exilé et n'est jamais revenu dans sa ville natale et est mort à Ravenne. Ensuite, il explique, malgré l'absence de documents essentiels et aussi du fait que la cité florentine florissante n'avait pas d'université, quelle a pu être sa formation intellectuelle. Il étudie la philosophie et la littérature. Mais il a été d'abord militaire et fonctionnaire avant de devenir poète. Si Enrico Malato n'apporte rien de très neuf pour connaître la vie de Dante, il a su parfaitement la remplacer dans un contexte assez compliqué. Et ce contexte est aussi utile pour comprendre la construction de son oeuvre poétique et théorique. De l'éloquence vulgaire (rédigé en latin) est sans doute le point de naissance de l'italien moderne car aujourd'hui tout Italien peut comprendre la Commedia et il l'apprend d'ailleurs à l'école alors que nous, nous sommes obligés de traduire Rabelais, un auteur de la Renaissance, en français moderne. Ce que je salue en cette recherche, c'est que l'auteur n'a pas privilégié un point de vue. L'homme politique et l'homme imprégné de théologie. Il insiste sur le fait que Dante est devenu un immense novateur - ce qui peut sembler contradictoire )- en combattant les poètes du stile novo, qui ont pourtant rajeuni l'art poétique. Lui, il veut que sa langue, le toscan, soit capable autant sinon plus que le latin, de manifester ses profondes croyances religieuses contre le sensualité propre à ses grands contemporains, surtout à son ami intime, Guido Cavalcanti. C'est là une excellente façon d'entrer en connivence avec ce poète qui, pour nous, serait au plein coeur du Moyen Age, alors qu'à Florence, il a contribué au début de la Renaissance, mais aussi de prendre la mesure de l'ensemble de son operare, et pas seulement de la Vita nova e de la Commedia, mais aussi les Epîtres et les Eglogues que nous avons tout à fait oubliés. Ce livre est indispensable pour mieux connaître un fervent croyant qui a été pourtant un fervent révolutionnaire.
|
