
Autoportrait, Jean-Pierre Raynaud, Editions du Regard, s. p., 18 euro.
Quand on songe aux premières heures de l'Art dit contemporain en France, quelques noms viennent à l'esprit, dont celui de Jean-Pierre Raynaud. Ses travaux sont restés gravés dans nos esprit quand son grand pot est resté de longues années devant le Centre Pompidou et lors de la vente spectaculaire (à tous points de vues) des gravats de sa fameuse maison en carrelage blanc dans des seaux est demeurés dans les annales. Ce volume retrace son parcours, de sa plus tendre enfance jusqu'à nos jours. Parcours édifiants, ponctué de réflexions et d'aphorismes, et illustré par d'innombrables photographies, qui montrent comment un non-artiste est parvenu à se faire un nom et un grand nom dans un monde de l'art prêt à tous les paradoxes. Les drapeaux sont inspirés de toute évidence par jasper Johns, mais ils n'ont aucune fonction picturale : Raynaud les place dans une situation qui rend leur présente hypothétique ou problématique. Il aurait pu se dispenser d émettre ensemble le drapeau israélien et le drapeau palestinien (une espèce de lieu commun en politique un peu pathétique) ou d'adjoindre la photographie de Ben Laden avec le drapeau américain : tout cela ressort des banalités les plus extrêmes. Et c'est là sa force : plus l'image produite est sans beaucoup d'originalité, plus elle est acceptée. Le banal n'est pourtant pas l'objet de sa quête, mais sa procédure. L'oeuvre d'art est assimilée aux faits produits par l'actualité et ne fait que les emblématiser. Le jeu formel des drapeau est une gentille parodie (et récupération sournoise) des recherches de l'hard edge et de la géométrie froide des Etats-Unis des années 60 et 70 ; c'est aussi un pied de nez peu gracieux adressé à Alighero e Boetti. Bref, nous sommes plongés dans les tréfonds du plagiat et de la dérision, tout en préservant un semblant de hauteur de vue et de forme. Car tout cela est très chic ! Ses digressions à partir du drapeau chinois sont enfantines et cela a plu et plaît encore sans doute car le message est simplet et lié à la réalité du monde. C'est là donner de la valeur à la pensée de qui ne pense pas. C'est penser la valeur des images les plus communes comme suprême dans la sphère spéculative de l'art. Quant à la célèbre demeure, c'est une pissotière de luxe, sans doute construite en hommage à l'urinoir de Marcel Duchamp (devenu une oeuvre d'art à posteriori après avoir été une blague de potache). En condensant son histoire, Jean-Pierre Raynaud en montre la vacuité, mais avec style !

Henri Michaux & Zao Wou-Ki dans l'empire des signes, Bernard Vouilloux, fondation Martin Bodmer/ Flammarion, 208 p., 35 euro.
En 1948, le peintre chinois Zao Wou-Ki fait la connaissance d'Henri Michaux peu après son arrivée à Paris ; une relation exceptionnelle va lier les deux créateurs. Déjà dans son pays natal, Zao Wou-Ki avait voulu échapper à l'emprise de la peinture traditionnelle chinoise. Une fois qu'il fut arrivé à Paris, il est allé étudier à la Grande Chaumière sous la direction d'Othon Friesz et commence à connaître le petit monde des peintres et des sculpteurs de Montparnasse. Mais c'est en 1951, quand il se rend à Berne, qu'il a la révélation de l'oeuvre de Paul Klee, qui l'oriente vers de nouvelles directions esthétiques. Cette fois, il abandonne presque complètement la figuration. Cette exposition qui a lieu à Colligny met en parallèle les deux oeuvres, qui ont bien des affinités électives, mais qui présentent aussi de profondes différences. Cela n'a jamais nui à une estime réciproque qui s'est changé en amitié. En dehors de cette histoire d'amitié profonde et de connivence dans l'art pictural, cette exposition a tablé essentiellement sur les quatre textes que Michaux a pu écrire. On trouvera ici en fac-similé les ouvrages de Michaux, à commencer par Lecture, accompagné de huit lithographies de Zao Wou-Ki et qui apparu en 1950. Et puis l'ouvrage abonde d'une documentation écrite et photographique d'une grande richesse sur la collaboration de ces deux êtres d'exception, ce qui en fait un livre d'histoire intime de l'art de premier plan.
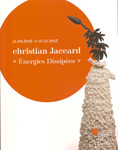
Energies dissipées, Christian Jaccard, galerie Valérie Bach, s.p.
Pour nous, Christian Jaccard fait partie de ce premier cercle qui a suivi les recherches du groupe Supports/Surfaces né en 1967. Et son oeuvre a tout de suite était remarquable par deux choses bien précises : le feu, c'est-à-dire la calcination sous toutes ses formes, et les noeuds, dérivés des noeuds marins. Ces deux procédures bien particulières ont été depuis longtemps analysées sous leur aspect psychanalytique comme sous leur aspect transgressif. Cette exposition met en avant un aspect de ses spéculations plastiques qui paraît aux antipode de sa démarche : une forme d'humour. Difficile de le rapprocher de Magritte ou de Broodhtaers. C'est d'ailleurs une remarque qu'on peut appliquer à plusieurs membres de Supports /Surfaces : derrière le discours très sérieux, parfois austère, se dissimule une poésie qui se nourrit des réflexions très arides et hardies de ces hommes qui ont voulu déconstruire la peinture et la sculpture. Prenons par exemple la sculpture baptisée Régime de bananes (2012) : le rapprochement de sa silhouette avec un véritable régime est peu être forcé, mais l'analogie sémantique amène l'analogie physique avec une déformation recherchée. Le processus qui s'installe met en jeu autant la botanique que les arts dits primitifs, une pratique ludique et la quête de formes inédites. Ce lent et patient travail de nouement, profondément obsessionnel, n'aboutit pas à un sérialisation comme chez Roman Opalka pour citer l'un des artistes les plus connus dans ce domaine. Jaccard connaît les limites de ses hantises et parvient à les dépasser en les orientant dans une autre direction, qui est celle de la création d'un monde fantasmagorique et divertissant. Quant aux combustions, c'est un acte iconoclaste qui est renversé : ce qui devrait aboutir à la disparition physique de l'oeuvre se change en une autre manière de concevoir l'acte de peindre qui possède lui aussi dans ce maniement du feu sa poésie propre. Ce catalogue résume assez bien une partie du cheminement intérieur de Christian Jaccard, beaucoup plus riche et intéressant qu'on le croit car on a tendance à l'enfermer dans des formules qui ne rendent pas justice à la beauté de son geste esthétique.

Mes apprentissages à Paris, Casanova, « Carnets », L'Herne, 144 p., 9,50 euro.
Non, il n'y a rien à faire : Casanova a un style d'une rare vivacité, et tout les faites relatés prennent sous sa plume une couleur, un ton, un mouvement -, il ne se contente pas d'avoir de l'esprit, mais fait preuve d'un sens particulièrement aiguisé de l'observation. Au cours de ses trois séjours à Paris, il fait un portrait de Louis XV, physique d'abord, puis moral et politique. Il semble apprécier et même admirer ce souverain, auquel il attribue de hautes qualités. Mais, d'un autre côté, il est très conscient du mécontentement populaire et déclare renoncer à venir s'installer en France pendant une assez longue durée à cause de l'agitation qui règne sourdement dans ce pays. Ce n'est pas ce genre de considérations qu'on aurait pu attendre de cet aventurier. De la même façon, il fait un portrait des membres de la noblesse, qui semble un mélange d'éloge et de réprimande. Il se lie avec un certain nombre d'entre eux, partage leurs engouements et leur style, pense sans doute faire partie de cette élite (il est peut probable qu'on ait vraiment cru au titre modeste qu'il s'était attribué), mais sait aussi discerner leurs limites. Sous sa plume alerte, on découvre la cour de Versailles, les hôtels particuliers de la capitale et un art de vivre enviable. Et c'est surtout la culture qui est mise en avant, la littérature avec sa relation étroite avec Crébillon, son goût pour le théâtre qui nous fait assister à des pièces qui font toujours partie de notre répertoire ; il nous présente Voltaire et La Harpe, entre autres. Il nous invite à l'opéra et nous fait connaître les plus grandes voix et les compositeurs marquants de cette époque. Et la peinture n'est pas négligée, d'autant plus que son frère s'était déjà fait un nom et recevait beaucoup de commandes. Tout est raconté avec beaucoup de charme et un peu d'ironie, d'humour et, je le répète, beaucoup d'esprit. La grand Histoire se mêle à la petite, et cette dernière éclaire la première. Ce sont des pages éblouissantes et beaucoup plus sérieuses que le laissent croire les apparences. Il est vrai que quand il rédige ces Mémoires, qu'il commence au château de Dux en Bohème en 1789. Il est probable qu'il ait révisé certains jugements à la lumière de ces événements. Mais il se trouvait alors bien loin de ce Paris qu'il avait tant aimé. N'est-ce pas lui qui a donné le l'Europe de cette période l'idée la plus juste ?

Roland furieux, Arioste, raconté par Italo Calvino, traduit de l'italien par Célestin Hippeau et Nino Frank, Gallimard, 416 p., 24 euro.
A mes yeux, cette oeuvre magistrale accomplie par Italo Calvino a donné naissance à l'un de ses plus beaux livres. L'écrivain italien a voulu raconter l'histoire assez compliquée de ce grand poème épique écrit par l'un de ses immenses précurseurs, Ludovico Ariosto (1474-1533), l'Orlando furioso, écrit en plusieurs étapes entre 1505 et 1531 (mais il a commencé à être publié en 1516 ; d'abord écrit dans le dialecte ferrarais, l'auteur le repris ensuite en italien littéraire, dérivé du toscan). Cet ouvrage qui compte près de 40.000 vers divisé en 46 chants est le chant du cygne du roman de chevalerie hérité du Moyen Age (cela dit, ce n'est pas le dernier car le Tasse compose en 1581 la Gerusaleme liberata, poème épique qui relate la croisade qui conduit Godefroy de Bouillon en Terre Sainte). Calvino le relie à sa première source, la Chanson de Roland car les personnages principaux sont liés au règne de Charlemagne et la constitution de son empire. L'Arioste a ensuite brodé sur une longue guerre imaginaire avec les Sarrasins qui s'achève sous les murs de Paris. Le succès de cet ouvrage est prodigieux, autant dans les hautes sphères de l'aristocratie que dans les milieux populaires. Le théâtre des puppi en Sicile en reprend les grands thèmes et le a interprétés librement jusqu'à sa disparition il y a environ une cinquantaine d'années. De nombreuses pièces de théâtres s'en sont inspirées, et des opéras innombrables en sont issus. Et, dans le domaine de la peinture, les figures héroïques de cette fable ont été utilisées par les plus grands artistes. Calvino s'est mis en devoir de racontée avec la plus grande clarté possible ces récits assez embrouillés qui sont en réalité de courts romans gigognes. C'est une entreprise littéraire rare et précieuse qui non seulement rend le texte bien plus proche dans une langue moderne, mais permet aussi d'en décrypter les ressorts dramatiques. L'idée de l'auteur n'avait pas été de simuler une pseudo historiographie, mais de mettre en scène des histoires de toutes sortes, les unes guerrières, l'autres amoureuses, les autres d'une autre nature encore, les unes et les autres ne cessant de s'imbriquer, avec des personnages historiques et des personnages inventés. Calvino nous explique de quelle manière cette épopée fictive s'articule et nous en montre les moments essentiels, toujours en fournissant les explications les plus indispensables, en particulier sur les innombrables figures et les événements relatés et souvent totalement fictifs. Ce qui est curieux dans ce texte, c'est que le monde mythologique de l'Antiquité est repoussé, ne subsistant plus que de manière très fragmentaire, sinon anecdotique : au terme de la Renaissance, ce rejet du modèle païen tant prisé est étrange car cela se passe dans le cas de l'Arioste avant la Contre-Réforme (le Concile de Trente est convoqué en 1542). Grâce à Calvino, tout lecteur peut jouir.

Promenades parisiennes, Mihail Sebastian, traduit du roumain par Alain Paruit, « Carnets », L'Herne, 240 p., 9,50 euro.
Je dois avouer humblement ignorer jusqu'au nom de ce écrivain roumain, né en 1907 et mort à cause d'un accident de la circulation à Bucarest en 1945. D'origine juive, il a fait scandale en 1934 avec un roman intitulé Depuis deux mille ans, avec une préface antisémite du philosophe Nae Ionescu : il y raconte l'histoire d'un Juif qui tente de conserver son identité tout en s'affirmant un bon Roumain. Cette tentative résumait bien la situation d'une grande majorité de la communauté juive en Europe, mais son projet ne fut pas compris et a été attaqué autant par l'extrême droite que par les critiques démocratiques. Ses Promenades parisiennes sont délicieuses. Elles concernent surtout les années 30 et nous fait voir Paris autrement que ne l'ont fait ses prédécesseurs. Ses périples passent souvent par les lieux inattendus, comme la Cité universitaire ou nous fait découvrir les particularités des squares parisiens. Même les sujets plus classiques, comme l'incontournable visite du musée du Louvre ou la découverte du Quartier latin sont traités de manière très originale -, et je dirais vraiment inattendues. Son amour de l'art nous amène rue de La Boëtie, qui était alors l'artère des grandes galeries, et il consacre de belles pages sur Toulouse-Lautrec et surtout sur Pascin qui meurt pendant son séjour français. En plus de son invitation à le suivre dans les monuments parisiens, il nous confie aussi des pages sur la littérature française, sur Stendhal d'abord, mais aussi sur Rémy de Gourmont et André Gide ou Jules Renard, qu'il prise beaucoup. C'est vraiment un petit livre passionnant, qu'on aurait être encore plus touffue (on a l'impression que l'auteur l'a commencé puis l'a délaissé en attendant des jours meilleurs). Mais déjà tel qu'il est, il est une invitation à voir et à comprendre Paris de cette époque selon des clefs assez différentes de celles que nous partageons.

Corps conducteurs, Sean Michaels, traduit de l'anglais (Canada) par Catherine Leroux, rivages, 448 p., 22 euro.
Curieux roman que celui de Sean Michaels ! D'a près ce que j'ai pu comprendre, c'est la première fois qu'il propose une oeuvre de fiction et l'on ne sait pas grand chose de lui en dehors du fait qu'il exerce la critique musicale. C'est déjà une piste cat il nous présente un personnage qui est à la fois un inventeur et un musicien d'avant-garde, qui n'hésite pas à adopter des principes ultramodernes. Il serait quelqu'un entre Edison et Luigi Russolo. S'il a été un partisan de la première heure de la Révolution d'octobre 1917 et collabore volontiers avec les nouvelles autorités bolcheviks, son destin va le conduire à vivre aux Etats-Unis grâce à sa géniale trouvaille qui a un succès fou : le thérémine, un nouvel instrument de musique en partie mécanisée, qui porte son nom. Le succès, la reconnaissance du milieu des musicologues et des mélomanes, l'exploitation plus ou moins difficile d'autres brevets, font de lui un homme riche et célèbre. Mais son existence ne sera pas toujours aussi rose. De retour en Union soviétique, il connaît la dure répression stalinienne et finit dans un goulag. Il faut dire sans attendre que l'histoire avec ses ramifications sentimentales n'est pas tout à fait bien ficelée et l'on se perd un peu dans les différents moments de l'existence de cet individu d'exception, d'autant plus qu'on passe sans cesse d'un récit assez réaliste à un autre quasi onirique. Les incohérences ne manquent pas - elles font même partie de l'essence de l'oeuvre, mais pas toujours à bon escient ! Toutefois, malgré de nombreux défauts, ce livre présente assez de qualités et aussi d'imagination pour faire croire à la valeur littéraire de Sean Michaels. Ce premier livre laisse espérer d'autres livres mieux construits, mais avec le même esprit d'innovation et de curiosité, cette absence de conformisme mais aussi cet amour de la littérature passée qui se traduit par des plagiats et des références qui prouvent amplement sa volonté d'aller plus loin dans cette aventure.

Obsessions, Jean-Jacques Schuhl, « Folio », Gallimard, 176 p., 7, 00 euro.
Rarement écrivain est parvenu à une telle notoriété avec une oeuvre si mince. En fait, deux livres parus pendant les années soixante-dix ont seuls contribué à sa gloire avec Rose poussière et Télex n°1 ; plus rien jusqu'à l'an 2000 où il publie alors Ingrid Caven, qui lui vaut de recevoir le prix Goncourt. Après quoi, il se limite à des récits brefs, qui sont chaque fois des ravissements. Les nouvelles réunies dans ce dernier recueil en date sont sans doute moins « expérimentales » que celles de ses premiers livres. Mais ils possèdent le même charme d'histoires improbables, rêvées ou jamais advenues, mais pourtant aussi captivantes que ceux de Joseph Conrad. Il possède ce don rare d'être capable déplanter un décor et d'e mettre en route une intrigue en quelques lignes pour ensuite semer le doute dans l'esprit du lecteur, qui n'en reste pas moins attaché aux éléments qui lui ont été fournis par l'auteur. Quand une trame semble se dégager, elle est rapidement mise à mal par l'écrivain, qui s'en sert comme leurre. Sa littérature est purement labyrinthique et parfois aléatoire. Il est borgésien en diable, non dans son écriture, mais dans la pensée de la fiction. De plus, il se révèle très proche des recherches modernes dans la sphère des arts plastiques et fait de la littérature un champ d'expériences, un peu comme l'avaient fait William S. Burroughs et Brion Gysin au Beat Hotel à Paris. D'où une poésie décalée et sans cesse en train de se redéfinir ; ces onze nouvelles sont toutes des pièges pour l'esprit qui est à la fois épris de modernité et des vieux romans d'amour du Grand siècle. Et dans cette quête hallucinée des illusions de la mode, du dandysme, de l'avant-garde, Schulh fait preuve d'une délicieuse auto ironie.

Moi, Abraham, Jerome Charyn, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Catherine Richard-Mas, Rivages, 608 p., 24 p.
Auteur inclassable, Jerome Charyn (né en 1937) est tout l'inverse des grands romanciers américains du XXe siècle, dont l'oeuvre est parfaitement indentifiable par leur style, leur constructions, leurs thèmes. Il n'a pas voulu s'imposer cette discipline et a abordé une multitude de sujets avec une multitude de méthodes d'écriture. Aucun livre n'est semblable au précédent et au suivant : il invente un type de fabrication pour chacun d'eux. De plus, il s'est pas mal consacré au roman policier et même à la bande dessinée. Il s'intéresse à l'histoire (comme le montre la Lanterne verte par exemple) ou à de grandes figures littéraires comme Emily Dickinson. Ce dernier roman en date évoque la figure totémique pour les américains d'Abraham Lincoln. Ce n'est pas une biographie classique, au contraire. C'est une tentative d'achever un portrait peu académique du président d'un pays emporté par la guerre civile. Son Lincoln devient un homme mélancolique, hypocondriaque, froid, secret, qui s'efforce de faire front à une situation qu'il ne parvient pas à maîtriser tout à fait. Charyn a beaucoup insisté sur son cercle de famille, en particulier sur son étrange épouse, et aussi sur la représentation peu engageante de ce pays à l'époque de ce conflit qui allait jouer son destin. C'est ainsi que l'on passe de questions tout à fait secondaires à d'autres qui sont majeures, et que jamais nous est offert une vision claire de cet homme et de son destin politique. Ce livre n'en est pas moins impressionnant par l'originalité de ce portrait, par la description de certaines situations, par la capacité de l'écrivain de dépeindre l'incendie de la ville de Richmond et des faits qui se apportent à un événement crucial de la guerre de Sécession, car elle marque la victoire des forces de l'Union sur les confédérés. Touffu, trop parfois, baroque dans sa composition, à la fois fascinant et fastidieux (il y a des passages un peu ennuyeux et d'un intérêt relatif), Moi, Abraham est tout de même un grand livre qui force à concevoir l'histoire avec un autre état d'esprit, surtout quand il s'agit de la grande Histoire, celle que tout citoyen est censé savoir. Il ne déboulonne pas la statue de Lincoln, mais il rend le personnage bien plus complexe et contradictoire, avec des aspects sombres et même inquiétants. Et l'Amérique de ces années tragiques, sous sa plume acérée, prend une autre allure et une autre profondeur.
|
