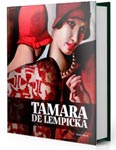
Tamara de Lempicka, Gioia Mori, 24Ore Cultura, 316 p., 42 euro.
La belle exposition du palais royal de Turin nous donne l'occasion de revisiter l'oeuvre de cette femme qui a été célèbre pour ses oeuvés picturales, mais aussi pour son étrange beauté. Tamara de Lempicka, après avoir connu la notoriété de son vivant, est devenue une icône de l'art du XXe siècle, un peu comme Hopper, une figure solitaire et insolite qui a eu l'heur de plaire à peu près à tous. Ses origines sont vagues. Elle est la fille d'un père russe et d'une mère polonaise. Elle s'appelait alors Tamara Rosalia Gurwik-Gorska. Mais on ignore l'année de sa naissance. Disons que ce fut en 1898. Elle rencontre le noble polonais, avocat de son état, Tadeuz-Lempicki en 1911 lors d'un bal masqué : elle l'épousera cinq ans plus tard dans la chapelle de des chevaliers de l'ordre de Malte à Petrograd. Leur fille, Marie-Christine, naît l'année même. En 1918, son mari est arrêté et elle s'enfuit en passant par la Finlande et parvient à Paris où vie sa soeur cadette Adrienne. Elle s'inscrit en 1920 à l'Académie Ranson et expose déjà au Salon d'Automne en 1922. Bientôt, elle se constitue un cercle d'amis célèbres, comme Cocteau, Joyce, Nathalie Barney, Romaine Brooks, Isadora Duncan, Poiret. En 1923, elle expose de nouveau au Salon d'Automne et aussi au Salon des Indépendants. Elle mène une vie mondaine, mais aussi quelque peu dissolue. Deux ans passent et elle se rend à Rome. Elle se lie avec les futuristes, et en particulier avec Marinetti. Elle vend deux portraits au Salon des Indépendants pour ne somme importante. En 1927 elle rend visite à Gabrielle D'Annunzio au Vittoriale. Le Vate tombe amoureux d'elle et tente de la séduire (les détails, on les trouve dans le journal de la femme de chambre de l'écrivain - mais doit-on la croire ?) Elle commence à compter dans le petit monde de l'art : la critique l'adule et elle a de nombreux articles dans la presse spécialisée, ses tableaux plaisent. Elle devient l'artiste de l'ère des Arts Décoratifs. Elle divorce en 19281, mais conserve le nom de son mari. Elle vend bien ses tableaux et a par conséquent la faculté d'être indépendante. Son succès ne se dément pas par la suite, même après la guerre. Ce que nous avons pu découvrir dans l'exposition, mais aussi dans le superbe catalogue préparé par Gioia Mori, ce sont des très nombreuses et belles photographies et des oeuvres peu connues, en particulier des oeuvres religieuses (sans doute pas les meilleures qu'elle ait pu peindre, en dehors d'un visage de la Vierge et le portrait d'une mère supérieure en larmes), des natures mortes et un certain nombre de dessin. La seule chose que n'a pu restituer le catalogue, ce sont les deux petits films d'époque qui al montre l'un dans son atelier et l'autre en compagnie d'une amie. Ce catalogue est en réalité une formidable monographie, indispensable pour tous ceux qui aiment la peinture de Tamara de Lempicka.

Le Lièvre aux yeux d'ambre, Edmund de Waal, traduit de l'anglais, par Marina Boraso, « Libres Champs », Flammarion, 8 euro.
Paru il y a une poignée d'années aux éditions Albin Michel, ce livre réparait sous son titre d'origine (je ne sais pas pourquoi chez le premier éditeur on l'avait baptisé « La Mémoire retrouvé »). Les mystères de l'édition sont insondables ! Il s'agit de l'histoire d'une famille et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de celle de l'auteur ! Tout a débuté à Odessa. Les Ephrussi ont su prospérer dans différents domaines, en particulier dans celui du commerce des céréales. Les deux frères, Léon et ignore font des choix différents : le premier s'installe en France, et le second, en Autriche. Cela faisait partie d'une stratégie des affaires qui les portait aux quatre coins du monde. L'auteur est un descendant d'Ignace. Son nom étrange que la petite-fille d'Ignace a épousé un Néerlandais, Hendrick de Waal. Cella n'en fait pas moins un Ephrussi ! Il s'est mis en devoir d'écrire l'histoire de cette famille qui est devenu, à la Belle Epoque, la plus en vue aussi bien à Paris qu'à Vienne. L'auteur a choisi de commencer par Paris avec Charles, qui s'est installé rue Monceau et s'est mis à collectionner. Il a été pris par le virus du japonisme et a acheté un nombre important de netsuke (264 exactement). Ces petits objets constituent le fil conducteur de cette chronique familiale. Mais il choisit aussi d'autres objets venus d'extrême Orient et, ensuite, s'intéresse aux impressionnistes (Monet et Pissarro en premier, puis Degas, Sisley, Renoir, en tout, une quarantaine de pièces). C'est lui qui a fait cette étrange commande à Edouard Manet, le priant de peindre pour lui une botte d'asperge. Comme le riche collectionneur a payé plus Manet que prévu, le peintre lui a envoyé un autre petit tableau avec une seule asperge, celle qui manquait à la botte ! Son épouse choisit de prier Carolus Duran de faire son portrait. Il accumule dans sa demeure du nouveau quartier parisien des oeuvres anciennes, dont des cartons de Raphaël, des toiles de Rembrandt, de Velàzquez. Il possède une sculpture de Donatello. Charles dirige en outre une revue, La Gazette, Courrier européen de l'art et de la curiosité. Si Charles Ephrussi est un collectionneur influent, il n'en est pas moins la cible de critiques virulentes, en particulier de la part d'Edmond de Goncourt qui le brocarde dans son Journal. Il est frappé par la vague d'antisémitisme qui fait alors rage en France. Quant à Marcel Proust, il se sert de son personnage pour son Swann. Quand son frère Viktor se marie à vienne, Charles lui offre les netsuke. Viktor est lui aussi un collectionneur passionné et lui aussi en butte aux critiques antisémites qui ne font que s'accentuer au fil du temps. Mais Viktor ne pressent pas le danger : il croit que le plébiscite organisé par le chancelier Schuschnigg a quelque chance d'être adopté. Quand les troupes allemandes franchissent la frontières, il est encore à Vienne et a toutes les peines du monder à partir avec femme et enfants. Il a presque tout perdu, dont son célèbre palais qui est immédiatement pillé. Il meurt sans avoir vu Vienne libérée par les Soviétiques. Quand ses enfants retournent dans le palais, il n'y a plus rien. Les restitutions se font au compte goutte et les compensations financières sont très modestes. Mais une de leurs servantes, Anna, avait caché tous les netsuke et les avait donnés au fils de Viktor et Emmy, Iggie. Celui-ci est allé vivre au Japon et les petites oeuvres sont rentrées dans un pays dévasté. C'est ensuite l'auteur qui en hérite, étant le petit-fils de Viktor. L'histoire de cette grande famille juive est passionnante à plusieurs chefs : pour leur incroyable position sociale et leur puissance à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, pour leur goût pour l'art et pour les terribles épreuves qu'ils connaissent avec la montée du nazisme et la dernière guerre. Les Ephrussi ont joué un rôle majeur dans le monde de l'art Ce ne sont jamais des innovateurs et ne prennent pas de risques inconsidérés, mais ils ont aidé des peintres à vivre, comme Renoir par exemple.

Icônes américaines, sous la direction de Gary Garrels, Rmn - Grand Palais, 184 p., 35 euro.
Cette exposition présentée au Grand Palais et qui ira ensuite au musée Granet d'Aix-en-Provence mérite le détour. Et plus encore. Dans cet ouvrage, on retrouve de très beaux exemples du Pop Art made in USA, des créations célèbres d'Andy Warhol et de Roy Lichtenstein, ainsi que des ouvrages remarquables de l'Art minimal, ceux de Donald Judd, de Sol LeWitt (avec une superbe suite de Drawing Stories, blanc sur blanc, de 1968) et de Dan Flavin. En fait, le parcours qui nous est proposé commence par Alexandre Calder, comme point d'ancrage dans la culture française, et se termine les Marylin Monroe et les Marlon Brando de Warhol. Ce n'est donc pas un projet didactique, mais plutôt un choix d'artistes qui ont marqué l'après-guerre, puisqu'on y trouve aussi Ellworth Kelly, avec deux très belles toiles des années cinquante, de Brice Marden et Cy Twombly, qui a été un inventeur rare dans la sphère picturale, sans doute l'un des plus grands peintre de la seconde moitié du XXe siècle. Le plus intéressant cependant réside dans la présence d'artistes moins connus. Je songe en particulier à Philip Guston, dont, je l'avoue, j'ignorais l'existence, qui a oscillé entre l'abstraction et la figuration, à Chuck Close, qui a fait de grands portraits composés de micro tableaux (une sorte d'Arcimboldo américain) et surtout Richard Diebenkorn, dont les compositions abstraites sont plus proches de l'esprit de Cobra (surtout de Jorn) que de l'Abstraction lyrique de la côte Est. En somme, ce choix nous permet de confronter plusieurs genres d'expériences plastiques, dont la variété dépasse largement les idées reçues en Europe. Je n'irai pas jusqu'à dire que ces trois derniers peintres sont des génies méconnus. Mais ils enrichissent considérablement notre connaissance de l'art d'Outre-Atlantique. Et, pour le reste, nous avons l'opportunité pas fréquente de pouvoir avoir en face de soi quelques oeuvres majeures des auteurs les plus célèbres. Enfin (las, but not least), on retrouve des tableaux d'Agnes Martin, peintre d'une haute qualité, qu'on a regardé puis oublié. Dès les années cinquante, elle a développé une forme d'abstraction qui ne ressemblait à aucune autre, à la fois rigoureuse dans la forme, mais d'une extrême sensibilité dans le traitement. - tout en sfumature ! Falling Blue est certainement une de ses superbes spéculations, avec une idée de monochrome bleu, mais qui insinue comme une trame en palimpseste aux tonalités jaune pâle. Remarquables aussi les deux tableaux presque blancs (elle introduit un soupçon d'impureté) de 1988, qui sont traversées par de fines lignes comme une partition en palimpseste. Sans aucune volonté d'être exhaustive, cette collection reflète le goût de la côte Ouest, sans rejeter l'aventure artistique qui a été menée à New York. Et la publication est plus qu'un catalogue : c'est un mémorandum qui sert à voir dans une autre optique l'art des Etats-Unis.
Journal du Japon, 1994-1998, Claude Molzino, Editions Manucius, 132 p., 15 euro.
Robert Groborne figure parmi les peintres importants de notre temps. On n'entend guère parler de lui car il est d'une discrétion absolue. Et son ambition est entièrement intériorisée. Mais les collectionneurs ne s'y sont pas trompés et, depuis quelques années, ils s'attachent à ne pas rater de prendre une ou deux pièces de sa main quand l'occasion se présente pour l'introduire dans leur « trésor ». J'avais déjà vu les beaux carnets de photographies qu'il avait faite lors de ses voyages au Japon. Groborne ne s'est pas inventé une seconde profession qui serait celle de photographe d'art. En réalité, ces clichés lui servent de notes. Quand l'auteur parle de Roland Barthes, cela m'a fait sourire, car il n'y a là rien qui puisse émerveiller un amateur de cette discipline moderne. Ce qui est merveilleux dans les prises de vue de l'artiste, c'est qu'elles tissent des liens secrets avec son oeuvre et son sens profond de la poésie. Groborne fait sans doute partie de cette catégorie rare de « néo japonistes » d'aujourd'hui : son oeuvre, noire désormais après avoir été blanche à ses débuts, n'est pas ésotérique à proprement parler, mais elle ne se dévoile pas au premier coup d'oeil. Elle possède cette essence qui se rapproche de l'art nippon ancien, où presque rien fait tout, dit tout, exprime tout. Ce n'est pas un minimaliste, loin s'en faut. C'est chez lui manifester le désir de rendre le monde à partir d'un point qui peut sembler infinitésimal et avec des miracles de subtilité et de finesse. Il n'y a pas concurrence chez lui entre la poésie et la peinture : elles ne forment qu'une seule et même entité. Il a posé un regard intense sur les choses qu'il a rencontrées au cours de ses promenades au pays du soleil levant qui ne recherchait ni le pittoresque, ni l'effet atmosphérique. Il s'est d'ailleurs surtout attaché à des objets anciens, à des parties de jardins, à des vues de bosquets perçues de l'intérieur d'une maison traditionnelle. Ce sont de belles choses, mais qui, en tant que telles, ne sont pas éloquentes. Elles ont nourri son imaginaire et stimulé son art poétique. On les retrouve sous d'autres formes dans ses compositions. Ce n'est pas un sketchbook au sens ancien, ni un carnet de voyage. C'est un journal au sens propre de ce qui l'a concerné à un instant précis. Le commentaire de Claude Molzino est intéressant car il éclaire la démarche du peintre et sculpteur. Il a su rendre sensible cette façon d'aller là où son oeil le porte pour voler une chose ou une autre, un fragment de jardin zen, un rayon de soleil sur une fenêtre en bois et en papier, des récipients couverts d'écritures. S'il ne travaille pas dans la même direction que Jean Degottex (quoi que je discerne quelques similitudes, en particulier dans le travail sur l'épaisseur du papier), il partage cet amour de l'Orient, qui a est un amour du sens plastique de la civilisation japonaise, qui nous échappe car sous-tendue par des principes bien loin des autres et sans concepts. Son oeuvre n'a rien de japonisant en apparence. Mais quand on a regardé ses photographies, on comprend bien à quel point ses créations ont un esprit assez similaire, mais dans le langage qui est le nôtre.

La Barbe ensanglantée, Daniel Galera, traduite du portugais (Brésil) par Maryvonne Lapouger-Pettorelli, Gallimard, 512 p., 24,90 euro.
On dit le plus grand bien dans les salons parisiens de Daniel Galera, ce jeune et séduisant auteur brésilien, né à São Paolo en 1979. Je lui trouve du talent, du souffle, une qualité d'écriture indéniable, dans un curieux mélange de réalisme et de fantasmagorie baroque. Mais suis-je enthousiaste après avoir lu ce roman interminable ? Pas excessivement, tout en lui reconnaissant de grandes qualités. La quête de ce jeune homme, qui apprend de son père malade et sur le point de s'ôter la vie quelle triste fin a faite son grand-père, dont il ne sait rien, est sans doute d'une nature « initiatique ». Mais son voyage à Garopaba, où a eu lieu ce drame, est long et fastidieux, même s'il se révèle un brillant narrateur. Peu à peu, il glane des informations sur ce grand-père dont il ne sait quasiment rien (son père s'est montré peu disert et surtout peu explicite), des témoignages sont placés en note (un artifice littéraire assez plaisant, qui rompt le rythme lancinant de son histoire). Il rencontre des personnages de tous les genres possibles et nous fait entrer dans l'univers de cette ville. C'est aussi une recherche qui le porte à découvrir des horizons nouveaux et à percevoir des vérités qui sont au-delà du réel. C'est une fiction qui a des aspects particulièrement prenants, mais sans doute le développement du récit est-il trop lent et trop bavard. L'ensemble manque de densité et surtout de force. Et puis, Daniel Galera n'a pas su rendre les aventures de son héros sans nom suffisamment palpitantes pour le lecteur. Des chapitres sont parfois ennuyeux et s'étirent sans qu'on progresse vraiment l'affaire. Et quand des événements extraordinaires surviennent, il ne les rend pas avec conviction. En somme, voilà un écrivain sans conteste doué, mais qui n'a pas pris toute la mesure du temps romanesque. N'ayant pas lu ses livres précédents, je ne saurais dire si c'est une transition ou un mauvais tournant dans son oeuvre. Mais ce n'est pas l'écrivain qu'on aurait pu attendre pour voir émerger la perle d'une nouvelle génération au Brésil. Attendons le prochain livre pour pouvoir formuler un jugement plus sûr sur Daniel Galera. Pour l'instant, je ne vois qu'un ouvrage plein à craquer de bonnes choses, qui n'est pas vraiment abouti sur un beau sujet et qu'il renferme trop de mots pour ce qu'il a vraiment à dire.

Salut Masino, Cesare Pavese, traduit de l'italien par Nino Franck, « L'Imaginaire », Gallimard, 240 p, 7,90 euro.
Le manuscrit de ce premier livre du jeune écrivain piémontais a été retrouvé dans es papiers après sa mort. Ecrit en 1926 (il n'a que dix-huit ans !), il préfère alors traduire des oeuvres de grands ouvrages de la littérature américaine, comme Moby Dick d'Herman Melville, et des auteurs anglo-saxons comme John Dos Passos, William Faulkner, Daniel Defoe et même James Joyce. Il a été un travailleur infatigable. Il a aussi écrit pour différents périodiques, dont Culture, publié par la maison d'édition Einaudi. Il n'écrit que la Trilogie des machines, trois petits essais de caractère futuriste, et Travailler fatigue en 1936. Ce n'est qu'en 1939 qu'il a écrit Il bel estate, qui n'a été mis sous presse que dix ans plus tard. Il s'est suicidé en 1950, mettant terme à une brillante mais trop brève activité littéraire. Ce petit livre consiste en deux histoire parallèle, l'une concernant Masino, je jeune intellectuel (pour l'instant, un journaliste débutant qui se pose une foule de questions) et Masin, le jeune ouvrier, qui rêve de quitter Turin, avec des poèmes en proses qui viennent s'intercaler entre les différents chapitres. Les deux récits ne sont pas vraiment parallèles, mais chacun de se deux héros est à la recherche de son propre chemin. Cette recherche est quelque peu catastrophique. Masin se marie, mais les relations avec son épouse se dégradent vite. Il l'assassinat dans son sommeil et prit la clef des champs. Mais il n'a pas tardé à être arrêté, jugé et condamné. Quant à Masino, après la mort tragique de son ami Hoffman, il poursuit sa carrière de journaliste. C'est vraiment un livre intéressant, écrit avec style si concis, si fin, si dense, sans parler de l'invention incessante de ses formules, tournures de phrases et enchaînements narratifs, qui a fait de lui par la suite l'un des meilleurs auteurs de l'immédiate après-guerre.

Tout ce qui m'est arrivé après ma mort, Ricardo Adolfo, traduit du portugais par Elodie Dupau, Métailié, 176 p., 17,50 euro.
Sans doute suis-je dépassé par les événements. Ce roman lusitanien est bien loin de Pessoa et de toute la tradition moderniste de ce pays riche en romans et en poésies. Non, il ressemble à ce qu'on peut lire en Italie en France ou aux Etats-Unis de nos jours. Un style à la diable, une histoire sans queue ni tête ( « tirée par les cheveux, dirais un de mes amis) qui fait passer Raymond Queneau pour un classique un peu barbant, une composition hirsute reposant sur des faits mêlant le réalisme le plus banal et le rêve échevelé. Le héros de ce livre est un bon père de famille, comme tant d'autres, qui va se promener avec sa femme et sa progéniture. Mais peu à peu les choses prennent un tour imprévu et, après un voyage en métropolitain et avoir traversé un marché bien achalandé, il se perd. Depuis le début de cette excursion urbaine, notre héros n'est pas très sûr du chemin à prendre. Les choses ne font qu'empirer dans un joyeux délire. La seconde partie du livre a un ton un peu différent. Notre héros est emporté dans une course-poursuite dans des quartiers, inconnus, au milieu d'immigrés parlant des langues inconnues et, toujours, en compagnie de sa femme, tente de regagner son domicile, mais en même temps fantasme toutes sortes de possibilités pour son existence. Je dois admettre que la fin est plus réussie que le début et a aussi beaucoup plus de densité et de poids. Ricardo Adolfo n'a pas écrit un chef d'oeuvre, loin s'en faut, mais quelque chose d'assez prometteur. Et si se mettait en tête de ne pas chercher de faire de la littérature commerciale, il recèle les qualités nécessaires et suffisantes pour affronter un thème littéraire d'une certaine portée.
|
